En deux mots
Virgile entretient sa forme. Pour mener à bien son projet, ramener la quarantaine de personnes qui logent dans un bidonville en Roumanie, il lui faut être affuté. Et rassembler vite une somme importante. Mais son trafic de drogue va gêner Nuri qui entend mener seul les affaires. Un affrontement à l’issue incertaine s’engage.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Des combats à l’issue incertaine
Philippe Lafitte nous propose dans son nouveau roman d’explorer les marges de notre société. Dans cette banlieue où règne la violence, Virgile le Roumain va affronter Nuri, le caïd de la cité, sous les yeux de sa sœur Yasmine. Et tous les coups sont permis.
Virgile prend soin de son corps. S’il se balance au-dessus d’un pont autoroutier, c’est pour rester musclé et avoir les armes pour se défendre ou pour fuir la police. Virgile est arrivé depuis près de deux ans dans ce coin de banlieue avec une quarantaine de compagnons d’infortune. À Buzescu, dans sa Roumanie natale, on lui avait fait miroiter le rêve français. Depuis, il a déchanté. Mais il a appris à se battre et à dealer, le trafic qui lui semble le moins risqué et le plus lucratif. Alors jour après jour, il se bat pour son grand projet, pouvoir se payer un bus et ramener toute la troupe en Roumanie, loin du bidonville et de la précarité qui les ronge tous.
Mais pour réussir dans son entreprise, il lui faut écarter la menace que représente Nuri qui a fait de ce coin de banlieue son territoire. Avec son armée de petites frappes, il gère les trafics, dirige une salle de sport et le Kebab House et entend ne pas se laisser doubler par ce rom qui s’arroge une partie de ses revenus. Il entend d’autant plus le mettre au pas que ses sbires lui ont rapporté avoir vu Virgile en compagnie de sa sœur Yasmine. Une fréquentation qu’il ne peut admettre, lui qui entend faire de la jeune fille une musulmane soumise. Yasmine – qui a dû renoncer à ses études pour s’occuper de ses frères et sœurs – ne rêve quant à elle que de fuir sa prison.
C’est dans ce climat explosif que Philippe Lafitte a situé ce roman à l’ambiance de polar, où il faut échapper à la police, savoir répondre à la violence par la violence et se tenir en permanence sur ses gardes. Entre Virgile qui termine de rassembler la somme nécessaire à son retour au pays où l’attend Lena, son amour de jeunesse qu’il n’a pas su convaincre de l’accompagner et qui per espoir de le revoir, Nuri qui entend se venger de ce rom qui, non content d’empiéter sur ses plates-bandes, drague aussi sa sœur et cette dernière qui prépare sa fuite, l’épilogue de ce roman plein de bruit et de fureur va être haletant. L’auteur sait à merveille entretenir le suspense, jouer avec la psychologie des personnages et proposer au lecteur une palette d’émotions fortes. Son exploration des marges de notre société, sans manichéisme et sans œillères, est très réussie.
Périphéries
Philippe Lafitte
Éditions du Mercure de France
Roman
176 p., 18 €
EAN 9782715260610
Paru le 02/02/2023
Où?
Le roman est situé principalement en banlieue parisienne, entre Asnières et Gennevilliers ainsi qu’au Vexin et à Paris. On y évoque aussi la Roumanie, à Buzescu et Bucarest.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
À vingt ans, Virgile est à la tête d’un groupe de Roms qui survit dans un bidonville aux marges du périphérique parisien. Depuis qu’il est en France, Virgile a un rêve tenace : ramener son clan en Roumanie. Pour cela il a besoin d’argent. Sans scrupule, Virgile s’improvise dealer. Mais il est sur les terres de Nuri, un concurrent redoutable qui fait régner sa loi sans pitié. Surtout, Virgile a rencontré Yasmine, la sœur de Nuri : il n’est pas insensible à son charme, et déjà la rumeur va son chemin…
Virgile sera-t-il à la hauteur de ses projets : rentrer dans son pays d’origine ou rester pour Yasmine ? Et Yasmine, assignée à domicile par son frère, ira-t-elle jusqu’au bout de son désir d’émancipation ? Trois destins mêlés qui poursuivent à leur façon le même rêve de liberté : échapper à leur condition. Quel qu’en soit le prix.
Avec un style vif et enlevé, Philippe Lafitte nous propose un récit sans concession, d’un réalisme noir et poignant. Urbain et nocturne, poétique et électrique, son roman pointe les drames invisibles qui se trament aux portes de nos grandes villes.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
BX1 (Dans Le courrier recommandé, David Courier reçoit Philippe Lafitte)
Grégoire Delacourt
(+ son bureau d’écrivain)
Blog de Jean-Claude Lebrun
Les premières pages du livre
« Qu’il pleuve ou qu’il vente, il revient tous les soirs sur cette portion de route express coincée entre des entrepôts, des barres d’immeubles et les voies sur berge. Dans le halo des réverbères il est une présence singulière, inhabituelle, obstinée. Une silhouette agitée par le temps de novembre. Dans la nuit jaune de banlieue son corps monte et descend en cadence, accroché à la barrière d’un pont autoroutier.
Malgré la température son torse est nu, tout en nerfs et en muscles, comme à vif, sculpté par les phares des voitures ; dans la nuit froide son corps monte et descend, luisant et lisse, ébloui d’éclairs automobiles. Cinquante impulsions, agrippé par les mains. Pause. Cinquante relevés, accroché par les pieds. Pause. Bras fléchis, mains aux tempes, alternance d’ombre et de lumière. Une montée pour une descente, une descente et une montée – avec ce souffle régulier comme une haleine de forge. Ceinture d’abdominaux roulant sous la peau. Ascension et chute. Mouvement et pause.
Autour de lui l’atmosphère est saturée de pluies acides, de vapeurs métalliques et d’odeurs d’essence. Dans tous les hivers industriels du monde, il fait froid.
Il reprend ses tractions, suspendu dans le vide, et sous ses pieds les voitures s’engouffrent dans la bouche du tunnel, zébrant son torse d’appels de phares stroboscopiques ; en sens inverse d’autres carcasses d’acier avancent tout en embouteillages, maculant cette fois son corps de lueurs rouges ; au loin un grondement de tonnerre menace et des motards remontent la bande d’arrêt d’urgence en frôlant les carrosseries dans un rugissement d’apocalypse. À hauteur de l’homme suspendu quelques curieux lâchent un coup d’avertisseur, certains ralentissent et, en écho, d’autres klaxons s’interpellent par à-coups ; enfermés dans leur cage de tôle, des hommes serrent mâchoires et volant comme si leur vie en dépendait.
Chaque soir, dans le même mouvement immuable des milliers d’automobilistes fuient le centre de Paris pour rejoindre les banlieues-dortoirs, à l’heure de sortie des bureaux. Indifférente à la rumeur lointaine, aux sirènes et au bruit, la silhouette reprend son entraînement.
C’est un tout jeune homme, à peine vingt ans, fumant de vapeur, d’énergie et de rage. Torse nu en plein hiver, tête brûlée penchée deux mètres au-dessus des voitures, c’est Virgile. Qui signifie « petite branche souple » en latin. D’une tout autre nature est le rêve qu’il poursuit : un rêve herculéen forgeant un corps à la force de ses muscles.
*
Il a cessé de pleuvoir. Sur le talus qui prolonge le pont, des ombres rôdent dans les broussailles. Au bord de la voie rapide des silhouettes surgissent comme si elles voulaient prendre les voitures d’assaut, et dans la pénombre on distingue les baraquements de planches où des femmes font claquer des couvertures ; courbés sous les bâches, des hommes alimentent les braseros à grand renfort de cartons et aussitôt des brassées de braises s’envolent dans la nuit comme des lucioles affolées.
Abrité du vent contre un escalier en béton, l’unique robinet d’eau potable fuit. Dans la nuit éclairée par les phares apparaît un gamin, traînant un seau plein d’eau qui racle le sol. Partout des sacs en plastique émergent des herbes folles, aux branches des arbres frissonnent les papiers gras et plus bas s’accumulent les ordures ménagères, bien au-delà des cabanes.
Voici le clan des Monescu. Femmes, enfants, hommes, vieillards. Le cheveu noir et lisse, plus rarement gris ou blanc, la peau mate, éclatante ou ridée. Les Monescu sont arrivés de Roumanie il y a deux ans. Interceptés au bout d’un mois sous une pile de pont autoroutier, regroupés aussitôt dans un centre de rétention d’Île-de-France. Recensés tant bien que mal par d’ex-immigrés devenus interprètes, de nationalité identique mais pas roms – et ça fait toute la différence. Qui leur signifient une fin de non-recevoir déguisée en mauvaise humeur chronique. « Qu’est-ce que vous faites là ? D’où venez-vous ? Qui est le chef du clan ? Vous cherchez quoi ? » Les derniers arrivés paient pour les autres.
Huit semaines se sont écoulées derrière des grillages couplés de miradors. Au pays lointain, personne ne les a prévenus de leur sort ici : on n’abîme pas les rêves que d’autres ont patiemment élaboré pour vous faire traverser l’Europe sans rechigner – comme le veut la tradition. Soixante jours enfermés dans une caserne réaffectée, avec cour en béton et préfabriqués en guise de paysage, c’est long pour des nomades. Aléas de l’administration, on les invite brusquement à quitter les lieux, pas de préparatifs ni de destination : démerdez-vous – si possible repartez d’où vous êtes venus.
Ils s’éloignent donc vers d’autres horizons, taiseux et amnésiques, avec pour ligne de fuite des rencontres hostiles et une méfiance constante jusqu’au bout du voyage. Plus tard ils occuperont un tunnel désaffecté de la Petite Ceinture dont les parois couvertes de moisissures diffusent une forte odeur de cave. Ils se dissiperont ailleurs, du côté des Maréchaux, aux portes de la capitale, là où des patrouilles de gardiennage privé les repousseront plus loin encore. On les chasse aussi d’une gare de triage en ruine, ou d’un immeuble de bureaux en construction. Un soir, le propriétaire d’un parking fait lâcher les chiens, les incitant à fuir de nouveau au petit matin, perdus dans des brumes périphériques sans savoir où ils vont.
Après le dernier incident, le clan s’est éparpillé dans les friches nord de la banlieue parisienne. Au premier printemps, comme réunis par un mystérieux lien télépathique, ils se regroupent sous une arche de béton, à la lisière de la ville. Paris n’est pas loin, on en aperçoit les lumières d’ici. Abrités sous le pilier de la voie rapide, ils attendent la nuit pour franchir la passerelle qui enjambe la Seine. Pont de Clichy. Marche silencieuse. Gennevilliers. File indienne. Trois cents mètres plus loin se profile le talus.
*
À une heure du matin la banlieue dort enfin, la voie est libre. À la pince, les hommes découpent une large entaille dans le grillage qui encercle le terrain vague. Font entrer le clan dans un silence religieux. Les plus valides portent des planches de chantier sur le dos, les femmes des tapis, les adolescents des plaques de contreplaqué en équilibre sur leur tête ; les enfants, eux, sortent de leurs poches de la ficelle, déroulent autour de leurs hanches du fil de fer, s’efforcent de lier entre eux des tasseaux de bois comme leur ont appris les anciens ; lesquels taillent au couteau des branches qui serviront à consolider les auvents.
Ils sont quarante comme ça, silencieux et unis, à construire le bidonville. Une enfilade de baraquements, bois de palettes et bâches de plastique qui s’édifie en quelques heures au bord de la voie rapide.
Alors que le trafic automobile s’éveille dans l’aube glacée d’un nouveau matin d’hiver, le clan s’affaire à dégager des chemins à travers la broussaille, à attiser du bois dans des fûts métalliques. Demain auront lieu les premiers brûlis pour dégager le terrain, cultiver les pommes de terre, les choux et les aubergines.
Dominant la scène, le projecteur d’un stade proche allonge les bicoques d’ombres expressionnistes ; d’autres rais de lumière éclairent les piles du pont où une banderole graffitée proclame : « Ici l’État laisse se développer un bidonville ! MUNICIPALITÉ EN LUTTE ! ». À force d’intempéries la banderole militante s’est délitée et pendouille dans le vide, frôlant les voitures qui continuent de traverser la banlieue comme si elles commettaient un délit de fuite. Le lieu du ban, on le traverse ou on rêve d’en partir, surtout pas d’y rester.
Ça fait plus d’un an qu’ils sont là, maintenant, fantômes invisibles survivant à un deuxième hiver. »
Extraits
« Depuis qu’elle a arrêté la fac, sa vie se borne à cette triangulaire : la salle, l’école, le foyer — une HLM de quatre pièces avec sept bouches à nourrir. Arrêter la fac, refermer son regard sur le monde. Se claustrer. Décision imposée par Nuri, juste avant la rentrée précédente. Insidieusement, progressivement, puis brutalement. « Tu ne retournes pas à la fac. » Frère aîné devenu chef de famille depuis qu’une chute de chantier a laissé le père grabataire, il y a dix-huit mois. « Il faut s’occuper des petits. » Frère de sang devenu tyran. La sidération a laissé Yasmine sans voix, tiraillée entre révolte et culpabilité. S’occuper des petits, avant tout. La mère est morte il y a trois ans — paix à son âme — et Yasmine pense que l’événement n’est pas étranger à la désorientation — et à l’accident — du père. En attendant, finie la fac.
La cascade de drames domestiques oblige à revoir les priorités, à serrer les coudes. Compter chaque euro. Pour parachever le tout, c’est comme si la fatalité avait répondu aux désirs de Nuri, dans sa volonté obsédante d’ordre familial: « Yasmine, si Dieu le veut, ta place est à la maison. »» p. 33
« Yasmine se penche sur son travail mais sa tête est ailleurs. L’histoire semble donc vouée à l’échec avant même d’avoir commencé. La fatalité. Comme un joug intangible reproduisant une tradition qui perpétue l’injustice et revient en boucle. Circuit fermé et héritage immémorial qui ne la concernent en rien. Recroquevillée sur son lit, elle rumine sa peine. Ainsi lui parle-t-on tous les jours d’un dieu auquel elle devrait se soumettre mais chaque jour, que fait ce dieu pour elle ? La réponse occupe ses pensées, flotte devant ses yeux. Chaque jour ici est un nouveau fardeau. Yasmine endure un monde où elle n’a pas son mot à dire alors que d’autres se réjouissent d’en profiter à chaque instant. Pourquoi ? Il n’y a pas de réponse satisfaisante à l’injustice. Son existence est le fond d’un puits obscur dont elle ne peut s’échapper qu’à certaines heures, pour des moments surveillés, comptabilisés, restreints. Le carcan, le joug et la chaîne. Seule subsiste une infime lueur d’espoir : elle a le numéro de portable du garçon. Et plus encore.
Elle se lève, ferme la porte de sa chambre à clé avec d’infinies précautions. Elle se fige dans l’écoute encore quelques secondes, l’oreille collée au panneau de contreplaqué. L’appartement est miraculeusement silencieux. » p. 93
À propos de l’auteur
 Philippe Lafitte © Photo Francesca Mantovani
Philippe Lafitte © Photo Francesca Mantovani
Né en 1960 à Boulogne-Billancourt, Philippe Lafitte travaille d’abord dans la publicité en tant que directeur artistique, puis il poursuit dans la freelance comme concepteur-rédacteur. C’est dans les années 2000 que son travail en écriture devient plus important. Parallèlement à la rédaction de romans, il développe également des projets de scénarios pour le cinéma et la télévision. En outre, il publie des nouvelles dans la revue littéraire Décapage et des chroniques culturelles pour le Huffington Post.
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur
Tags
#peripheries #PhilippeLafitte #editionsdumercuredefrance #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #romannoir #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

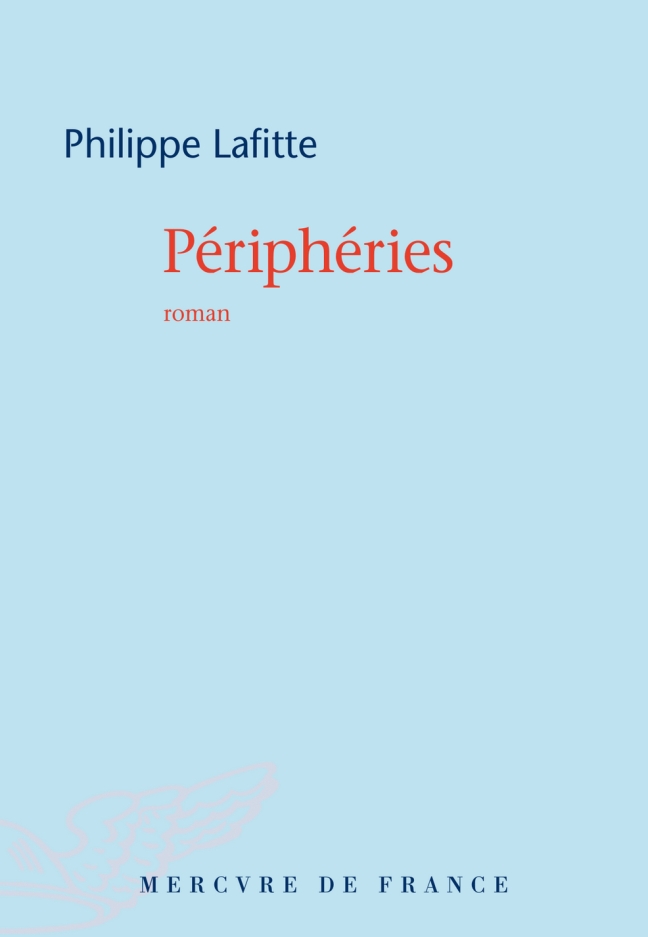







 Jean-Michel Olivier © Photo Indra Crittin
Jean-Michel Olivier © Photo Indra Crittin


