Lauréat du Prix du Roman historique 2023
En deux mots
Le peintre Jacopo da Pontormo est retrouvé assassiné dans la chapelle San Lorenzo où il achevait la réalisation de fresques. À l’émoi et aux questions suscitées par sa mort vient désormais s’ajouter l’enquête pour retrouver le coupable. Vasari va demander à Michel-Ange de le seconder dans cette tâche dans une Italie où les Médicis sont au cœur de toutes les intrigues.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Qui a assassiné Jacopo da Pontormo?
Laurent Binet nous offre un roman épistolaire doublé d’une enquête policière. Située dans la Florence des Médicis, Perspective(s) est aussi une leçon d’Histoire, une exploration du monde foisonnant de l’art. Érudit, intrigant, emballant !
C’est à Jacopo da Pontormo que l’on confie le soin de réaliser les fresques du chœur de Basilique San Lorenzo de Florence. Quand commence ce roman, en janvier 1557, il met la dernière main à son œuvre. Mais il n’est pas satisfait du résultat et déprime. Il n’aura toutefois pas l’occasion de se morfondre bien longtemps puisqu’il est «retrouvé avec un ciseau fiché dans le cœur, juste en dessous du sternum». C’est ce que confie Giorgio Vasari à Michel-Ange Buonarroti dans l’une des premières lettres de ce roman épistolaire. Proche du duc de Florence, l’architecte Vasari est missionné pour mener l’enquête, mais se perd en conjectures. Pourquoi sa fresque a-t-elle été retouchée? Et par qui? Quel peut être le mobile du crime? Pourquoi un tableau a-t-il été volé? Autant de questions auxquelles il va lui falloir répondre et pour lesquelles il sollicite l’aide de Michel-Ange, même si celui-ci est à Rome où il supervise la décoration de la chapelle sixtine.
Pour l’artiste, le meurtrier est à chercher parmi tous ceux qui côtoyaient Pontormo et qui étaient à Florence à l’heure du crime. Ce qui fait déjà une longue liste de suspects, à commencer par les peintres – des apprentis aux valeurs sûres – engagés à ses côtés, mais aussi aux seconds couteaux, des broyeurs de couleur au petit personnel. Il ne faudra pas moins de 176 lettres pour venir à bout de ce mystère.
Entre-temps, on aura plongé dans une époque, un monde de l’art en effervescence, secoué lui aussi par la Contre-Réforme et par des rivalités intestines au sein de la famille Médicis, rivalités auxquelles Catherine prend sa part, bien que demeurant en France.
L’érudition de Laurent Binet fait ici merveille. Il a pu développer son intrigue à partir d’un mystère jamais élucidé – personne ne sait rien sur les circonstances et la date exacte de la mort de Pontormo – et d’un fait avéré, la destruction des fresques du peintre. Avec subtilité, il passe de l’art à la politique, montre que le tableau représentant la fille du Duc en Vénus lascive – il figure sur le bandeau du livre – peut provoquer à lui tout seul une affaire d’État et souligne que dans cette ambiance même le grand Michel-Ange se désole. Le romancier peut ici s’en donner à cœur joie, car la forme épistolaire lui permet de jongler avec les styles et avec les hypothèses. On se régale tout au long du livre de cette narration qui n’a rien à envier à ses glorieux prédécesseurs, des Lettres persanes de Montesquieu à La Nouvelle Héloïse de Rousseau et plus encore aux Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. D’ailleurs le romancier emprunte à son aîné le scénario des lettres retrouvées dont il n’est que l’humble traducteur. C’est ironique et impertinent, iconoclaste et documenté. Et servi avec un irrésistible humour.
Après Civilizations et La septième fonction du langage, voici une nouvelle preuve de la virtuosité de Laurent Binet.
 Vénus et Cupidon © Galleria dell’Accademia di Firenze
Vénus et Cupidon © Galleria dell’Accademia di Firenze
Perspective(s)
Laurent Binet
Éditions Grasset
Roman
304 p., 21,50 €
EAN 9782246829355
Paru le 16/08/2023
Où?
Le roman est situé en Italie, principalement à Florence. On y voyage aussi, notamment à Rome.
Quand?
L’action se déroule 1er janvier 1557 au 10 août 1558.
Ce qu’en dit l’éditeur
Florence, 1557. Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis onze ans. Un tableau a été maquillé. Un crime de lèse-majesté a été commis. Vasari, l’homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l’enquête. Pour l’assister à distance, il se tourne vers le vieux Michel-Ange exilé à Rome.
La situation exige discrétion, loyauté, sensibilité artistique et sens politique. L’Europe est une poudrière. Cosimo de Médicis doit faire face aux convoitises de sa cousine Catherine, reine de France, alliée à son vieil ennemi, le républicain Piero Strozzi. Les couvents de la ville pullulent de nostalgiques de Savonarole tandis qu’à Rome, le pape condamne les nudités de le chapelle Sixtine.
Perspective(s) est un polar historique épistolaire. Du broyeur de couleurs à la reine de France en passant par les meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, chacun des correspondants joue sa carte. Tout le monde est suspect.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
RFI (L’invité culture)
France Info Culture (Juliette Pommier)
Causeur (Jean-Paul Brighelli)
Le Télégramme (Stéphane Bugat)
20 minutes
Ernest mag (David Medioni)
La Règle du jeu (Christine Bini)
Actualitté (Hocine Bouhadjera)
Bilan.ch (Étienne Dumont)
Le Devoir (Sonia Sarfaty)
France culture (Fou d’histoire)
Atlantico (Jean-Pierre Tirouflet)
Petit bulletin (Laurent Duchêne)
Blog Je lis, je blogue
Blog Tours et culture
Blog Christlbouquine
Blog Vagabondage autour de soi
Blog Bulles de culture
Laurent Binet présente «Perspective(s)» © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
1. Maria de Médicis à Catherine de Médicis, reine de France
Florence, 1er janvier 1557
S’il savait que je vous écris, mon père me tuerait. Mais comment refuser une faveur si innocente à votre altesse ? Il est mon père, mais n’êtes-vous pas ma tante ? Que me font, à moi, vos querelles, et votre Strozzi, et votre politique ? À la vérité, votre lettre m’a causé une joie que vous ne pouvez concevoir. Quoi ? La reine de France me supplie de l’entretenir sur sa ville natale, en échange de son amitié ? Quel plus beau cadeau le Ciel pouvait-il offrir à une âme esseulée comme celle de la pauvre Maria, qui n’est qu’entourée d’enfants et de servantes ? Mes petits frères sont trop occupés à jouer aux princes, mes petites sœurs jurent qu’elles n’épouseront jamais personne car nul parti ne saurait être assez digne d’elles – quand bien même il s’agirait du fils de l’empereur ! – et, dans les murs froids de ce vieux palais, je vois bien que ma mère complote avec mon père, sans rien me dire à moi, si bien que la seule certitude que je puis avoir est que l’on songe à me marier. Avec qui ? Personne n’a jugé utile jusqu’à présent de me renseigner sur ce point. Mais voilà déjà que j’abuse de votre amitié : assez parlé de moi !
Figurez-vous, ma chère tante, qu’il s’est produit dans Florence un drame épouvantable. Vous aurez peut-être gardé le souvenir du peintre Pontormo, car au milieu de tous les artistes dont notre patrie est si féconde, il passait, à ce qu’on raconte, pour l’un des plus réputés à l’époque où vous n’aviez pas encore quitté l’Italie pour la France, en route vers votre royale destinée. Imaginez qu’on l’a retrouvé mort dans la chapelle majeure de San Lorenzo, sur le chantier même auquel il travaillait depuis un temps immémorial : onze ans ! On raconte qu’il s’est donné la mort parce qu’il n’était pas satisfait du résultat. Je l’avais croisé quelquefois, chez son ami Bronzino : il avait l’air de ces vieux fous qui marmonnent dans leur barbe. N’importe, c’est bien triste.
Heureusement, toutes les nouvelles ne sont pas aussi tragiques, mais les autres n’auront, je le crois, rien pour vous surprendre : vous savez que chaque année, les préparatifs du carnaval commencent de plus en plus tôt, si bien que nos places sont déjà envahies par les ouvriers qui s’emploient à dresser des estrades, tandis que dans les maisons les couturières s’affairent à leurs ouvrages. Vous me trouverez futile, sans doute, si je vous dis que j’aime quand Florence se pare de ses habits de fête, mais qu’y puis-je ? Cette effervescence me réjouit, moi qui n’ai pour ainsi dire pas de distraction, à part aller poser pour l’un des innombrables portraits que mon père fait faire par Bronzino de tous les membres de sa famille, vivants ou morts. Rester assise pendant des heures : c’est vous dire si je m’amuse.
Le fils du duc de Ferrare, Alfonso d’Este, que vous avez peut-être connu en France car on m’a dit qu’il a combattu dans les Flandres au côté de votre époux le roi Henri, est arrivé cette semaine pour présenter ses hommages à mon père, qui tient absolument à me le faire rencontrer. On dit qu’il est sinistre, quelle corvée ! D’ailleurs, voilà maman qui m’appelle. Je vous baise les mains avec la ferveur d’une nouvelle amie. J’ai brûlé votre lettre selon votre désir, et je suivrai vos indications pour vous faire parvenir la mienne en toute discrétion. Quel dommage que vous soyez fâchés, avec mon père ! Mais je suis sûre que cette brouille ne durera pas et que vous viendrez sous peu visiter votre famille, et reverrez enfin votre belle Florence. Qui sait si le Bronzino ne fera pas votre portrait, à vous aussi ?
2. Giorgio Vasari à Michel-Ange Buonarroti
Florence, 2 janvier 1557
Cette fois, mon cher Maître, je ne vous écris pas à la demande du Duc pour vous supplier de revenir à Florence. Hélas, c’est un tout autre sujet qui m’amène à troubler vos journées romaines, dont je sais combien elles sont occupées par vos admirables travaux et les nombreuses contrariétés auxquelles votre art se confronte quotidiennement, surtout depuis l’élection de notre nouveau souverain pontife, qui semble si peu enclin à apprécier les beautés antiques ou modernes, au contraire de ses prédécesseurs.
Vous souvenez-vous lorsque, il y a quinze ans, je vous consultais en tout ? Vous aviez alors la bonté de me dispenser vos conseils, et c’est ainsi que je m’étais livré de nouveau, et avec plus de méthode et de fruit, à l’étude de l’architecture, ce que je n’aurais probablement jamais fait sans vous. C’est encore de méthode que j’ai besoin aujourd’hui, mais dans un domaine tout différent. Le Duc, en effet, a bien voulu m’honorer de sa confiance en me chargeant d’une mission aussi délicate qu’inhabituelle.
Jacopo da Pontormo, dont vous vantiez déjà le grand talent lorsqu’il n’était qu’un enfant plein de promesses, n’est plus. Il a été retrouvé mort dans la chapelle San Lorenzo, au pied de ses fameuses fresques qu’il avait jusque-là soustraites aux regards derrière des palissades de bois. Cette nouvelle en elle-même m’aurait décidé à vous écrire, car il fallait bien que quelqu’un vous apprenne ce terrible malheur. Mais ce sont les circonstances de sa mort qui justifient pleinement que je me tourne vers vous, une fois de plus.
En effet, dans la mesure où son corps a été retrouvé avec un ciseau fiché dans le cœur, juste en dessous du sternum, la thèse de l’accident nous a semblé d’emblée difficile à soutenir. C’est pourquoi le Duc m’a confié la charge d’éclaircir cette malheureuse histoire, d’autant plus que les zones d’ombre ne manquent pas, comme je vous laisse le soin d’en juger par vous-même : le corps de Jacopo, outre le ciseau qui l’a tué, portait les traces d’un coup violent à la tête, assené par un marteau qu’on a retrouvé sur le sol de la chapelle, au milieu de ses autres outils. Le pauvre Jacopo était étendu sur le dos, devant sa fresque sur le Déluge, dont il semble, aux traces de peinture fraîche, qu’il avait repeint une partie avant de mourir, au risque de laisser un raccord apparent. Vous savez comme moi que Jacopo était aussi lent qu’exigeant dans son travail et qu’il se corrigeait sans arrêt, mais cette retouche sur une petite partie du mur, qui devait inévitablement laisser voir le raccord à un endroit qui coupait une figure en deux, n’a pas manqué de m’étonner. Le connaissant, j’aurais pensé qu’il recommence le pan de mur entier, s’il n’était pas satisfait de la moindre parcelle de l’ensemble.
Cependant, les bizarreries de cette affaire ne s’arrêtent pas là. Lorsque le corps fut découvert, l’on se rendit à la maison où vivait Jacopo, via Laura, qui est une espèce de grenier auquel on accède par une échelle. Or, parmi une foule de dessins, de cartons et de maquettes remisés dans son atelier, se trouvait un tableau que vous ne connaissez que trop bien, puisque vous en avez jadis dessiné le modèle : vous vous souviendrez sans doute de ce Vénus et Cupidon dont le succès fut tel qu’il a inspiré des copies dans l’Europe entière – vous savez peut-être que j’eus moi-même le privilège d’en réaliser quelques-unes, qui n’égalent en aucune façon celles du Pontormo, mais qui toutefois eurent l’heur de plaire, car tout ce qui s’inspire de vos dessins ne peut que porter la trace de votre divin génie. C’était ce temps d’avant le retour de l’Inquisition, qui nous paraît déjà si loin, quand le cardinal Carafa n’était pas encore devenu Paul IV, où les nus n’étaient pas tombés en disgrâce mais étaient au contraire particulièrement recherchés. Bien entendu, personne n’aurait l’idée aujourd’hui de peindre un tel tableau, mais vous connaissez l’excentricité dont pouvait être coutumier notre brave Jacopo. Ce n’est pas, cependant, ce qui a retenu notre attention, car, si l’on met de côté les quatre années où le moine Jérôme Savonarole avait ravi les cœurs des gens simples, nous savons encore, nous autres Florentins, reconnaître les beautés du corps humain sans les considérer comme des obscénités diaboliques. D’ailleurs, le morceau d’étoffe que le Pontormo avait autrefois rajouté pour couvrir les cuisses ouvertes de la déesse avait été retiré sur la copie qui s’offrait à nos yeux. Mais ce qui nous étonna bien davantage – je ne sais comment formuler cela, ayant le désir de n’offenser personne, et surtout pas la famille de Son Excellence – était qu’en lieu et place du visage de Vénus, Jacopo avait substitué celui de la fille aînée du Duc, mademoiselle Maria de Médicis.
Vous voyez tout ce que cette histoire peut avoir de déplaisant, et pourquoi le Duc a tenu à en confier la résolution à un homme de confiance, faisant, dans le même temps, circuler la rumeur que le pauvre Jacopo avait mis fin à ses jours en raison de l’extrême mécontentement de lui-même dans lequel il était tombé. Il n’en demeure pas moins que tout ceci me laisse dans un épais brouillard, pour quoi je me permets, afin de démêler les fils embrouillés de cette ténébreuse affaire, de solliciter votre grande sagesse dont je sais qu’elle égale presque votre talent et concourt pleinement à votre génie.
3. Michel-Ange Buonarroti à Giorgio Vasari
Rome, 5 janvier 1557
Messire Giorgio, mon cher ami, je ne saurais vous dire combien je suis abattu, au point que je n’ai pas quitté le lit depuis ce qui me semble une éternité. Au vrai, j’étais déjà écrasé par tous les soucis que me donne le chantier de Saint-Pierre, mais la mort de Jacopo m’a pour ainsi dire achevé, et j’ai pleuré en lisant votre lettre. Jacopo était un peintre de grand talent, et selon moi l’un des meilleurs, non seulement de sa génération (celle qui est née entre la mienne et la vôtre, car je suis aux portes de la mort et vous encore dans la force de l’âge) mais tout simplement de son temps. En me demandant de vous aider à retrouver le coupable de ce crime inconcevable aux yeux de Dieu et du monde, je ne sais si vous frappez à la bonne porte, et je crains que vous ne surestimiez quelque peu l’étendue de ma sagesse, car voici déjà longtemps qu’à Rome l’on dit de moi que je suis sénile et fou. Néanmoins, et comme je veux vous être agréable, tout autant que je souhaite honorer la mémoire du Pontormo, je suis disposé à vous aider dans la mesure de mes moyens. Peut-être, en effet, qu’un point de vue, disons, oblique, c’est-à-dire non florentin, vous serait utile dans vos recherches. Si l’on approche le problème avec la rigueur et la logique d’un Brunelleschi ou d’un Alberti, il faut, pour trouver le coupable, établir d’abord l’occasion, ensuite la cause, ou bien d’abord la cause, puis l’occasion. Qui pouvait désirer la mort du pauvre Jacopo ? Et qui était avec lui, ce soir-là, pour lui asséner ce coup mortel ? En écrivant ces lignes, mes yeux se mouillent de larmes, et je le vois gisant dans son sang, le cœur transpercé par l’un de ces outils qui nous font vivre, nous autres artistes, tué par son propre ciseau, frappé par son propre marteau, et c’est comme s’il avait été trahi par ses plus fidèles compagnons. Mais foin d’effusions stériles. Si mes larmes sont un tribut à la mémoire de notre ami, elles ne nous aideront pas à identifier l’assassin. Enfin, une première conclusion : le coupable est à Florence, parmi vous.
J’ai peur, mon bon Giorgio, de ne pouvoir vous aider davantage, faute d’éléments supplémentaires. Après tout, je ne suis qu’un modeste sculpteur et, de Rome, le regard ne porte pas jusqu’à San Lorenzo. Par amour pour Jacopo, soyez mes yeux et tenez-moi informé des suites de vos recherches, je vous en prie.
Mais vous ne m’avez pas parlé de ses fresques. Comment les avez-vous trouvées ? On dit que le Duc lui avait donné pour tâche de rivaliser avec la Sixtine. Dites-moi votre sentiment, cher Giorgio, vous savez que j’ai toujours fait grand cas de votre jugement.
4. Giorgio Vasari à Michel-Ange Buonarroti
Florence, 7 janvier 1557
Cher Maître, d’emblée je veux vous rassurer : votre Sixtine ne sera pas surpassée par la chapelle du Pontormo. Comme vous m’en avez prié, je vous décrirai ce que j’ai vu : tout d’abord, en divers compartiments, dans la partie supérieure de la chapelle, la Création d’Adam et d’Ève, leur Désobéissance, leur Expulsion du Paradis, leurs travaux sur Terre, le Sacrifice d’Abel, la Mort de Caïn, la bénédiction des enfants de Noé et la construction de l’Arche. Ensuite, sur l’une des parois, dont la dimension est de quinze brasses en tous sens, un Déluge universel, où l’on voit une foule de cadavres et Noé conversant avec Dieu. C’est au pied de ce Déluge qu’on a retrouvé le pauvre Pontormo, et c’est sur cette paroi qu’il a retouché une partie de l’ensemble, alors que le reste était sec depuis longtemps. Sur l’autre paroi, il a figuré une Résurrection universelle, où domine une confusion égale, pour ainsi dire, à celle qui régnera le jour suprême. Vis-à-vis de l’autel sont groupés, de chaque côté, des personnages nus, qui sortent de terre et montent au ciel. Au-dessus des fenêtres, des anges environnent le Christ, qui dans toute sa majesté ressuscite les morts pour les juger. J’avoue que je ne comprends pas pourquoi Jacopo a placé sous les pieds du Christ Dieu le Père créant Adam et Ève. Je m’étonne aussi qu’il n’ait varié ni ses têtes ni sa couleur, et je lui reprocherai encore de n’avoir tenu aucun compte de la perspective. En un mot, le dessin, le coloris et l’ajustement de ses figures offrent un aspect si triste que, malgré mon titre de peintre, je déclare n’y rien comprendre. Il faudrait que vous puissiez la voir de vos propres yeux pour me l’expliquer, mais je doute cependant qu’alors votre jugement s’écarterait grandement du mien. Cette composition renferme bien quelques torses, quelques membres, quelques attaches merveilleusement étudiés, car Jacopo avait eu soin d’exécuter des maquettes en terre d’un fini extraordinaire, mais tout cela pèche par l’ensemble. La plupart des torses sont trop grands, tandis que les bras et les jambes sont trop petits. Quant aux têtes, elles sont totalement dépourvues de cette grâce et de cette beauté singulière que l’on observe dans ses autres peintures. Il semble ici ne s’être occupé de certains morceaux que pour négliger les plus importants. En somme, loin de se montrer dans ce travail supérieur au divin Michel-Ange, il est resté inférieur à lui-même, ce qui prouve qu’en voulant forcer la nature on aboutit à des qualités que l’on devait à sa libéralité. Mais Jacopo n’a-t-il pas droit à notre indulgence ? Les artistes ne sont-ils pas exposés à se tromper de même que les autres hommes ? Demeure cette question qui restera désormais sans réponse, puisque Jacopo l’a emportée dans la tombe : pourquoi avoir souhaité, peu de temps avant sa mort, retoucher une partie de son Déluge ? Qui peut dire de quoi étaient faites les rêveries profondes de cet homme ?
Quoi qu’il en soit, le Duc, dans sa grande sagesse, a confié l’achèvement des fresques au Bronzino.
5. Michel-Ange Buonarroti à Agnolo Bronzino
Rome, 9 janvier 1557
Messire Agnolo, j’ai appris par Vasari l’horrible drame qui a frappé Florence et nous tous, amants des arts et de la beauté, en la personne de votre maître et ami, foudroyé sur le lieu de ses plus grandes espérances mais aussi – je ne le sais que trop moi-même par mon expérience chèrement acquise – de ses plus grandes tortures. En effet, qu’y a-t-il de plus horrible que de peindre à fresque ? On passe la journée le cou tordu, la tête à l’envers, dix ou quinze pieds au-dessus du sol, à manier le pinceau comme on peut avant que l’enduit ait séché, sans quoi il faut tout recommencer. En vérité, si Messire Vasari ne m’avait rapporté les circonstances de sa mort, qui ne semblent guère prêter à équivoque, je n’aurais pas été surpris d’apprendre que le pauvre Pontormo avait mis fin à ses jours, car c’est une pensée qui m’a moi-même assailli certains soirs de désespoir, quand je sentais mon cou et mon dos brisés par le labeur, et qu’il me venait un goître à force d’avoir la tête en bas, sans même parler des intrigants et importuns toujours prompts à répandre la calomnie et à manigancer contre moi. Vous savez comme mon Jugement universel a été attaqué et décrié depuis près de vingt ans, l’Arétin, ce fils de pute, Dieu ait pitié de son âme, allant même le comparer à un bordel niché dans la plus grande chapelle de la Chrétienté. Ces critiques, non seulement n’ont pas cessé, mais n’ont fait que se multiplier et s’amplifier. C’en est au point où aujourd’hui le pape Paul IV, après avoir envisagé la destruction pure et simple de mon œuvre, a commissionné mon bon ami Messire Daniele da Volterra pour rhabiller mes figures dénudées, tant et si bien que le pauvre Daniele, contraint à cette tâche indigne, se voit déjà affublé du beau surnom de « caleçonneur » dans toute Rome. Voilà où nous en sommes. Il est bien loin, le temps où les papes m’offraient de somptueux cadeaux. Même Paul III, à qui le monde doit pourtant le retour de l’Inquisition romaine, m’avait fait présent d’un magnifique pur-sang arabe, qu’il prétendait être le coursier le plus rapide d’Orient et d’Occident. Rien n’était trop beau, alors, pour s’attacher mes services. Pauvre bête qui se languit dans son écurie comme moi dans ma tanière.
Je ne doute pas que Jacopo ait eu à subir les mêmes avanies car je me souviens de certains malveillants, jaloux et autres calomniateurs qui peuplaient Florence à mon départ, et je ne vois guère de raisons à ce qu’ils n’aient pas fait d’émules. C’est pourquoi je veux apprendre de votre bouche quel accueil on a fait aux fresques de Pontormo, et par-dessus tout avoir votre opinion sur son travail, car même s’il n’y a pas lieu de mettre en doute les réserves émises par Vasari, je penserai toujours que deux jugements valent mieux qu’un, dès lors qu’ils proviennent de personnes avisées et loyales.
6. Agnolo Bronzino à Michel-Ange Buonarroti
Florence, 11 janvier 1557
N’est-il pas vrai, cher Maître, que vous n’êtes pas revenu à Florence depuis vingt-trois ans, malgré les demandes répétées de Son Excellence le Duc, appuyées par les sollicitations de vos amis ? Peut-être ce nouvel argument viendra-t-il à bout de vos résistances, et notre pauvre Pontormo réussira-t-il là où tous les autres ont échoué : je vous jure que ses fresques sont d’une splendeur telle qu’on n’en avait pas vu de semblables depuis votre Sixtine. C’est un spectacle que le grand Michel-Ange se doit de contempler par lui-même, puisque aucun mot ne suffira à les décrire.
Ne croyez pas Messire Giorgio qui, pour être un homme de goût dont la probité ne saurait être questionnée, est aussi un courtisan qui sait se plier aux exigences de son maître. Vous ne savez que trop bien, comme le confirme votre lettre, combien la nudité des corps n’est plus en odeur de sainteté depuis que la Curie romaine a jugé bon d’offrir la tiare au contrôleur général de l’Inquisition, ce Carafa insensible aux beautés de l’art, pour qui toute représentation du corps humain est une offense faite à Dieu. L’extraordinaire Déluge qui est sorti de l’esprit et des mains sans pareilles de Jacopo n’a pas eu l’heur de plaire à la Duchesse, dont le goût espagnol s’accommode mal d’une vision aussi extraordinaire : des corps nus entassés dont certains semblent avoir été gonflés par leur séjour prolongé dans les eaux. Il y a tant de vérité dans cette peinture qu’une rumeur s’est répandue en ville prétendant que Jacopo aurait utilisé comme modèle des cadavres de noyés qu’il allait lui-même récupérer dans les hôpitaux. Ces racontars ne sont évidemment que pure fantaisie, mais la fabuleuse peinture du Pontormo est cause même de cette outrance : on n’a jamais vu noyés plus vivants que sur ces murs.
Son Excellence Cosimo, si elle ne partage pas les préventions de la Duchesse contre la représentation des chairs, n’étant ni Carafa ni femme ni espagnol, convoite néanmoins depuis trop longtemps le titre de roi de Toscane pour ne pas donner des gages au pape, seul habilité à lui octroyer une telle dignité. C’est pourquoi elle s’est bien gardée de manifester aucune marque d’approbation lorsque les fresques furent révélées à un petit nombre de privilégiés, après que le Duc leur eut fait ouvrir les palissades derrière lesquelles Jacopo les dissimulait. Mais je suis sûr, moi, que ces peintures plaisent au Duc malgré tout, et j’en veux pour preuve qu’il m’a confié l’honneur de les achever, car il sait qu’en tant que plus fidèle élève du Pontormo, je ne trahirai pas son héritage. Ainsi, Dieu dût-il m’en juger digne, quand le grand œuvre de Jacopo da Pontormo sera fini par mes soins, j’apposerai fièrement mon nom au côté du sien. Ce sera sa vengeance, et la nôtre, car nul doute qu’on l’a tué à cause de ses fresques, en raison de ce nouvel esprit du temps, qui est décidément bien sombre et bien contraire aux gens comme nous.
Extraits
« Cela étant dit, puisque tout tourne autour de l’assassinat du Pontormo, nous suivons d’autres pistes dont je peux assurer Votre Excellence qu’elles sont dans un état d’avancement promoteur et ne manqueront pas de porter leurs fruits sous peu, à savoir la recherche de la femme qu’on a vue au logis du peintre, ou cette bizarrerie observée sur l’un des panneaux de San Lorenzo, que je suis retourné voir pour constater que les couleurs sur la partie retouchée s’étaient, en séchant au fil des jours, en quelque sorte séparées de celles du reste du tableau, s’en distinguant légèrement, si bien que la partie retouchée est désormais nettement visible, ce qui ne peut signifier qu’une seule chose : celle-ci a été peinte par un peintre très habile mais pas par Pontormo. »
« Faites donc la liste des personnes, sans en écarter aucune, qui auraient pu ou voulu tuer Jacopo (ou bien, encore mieux, les deux ensemble). Si je vous ai bien suivi, nous avons l’ouvrier Marco Moro, dont je ne peux rien vous dire car je ne le connais pas, l’apprenti Battista Naldini, que je connais pour l’avoir employé comme professeur de dessin aux Innocents et qui ne m’a jamais causé le moindre tracas, notre ami Bronzino (aussi invraisemblable que paraisse cette supposition, forçons-nous à la considérer), la Duchesse (ne protestez pas, il s’agit là d’un exercice de l’esprit, rien de plus), et la femme mystérieuse qui est venue chez Jacopo en son absence (d’après Battista). Rajoutons même le Duc, pour que vous ne puissiez pas me reprocher d’être incomplet! En vérité, tous ceux qui étaient alors à Florence auraient pu commettre ce crime, n’est-ce pas ? Mais un seul y a trouvé un intérêt assez puissant pour mettre son projet à exécution. De quelle nature était cet intérêt ? C’est ce que nous devons découvrir. » p. 64
« Très cher ami Messire Giorgio, plus j’y songe et plus je pense que la clé du mystère est dans ce tableau de Vénus et Cupidon. Pourquoi avoir remplacé la tête par celle de la fille du Duc ? En dépit de ce que j’en ai moi-même jadis dessiné le modèle, sans autre intention que de montres la beauté de l’Amour mais aussi ses dangers et ses pièges, je ne peux ignorer que cette substitution trahit une intention provocante et hostile à l’égard de la famille ducale, car je me doute que la jeune Maria, qui ne doit pas avoir plus de dix-sept printemps et que son père songe sans doute à marier, n’a que peu à voir, au physique comme au moral, avec ma Vénus lascive et épanouie. D’autre part, je vois mal le brave Pontormo se découvrir un goût vicieux pour les jeunes vierges à soixante ans passés. Je pense que ce n’est pas la fille mais le père qui est visé dans cette peinture. Mais pourquoi donc Pontormo en aurait-il voulu à son protecteur et bienfaiteur, pour lequel il donnait tout son labeur depuis plus de dix ans, et en vérité depuis près de vingt? y a un mystère que je ne m’explique pas. Vous qui avez vu le tableau, avec votre œil de peintre confirmé, n’avez vous repéré aucun indice? En admettant que Naldini ait dit vrai sur la visite nocturne d’une femme encapuchonnée, que pouvait-elle bien vouloir, sinon quelque chose en rapport avec ce tableau? Et qui d’autre que le Duc ou sa famille aurait pu se sentir offensé d’un tel tableau? » p. 66
À propos de l’auteur
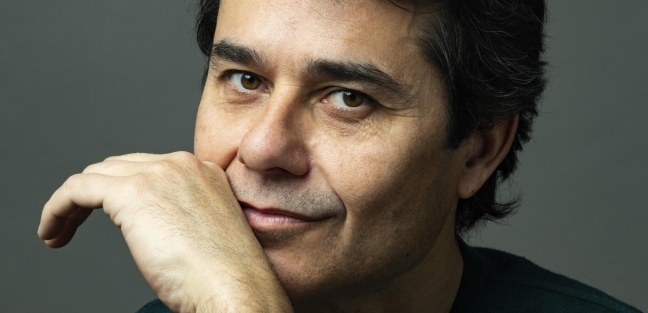
Laurent Binet © Photo Jean-François Paga
Laurent Binet a été professeur de lettres pendant six ans en Seine–Saint-Denis. Son troisième roman, HHhH, paru en 2010 chez Grasset, lui a valu le prix Goncourt du premier roman. L’ouvrage raconte l’opération Anthropoid, tournée vers l’élimination du SS Vice-gouverneur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. Depuis, il a publié tous ses romans chez Grasset. Son cinquième roman, La septième fonction du langage, axé autour de la mystérieuse mort du sémiologue Roland Barthes, remporte le Prix Interallié 2015. Il a été adapté en bande dessinée par Xavier Bétaucourt, Olivier Perret et Paul Bona en 2022, chez Steinkis. En 2019, son texte Civilizations est lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française 2019. Il a par ailleurs publié un Dictionnaire amoureux du tennis avec Antoine Benneteau, frère du tennisman Julien Benneteau.
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Tags
#perspectives #LaurentBinet #editionsgrasset #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #NetGalleyFrance #lundiLecture #LundiBlogs #Florence #renaissancetardive #beauxarts #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie





