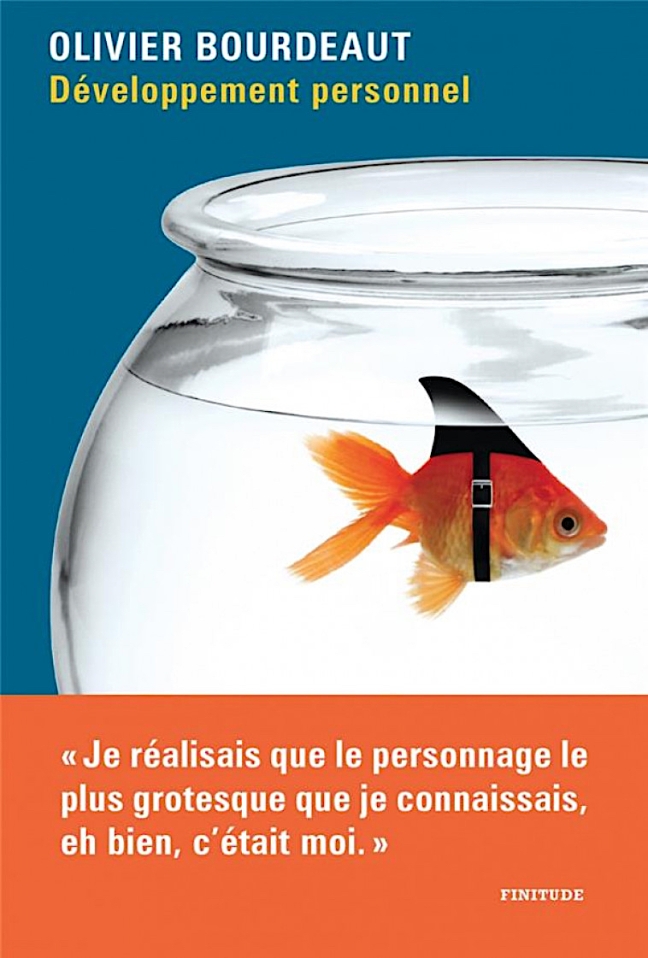En deux mots
L’admiratrice de Brigitte Bardot vient régulièrement déposer des lettres sous un caillou devant la Madrague, espérant une réponse. La star, à la veille de ses 90 ans, ne lui répond pas, mais s’appuie sur ces écrits pour raconter sa vie, ses amours, ses engagements.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Derrière les initiales BB
Simonetta Greggio dialogue avec Brigitte Bardot en s’imaginant admiratrice de l’actrice déposant ses lettres à la Madrague et faisant parler la nonagénaire. Deux voix qui remettent en perspective la carrière, les amours et les engagements d’une femme exceptionnelle.
Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin. Parce que les lignes qui concluent le roman de Simonetta Greggio expliquent son projet et résument parfaitement comment et pourquoi après avoir travaillé longuement pour une série sur France culture, elle a voulu écrire sur BB.
«Pieds nus et cheveux dans le vent, Brigitte Bardot a chevauché le siècle. Têtue comme un mustang, grondant comme une louve, farouche comme une biche, elle a tracé son chemin entre un patriarcat à la papa et le féminisme des années soixante-dix qui tourne la page avec MeToo, déposant sur son sillage les coquillages d’une vie qui ne ressemble à aucune autre. J’ai cherché BB comme on cherche une sœur perdue — je l’ai aimée pour sa beauté, sa force, son exil, son courage, sa connerie qui se fout de tout.
Traquer sa vérité, c’est peine perdue — mais ça, je le savais avant. Et ce n’est pas grave, pas du tout. De louve à louve, c’était ma propre vérité que je cherchais: quel est le prix à payer pour être libre ?»
En revisitant sa vie, sa filmographie, ses amours et ses engagements, la romancière nous offre une traversée de près d’un siècle qui va nous permettre de suivre l’évolution de la société dans les pas de l’actrice. Quand a 17 ans, elle part en Suisse pour avorter, quand après le succès de Et Dieu créa la femme, elle doit acheter La Madrague en payant cash parce qu’elle n’a pas droit à un carnet de chèques ou encore quand, bien des années avant MeToo, elle doit remettre en place tous ces hommes de pouvoir – à commencer par un certain François Mitterrand – qui concrétisent leurs fantasmes par des paroles et des gestes déplacés. N’oublions pas non plus les paparazzis qui ont pourri sa vie. Cette traque incessante restant sans doute traumatique: «on m’a poursuivie comme un animal. On m’a aimée à m’en tuer. Il n’y a pas de haine aussi forte que cet amour-là. Il est vrai que je me suis exposée aux regards du monde — alors que personne ne sait qui je suis, pas vraiment. Personne ne le peut. Ce que les gens perçoivent, c’est mon personnage ; moi, je fus et reste invisible. Ils ont cru m’apprivoiser parce qu’ils m’ont vue nue, autrefois.»
Au fil de la correspondance déposée devant la Madrague, on revisite aussi la vie amoureuse et tumultueuse de la plus belle femme du monde. De Vadim à Gunther Sachs, en passant par Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Jacques Charrier, Sami Frey ou Serge Gainsbourg, on essaie de démêler un écheveau inextricable de passion, de désir, de soif de liberté et de profonde dépression allant jusqu’au suicide.
C’est alors que s’ouvrent les pages les plus noires du livre: «Mon âme animale m’a sauvée à un moment où je ne pouvais que sombrer dans l’alcool, les barbituriques, la dépression, la maladie. J’ai eu un cancer du sein que je ne voulais pas faire soigner, j’ai eu des nuits qui duraient des semaines, j’ai eu envie de mourir mais ça ne s’est pas fait. J’ai payé chaque seconde de joie, chaque instant où j’ai dansé, chaque brasse dans la mer, chaque murmure d’amour fou, chaque baiser à couper le souffle.»
En parlant d’âme animale, on comprend aussi que l’engagement de BB contre la souffrance animale n’est pas née de l’ennui d’une retraite précoce, mais dès ses premières années. Une cause que la romancière fait sienne. Une cause qui va aussi rapprocher BB et Marilyn, Mes nuits sans Bardot et Poussière blonde de Tatiana de Rosnay avec cette évocation des mustangs dans Les désaxés.
On saura gré à Simonetta Greggio d’avoir eu le cran de se glisser dans la peau de BB pour nous raconter un destin hors du commun. Et si elle termine en soulignant qu’il reste bien des questions à poser, j’aimerais bien en ajouter une à mon tour, elle aussi sans réponse pour l’instant: qu’est-ce-que Brigitte Bardot a bien pu penser de ce livre?
Mes nuits sans Bardot
Simonetta Greggio
Éditions Albin Michel
Roman
320 p., 20,90 €
EAN 9782226484321
Paru le 2/04/2024
Où?
Le roman est situé en France, principalement à Saint-Tropez.
Quand?
L’action se déroule des années 1950 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
« On a cru me connaître parce qu’on m’a vue nue. Personne ne sait qui je suis vraiment. »
Une femme s’installe à Saint-Tropez, tout près de La Madrague, afin de percer les mystères qui entourent la star flamboyante et secrète. Leurs voix, leurs histoires se répondent, mettant en lumière les multiples facettes de Bardot – de la fillette disgracieuse à l’amoureuse passionnée en passant par l’adolescente perdue et la militante de la cause animale -, et font ressurgir du passé de grandes figures artistiques : Colette, Vadim, Brando, Trintignant et Gainsbourg…. À travers un troublant jeu de miroirs, se recrée sous nos yeux le mythe BB, un être d’une stupéfiante modernité.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Diversions mag.
PodMust (Un café au comptoir)
Blog de Gilles Pudlowski
Les premières pages du livre
« 1
Assise sur le muret de La Madrague, je ferme les yeux ; tout est trop bleu, le ciel, le portail, la mer qui bat tout près – on dirait un cœur, comme quand on pose la joue sur la poitrine de l’être aimé. Les estivants sont partis, les plages, désertes, les villas, fermées. Moi je reste là, dos appuyé à l’eucalyptus, tranquille, comme en prière.
Tranquille, comme endormie.
Ma chienne à mes côtés.
Je remonte ma capuche sur ma tête. Malgré la tiédeur de l’air, je tremble. L’automne commence, temps d’étoiles filantes dans les nuits transparentes, des feuilles qui craquent sous les pieds.
Dans Saint-Tropez, les brumes marines s’installent matin et soir : on croit que ce village côtier n’est qu’un port, on oublie les pins parasols serrés comme une forêt, les vignobles rangés en files ordonnées, les fermes endormies dans les oliveraies. On imagine le champagne coulant entre les seins des filles sur les yachts, on ne sait pas le silence et le secret des collines, les méandres des chemins blancs où de la mer ne subsiste qu’un parfum, au loin.
Saint-Tropez est un poisson, tête dans l’isthme, longue épine dorsale sur les sables de Pampelonne, queue posée sur l’Escalet. Saint-Tropez est le diamant de la couronne, le dernier à souffler ses lumières quand Ramatuelle et Gassin sont déjà dans le noir. Saint-Tropez est une huître dont la perle s’appelle Brigitte Bardot.
Je frissonne, ne bouge pas. La chienne à mes pieds s’étire, se retourne, soupire. Ouvre un œil.
La balle ? Non, ma Pépette, pas maintenant.
On attend.
Tranquilles.
3 octobre
Première lune d’automne
Chère Brigitte Bardot,
Tout à l’heure j’ai sonné à votre porte. J’ai tiré sur la chaînette, la cloche a retenti de l’autre côté de l’enceinte vêtue de lierre ; dans le calme du soir, aucune réponse, pas même un gardien ou un chien qui aboierait.
Je hausse les épaules comme vous le feriez.
Vous le savez sans doute, il y a de sales bruits qui courent. Un célèbre agent d’acteurs vient de publier la nouvelle de votre mort sur les réseaux sociaux, post vite retiré. Qu’en est-il ? A-t-il des informations que personne encore ne connaîtrait ? Que deviendrait ce monde si vous n’y respiriez plus, si vous n’y tempêtiez plus, si vous ne vous en preniez plus aux ministres et aux présidents de la République française pour leur inaction coupable vis-à-vis des animaux ? Si vous n’êtes plus là, qui sauvera les ours de cirque, les chevaux à sushis, les chèvres de l’Aïd, les chiens abandonnés sur les autoroutes chaque été ?
Si vous venez à manquer, Brigitte, qui sera la plus belle désormais ?
Après la nouvelle, j’ai couru ici depuis le vieux Saint-Tropez en passant par le débarcadère de La Ponche et la plage des Canoubiers. Je pensais en chemin à votre âge, à votre fragilité, à votre force aussi – à ce que vous représentez, à qui vous étiez, à celle que vous êtes devenue.
J’ai pensé à vous et à cette autre femme – j’allais écrire flamme – qui habita longtemps une villa proche de la vôtre, Colette la grande écrivaine. Il me revenait l’une de ses répliques, je cite de mémoire, Une vieille dame est quelqu’un qui connaît toutes les réponses mais à qui l’on ne pose plus de questions.
Moi, à toutes les questions qu’on me pose, que je me pose, je ne trouve pas vraiment de réponse.
J’ai sonné une deuxième fois. Je ne veux pas vous déranger, juste savoir.
Encore ce silence.
Peut-être cet agent a-t-il raison, vous n’êtes plus là. Vous vous êtes envolée, votre entourage joue le jeu, respectant vos dernières volontés, Surtout pas de bruit, il y en a assez eu, faites comme si j’étais toujours parmi vous, reine des pommes, princesse des chatons.
Dans le bruissement des cannes de bambou, un geai bleu s’envole. Je me sens observée. Je tourne la tête, personne. On ne me regarde pas, on ne me voit pas. Juste un lézard, immobile à mes côtés, sommeille sur la pierre encore chaude de la journée.
Une brise agite les branches de l’eucalyptus au-dessus de moi, poussant les cheveux sur mon visage. Dans une brassée, je les ramène en queue de cheval et les attache. Je me souviens de ma mère qui avait adopté votre chignon au sommet de la tête, nuque nue. Les femmes ont tellement voulu vous ressembler ! Vous bougiez la tête de haut en bas, c’était une moisson de blé, un grain d’été, une pouliche qui s’ébrouait. Le frisson de la liberté.
Ça n’a jamais été l’icône qui m’a attirée chez vous – encore que, enfant, j’avais étudié une soirée entière l’une de vos photos dans laquelle vous apparaissiez fort peu habillée, quoique chaussée de longues cuissardes blanches. Et ce n’est pas non plus la star qui me passionne, même si je trouve fascinant le rôle que vous avez joué au cours du siècle passé.
Que penser, BB, d’une trajectoire comme la vôtre ? Qui est cette fille qui a croisé la lumière et en a été dévorée ? Tout est lié, les scarabées d’or et l’horloge de l’Apocalypse, les étoiles du firmament et les étoiles de mer.
Vous et moi, en tout cas.
Une fois cette lettre terminée, je la laisserai sous un caillou devant votre porte ; je fais plus confiance à ce moyen rudimentaire qu’à la poste, aux mails, à Instagram et Facebook. Qui sait ce qui se cache derrière ces derniers. Des fake, des fous, des groupes bizarres, des influenceurs flous.
Le caillou, donc. C’est plus sûr. Si je n’ai pas de réponse, j’aurai au moins la certitude que mes paroles vous sont parvenues physiquement. Et plus tard, entre chien et loup – à l’heure bleue, votre heure, BB –, j’irai boire une bière sur la plage en contrebas ; je verrai une lumière s’allumer à La Madrague et je saurai que vous êtes là. Les vagues que vous entendrez seront les mêmes que celles qui viendront mouiller mes pieds, ma chienne se couchera près de moi en soupirant après cette journée à jouer, courir et se marrer, et je lui dirai, Hein, chérie, elle n’est pas belle la vie ?
Dites, Brigitte.
Ne mourez pas.
S’il vous plaît.
La Madrague
Tout à l’heure la sonnette a retenti. J’ai regardé en douce, personne. J’en ai tellement marre de tout ça ! Depuis le temps que ça dure, BB, où es-tu ? BB, sors de là ! Allez, BB, montre-toi. BB, t’es pas morte au moins ? Ben non, n’en déplaise à ce macaque qui a annoncé ma disparition, ça te plairait n’est-ce pas vieux cornichon que je m’en aille avant toi ? Ce n’est pas la première fois qu’on annonce ma mort, ce ne sera pas la dernière non plus, jusqu’à ce que ça ressemble à l’histoire de « L’enfant qui criait au loup ». Ah, j’aurai tout vu quand même ! Heureusement, mon quotidien ce sont plutôt des lettres, des fleurs fraîches et des corbeilles de fruits ! Mais aussi des paniers de chatons nouveau-nés, un gabian blessé, une vieille tortue. Parfois dans le tas il y a encore des billets d’insultes ou de menaces, mais de moins en moins souvent.
Quand ça remue trop à ma porte, je reste tapie, ça finit toujours par se calmer, et si ça ne se calme pas, je siffle mes bêtes et je file à La Garrigue, de l’autre côté de la presqu’île, là où personne ne peut me trouver. Il est rare maintenant que je demeure ici toute la journée, je ne peux le faire que l’hiver, quand les bateaux restent ancrés au port, bâchés, muets. J’oublie : pendant les trois mois d’aliénation estivale, un rafiot passe jusqu’à dix fois par jour devant chez moi. Un haut-parleur répète chaque fois la même litanie, cela résonne jusqu’aux rivages, à croire que l’abrutissement alcool/coups de soleil rend sourd l’auditoire, Mesdames, Messieurs, voici La Madrague, la célèbre villa de Brigitte Bardot. Cachée derrière ce mur qui la protège des regards indiscrets, notre grande star bien-aimée, bla-bla, etc. Suit pêle-mêle la liste de mes hauts faits et de mes amours, toutes les deux heures on me rappelle ma fortune et mes erreurs, mes suicides et mes mariages, mes ratages – et mon âge.
Tout est vrai, tout est faux, jusqu’à l’histoire de ce mur abusif qui, de toute façon, ne me protège guère des raseurs venus de la mer. Disons qu’il est dissuasif, mais il ne me sauve pas de ceux qui débarquent jusqu’à mon portail à pied, en voiture et même en car dans l’espoir de m’apercevoir. Mais pourquoi ? À quoi s’attendent-ils ? Que je les bénisse, comme le pape à Rome ? J’aimerais bien en écrabouiller un ou deux au passage. Ah, ça leur ficherait une bonne trouille ! J’en ai vu sauter dans le fossé, se casser la figure et me crier après, mais qui a commencé, hein ? Tout ce que je demande, tout ce que j’ai jamais voulu, c’est qu’on me laisse tranquille ; or j’aurai passé le plus clair de mon existence sur le devant de la scène à lutter pour la défense de mes intérêts et celle des animaux, les deux coïncidant d’ailleurs depuis si longtemps qu’on ne peut plus les démêler.
En attendant, merci mon Dieu merci la Vierge Marie, c’est la morte saison qui commence. Je peux dormir dans mon plumard centenaire, s’il pouvait parler celui-là, c’est tout de même cocasse que je n’en aie jamais changé. Enfin, jamais… sauf quand mon chez-moi est devenu, grâce à des gardiens abjects, un lupanar. En mon absence, ils louaient ma chambre à des prostituées qui y accueillaient leurs clients. Je n’ose imaginer ce que mes murs ont entendu, sûrement pas ce à quoi ils étaient habitués avec moi.
On me croyait volcanique, j’étais câline. On me voyait mangeuse d’hommes, je me laissais croquer plus souvent qu’à mon tour. Le sex-symbol que j’ai été a toujours préféré les symboles au sexe.
Aujourd’hui, la passion, les peines de cœur, les sanglots à fendre l’âme me semblent appartenir à une autre que moi. Une sorte d’alter ego, une jeune femme qui marcherait à mes côtés, dont je connaîtrais intimement le cœur et pour laquelle j’éprouverais une tendre peine teintée de dérision. L’amour ? C’est un peu comme lorsque mes chattes considèrent, d’un coup de griffe rentrée, une sauterelle, une mouche, qu’elles sont trop repues (ou trop vieilles) pour attraper.
Je suis bien cette nuit. Il y a tellement d’étoiles dans le ciel, on dirait qu’elles sont plus brillantes que d’habitude. C’est quelque chose qui ressemble au bonheur de rester là, étendue les yeux ouverts, et de repenser à ce qui s’est passé. À ceux que j’ai aimés. À ceux qui m’ont aimée. Parfois, cela arrivait en même temps, qu’on s’aime. C’était bien. Le bonheur n’est peut-être qu’une étincelle. À moins que cela ne s’appelle joie, mais il me semble que c’est autre chose encore que j’expérimente aujourd’hui, une sorte de douceur qui s’est installée en même temps que la vieillesse.
Pas toujours. Pas à jamais. Parfois, oui, je suis sereine.
Pas toujours. Pas à jamais.
Cette nuit je le suis, et cela me suffit.
2
Sur le chemin blanc de poussière qui mène à la plage des Canoubiers, cloué au mur extérieur qui entoure un bout de jardin ensauvagé, se balance un panneau « À LOUER », un vieux morceau de métal tout abîmé avec un numéro de téléphone fixe lessivé par les années.
J’appelle. Une voix masculine sans âge, irascible et expéditive, me donne ses conditions. Je dis oui à tout, sans discuter, sans presque écouter. Je signe l’après-midi même, dans un studio de notable défraîchi de la vieille ville. Le soir j’ai un toit pour nous abriter, Pépette, sa balle et moi, ces prochains mois. Je ne sais pas ce que j’y ferai, mais l’absolue nécessité de rester ici m’est apparue clairement, d’un coup.
La combinaison de deux variantes ajustables qui ont matché.
La nouvelle de sa mort supposée.
Mon errance qui a besoin de souffler.
La maison est ancienne, spartiate, avec une cuisinière à bois pour chauffer et faire à manger, comme autrefois. Les portes grincent. L’odeur de moisi règne avec celle, plus sèche, aigre, des souris qui doivent nicher quelque part. J’ai posé mon ordinateur, mon carton et mes carnets sur la nappe cirée qui recouvre la table de la cuisine. Par la fenêtre aux vitres sales je vois le chêne qui perd ses feuilles – déjà. Je donne des coups de pied aux objets hétéroclites qui encombrent le sol, je fais le tour et ouvre les fenêtres, poussant les volets. Le bois a travaillé, gonflant dans les gonds. Ça racle la pierre. Les coques vides des cigales tombent dans les herbes jaunies.
C’est triste et beau.
J’ai posé le panier de Pépette près du lit dans la chambre la plus spacieuse, celle qui a une grande armoire avec un miroir en pied intérieur. Ça m’aidera à me souvenir de la tête que j’ai car souvent je ne sais plus trop – comme si je m’étais perdue de vue. C’est aussi la chambre la plus commode, le mur est mitoyen de la cuisine, un peu de la tiédeur du poêle arrive jusqu’ici, la nuit. Ma chienne, elle, s’en fout du confort. Elle pourrait dormir n’importe où tant que je suis à ses côtés. Quitte à se glisser au petit matin sur mon oreiller, ses oreilles duveteuses si près de mon nez que j’en éternue en me réveillant.
Ça la fait rire, on dirait.
J’ai laissé les pièces s’aérer, s’imprégner de la douceur de l’air, et je suis sortie. J’ai marché dans cette obscurité tranquille, sans vent, aux odeurs de vagues et de sable humide, d’herbe à curry grillée, d’eucalyptus, de pommes de pin tombées à terre et éclatées au sol. Les derniers grillons stridulent dans les fossés. Maintenant, blottie dos aux bateaux retournés dans la nuit qui vient, tête levée vers ces étoiles brillantes comme jamais, ma bière tiédie à la main, Pépette pelotonnée à mes pieds après avoir aboyé derrière des vols de mouettes impavides, des éclairs dans le lointain, je songe à elle, encore, et à moi, un peu.
BB petite fille, comme une copine d’école, cheveux en queue de cheval, chaussettes tirées sur les genoux écorchés.
BB jeune femme, un autre moi, flamboyant.
BB vieille dame, qui éclaire mon chemin en regardant derrière elle désormais.
Tout à l’heure, depuis la maison, assise sur les marches encore tièdes du perron qui donne sur le jardin, j’ai appelé une biographe de mes connaissances. Elle connaît Bardot pour en avoir étudié le phénomène de manière quasi anthropologique. Je lui ai demandé si elle serait par hasard au courant d’une mauvaise nouvelle concernant BB, et dont le commun des mortels ne saurait encore rien. Elle m’a rassurée, Pensez-vous, ça réveillerait la Terre entière en un claquement de doigts, une bombe pareille, qu’est-ce que vous croyez, ce serait comme un pan du pôle Nord qui s’écroule, ce serait la tour Eiffel décapitée.
Je ne crois rien, justement, je suis si près, à ses pieds pour ainsi dire, et pourtant j’ignore comment elle se porte, si elle est seule, si elle a besoin de quelque chose, de quelqu’un.
Après m’avoir quelque peu rassurée – mais pas encore tout à fait –, la biographe a continué à discourir, de BB et du reste ; elle m’a confié que ce qui la motive quand elle écrit une biographie, c’est la quête du dépouillement, ce chemin qui conduit du personnage à la personne. Lorsque nous avons raccroché, je me suis demandé si je ne courais pas derrière une chimère ; ne pas me rendre compte que contempler de si près le monstre, c’est contempler le monstre en moi, ce serait me faire plus innocente que je ne suis. Mais aussi, l’idolâtrie qui a entouré BB, cette folie qui l’a contrainte à fuir ou à mourir, m’intéresse infiniment. Cela me fascine comme me fascinent les migrations des hirondelles, les accouchements des ourses, l’observation de la voûte stellaire. Beaucoup plus que le prodige, la puissance, la gloire, ce dont je me fous. J’ai des obsessions mais je ne suis pas une collectionneuse, ni l’une de ces maniaques qui recueillent les miettes de leurs idoles pour les placer devant un autel. D’ailleurs, je n’ai pas d’idoles, seulement des passions qui se rejoignent dans mes cartons, mes boîtes à souvenirs – mes memory boxes, comme disent les Anglais.
Je ne possède pas grand-chose, je n’ai pas beaucoup de bagages. Je suis nomade depuis longtemps, par choix et nécessité, quatre murs ont vite fait de ressembler à une prison ; j’ai besoin de respirer. C’est ainsi depuis mon adolescence. Je ne fuis pas, je pars prendre l’air, dans la vie et en amour. Malgré mes multiples déménagements, je me retrouve avec des caisses remplies de journaux intimes, de bouts de pellicule, de photos, dans un pêle-mêle où moi seule peux retrouver ce que je cherche – et souvent, ce que je ne cherche pas. Parmi ces fragments d’étés perdus, une photo de BB, longtemps punaisée aux murs d’anciens logements.
C’est une ballerine aux yeux tristes, une minuscule BB qui m’émeut.
Je ne tombe pas amoureuse des gens.
Je tombe amoureuse des destinées.
Extraits
« Et c’est vrai que La Madrague a été mon refuge, mais elle a été un piège aussi. Le rempart du parc contre lequel le cerf se retrouve acculé.
Car on m’a poursuivie comme un animal. On m’a aimée à m’en tuer. Il n’y a pas de haine aussi forte que cet amour-là. Il est vrai que je me suis exposée aux regards du monde — alors que personne ne sait qui je suis, pas vraiment. Personne ne le peut. Ce que les gens perçoivent, c’est mon personnage ; moi, je fus et reste invisible. Ils ont cru m’apprivoiser parce qu’ils m’ont vue nue, autrefois. Dans l’intimité de la salle noire, ils se sont imaginés au lit avec moi. C’est comme si j’avais couché avec chacun d’entre eux. On a cru me connaître parce qu’on me reconnaissait. Ça aussi, c’était faux; moi-même, je ne me reconnais que dans la petite fille que j’étais, la petite fille que je suis.
À la morte saison je reste seule ici avec ceux que j’aime, mon dernier compagnon, les copains rescapés qui viennent me saluer. Les touristes détestent le mistral, et moi, je suis tranquille. » p. 29
« Il me faudrait un cahier noir pour écrire les choses que je ne veux pas qu’on sache, celles qui n’appartiennent qu’à moi seule, celles que je ne veux pas partager, celles que je ne veux pas me rappeler la plupart du temps, celles que je ne peux malgré tout pas oublier, quand bien même des dizaines d’années se sont écoulées. Il me faudrait une boîte spéciale, une boîte de contes de fées que l’on ne peut ouvrir qu’avec trois petites clés, une en or forgée par les géants dans les viscères de la Terre, une en cristal soufflée par les êtres de lumière qui habitent le Ciel, une en flamme ardente, façonnée par le cœur de ceux qui m’ont aimée. Mon âme animale m’a sauvée à un moment où je ne pouvais que sombrer dans l’alcool, les barbituriques, la dépression, la maladie. J’ai eu un cancer du sein que je ne voulais pas faire soigner, j’ai eu des nuits qui duraient des semaines, j’ai eu envie de mourir mais ça ne s’est pas fait. J’ai payé chaque seconde de joie, chaque instant où j’ai dansé, chaque brasse dans la mer, chaque murmure d’amour fou, chaque baiser à couper le souffle. » p. 116
« Dans Les Désaxés, son dernier film, il y a cette scène avec les mustangs pris au lasso. Je ne pouvais retenir mes larmes au cinéma en la regardant tenter d’arrêter le massacre, si perdue, elle et ces hommes qui ne savent plus où ils en sont, qui tuent par désespoir et parce qu’au fond ils sont eux-mêmes comme ces chevaux, rien que de la chair à canon, des créatures au rabais. The Misfits, Les Désaxés, est un mot intraduisible qui dit bien cela: dans cette histoire les personnages sont des minables, des misérables. D’ailleurs, après ce tournage, Clark Gable est mort d’un infarctus, Montgomery Clift aussi, et Marilyn Monroe ne terminera pas son film suivant. » p. 197
« Chère Brigitte B.,
Il me reste mille et une questions à vous poser pour mille et une réponses que je n’obtiendrai pas, mais le fait même de les formuler me plaît. Oui, ça me plaît de vous écrire des lettres, et même ne pas savoir si vous les lisez ou pas, en fin de compte, me réjouit.
J’aime être impatiente. J’aime frémir.
Avez-vous déjà éprouvé ce bonheur vague, indéfinissable et indéfini, qui ne correspond à aucune réalité? On ne sait pas d’où cela vient, on ne sait pas au juste quand on l’a déjà ressenti, mais on le reconnaît. C’est une nostalgie, une plénitude mélancolique et joyeuse à la fois. » p. 240
« Pieds nus et cheveux dans le vent, Brigitte Bardot a chevauché le siècle. Têtue comme un mustang, grondant comme une louve, farouche comme une biche, elle a tracé son chemin entre un patriarcat à la papa et le féminisme des années soixante-dix qui tourne la page avec MeToo, déposant sur son sillage les coquillages d’une vie qui ne ressemble à aucune autre. J’ai cherché BB comme on cherche une sœur perdue — je l’ai aimée pour sa beauté, sa force, son exil, son courage, sa connerie qui se fout de tout.
Traquer sa vérité, c’est peine perdue — mais ça, je le savais avant. Et ce n’est pas grave, pas du tout. De louve à louve, c’était ma propre vérité que je cherchais: quel est le prix à payer pour être libre ?
Et si c’était la solitude, est-ce que j’en serais capable moi aussi — est-ce que je pourrais ? » p. 305
À propos de l’autrice
 Simonetta Greggio © Photo AFP – Ulf Andersen
Simonetta Greggio © Photo AFP – Ulf Andersen
Journaliste, scénariste, Simonetta Greggio est l’autrice de nombreux romans parmi lesquels La Douceur des hommes; Dolce Vita; Les Nouveaux Monstres; Bellissima (éditions Stock); Elsa mon amour (Flammarion). Elle a également produit pour France Culture des documentaires consacrés à Virginia Woolf, Brigitte Bardot, Elsa Morante et Mussolini. (Source: Éditions Albin Michel)
Page Wikipédia de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice

Tags
#mesnuitssansbardot #SimonettaGreggio #editionsalbinmichel #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #BrigitteBardot #cinema #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie




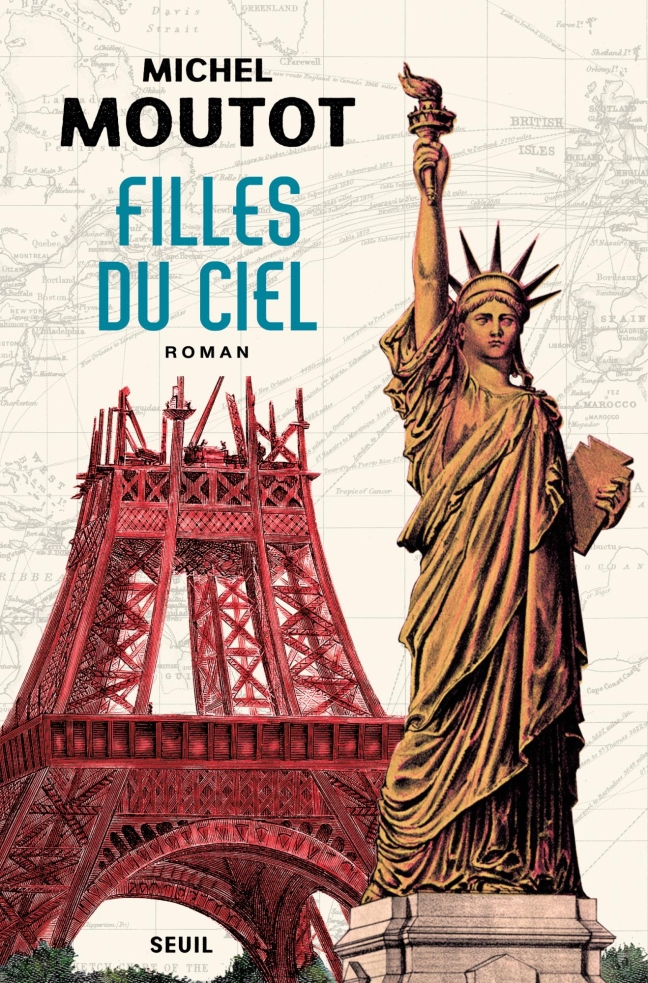


 Michel Moutot © Photo Hermance Triay
Michel Moutot © Photo Hermance Triay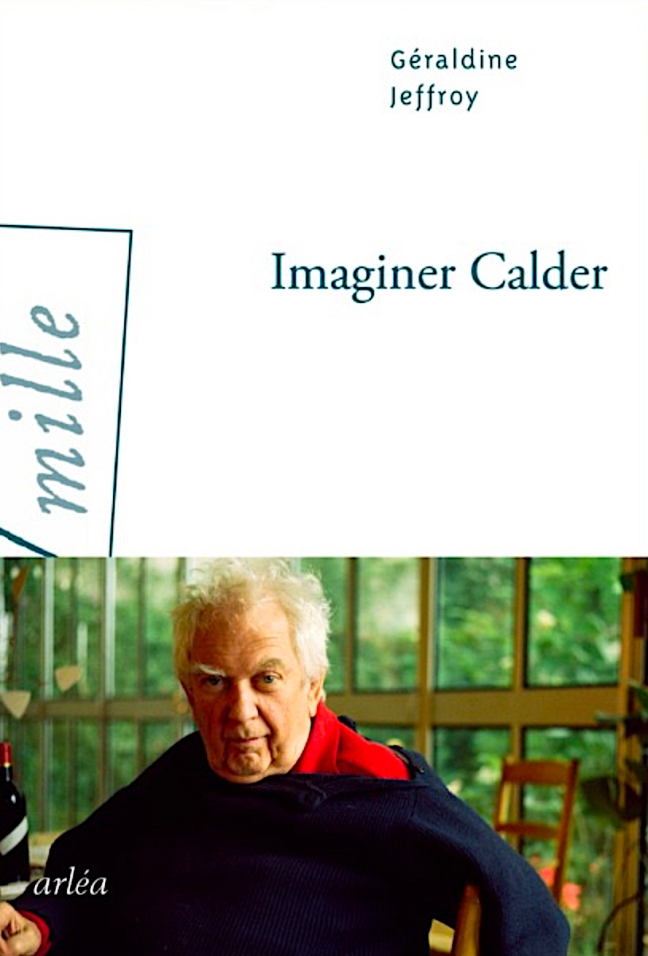



 Barbara Abel © Photo Marc Bailly
Barbara Abel © Photo Marc Bailly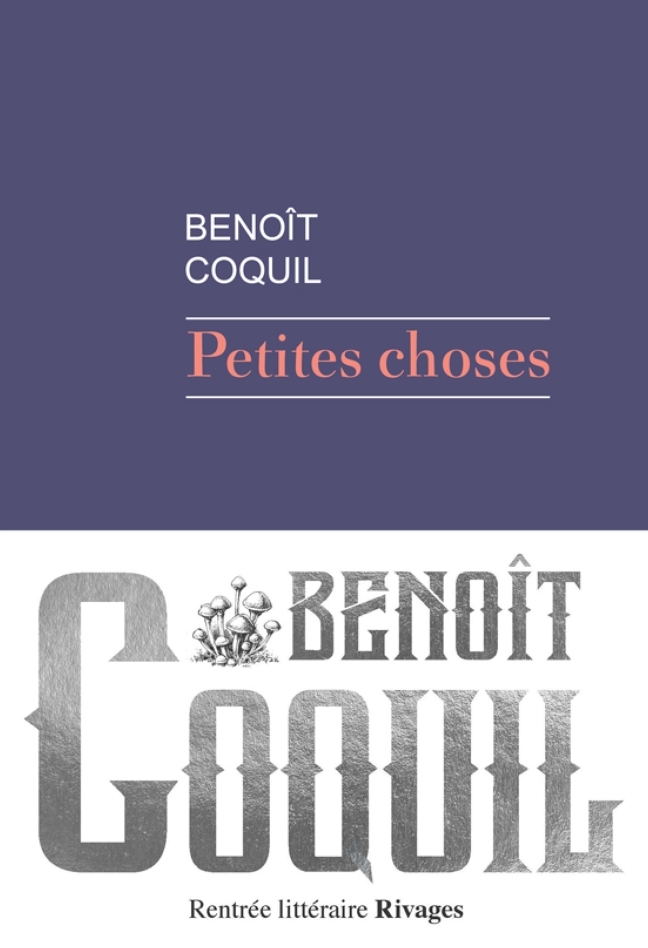


 Benoît Coquil © Photo Michel Coquil
Benoît Coquil © Photo Michel Coquil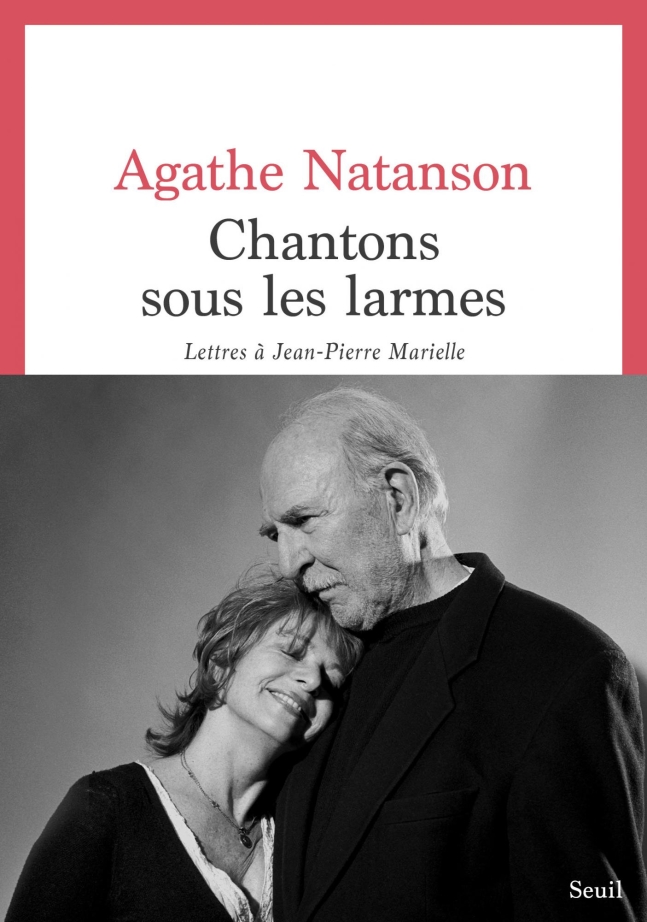
 Agathe Natanson © Photo Max Colin
Agathe Natanson © Photo Max Colin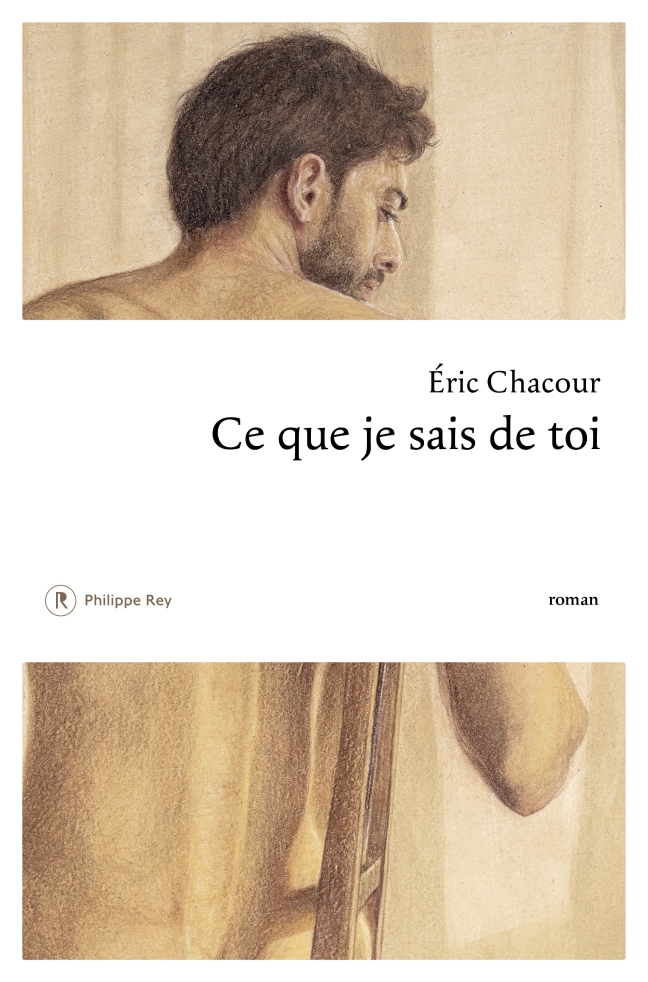

 Éric Chacour © Photo Justine Latour
Éric Chacour © Photo Justine Latour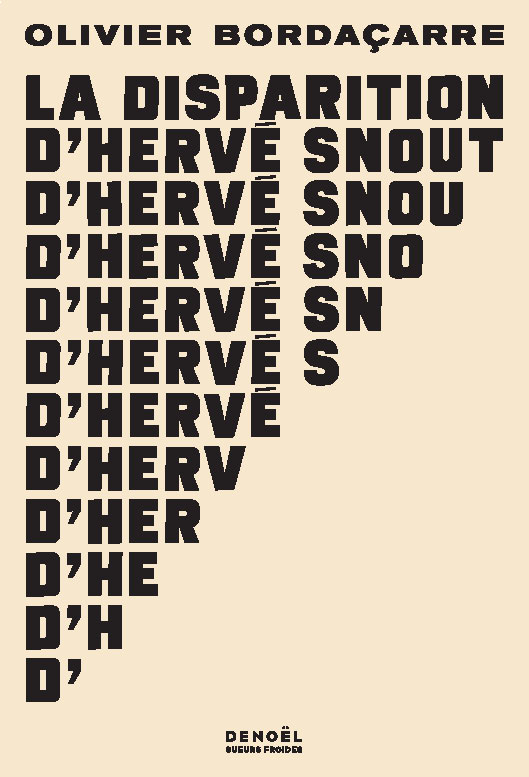

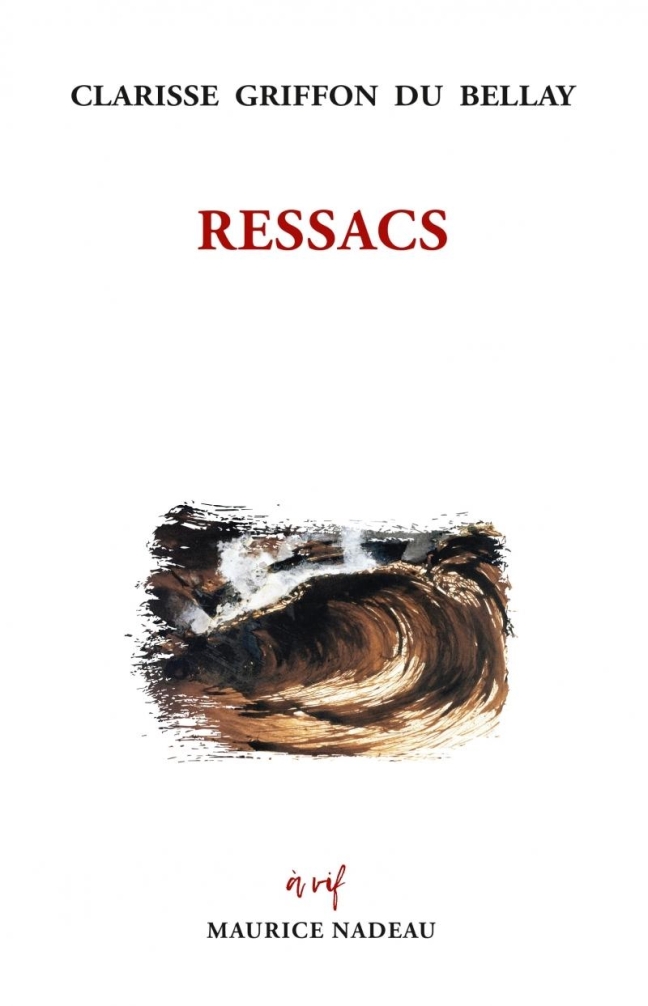

 Clarisse Griffon du Bellay ©Radio France Charlotte Perry
Clarisse Griffon du Bellay ©Radio France Charlotte Perry