En deux mots
Valentina et Gordon Wasson vont se passionner pour les champignons et créer l’ethnomycologie. Après la théorie, ils vont sur le terrain et découvrent au Mexique une espèce hallucinogène. Les deux ethnomycologues ne se doutent pas qu’ils vont bientôt changer le monde.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Les champignons qui changent le monde
Dans un premier roman hallucinant, Benoît Coquil nous raconte comment un couple de passionnés découvrent les psilocybes, des champignons hallucinogènes qui vont transformer la société. Stupéfiant!
Quand Gordon Wasson rencontre Valentina, il est loin de se douter que sa future épouse va l’entraîner dans une folle aventure. C’est lors de leur voyage de noces dans les Catskill Mountains que Valentina découvre des champignons dont elle fera une bonne poêlée sous l’œil méfiant – pour ne pas dire angoissé – de son jeune mari.
Rentrés à New York, «ils commencent à lire frénétiquement tous les ouvrages qui traitent des champignons dans les cultures anciennes et modernes. Ils se passionnent pour la façon dont on les nomme et les consomme ici et là, dont on en fait des êtres supérieurs ou bien des monstres. Partout dans le pays, et même ailleurs, les Wasson vont écumer les bibliothèques des musées, des collections ethnographiques, des instituts de botanique. Leurs carnets se remplissent de croquis, de cartes, d’idéogrammes, de noms surnaturels, Lycoperdon furfuraceum, Marasmius oreades, satyre élégant, fairy circles. Toute une vie de recherche s’ouvre pour les Wasson, bien que ce qui les séparait va maintenant les lier résolument. Au passage, ils s’inventent un titre pour leur passion bizarre: ils seront ethnomycologues.»
Une passion que la naissance de deux enfants ou l’ascension au poste de vice-président de la J.P. Morgan et Company ne vont nullement entamer. Ils continuent de voir des champignons partout. Dans les productions de Disney, Fantasia puis Alice au pays des merveilles, que Tina va voir avec Peter et Masha. Dans les recherches du chimiste Hoffmann à Bâle qui va bientôt breveter le LSD. Dans les faits divers, comme cette curieuse affection qui frappe les habitants de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Le 17 août 1951 des centaines d’habitants sont bizarrement intoxiqués, sans que l’on sache précisément pourquoi.
Un mystère de plus qui va aiguiser la curiosité de notre couple. Alors quand ils lisent qu’au Mexique des cérémonies mettent en scène les champignons, ils prennent l’avion. De Mexico ils se rendent à Huautla de Jiménez, où «les champignons t’emportent donde está Dios, là où se tient Dieu.»
Un voyage suivi de plusieurs autres expéditions et d’expériences quasi mystiques que María Sabina, la grande prêtresse, leur demande de garder secrètes.
Un serment que Gordon va trahir plusieurs millions de fois, soit le tirage du magazine Life auquel il a confié son histoire et ses clichés. «Cela s’appelle «Seeking the magic mushroom», et s’ouvre sur une photo pleine page de María Sabina tenant un champignon dans la fumée bleutée du copal. Puis vient un long texte où Wasson explique ses premières recherches, revient sur les rites ancestraux autour des champignons en Amérique Centrale, raconte sa découverte des pierres-champignons et ses voyages à Huautla, sa rencontre avec la chamane, ses visions sous psychotropes.»
On l’aura compris, le premier roman de Benoît Coquil ne se contente pas de vulgariser la mycologie en explorant son histoire, mais y ajoute un aspect que l’on pourrait qualifier de folklorique s’il n’avait pas profondément bouleversé le monde. Le Flower Power avec ses effets politiques, sociaux, culturels est une révolution à laquelle les Psilocybes ne sont pas étrangers. Paraphrasant Thierry Hazard, on pourrait dire que Petites choses est «un Spécimen rare chef-d’œuvre unique, Modèle d’époque pièce authentique, C’est un roman psyché, un roman psychédélique.
Petites choses
Benoît Coquil
Éditions Rivages
Premier roman
224 pages, 19,50€
EAN 978000
Paru le 23/08/2023
Où?
Le roman est situé aux États-Unis, à Great Falls, Montana, à Newark, New Jersey, à New York ainsi que dans les Catskill Mountains et à Danbury, Connecticut. Puis on voyage au Mexique, de Mexico jusqu’à Huautla de Jiménez. On y évoque aussi Paris et Bâle.
Quand?
L’action se déroule dans les années 1950-1960.
Ce qu’en dit l’éditeur
Mexique, années 1950. Au cœur des montagnes brumeuses de la région de Oaxaca, la chamane María Sabina se livre à d’étranges incantations, mêlées de transes et de chants. Elle a recours dans ses rituels aux psilocybes, de puissants champignons hallucinogènes, qu’elle appelle ses « petites choses ».
Mus par une insatiable curiosité, Gordon et Valentina Wasson, d’étonnants scientifiques autodidactes, partent depuis New York en quête du dernier psychotrope encore inconnu de l’Occident.
Le récit de leur découverte et de leurs expériences sous l’effet de cette substance va bientôt faire vibrer la planète, de la CIA au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, de la contre-culture psychédélique aux laboratoires Sandoz. Et faire basculer à tout jamais l’univers de María Sabina.
D’une plume vive et jubilatoire, entre récit d’aventures et tableau magique, Benoît Coquil nous fait revivre la fabuleuse histoire d’un champignon qui a changé le monde.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Technikart (Anna Prudhomme)
Kimamori (Yassi Nasseri)
Brut media
RFI (Vous m’en direz des nouvelles)
America Nostra
Blog de Kitty la mouette
Blog Ma voix au chapitre
Blog Les livres de Joëlle
Blog Alex Mot-à-mots
Benoît Coquil présente son premier roman, «Petites choses» © Production TV5 Monde
Les premières pages du livre
« Voici Psilocybe.
Psilocybe qui se tient droit, se dresse sur la terre, pas bien haut.
Psilocybe le discret ne paie pas de mine. Il passe inaperçu. Un corps mince, élancé, fait d’un seul tenant, là-dessus un simple chapeau brun beige terreux, un peu élimé sur les bords. Vous le trouverez le plus souvent près d’un champ de maïs ou bien dans une prairie, à l’abri du soleil. Psilocybe, comme tous les autres, se tient dans l’ombre. Et comme tous les autres, il est là pour quelques jours à peine, après la pluie. Il ne fait que passer.
Pas tape-à-l’œil, Psilocybe. Rien à voir avec Amanita muscaria et son chapeau rouge à pois blancs, tout droit sorti d’un conte pour enfants.
Mais, sous ses apparences d’individu banal, il cache bien son jeu. Sous la cape et le chapeau couleur de terre, malgré la courte stature, la silhouette filiforme, Psilocybe a tout d’un mage. Hygrophane, sa peau change de couleur selon le climat. Si vous tenez à croiser son chemin, gare à vous. Ses pouvoirs sont multiples.
Psilocybe n’exaucera pas de vœu de fortune, ne vous offrira pas d’éternelle jeunesse. Psilocybe n’est pas ce genre de génie bienfaiteur. Il œuvrera en vous selon son bon vouloir, dans l’obscur, dans la clarté, ou bien dans le gris entre les deux. Vous ne déciderez de presque rien.
À coup sûr, il fera s’emballer ou ralentir votre cœur, dilatera vos pupilles. C’est toujours ainsi avec lui. Sans doute, il vous fera connaître l’euphorie et les larmes. Il ne vous montrera rien de lui, vous fera plutôt voir en dedans de vous-même.
Peut-être vous montrera-t-il vos morts, ceux qui étaient là avant vous. Vos morts et aussi votre mort à venir. Ce sera terrifiant ou apaisant, impossible de le savoir à l’avance.
Si vous avez un au-delà, Psilocybe vous le fera toucher du doigt. Il vous fera tutoyer votre dieu, vos dieux.
Si vous croyez au temps des horloges, au temps régulier résolu rectiligne des horloges, Psilocybe le rendra liquide et sinueux comme le ruisseau, le fera s’épaissir, le rendra solide, gazeux, changera les heures en secondes.
Si vous croyez aux contours de votre personne, Psilocybe les abolira. Psilocybe vous amplifiera, lèvera les barrières douanières de votre tout petit ego, vous fera arbre parmi les arbres. Vous oublierez ce qui vous distingue de la chaise qui vous soutient, de l’air qui vous emplit, de la pluie tombée sur vous, de la mouche posée sur vous. Psilocybe vous rendra cosmique.
De tout cela il est capable, malgré ses cinq ou dix centimètres, malgré son air de rien. De tout cela vous ne déciderez pas.
Psilocybe vient du Mexique. C’est là que tout commence. Les Anciens, en náhuatl, l’ont appelé teyuinti-nanácatl, « celui qui enivre », ou bien teonanácatl, « chair des dieux ».
C’est autour de lui, Psilocybe l’imperturbable, celui qui revient toujours après la pluie, autour de Psilocybe qui enivre, que tourne cette histoire. C’est autour de son pied mince et droit que tous vont orbiter, chamanes, sorciers, chercheurs, chimistes, espions, hippies, sages et fous, dieux et diables. Approchez voir Psilocybe haut comme trois pommes. Penchez-vous pour le cueillir et vous les verrez tourner, ces histrions du siècle dernier, enivrés qu’ils sont de lui.
Approchez, et vous saurez.
I
A SHORT CUT TO MUSHROOMS
Gordon Wasson a cinq ans à peine lorsqu’il quitte Great Falls, Montana, la ville où il est né, pour s’installer avec ses parents et son frère à Newark, New Jersey, juste à côté de New York. Autant dire à l’autre bout du pays. Il ne s’en souvient pas, ou alors comme d’un voyage sans fin, d’une durée qui frôle le surnaturel. Un voyage si long qu’il mène vers un autre monde. Peut-être garde-t-il tout de même le souvenir très net de ces quelques minutes où il perd de vue ses parents dans la gare de Minneapolis noyée par la vapeur des locomotives, minutes qu’il passe à fixer sans le comprendre le logo du Northern Pacific Railway, une espèce de yin et yang rouge et noir qui l’hypnotise, jusqu’à ce que sa mère affolée le retrouve enfin et l’arrache à son hypnose de gamin fatigué.
En 1900 et quelques, les Wasson passent donc de l’interminable plaine du Montana à la grande ville debout. Ils ont pris une douzaine de trains pour y arriver et pourtant les voilà, fourbus mais heureux, dans leur maison en brique près de l’Hudson, à quinze kilomètres de Manhattan.
Le père, Edmund Atwill Wasson, est pasteur. Il a été promu par le diocèse pour guider les âmes égarées de la paroisse de Newark. On se figure révérend Edmund comme un large bonhomme ventripotent qui impressionne ses fils par des yeux très clairs qu’il écarquille lors de ses sermons, parce qu’il aime théâtraliser, surtout lorsqu’il leur raconte l’histoire du Buisson ardent et que sa grosse voix résonne dans la nef.
N’imaginons pas pour autant un personnage austère : Edmund est aussi amateur de bonne chère et ne crache pas sur le vin de messe, bientôt le seul alcool en circulation en ces années de prohibition galopante. D’ailleurs, il s’apprête à faire paraître un livre intitulé Religion and Drink, dans lequel il plaide pour que ses ouailles puissent continuer à boire du vin, dans les limites de la modération chrétienne, s’en référant à saint Jean Chrysostome – « Ne condamnez point le vin, mais l’abus que l’on fait du vin ! » Alors que les brasseries et les tripots ferment les uns après les autres, tandis que dans les saloons on se met à l’eau de Seltz, Edmund, les yeux pétillants après quelques verres du Précieux Sang, devise peut-être sur les Noces de Cana ou sur l’Extase de sainte Thérèse d’Avila, « enivrée de vin céleste ».
Son goût pour le mystère, le petit Gordon le doit sans doute à sa lecture immodérée des aventures de Sherlock Holmes, quoique son père lui répète qu’en matière de mystère, rien n’égale ceux, majuscules, de Dieu et de la Bible. Mais cela, Gordon le sait. À quatorze ans, il a déjà achevé sa troisième lecture de l’Ancien et du Nouveau Testament, et trouvé là-dedans bon nombre de mystères. Ses épisodes favoris sont, par ordre croissant de préférence : Jonas mangé puis recraché par la baleine ; Élie monté au ciel dans un tourbillon ; les flammes de l’Esprit-Saint perchées sur les têtes des apôtres qui se mettent à parler toutes les langues.
C’est aussi à leur père que Gordon et son frère Tom doivent leur bel anglais, cette prose si châtiée qu’ils déroulent à toute heure, même pour parler de baseball, car révérend Edmund leur interdit, dans un but d’enrichissement stylistique, l’usage de l’adverbe very et du verbe get, et leur a promis les flammes des enfers s’ils s’avisaient de confondre like et as, shall et will, should et would.
Non contents de faire de leurs fils de bons chrétiens et des anglophones hors pair, les parents Wasson veillent aussi à les dégourdir, de corps et d’esprit : une fois par mois, Gordon et Tom reçoivent un billet de train aller-retour et quelques dollars pour aller visiter tout seuls un musée de la capitale. C’est l’aventure : New York est comme un archipel. Il faut traverser trois fleuves pour arriver jusqu’à Manhattan, puis à la jungle de Central Park, échapper aux brigands de la Cinquième avenue, aux espions de Times Square, avant de découvrir enfin le trésor attendu : momie, squelette de dinosaure, automate musicien, selon le musée.
Un jour, au Metropolitan Museum, au fond de la grande salle déserte des arts océaniens, Gordon tombe nez à nez avec un masque de Nouvelle-Guinée qu’il dévisage – ou plutôt qui le dévisage – pendant presque une heure. À nouveau, il est hypnotisé, comme dans la gare de Minneapolis. Plutôt qu’un masque, c’est comme un heaume de chevalier – un heaume majestueux en écailles de tortue, avec au milieu un long nez pointu et deux yeux grands ouverts, très blancs, qui le clouent sur place. À son sommet, un oiseau marin en bois, genre albatros ou frégate, aux vastes ailes déployées. Un masque à métamorphose, donc, une sorte d’objet magique qui transformerait son porteur en oiseau des mers, ou lui conférerait au moins le don de voler. Est-ce à cela que pense le petit Gordon planté là ? S’imagine-t-il chausser le masque et s’envoler par la pensée au-dessus de Long Island ? A-t-il déjà l’intuition qu’il existe des voyages immobiles ? Mais ça y est, la rêverie est finie, cette fois c’est son frère qui l’attrape par le collet.
D’après la notice biographique mise en ligne par le musée botanique de l’université d’Harvard, c’est vers 1914 que tout s’emballe. La guerre éclate au loin, Gordon a seize ans. Il ne traîne plus dans les musées. Il part pour l’Angleterre rejoindre son frère. En 1917, il s’enrôle dans le corps expéditionnaire américain en France. D’abord dans l’infanterie, puis comme opérateur radio.
Après 1918, une fois la paix retrouvée, la notice passe des faits d’armes au curriculum : Columbia School of Journalism, London School of Economics, professeur d’anglais à Columbia, reporter pour le New Haven Register, chroniqueur économique pour le New York Herald Tribune, à peu près quarante ans avant que Jean Seberg ne vende ce même journal sur les Champs-Élysées dans À bout de souffle.
L’ennui, c’est que ça ne nous dit pas s’il préfère l’automne à Londres ou à New York. S’il est le premier de sa famille à avoir autant voyagé. Si, une fois de retour, il regrette l’Europe, comme Rimbaud. Ça ne nous apprend rien de la guerre qu’il a vue, si elle le précipite dans l’âge adulte, s’il a vu Verdun ou Craonne, s’il en tremble encore. C’est le problème avec les notices biographiques : ça ne raconte pas grand-chose. Celle de Wasson nous renseigne au moins sur l’enfant rêveur qu’il a cessé d’être ou bien qu’il a fait taire pour un temps. »
Extraits
« Ils en font même le trait d’union de leur histoire commune, puisqu’à partir de 1927 ils commencent à lire frénétiquement tous les ouvrages qui traitent des champignons dans les cultures anciennes et modernes. Ils se passionnent pour la façon dont on les nomme et les consomme ici et là, dont on en fait des êtres supérieurs ou bien des monstres. Partout dans le pays, et même ailleurs, les Wasson vont écumer les bibliothèques des musées, des collections ethnographiques, des instituts de botanique. Leurs carnets se remplissent de croquis, de cartes, d’idéogrammes, de noms surnaturels, Lycoperdon furfuraceum, Marasmius oreades, satyre élégant, fairy circles. Toute une vie de recherche s’ouvre pour les Wasson, bien que ce qui les séparait va maintenant les lier résolument. Au passage, ils s’inventent un titre pour leur passion bizarre : ils seront ethnomycologues. » p. 29
« à Huautla, les champignons t’emportent donde está Dios, là où se tient Dieu. » p. 89
« Cela s’appelle «Seeking the magic mushroom», et s’ouvre sur une photo pleine page de María Sabina tenant un champignon dans la fumée bleutée du copal. Puis vient un long texte où Wasson explique ses premières recherches, revient sur les rites ancestraux autour des champignons en Amérique Centrale, raconte sa découverte des pierres-champignons et ses voyages à Huautla, sa rencontre avec la chamane, ses visions sous psychotropes. Le tout agrémenté de nombreuses images : portraits des époux Wasson au travail, maisons du village, étapes de la cérémonie – María Sabina distribuant les paires, María Sabina en prière après les avoir mangées, deux enfants en transe – et plusieurs aquarelles représentant les différents spécimens hallucinogènes trouvés dans la région. » p. 111
À propos de l’auteur
 Benoît Coquil © Photo Michel Coquil
Benoît Coquil © Photo Michel Coquil
Benoît Coquil enseigne la littérature et la civilisation d’Amérique latine. Petites choses est son premier roman. (Source: Éditions Rivages)
Tags
#petiteschoses #BenoitCoquil #editionsrivages #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #68premieresfois #roman #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #primoroman #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

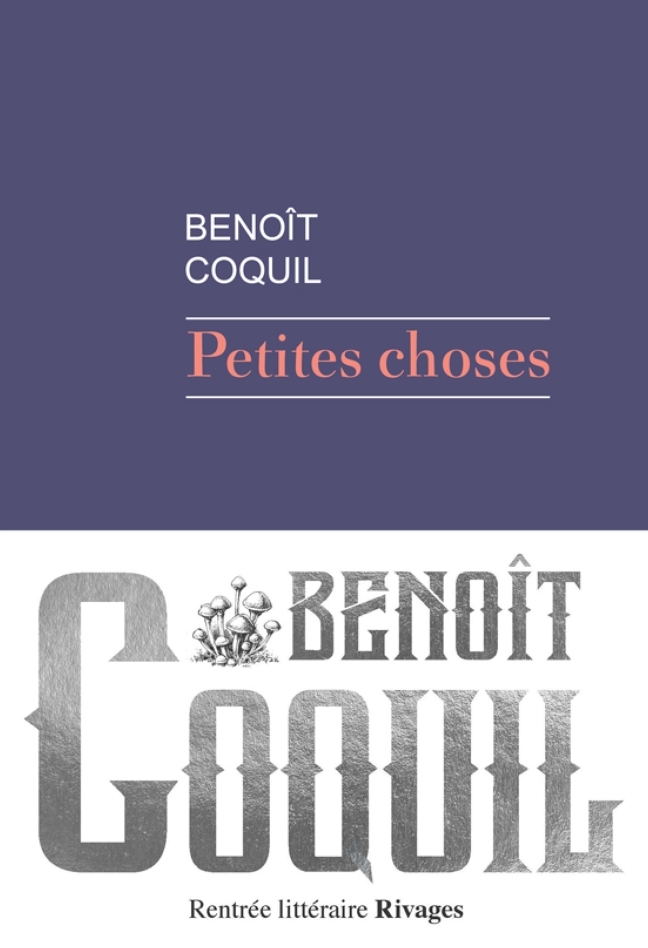




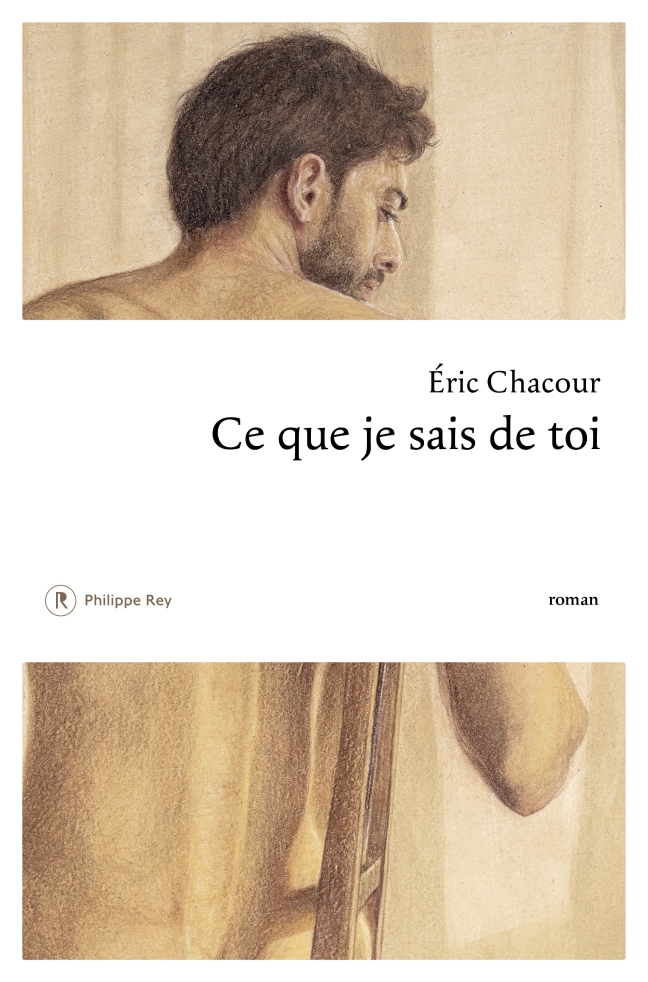

 Éric Chacour © Photo Justine Latour
Éric Chacour © Photo Justine Latour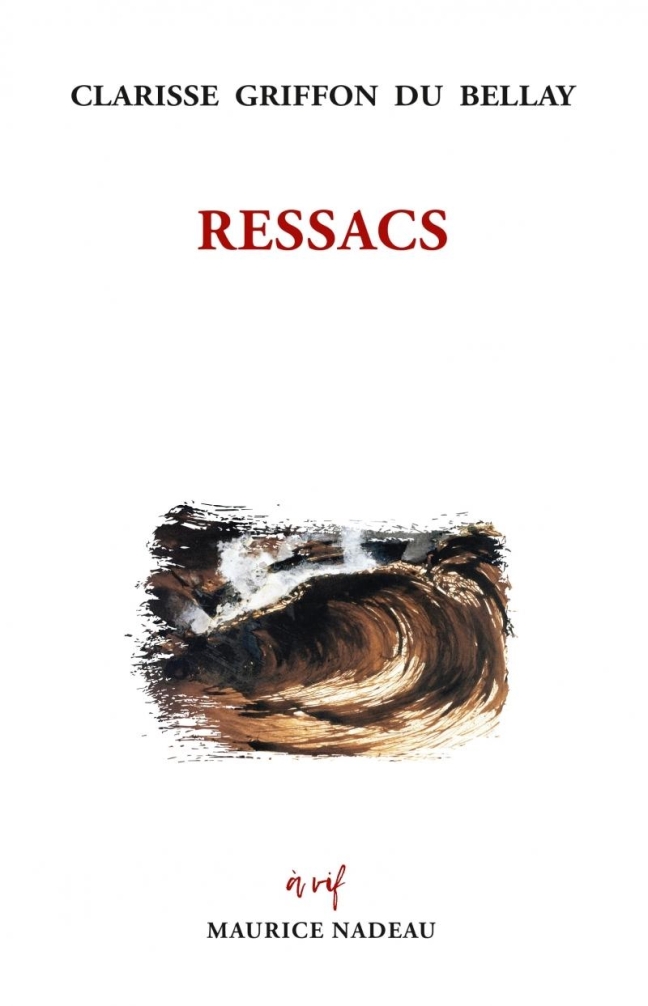


 Clarisse Griffon du Bellay ©Radio France Charlotte Perry
Clarisse Griffon du Bellay ©Radio France Charlotte Perry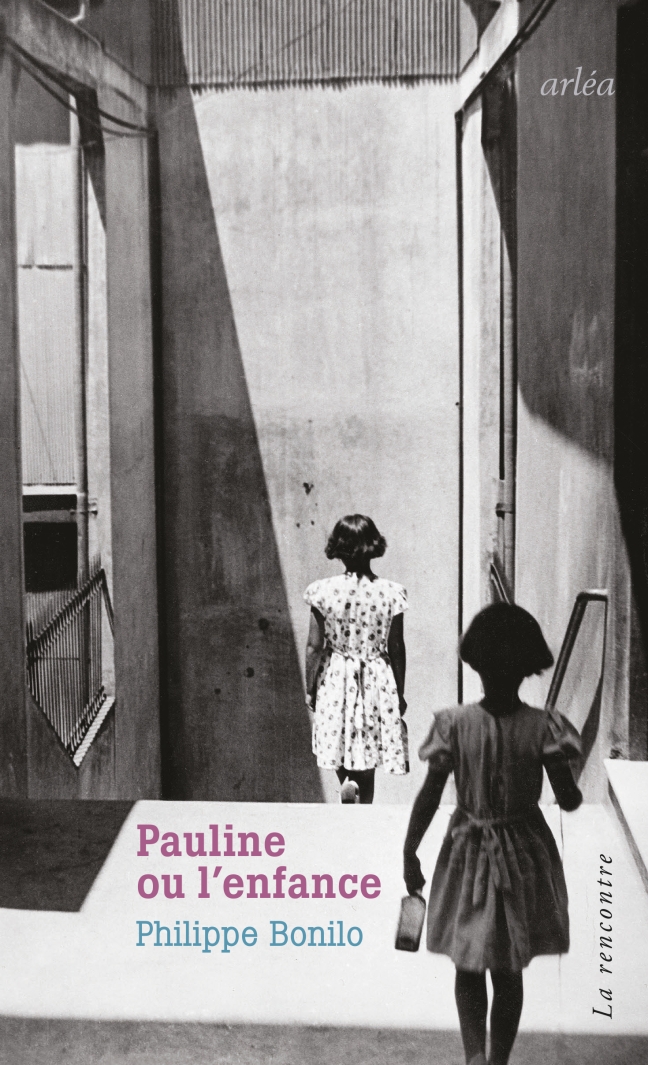

 Philippe Bonilo © Photo DR
Philippe Bonilo © Photo DR


 Charlotte Monsarrat © Photo DR
Charlotte Monsarrat © Photo DR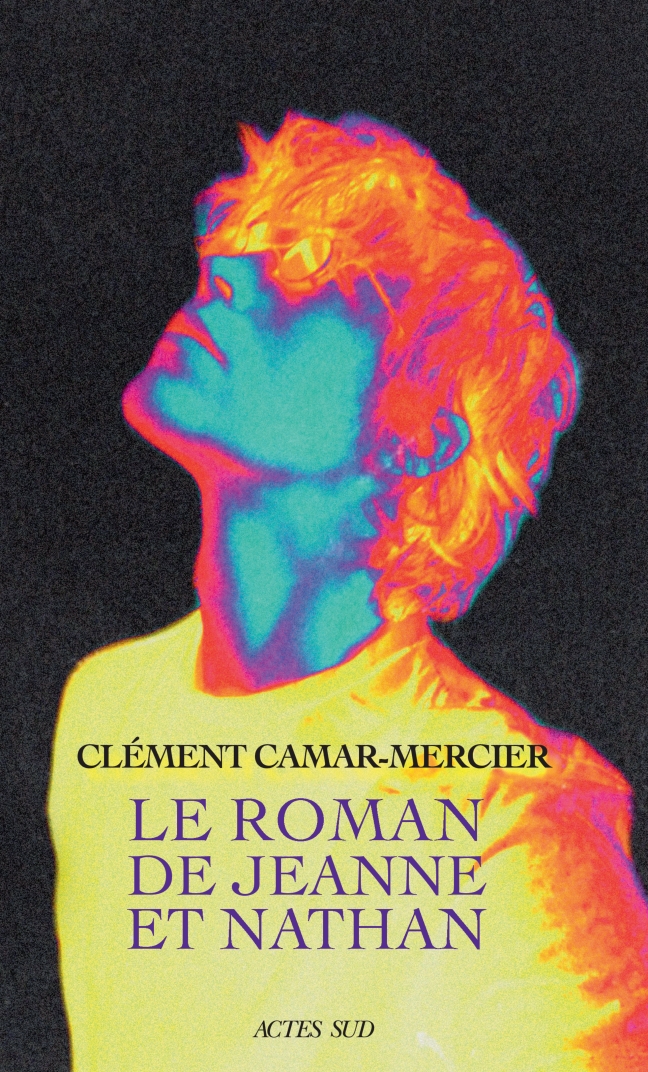





 Amaury Barthet © Photo François Bouchon
Amaury Barthet © Photo François Bouchon





 Tiphaine Auzière © Photo DR
Tiphaine Auzière © Photo DR

