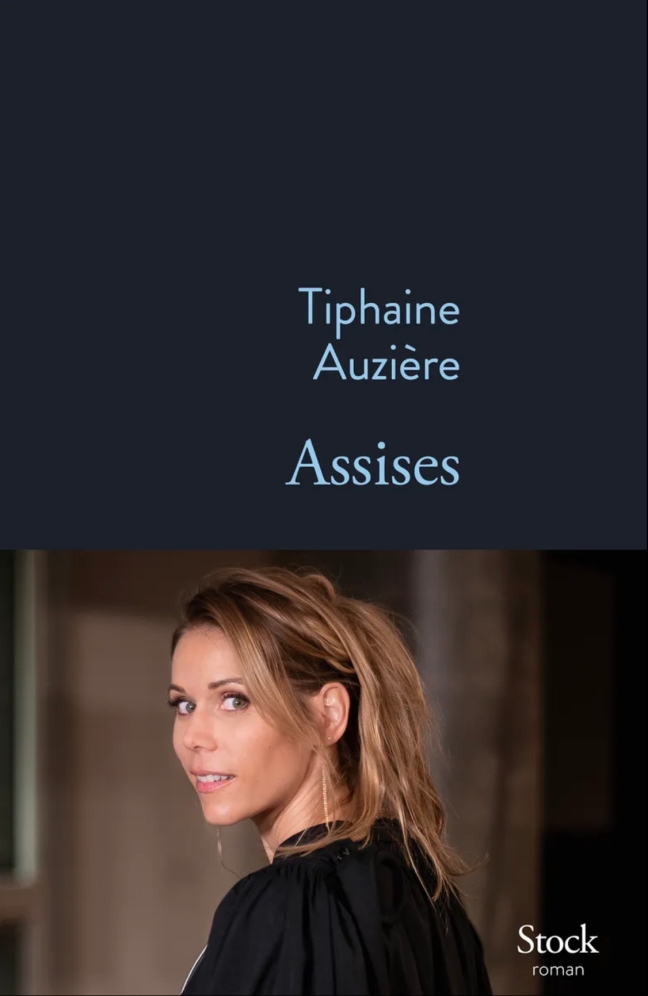
En deux mots
Diane Delaurel, avocate installée à Montreuil-sur-mer, s’est emparée du dossier de Jeanne, une enfant victime d’inceste, de Laura qui n’a plus supporté les violences conjugales et a fini par tuer son bourreau. On va la suivre jusqu’au verdict, cherchant la meilleure stratégie, essayant de ne pas se laisser envahir par les émotions, y compris dans sa vie privée.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
L’avocate, sa cliente et la cour d’assises
Tiphaine Auzière est avocate. Aussi a-t-elle choisi pour son premier roman de nous entraîner dans les pas d’une consœur fictive, en charge de délicats dossiers d’affaires familiales. Une plongée réussie dans un milieu que chacun croit connaître, souvent à tort.
«On ne sort jamais indemne d’une cour d’assises, qu’on y soit victime, accusé ou auxiliaire de justice». En choisissant de retracer les affaires dont Diane, avocate installée à Montreuil-sur-Mer sur la Côte d’Opale, Tiphaine Auzière nous démontre route la justesse de cette affirmation. Quand nous faisons sa connaissance, elle se rend au tribunal de Boulogne-sur-Mer pour y retrouver Jeanne, une fillette victime d’inceste. Il lui faut user de beaucoup de pédagogie, d’humour et d’empathie pour pouvoir entendre l’histoire de cette enfant. Un premier dossier qu’elle mènera à bien et qui assoit sa réputation d’avocate aussi ambitieuse que tenace.
Et de la ténacité, il va lui en falloir pour défendre Laura, qui se retrouve derrière les barreaux pour avoir assassiné son conjoint. Un coup de couteau porté au cou qu’elle ne nie pas et des aveux qu’elle accompagne d’un mutisme qui ne va pas faciliter la tâche de celle qui entend la défendre. Tout au long de l’instruction qui nous est ici détaillée jusqu’au verdict final, Diane va user de toute son expérience, de sa connaissance des méandres de la justice et des secrets de la procédure pour réussir à atténuer la peine encourue par sa cliente.
Pour cela, elle va même devoir user de son charme qui n’a pas échappé au procureur et avec lequel elle va jouer une danse très troublante.
Au fil des entretiens au parloir avec Laura, elle va chercher à gagner la confiance de la prévenue, à l’amener à lui ouvrir d’autres perspectives qu’une vie derrière les barreaux, en bref à se défendre après avoir subi pendant des années des violences conjugales.
Bien entendu, il n’est pas question ici de dévoiler l’issue du procès, par ailleurs très bien raconté, mais bien de souligner qu’effectivement il va changer la vie de tous ceux qui l’ont vécu. L’avocate et sa cliente, mais aussi les magistrats et les jurés, autres rouages essentiels de cette justice qu’on aimerait toujours juste.
Avec beaucoup de finesse et de sensibilité, Tiphaine Auzière nous fait partager les doutes et les interrogations des uns et des autres, rendant toute son humanité à une institution à laquelle il arrive d’en manquer cruellement. Mais pour la fille de Brigitte Macron, il n’est pas question d’écrire un réquisitoire soulignant les failles de l’institution, mais bien davantage de faire preuve de pédagogie et de nous faire découvrir le fonctionnement d’un tribunal. Exercice parfaitement réussi pour l’avocate qui peut désormais se targuer d’avoir rejoint les autrices qui l’ont inspirée comme Delphine de Vigan avec Les Loyautés et Karine Tuil avec Les Choses humaines. Un duo auquel j’associerai également une autre primo-romancière, Claire Jéhanno avec La Jurée. Car j’ai perçu là aussi, derrière le besoin de partager une expérience et un univers, l’envie – sinon le besoin – d’écrire. Un second roman viendra sans doute étayer cette hypothèse, du moins je l’espère.
Assises
Tiphaine Auzière
Éditions Stock
Premier roman
220 p., 20,90 €
EAN 9782234096875
Paru le 06/03/2024
Où?
Le roman est situé principalement dans les Hauts-de-France, principalement sur la Côte d’Opale.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Un soir ordinaire de violences conjugales, quand la victime consentante dit non, et ôte la vie de son compagnon et persécuteur.
À la croisée des chemins et des tribunaux, autour de Diane, avocate, se nouent et se dénouent les destins. Laura accusée du meurtre de son conjoint, la petite Jeanne victime d’inceste, qui va tenter de se reconstruire. Comment certains ont pu se retrouver là? Que vont-ils devenir? On les découvre, on s’y attache, on vit avec eux le temps d’un procès. Tantôt du côté des victimes, tantôt de celui des coupables; mais la frontière est-elle si évidente? Entre la droiture de la justice et l’ambivalence des êtres, les individus évoluent sur des lignes de crêtes mouvantes.
Dans son premier roman, Tiphaine Auzière nous plonge au cœur de la justice, elle décompose le mécanisme des assises, on écoute le ressac des vies brisées, on entre dans les considérations parfois contradictoires de la plaidoirie, finalement on se questionne sur sa propre posture; qu’aurions-nous fait à leur place?
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Madame Figaro (Minh Tran Huy)
Diverto (Pauline Laforgue)
Affiches Parisiennes (Boris Stoykov)
Blog Les chroniques de Koryfée (Karine Fléjo)
Tiphaine Auzière présente son roman «Assises» au micro de Léa Salamé © Production France Inter
Les premières pages du livre
« Chapitre 1
Jeanne patientait sur une chaise, ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle semblait si petite dans ce couloir interminable. Tout était sombre, sauf elle. Elle avait mis une robe en jean, des baskets neuves et un nœud rouge pour attacher sa queue-de-cheval blonde. Elle paraissait prête et déterminée au milieu de ce dédale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Un enchevêtrement de chemins, de recoins, dans lesquels se côtoient victimes, coupables et auxiliaires de justice. La lumière y est artificielle, l’angoisse réelle et le brouhaha permanent. On y court, on y attend, on craint autant que l’on espère. Même si parfois l’air est difficilement respirable. Une cohabitation bruyante, surprenante, normée, où chacun a sa place, son rôle, son temps d’audience.
Ce jour-là, dans le couloir de l’instruction, devant le cabinet 2, on pouvait apercevoir une succession de chaises vides puis cette petite fille aux yeux marron qui serrait son doudou contre son cœur. Elle emplissait tout l’espace par sa présence. Jeanne était ce paradoxe de la jeunesse et de la maturité. Face à elle, Sandra, sa maman, s’agitait, tournait en rond, froissant nerveusement la convocation qu’elle tenait dans sa main. Ce 1er septembre 2016, c’était le jour de leur audition devant M. Deiss, juge d’instruction en charge du pôle des mineurs.
Jeanne avait tenu à prendre son cartable, elle voulait se rendre à l’école dès sa sortie du tribunal. Elle aurait préféré faire sa rentrée comme tout le monde, à 9 heures, avec ses amies et le mot d’accueil du directeur. D’autant que c’était sa dernière année en primaire. Mais depuis un an, la vie de Jeanne n’était plus tout à fait normale.
C’est de cela qu’elle devait parler ce matin alors qu’elle aurait aimé se taire. La petite fille joyeuse et bavarde aurait souhaité qu’on arrête de la questionner. Ou alors qu’on l’interroge sur son chien, ses copines, les menus de la cantine, mais pas sur ça. Ça, comme elle l’appelait, c’était le viol qu’elle avait subi par son beau-père quand elle avait huit ans.
« Maman, quand est-ce qu’elle arrive ? On en a pour longtemps ?
– On parle de moi ? Je te manquais déjà, Jeanne ? rétorqua une jeune femme souriante.
– Si vous saviez, elle n’arrête pas de vous réclamer depuis ce matin, maître Delaurel. Elle est très énervée parce que c’est la rentrée.
– Ah oui, j’avais oublié ! »
Diane Delaurel sortit de sa sacoche en cuir sa robe d’avocat.
« Comme d’habitude, à toi puis à moi ? »
Jeanne sauta de sa chaise avec un hochement de tête satisfait. Elle enfila la robe, fit quelques pas dans le couloir, puis défia sa mère et Diane en tendant un bras vers elles.
« C’est moi, maître Jeanne.
– Alors dites-moi, maître, vous avez une stratégie pour notre rencontre de ce matin avec M. Deiss ? lui demanda Diane.
– Garder le silence. »
Tout était dit. Jeanne était toujours ainsi, déconcertante de vérité.
« J’entends, maître, mais permettez-moi de vous proposer autre chose. Pour cela, accepteriez-vous de vous approcher ? »
Intriguée, Jeanne s’avança vers son avocate qui lui tendit un petit paquet dont elle s’empressa de déchirer le papier cadeau. Elle découvrit un carnet de notes, une trousse et un joli stylo plume gravé à ses initiales.
« Ouah, vous n’aviez pas oublié du tout !
– Que c’est la rentrée. Que j’accompagne la petite fille la plus incroyable que je connaisse et qu’elle mérite bien un cadeau pour cette nouvelle année scolaire ? Ou que tu dois me rendre ma robe ? Non, je n’ai pas oublié. »
Jeanne fit un dernier pas de danse avant de rendre à Diane son armure.
« Ce stylo et ce carnet, c’est pour te permettre d’écrire et dessiner ce que tu veux et de me le montrer ou non. Notre aventure continue, avec cette audition et, dans quelques mois, le procès aux assises. Sans doute auras-tu des questions, de la colère, de la tristesse, ou peut-être voudras-tu juste faire une BD de toi et moi ?
– Ça me plairait bien, ça, mais je vais réfléchir.
– En attendant, ce matin, j’ai besoin de toi maître Jeanne pour m’assister. Il faut que tu répondes une dernière fois à M. Deiss pour qu’il puisse terminer son rapport afin d’aider les juges aux assises. En es-tu d’accord ?
– Je vais essayer. »
M. Deiss, qui avait suivi la scène à l’autre bout du couloir, s’était bien gardé de se montrer ou d’intervenir. Cet homme de loi, proche de la retraite, à la patience infinie et l’écoute attentive, connaissait la difficulté de l’exercice qui attendait la petite. Comment faire parler un enfant de choses dont il devrait tout ignorer à son âge ?
Cet ancien policier, devenu magistrat sur le tard, avait voué sa vie aux mineurs. Il s’était formé auprès de psychologues, se remettait sans cesse en question, se réinventant à chaque affaire pour être en capacité de rendre des instructions cohérentes et objectives pour ses pairs, dans le respect des jeunes victimes.
Il faut dire qu’il œuvrait dans un tribunal hanté par le fantôme de l’affaire Outreau. Ce procès, qui avait eu lieu douze ans plus tôt, mettait en cause dix-sept adultes pour des faits de viols, de corruption de mineurs ou encore de proxénétisme sur douze enfants. Des habitants de Boulogne et des environs dont le bruit des pas retentissait encore dans le couloir de l’instruction. Tout le monde gardait à l’esprit la décision de la cour d’appel de Paris de novembre 2005 qui avait fini par innocenter treize des mis en cause au motif notamment d’une dénonciation mensongère de certains enfants souffrant d’un syndrome d’aliénation parentale. Face à cette débâcle judiciaire, le garde des Sceaux de l’époque, Pascal Clément, ainsi que le président Jacques Chirac avaient même présenté leurs excuses au nom de l’institution judiciaire. Des excuses à qui ? Et pourquoi ? Aux adultes, évidemment, pour avoir été privés injustement de leur liberté. Ceux dont la réputation et la vie sociale avaient été définitivement ruinées sur l’autel médiatique.
Quid des enfants ? Hélas, pas un mot sur ces victimes collatérales du rouleau compresseur de la justice. Ces enfants violés, à la fois victimes et coupables d’un système qui n’avait su ni les entendre ni les protéger.
L’erreur judiciaire avait mis en lumière deux dysfonctionnements majeurs que le tribunal de Boulogne s’efforçait d’oublier et de corriger. D’une part, l’isolement du jeune magistrat, chargé d’enquêter seul sur une importante affaire de pédophilie. Il lui avait été reproché d’avoir instruit contre les accusés et non à charge et à décharge, comme le lui imposait la loi, pour connaître la vérité. À cela, il fallait remédier par la collégialité en assurant aux magistrats instructeurs la possibilité de traiter à plusieurs ce type de dossiers pour permettre à chacun de partager ses doutes, remettre les autres en question, éviter l’erreur. Et surtout repenser la manière dont on recueille la parole des enfants. Des mots qui défilent parfois sous la contrainte, les conflits de loyauté, ou qui reprennent la parole d’un adulte ayant autorité. Comment faire parler et entendre un enfant ?
Avec les années, le juge Deiss n’avait acquis aucune certitude. Il vivait de ses doutes, qui le rendaient humain, sensible et assurément juste. Tous regrettaient son départ prochain à la retraite. Ainsi, dans ce couloir du tribunal de Boulogne-sur-Mer, il était ému par la scène qu’il venait de voir entre Jeanne et son avocate. Cette complicité de cour, ces instants volés et des rires qui, même entre ces murs, pouvaient résonner.
« Bonjour, Jeanne, madame, maître Delaurel. J’ai cru comprendre que j’aurais affaire à deux avocates ce matin, j’ai intérêt à bien me tenir. »
Ils entrèrent dans son bureau.
« Jeanne, tu connais mon poisson presque rouge, Maurice ?
– Oui. Je peux lui donner à manger, comme la dernière fois ?
– OK, et après on commence, ça te va ? »
Jeanne s’approcha du poisson et versa quelques granulés dans l’eau.
« Regardez, maître, il est comme moi, il ne tourne pas tout à fait rond dans son bocal. »
Jeanne retourna s’asseoir en prenant au passage la poupée qui était sur l’étagère. Après quatre auditions, elle savait ce qui l’attendait. La figurine était le témoin de son effraction corporelle. D’abord la déshabiller puis la caresser, la toucher, au niveau des cuisses, de la poitrine, en terminant par les fesses et le sexe. Son beau-père suivait toujours le même rituel dès que sa mère était absente. Jeanne mimait les gestes presque mécaniquement. Sa mémoire corporelle était intacte tandis que son cerveau semblait ailleurs. Il n’y avait plus qu’en ce lieu qu’elle jouait à la poupée. À la maison, elle les avait toutes jetées.
Son avocate la regardait avec admiration autant qu’avec compassion. Elle percevait en elle une résilience et une force dont bien des adultes ne pouvaient se targuer. Une fois l’exercice terminé, les yeux de Jeanne se rallumaient.
« C’est bon, j’ai tout bien fait ? On peut y aller ? »
Jeanne souffrait du « syndrome du premier de la classe ». En présence du juge, ou de son beau-père, elle cherchait toujours à être la meilleure, à faire plaisir aux autres.
« Jeanne, tu sais ici il n’y a pas de notes. Et moi, ce qui me rend heureux, c’est déjà ta présence et que tu acceptes de répondre à mes questions. Tes réponses t’appartiennent et, pour ton âge, tu fais déjà sacrément entendre ta voix. Alors, ce qui compte, c’est ta vérité. Pas celle que l’on a pu te demander de raconter. Pas celle que tu aurais envie de dire pour épargner ta maman, ton beau-père ou le reste de ta famille. Celle que tu ressens, qui est juste, pour nous permettre de faire notre travail. »
Jeanne poussa un léger soupir de soulagement et regarda son avocate.
« De toute façon, je ne connais qu’une seule histoire, la mienne. »
Cette phrase sonna la fin de l’audition et la clôture prochaine de l’instruction.
« Jeanne, si on allait manger un welsh pour fêter ça ? À moins bien sûr que tu préfères aller à la cantine, lui lança Diane.
– Ah oui ! Hein, maman, je peux ? »
Sandra hocha la tête en guise d’assentiment. Si, au départ, il lui avait été difficile d’accepter le lien qui s’était créé entre Diane et sa fille, elle avait compris qu’il était nécessaire pour Jeanne de pouvoir refaire confiance à d’autres adultes et de pouvoir s’exprimer devant une personne extérieure à la famille. Unique moyen pour Jeanne de parler sans la crainte de déplaire ou de faire souffrir. Aussi, elle s’amusa de voir sa fille partir au restaurant comme si rien ne s’était passé.
« Promis, je vous la ramène à temps pour l’école cette après-midi. Faut bien qu’elle bosse, cette petite, si un jour elle veut reprendre mon cabinet. »
Chapitre 2
La calculette mentale de Diane fonctionnait à plein régime. Plus que trois jours, une garde à vue, une plaidoirie et une visite en centre pénitentiaire pour clore cette année. Quelle ironie que d’être enfermée pour les derniers jours de décembre ! Ultime manière de retenir encore les jours tranquilles de 2016, comme si 2017 devait s’annoncer tumultueuse. C’était son truc, à Diane, de compter – les jours, les tâches à réaliser, les bougies sur les gâteaux –, lui donnant l’illusion de la maîtrise du temps. Elle s’appliquait d’ailleurs à l’organiser méticuleusement – pour les autres, évidemment.
Diane s’était toujours sentie légitime à le faire puisqu’elle anticipait et faisait siens les désirs des autres. Pas un délire de toute-puissance, plutôt un don qu’elle s’était évertuée à développer. En effet, elle avait vite compris qu’en devançant les besoins des autres, en s’attelant à les combler, elle pouvait tout obtenir. Offrez de la réussite scolaire, et vous aurez le respect de vos parents. Offrez de la franche camaraderie, et vous aurez des amis. Offrez de l’écoute, de l’admiration, du sexe, et vous aurez un homme. C’était devenu son mantra : contenter les autres pour se réaliser. Ce faisant, elle avait obtenu tout ce qu’elle voulait. Pas de redoublement, pas de détour, de la réussite dans le travail comme en amour. À commencer par une trajectoire professionnelle ascendante. Diane pouvait se targuer d’avoir créé son cabinet d’avocats, là où beaucoup de ses camarades avaient choisi la collaboration dans des cabinets dont la réputation n’était plus à faire. Elle avait pris ce risque en décidant de s’installer sur la place de Montreuil-sur-Mer. Une jolie ville des Hauts-de-France dans laquelle Diane se sentait heureuse. Elle y trouvait le confort d’une ville bourgeoise de province, protégée par ses remparts, avec une perspective sans limites sur la campagne et l’horizon.
Diane incarnait les contrastes de cette terre qu’elle avait arpentée enfant avec ses grands-parents, de riches industriels du Nord qui avaient fait fortune dans le textile. À chaque période de vacances, ils se rendaient en villégiature au Touquet en emmenant avec eux la petite Diane, son père étant trop occupé par son travail, et sa mère à l’attendre.
Faute d’avoir hérité de l’affaire familiale dont la transmission se faisait uniquement de père en fils, la mère de Diane avait opté pour un bon mariage. Celui qui la mettrait à l’abri du besoin et lui permettrait d’avoir des enfants, comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Avec l’âge, ses critères avaient évolué. Elle avait oublié un point : l’amour ! Celui que son mari accordait à d’autres et qui lui manquait cruellement. La dépression l’avait cueillie alors que Diane n’avait que neuf ans tandis que ses deux frères venaient de quitter la maison. Dès lors, avec sa mère, elle vivait les montagnes russes de la bipolarité. Elle la relevait lorsqu’elle sombrait, tentait de l’apaiser lorsqu’elle s’enflammait. Son père avait quitté le champ de bataille, achetant l’amour de Diane à coups de cadeaux faramineux. Assurément, elle ne manquait de rien, sauf d’un père.
Dans sa jeunesse, la Côte d’Opale avec ses grands-parents était devenue son échappatoire. Elle n’avait plus à porter le poids des angoisses de sa mère, à peser chacun de ses mots pour éviter de déclencher une crise aussi inattendue qu’inexpliquée. Loin de ses parents, elle n’était plus obligée de mentir pour sauver les apparences. Là, personne ne connaissait sa famille, elle n’avait donc plus besoin de la survendre. Le Touquet avait pour Diane la saveur de l’insouciance. Tout lui y paraissait plus doux – la caresse du sable fin sous ses pieds, l’enveloppante lumière de la fin de journée qui se reflétait sur les vagues. Elle était si heureuse lorsque sa grand-mère l’emmenait rue Saint-Jean pour acheter un jouet à La Boîte à joujoux et déguster une crêpe à la cassonade aux Mignardises. Diane aimait aussi accompagner son grand-père au marché le samedi matin. Ces étals colorés, cette ambiance où se mêlaient les familles et les vendeurs ambulants. Son préféré, c’était « Aster », comme elle l’avait surnommé. Un homme convivial qui haranguait la foule avec un slogan imparable : « Y a des affaires à faire à cette heure ! »
Au fil des années, Diane avait fait un refuge de la maison de ses grands-parents. Dessinée par l’architecte Louis Quételart, cette demeure au charme anglo-normand était typique des habitations touquettoises, avec de larges fenêtres donnant au sud, une grande hauteur sous plafond et un salon immense dans lequel Diane jouait avec Hutch, le labrador noir de la famille. Avec lui, elle explorait chaque parcelle du jardin et s’amusait à guetter le passage des chevaux qui se promenaient le long des allées cavalières bordant le terrain. Diane avait toujours été fascinée par ces animaux qui l’attiraient autant qu’ils l’effrayaient. Elle était sensible à leur beauté, la grâce de leurs mouvements, la vivacité de leur instinct et l’imprévisibilité de leur comportement. Elle aurait tant aimé ressentir la liberté du cavalier qui galope sans destination. Ses parents lui avaient formellement interdit de monter à cheval, de crainte qu’elle ne se blesse. Alors, Diane se contentait de les regarder avant de regagner la maison. Elle adorait jouer au Uno avec ses grands-parents devant la large cheminée du salon qui la réchauffait après les journées denses et fraîches qu’elle passait au club de plage Caddy Sports. Là-bas, elle nourrissait des amitiés estivales faites de bonheurs simples et de soucis passagers. Le temps des vacances était pour elle celui de l’enfance.
C’est à cette époque-là que Diane avait tissé un lien fusionnel avec la plage du Touquet. Son relief était à l’image de son être, pluriel et changeant, ses dunes comme autant de petites collines de sable qu’elle s’évertuait à gravir toujours plus haut – hauteur dont elle avait besoin pour s’apaiser en contemplant le paysage. Elle aimait le jeu entre les marées et le sable, cet éternel recommencement où la mer recouvrait en quelques heures ce qu’elle venait de découvrir. Diane préférait la marée basse, sa plage immense et la confusion qu’elle entraînait pour le regard du promeneur, quand la mer et l’horizon semblaient ne faire qu’un, une ligne lointaine et continue où rien ne s’arrête et tout commence. Sur cette plage sans limites, Diane ne s’en fixait aucune. Chaque parcelle de sable conquise, chaque nouveau sommet franchi était autant de victoires pour cette petite fille qui n’aspirait qu’à la liberté des grands espaces. Un jour, elle cesserait de subir le choix des autres et déciderait par elle-même de sa vie.
Aussi, ce fut pour elle une évidence de s’établir sur cette terre d’Opale dans laquelle elle avait puisé sa force. Lorsqu’elle vissa la plaque de son cabinet d’avocats devant ses amis et ses frères, elle esquissa un sourire et pointa les remparts en déclarant :
« Pourvu que je ne finisse pas en ruine ! »
Connaissant l’ironie de Diane, tous n’y avaient vu qu’une facétie. Pourtant elle avait beau lutter, elle sentait parfois la fragilité de son édifice. Et puis, elle repensait à cette tirade de Roméo à qui l’on annonce qu’il est banni de Vérone : « Ah ! le bannissement ! Par pitié, dis la mort ! L’exil a l’aspect plus terrible, bien plus terrible que la mort. […] Hors des murs de Vérone, le monde n’existe pas […]. Être banni d’ici, c’est être banni du monde […]. »
C’était bien là ce que pensaient ses anciens camarades des grandes écoles parisiennes. Pour eux, le Nord, c’était la mort professionnelle. Comment avait-elle pu faire ce choix, d’autant qu’elle avait reçu de multiples offres de la part de prestigieux cabinets de la capitale ? C’était le chemin tout tracé, la collaboration dans une grande et belle enseigne pour cinq ans avant d’envisager de devenir associée d’un cabinet dont la carte de visite faisait rêver le Tout-Paris. Certains accusaient Diane de fuir son destin ; c’était pour elle un retour aux sources. Elle refusait d’être comme ses jeunes confrères qui grattent du papier pour leurs associés sans jamais rencontrer un client avant d’avoir quarante ans. Diane avait choisi cette profession pour côtoyer des gens, non des conclusions. Elle avait envie d’échanger, de ressentir, de s’investir aux côtés de personnes de chair et d’os, pas de cas A ou B qu’on lui soumettrait sur papier. Alors, qu’importent les avis, elle s’était bannie en province et promis de réussir, même si ça devait prendre plus de temps. Elle n’avait pas pour habitude de choisir, encore moins de renoncer, elle voulait tout et elle y était parvenue.
À trente-six ans, elle s’était hissée au classement Choiseul Hauts-de-France des leaders économiques de demain avec pour objectif de devenir la pénaliste incontournable en France pour ses quarante ans.
Dans sa vie privée, Diane n’avait également laissé aucune place au hasard. La jolie brune aux yeux verts avait eu l’embarras du choix. Pourtant, elle ne s’était jamais égarée en chemin, usant avec parcimonie de sa beauté, dont elle ne mesurait pas la portée. Elle était allée droit au but en rencontrant au lycée celui qui deviendrait quelques années plus tard son mari, Georges. Un jeune homme de bonne famille au charme simple qui avait rapidement suscité son intérêt. Il était doux et attentionné. À l’âge des beaux parleurs, Georges était un garçon timide et honnête en qui elle pouvait avoir confiance. Il lui était à la fois familier et prévisible, lui apportant la sérénité dont elle avait toujours manqué. Ne restait plus à Diane qu’à dérouler son plan de vie : le diplôme, le métier, le mari et la famille.
Loin des romans du XIXe siècle dont elle s’était abreuvée et des héroïnes qu’elle avait admirées, Diane avait écrit son conte de fées, s’évertuant à dissimuler ses élans romantiques pour ne pas sombrer comme Emma Bovary. Elle s’efforçait donc de se départir de sa sensibilité qui lui apparaissait comme une fragilité. Elle avait bâti autour d’elle et de ses émotions une forteresse qu’elle pensait imprenable. À l’abri des passions et de tout emportement, elle en avait fait son havre de paix – d’aucuns diraient sa cage dorée –, avec pour corollaire son lot d’envieux. Après tout, c’était énervant, les gens heureux ! En cette fin d’année-là, Diane elle-même semblait s’en agacer. Chaque nouvel an était pour elle un éternel recommencement, où il lui fallait tout questionner, comme si quelque chose lui avait jusqu’alors toujours échappé. Elle repensa à un article qu’elle avait lu la veille sur l’espérance de vie des femmes, 83,5 ans dans l’Union européenne. Une question la percuta : si elle avait déjà tout, n’avait-elle donc plus rien à se souhaiter pour les 46,5 années qu’il lui restait à tirer? »
Extrait
« On ne sort jamais indemne d’une cour d’assises, qu’on y soit victime, accusé ou auxiliaire de justice.» p. 159-160
À propos de l’autrice
 Tiphaine Auzière © Photo DR
Tiphaine Auzière © Photo DR
Tiphaine Auzière est née le 30 janvier 1984 à Amiens. Elle est la troisième enfant du couple formé par Brigitte Macron et André-Louis-Auzière, décédé en 2019. Elle grandit à Amiens et y passe la majeure partie de sa scolarité. Après l’obtention de son baccalauréat, elle déménage à Paris et entame dans un premier temps une prépa hypokhâgne, qu’elle arrête cependant au bout d’un mois. Elle intègre par la suite l’université Panthéon-Sorbonne et y suit des études de droit. Elle choisit alors une spécialisation en droit du travail, et finit par intégrer l’école de la formation du barreau de Paris en 2009. Durant un stage d’étude, elle exerce pendant plusieurs mois le rôle de défenseur syndical auprès de la CFDT. Elle prête serment en 2009 et exerce d’abord au barreau de Lille, puis au barreau de Boulogne-sur-Mer. Elle se spécialise à nouveau dans la défense des salariés et des syndicats. Mariée au gastro-entérologue Antoine Choteau, Tiphaine Auzière est également la maman de deux filles : Élise et Aurèle. Aujourd’hui inscrite au barreau de Paris, elle vit dans les Hauts-de-France. Assises est son premier roman. (Source Marie-Claire / Éditions Stock)
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte X (ex-Twitter) de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice
Tags
#assises #TiphaineAuziere #editionsstock #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #NetGalleyFrance #VendrediLecture #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #roman #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

















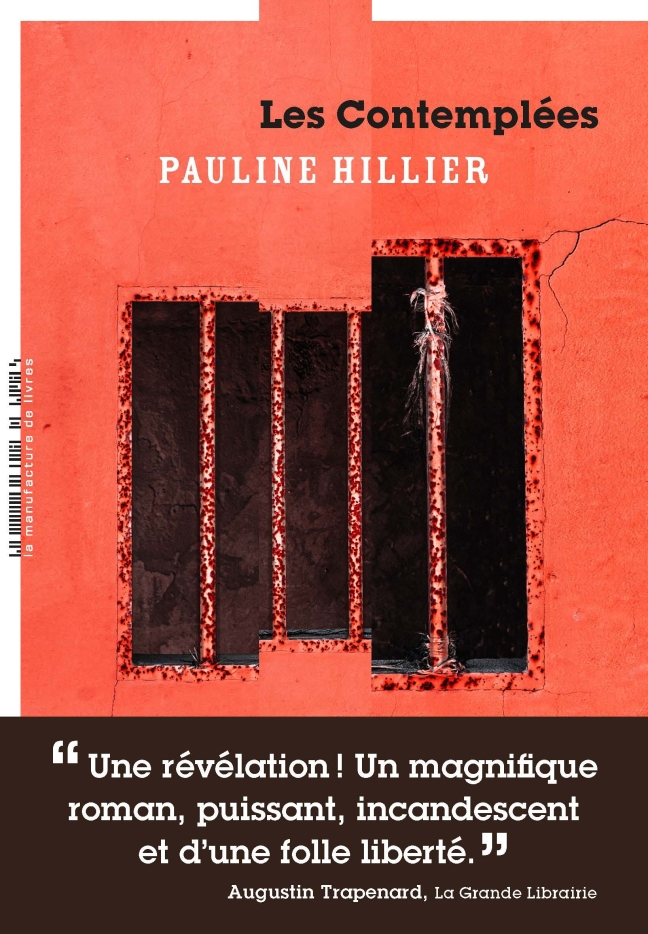


 Pauline Hillier © Photo Vincent Loison
Pauline Hillier © Photo Vincent Loison


 Sophie Wouters © Photo DR
Sophie Wouters © Photo DR


 Julia Minkowski © Photo Patrice Normand
Julia Minkowski © Photo Patrice Normand


 Philippe Besson © Photo DR
Philippe Besson © Photo DR


 Pascale Robert-Diard © Photo DR
Pascale Robert-Diard © Photo DR

 Polina Panassenko © Photo Patrice Normand
Polina Panassenko © Photo Patrice Normand