En deux mots
Paul Sorensen part à Montréal récupérer la dépouille de son père. Mais à son retour, il est arrêté pour avoir mutilé le cadavre. Ayant écopé d’une peine de prison avec sursis et soumis à des soins, il va raconter sa vie à son thérapeute.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Vengeance sur un corps déjà froid
En retraçant le parcours de Paul Sorensen, coupable d’avoir tiré sur un cadavre, Jean-Paul Dubois explore l’origine de l’identité, les liens tissés dès la naissance et dont on ne peut se défaire. Une confession mélancolique, une sombre comédie.
«Je me nomme Paul Sorensen. Pour des raisons que j’ignore, et que nul n’a jamais pu m’expliquer, j’ai été enregistré à l’état civil sous le nom de ma mère biologique, Marta Sorensen, morte à ma naissance, emportant avec elle mon frère jumeau, le 20 février 1980, à 21 h 30. Cette nuit-là, mon père est ailleurs. Il dîne, paraît-il, en ville. Il n’apprendra la mort de sa femme et celle de l’un de ses fils que le lendemain avant de confier la charge du survivant à un parent et de partir illico pour deux semaines de villégiature dans le sud de l’Italie. Cinquante et un ans plus tard, cet homme est décédé comme je suis né, seul, à l’hôpital de Montréal.»
Cet homme, qui est au cœur de cette sombre comédie, va prendre deux balles dans la tête. Un geste qui peut sembler n’avoir guère d’importance, car il était déjà mort depuis bien longtemps. Mais il lui fallait accomplir ce geste, cette vengeance post-mortem. Rapatrié à Toulouse, Paul doit s’expliquer devant les policiers et magistrats venus recueillir ses aveux.
On apprend alors qu’une jurisprudence existe pour de tels cas. Qu’il convient de différencier les actes exécutés sans savoir que la victime était morte et ceux qui sont commis sciemment sur des cadavres. Dans ce cas, la peine encourue est minorée. Paul pourra compter sur la mansuétude du juge et bénéficie du sursis, avec obligation de soins.
C’est alors que le Dr Guzman entre en scène. Le thérapeute prescrit douze séances, une par mois, pour faire la lumière sur cette affaire. Au fil des chapitres, il va tenter de cerner la personnalité de cet homme cerné par la mort, le vide, l’absence depuis son enfance. «Ce dont je suis certain, c’est que depuis ce 20 février, depuis ce premier jour, il y a un trou en moi. Je ne sais pas l’exprimer autrement. Il y a un trou au fond de moi. Creusé à mes mesures. Suffisamment profond pour m’accueillir. Il habite en moi.» Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son père ne fait rien pour le combler. Il efface toute trace de cette femme et la remplace très vite par une nouvelle épouse, Rebecca. Cette dernière va bien essayer de combler cette béance, mais elle va être à la fois emportée par le caractère de cochon de son homme, ses malversations qui vont le pousser à prendre la fuite sans prévenir et par une maladie héréditaire aussi rare que grave. Paul, qui a fini par retrouver l’adresse de son père réfugié à Montréal va alors lui téléphoner toutes les semaines. «Mais pour lui, sa femme était déjà morte. Quant à moi, je n’aurais pas dû naître.»
Après Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, Jean-Paul Dubois a choisi un registre un peu plus noir encore, proche de ses sujets et thèmes de prédilection, la famille, la mort, la transmission. L’occasion aussi pour le Toulousain de parcourir à nouveau la planète autour des lieux qu’il affectionne comme le Canada et la Suède. L’occasion aussi de rappeler à ses inconditionnels que Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l’ONU et Prix Nobel de la paix, qui va tenir dans ce roman un rôle étonnant, était l’objet de sa dernière nouvelle publiée en 2022 dans le recueil collectif 13 à table! Et sobrement intitulée Dag Hammarskjöld.
Si l’humour se fait ici plus sous-jacent, il demeure aussi l’une des marques de fabrique d’un auteur rare qui, à l’image de son personnage, n’aspire qu’à un bonheur simple, selon sa formule «devenus ce que nous pouvions, étant ce que nous étions». Encore une belle réussite pour celui qui déclarait avant l’obtention de son Prix Goncourt à l’OBS où il a longtemps travaillé, «je réclame le droit à la paresse, au bonheur et à la dépression».
L’origine des larmes
Jean-Paul Dubois
Éditions de l’Olivier
Roman
256 p., 21 €
EAN 9782823620795
Paru le 15/03/2024
Où?
Le roman est situé principalement en France, à Toulouse, à Montréal puis en Suède, à Uppsala et au Pays basque, à Hendaye et environs.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Paul a commis l’irréparable: il a tué son père. Seulement voilà: quand il s’est décidé à passer à l’acte, Thomas Lanski était déjà mort… de mort naturelle. Il ne faudra rien de moins qu’une obligation de soins pendant un an pour démêler les circonstances qui ont conduit Paul à ce parricide dont il n’est pas vraiment l’auteur.
L’Origine des larmes est le récit que Paul confie à son psychiatre: l’histoire d’un homme blessé, qui voue une haine obsessionnelle à son géniteur coupable à ses yeux d’avoir fait souffrir sa femme et son fils tout au long de leur vie. L’apprentissage de la vengeance, en quelque sorte.
Mélange d’humour et de mélancolie, ce roman peut se lire comme une comédie noire ou un drame burlesque. Ou les deux à la fois.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Les premières pages du livre
« Scrotum et Stramentum
Il pleut tellement. Et depuis tant de temps. Des averses irréversibles qui semblent surgir de partout, la nuit comme le jour. Parfois une accalmie laisse entrevoir une parcelle du ciel d’autrefois, bleu lavé, mais très vite assombri par de sombres vagues de nimbocumulus. Cela fait deux années que le temps s’est graduellement détrempé, transformant cette ville de briques sèches en une vallée lessivée par un régime de pluies. Tantôt ce sont de brusques et violentes tempêtes qui décoiffent les toits, tantôt de longues et patientes averses épuisent les arbres et font enfler les fleuves. La punition des eaux épure les rues, accable les charpentes et habite nos vies.
Je suis à la maison, devant la fenêtre de mon bureau, et je regarde les bourrasques qui bousculent les arbres. Cela fait des années que je n’ai pas ressenti autant de calme au fond de moi. Je sais que ces instants sont précieux car ils ne reviendront pas avant longtemps. Après ce que j’ai fait, et cela me surprend à peine, je n’éprouve pas de regret ni d’angoisse. En dépit du déluge, je suis apaisé, comme un homme fatigué qui a fini sa journée. Je sais que l’on va bientôt venir me chercher et m’interroger. Je suis là, prêt à dire ce qui doit l’être. Je ne redoute rien de ce qui vient. J’attends et je profite humblement de cette pluie robuste et têtue qui détrempe nos vies.
Oui, je regarde et j’attends. Je n’ai plus que cela à faire. Je regarde le ciel de cette aube vagissante, je pense à cette maison qui sait tout, à ces murs qui ont tout vu, à toutes ces choses familières qui m’entourent et qui ont tout entendu durant tant d’années. Mais elles ne me seront d’aucun secours. Elles ne diront rien, ne témoigneront pas. Elles demeureront à leur place, me laissant le soin de faire face à ces heures et ces jours et ces nuits qui m’attendent. À ces questions inutiles, ces interrogations déplacées. Se défendre n’est jamais chose facile quand on est seul et que l’on ignore le remords. D’une certaine façon je suis indéfendable et d’ores et déjà condamné à perpétuité à porter la dépouille souillée de l’aïeul. Et peu importe que ce vieillard fût un diable.
J’attends que l’on vienne me chercher.
Mon père, Thomas Lanski, est mort voilà deux semaines, à l’Hôpital général de Montréal, à l’âge de quatre-vingt-deux ans. Mutique, paralysé, il a passé la dernière année de sa vie dans cet établissement. Après son décès, son corps a été conservé durant six jours dans le dépositoire de cette institution. Lorsque j’en ai été officiellement informé, j’ai pris l’avion pour le Canada afin de faire rapatrier sa dépouille et régler les démarches administratives auprès du consulat de France à Montréal. La semaine dernière, lui en soute et moi en cabine avons embarqué sur le vol Air France AF349 à destination de Paris. Quarante-huit heures plus tard, débarqué à l’aéroport de Toulouse et transféré nuitamment, le corps de mon père a été déposé dans une morgue de banlieue, vissée dans un ancien abattoir réhabilité, proche d’un des centres hospitalo-universitaires de la ville.
Durant le vol de Montréal à Paris, une dame assise à mon côté est morte pendant le trajet. Émergeant dans la pénombre climatisée d’un sommeil qui paraissait paisible, sa tête s’est tournée vers moi semblant vouloir saisir une idée qui la fuyait, puis a pris une lente inclinaison vers l’avant, et c’était fini. Le personnel de bord a signalé que le vol allait devoir dévier de sa trajectoire et faire une escale technique pour se poser, au cœur de la nuit, à Shannon, dans le comté de Clare, en Irlande. Sans en préciser le motif, mais insistant pour que chacun demeure à sa place.
C’est là que le corps fut débarqué sur une civière. L’éclairage au sodium du tarmac surlignait la silhouette des hommes qui s’affairaient autour de l’ambulance portes grandes ouvertes. Ils rangeaient calmement leurs accessoires comme les remballent des ouvriers à la fin de leur journée. À cet instant j’ai songé à la famille de cette passagère qui à cette heure-là, blottie au creux d’un autre fuseau horaire, dormait encore dans la quiétude de l’ignorance.
Le fait que j’aie fréquenté plus de morts que de vivants durant ma vie a sans doute contribué à ce que cet événement, pourtant rare dans un avion de ligne, ne m’ait pas surpris ni bouleversé outre mesure. Dans la soute, je suis convaincu que Thomas, lui, a dû s’amuser de la situation en voyant son fils sans qualité côtoyer au plus près une nouvelle fois un corps sans vie. Dans notre famille, et dans l’entreprise Stramentum qu’elle dirige, il faut bien convenir que la mort est sans conteste notre égérie, notre actionnaire principale, que je suis le fade héritier de cette firme macabre et très certainement, aussi, le continuateur de la sombre génétique qui l’inspire.
Je m’expliquerai longuement là-dessus.
En attendant ceux qui doivent venir, j’écoute avec attention le bruit régulier de l’eau ruisselant dans les chenaux, je respire le pétrichor, cette odeur froide, organique, de la pluie se mêlant à la terre, et regarde passer les heures qui, elles aussi, avec lenteur, s’écoulent. Parfois, il m’arrive de me dire que je ne vaux peut-être pas mieux que mon père, ce Thomas Lanski-là. Si tant est que cet infâme nom fût véritablement le sien.
Ils sont arrivés tout à l’heure, vers 6 heures et quart. Trois hommes ruisselants, souillés par l’averse. Des visages interchangeables. Ils se sont présentés à moi et, après avoir vérifié mon identité, m’ont signifié le début de ma garde à vue avant de me demander de les suivre.
Je range quelques affaires dans un petit sac de voyage. J’ignore tout de la durée et de l’itinéraire de celui que j’entreprends. Je vais devoir traverser tellement de pans de mémoire, arpenter tant d’années. Revisiter sa vie, en répondre, est une expédition incertaine, périlleuse et lointaine.
Avant de monter dans la voiture de mes gardiens, je regarde la maison et, à cet instant, je sais qu’elle aussi me dévisage. Elle me murmure la phrase que m’avait dite la seconde femme de mon père vers la fin de son existence : « Il n’y a que deux dates qui comptent dans une vie. Celle de ta naissance et celle de ta mort. »
La clarté du jour n’est plus la même qu’avant. Sous le poids des nuages d’orage, mois après mois, la lumière a décliné. Il n’est pas rare, certains jours, de devoir allumer l’électricité dès le milieu de l’après-midi. L’humidité habite en chacun de nous, pèse sur nos poitrines et une atmosphère de chancissure imprègne l’air que nous respirons.
Les pneumatiques de la voiture, menée bon train dans les rues détrempées, font éclater les flaques en gerbes d’eau. À l’intérieur nul ne parle et seule la radio de bord égraine par moments des messages de patrouille qui se désagrègent dans l’indifférence des fonctionnaires.
Une odeur de tissus moisis tapisse les couloirs réglementaires de l’hôtel de police.
Je suis assis devant une table administrative plaquée d’un faux bois maladroit qui a depuis longtemps renoncé à donner le change.
Face à moi, un homme hésitant s’exprime à tâtons. Il s’est présenté. Comme une ombre. Sa voix éraillée fabrique des mots qu’il semble extirper péniblement de sa gorge. Il n’y a pas si longtemps il était encore jeune. Aujourd’hui son visage présente déjà des traces fugaces de lassitude et de renoncement. Dans le dos de cet inspecteur, une porte de verre, opaque et sablée, barrée d’une plaque noire gravée qui révèle la nature de notre rencontre : « Interrogatoires, salle no 1 ».
L’homme a des yeux cernés de noir, des yeux de mineur qui remonte du fond. Il n’est pas sans conséquence d’archiver ainsi chaque jour les minutes du dégât des hommes. Le hasard nous a mis face à face dans ce que j’appellerais une intimité procédurale. Nos rôles sont assez convenus. Je dois parler, et lui, transcrire.
D’abord les faits, bien sûr. Ceux qui ont motivé la garde à vue. Commencer par ça. Pour le reste, c’est-à-dire l’essentiel, on verra.
Je me nomme Paul Sorensen. Pour des raisons que j’ignore, et que nul n’a jamais pu m’expliquer, j’ai été enregistré à l’état civil sous le nom de ma mère biologique, Marta Sorensen, morte à ma naissance, emportant avec elle mon frère jumeau, le 20 février 1980, à 21 h 30. Cette nuit-là, mon père est ailleurs. Il dîne, paraît-il, en ville. Il n’apprendra la mort de sa femme et celle de l’un de ses fils que le lendemain avant de confier la charge du survivant à un parent et de partir illico pour deux semaines de villégiature dans le sud de l’Italie. Cinquante et un ans plus tard, cet homme est décédé comme je suis né, seul, à l’hôpital de Montréal.
Hier soir, 17 mars 2031, aux alentours de 23 heures, je me suis rendu à la morgue qu’il m’arrive de fréquenter occasionnellement en raison de mes activités professionnelles. Malgré l’incongruité de l’horaire j’ai demandé à l’un des préposés de garde de me conduire jusqu’à la dépouille de Thomas Lanski, mon père. L’homme, qui m’avait reconnu, ne fit aucune difficulté. Et lorsque je lui révélai le but de ma visite, déposer le corps de mon père dans une des housses mortuaires que nous fabriquons chez Stramentum, il m’offrit même son aide pour glisser le cadavre congelé de Lanski dans son nouveau body bag familial. Une fois le transfert accompli, et le cadavre à nouveau déposé dans son tiroir de conservation, il se retira, me laissant me recueillir devant Lanski. J’emploie son nom seul à dessein, ce nom souillé, car il m’est très difficile de prononcer le mot de « père » le concernant. On se fait tout un monde de ce que je vais maintenant raconter. Mais non. Les choses se font naturellement, presque paisiblement, elles s’enchaînent dans une quiétude mentale alimentée par une haine sereine, une sauvagerie légitime couvée depuis l’enfance. J’ai donc baissé la fermeture éclair de notre Stramentum modèle 3277 jusqu’à ce que le corps nu et vieilli de Lanski soit à nouveau dévoilé. J’ai regardé ces vieilles chairs, viandes fripées d’où saillaient quelques os. Son sexe reposait en arc de cercle sur l’une de ses cuisses. De ses couilles, déjà avalées par l’entrecuisse, plus aucune trace. Pourtant, mon frère mort-né et moi venions de cet endroit-là. J’ai regardé ce bas-ventre, ce canal conjonctif qui nous avait propulsés vers la vie, cet appendice flétri qui ce jour-là s’était mis en tête de fonder ce qui allait tout détruire, une vie de famille.
L’inspecteur me demande de lui accorder un instant. Puis se lève et sort de la salle. Cet homme est peut-être trop jeune pour entendre ce genre de choses. L’odeur du commissariat est si forte qu’elle finit par déposer comme un goût dans la bouche, qui évoque les vapeurs d’un voile cryptogamique. Le policier est revenu et dépose deux verres d’eau sur notre table. Il réajuste la caméra qui enregistre ma déposition et me demande de bien vouloir répéter que je refuse la présence et l’assistance d’un avocat.
Je poursuis. Maintenant, remonter la fermeture de façon à ce que seul le visage de mon père émerge de son emballage familial. Glisser la main dans ma poche, armer le revolver acheté quelques heures plus tôt, appliquer le canon à même la peau et tirer deux balles. Le premier projectile traverse l’os frontal de la boîte crânienne, l’autre, tiré de biais, brise le sphénoïde, avant de s’enliser dans la vase cérébelleuse et nauséabonde où pourrissent les archives et les méfaits de toute une vie. Deux coups de feu, deux claquements qui résonnent dans l’environnement glacial et métallique des tiroirs funéraires. J’ai scruté les conséquences de mon tir sur le visage de Lanski. Elles étaient peu spectaculaires. Deux trous, un peu de sang mort réfrigéré et c’est tout. J’ai essuyé une petite éclaboussure qui souillait un pan de notre 3277. Puis j’ai remonté la fermeture éclair et, d’un geste sans remords, renvoyé Lanski dans ses ténèbres à coulisses. J’ai pensé très fort à mon frère, puis, sans rencontrer personne, quitté l’endroit en traversant le long couloir par lequel j’étais venu.
Voilà pour les faits. C’est bien moi, son fils Paul, qui, cette nuit, ai abattu Lanski. Une quinzaine de jours après sa mort.
Ce que je ne pourrai jamais dire à l’enquêteur, c’est que tout à l’heure, dans cette morgue, se tenant en retrait dans la pénombre, j’ai aperçu la silhouette de mon frère. Il était revenu pour moi, pour être à mes côtés. Sa présence était en chaque chose, à chaque instant. Il n’eut pas un regard pour notre père, mais ses yeux que j’avais cherchés toute ma vie étincelaient et me répétaient : « Si tu ne l’avais pas fait c’est moi qui m’en serais chargé. » Qui pourrait croire une chose pareille ?
L’homme encore jeune m’observe professionnellement en s’efforçant de ne pas laisser transparaître la moindre émotion. Mais il ne peut s’empêcher parfois de baisser les yeux.
Qui que nous soyons, quelle que soit notre place en ce monde, nous portons en nous trop de choses douloureuses ou déshonorantes. En silence, elles nous embarrassent et, un jour, elles nous trahissent.
Le visage de l’enquêteur se voile maintenant d’un air embarrassé. Son assurance a été de courte durée et je vois bien qu’il ne sait plus quoi penser à mon sujet. C’est sans doute la première fois de sa vie qu’il a à prendre une déposition d’une telle nature. Nous sommes, assis face à face, à pouvoir nous toucher. J’essaye de répondre à ses interrogations avec loyauté, mais mon récit est sans doute trop frontal. Je lui confie alors qu’il faudrait tellement de temps et de nuances pour rendre justice à cette histoire. Mettre de l’ordre en moi-même, trier dans la honte et la douleur des souvenirs. À commencer par l’intimité du désastre originel. Celui d’un enfant né d’une mère morte.
L’enquêteur me fait répéter cette phrase. Je devine qu’elle le surprend, le met sans doute, une nouvelle fois, mal à l’aise. Il la transcrit avec fidélité sans parvenir à dissimuler une forme d’embarras.
Je continue. En entrant dans la salle d’accouchement cette nuit-là, nous étions trois. Intimement liés par le cœur et le sang. Marta Sorensen, ma mère, mon frère jumeau, et moi. Nous vivions des mêmes eaux et en quelques minutes le malheur nous a désossés. Je fus le seul à survivre. Amputé des miens, il me fallut apprendre à aimer une seconde mère, à endurer la folie, la perversion et les raptus d’un père malfaisant. Celui-là même que je viens d’abattre post mortem. Le moment venu, je reviendrai sur ce geste étrange ainsi que sur la jurisprudence qui l’éclaire. D’autant qu’il m’en souvienne, ce père a toujours été un être désaxé, dangereux, pervers, irrigué en permanence d’un flux malveillant. Dans cet univers inversé, mon seul et unique projet fut de grandir contre lui.
À cet instant j’observe que l’enquêteur a du mal à concevoir l’idée que l’on puisse ainsi grandir contre quelqu’un, a fortiori lorsqu’il s’agit de son géniteur. Mais comment saurait-il que, pour mon sixième anniversaire, cet homme m’offrit un canari dont il venait d’arracher la tête avec les dents ?
Ce que je vais dire maintenant peut sembler singulier, sans rapport direct avec ce qui précède, mais reflète pourtant l’architecture, le tissu profond de ma réalité : dans cet enclos familial, dès le début de mon existence, j’ai confusément ressenti que la mort cheminerait toujours à mes côtés, me témoignerait une bienveillance distante, veillerait sur moi à sa façon, allant, plus tard, jusqu’à subvenir à mes besoins en m’offrant un emploi pour le moins singulier et un certain confort financier. Les premiers mots de mon père à mon endroit, furent : « Tu es marqué par la mort. Tu devras toute ta vie apprendre à vivre avec elle. »
Cette dernière précision rassure l’enquêteur, même si sa compréhension générale de l’affaire, loin de progresser, semble au contraire s’effilocher au fil de notre conversation.
Nul ne peut prétendre raconter le récit de sa naissance. Pourtant, je me souviens, disons, de l’essentiel. Je ne saurais dire par quel canal d’enregistrement ces moments se sont inscrits en moi. La mémoire n’y est évidemment pour rien. C’est autre chose. Une capture de sensations, de la peur panique, un froid glacial et, sans doute, la découverte d’une peine primaire, un chagrin animal, une détresse archaïque. Comme si les chairs et les os avaient fait le travail d’archivage. Comme s’ils avaient classé chaque moment, chaque molécule. Et dans l’air, ce vide, cette solitude glaciale, ce goût aride du sang de la naissance.
Chacun de mes anniversaires commémore la mort de Marta et de mon frère. L’origine des larmes se trouve là, au fond du ventre de ma mère. Ce ventre dont je n’aurais jamais dû sortir. Ce ventre qui aurait dû m’ensevelir au côté de mon frère. Ce ventre qui m’a expulsé au dernier moment vers la vie sans que je demande rien ni que je sache pourquoi. De l’air est entré dans mes poumons pour la première fois au moment même où leurs cœurs ont arrêté de battre.
Je ne parle jamais de ces choses-là. Ce sont les circonstances de l’interrogatoire qui m’amènent à convenir de ce qui suit : j’ai en moi l’inconcevable conviction d’avoir été présent cette nuit-là, debout, dans un coin de la salle d’accouchement, déjà vieux, témoin brisé et pétrifié de mon avènement, scrutant les derniers instants d’un marché odieux, de l’échange insensé qui était en train de se jouer dans cette maternité, devant moi : deux morts contre ma vie. Je suis le fruit de cette rançon. Je sais ce que je dis. Je connais l’origine des larmes.
L’enquêteur se bloque sur cette phrase, marque un temps, se raidit. Son visage se crispe d’un rictus fugace, évoquant le frisson d’un homme pénétrant dans de l’eau froide. Ses doigts s’éloignent lentement du clavier comme si son contact s’avérait soudain désagréable. Il cherche une issue pour dissimuler ce malaise. Il se ressaisit et me demande de lui confirmer que j’ai bien déclaré que je connaissais « l’origine des larmes », même si, selon lui, cette curieuse affirmation n’a rien à voir avec les faits qui précèdent et encore moins avec l’affaire qui nous occupe.
Je ne réponds pas. Je ressens simplement qu’il m’appartient d’imposer et de définir les contours du silence et des mots qui nous enferment dans cette pièce. Il faut que ce jeune homme se mette bien en tête que je n’ai tué personne.
Dehors, la luminosité décline et les averses fouettées par les bourrasques malmènent les vitrages. Après des années de sécheresse, d’aridité et de chaleurs abrasives qui faisaient craquer les corps et les écorces, la pluie s’est installée. Elle s’infiltre en nous, change nos vies, et nul ne sait dire pourquoi. Elle m’obsède. Je suis hanté par ces eaux. Depuis plusieurs années nous vivons ainsi sous des régimes insensés de brutales bascules météorologiques. Depuis deux ans, à des degrés divers, le fleuve marche sur les terres, déborde dans nos existences et, patiemment, envahit tout ce qui peut l’être.
Je regarde le visage de mon interlocuteur. Outre les soixante-cinq pour cent d’eau qui irriguent son corps, j’essaye de deviner ce qu’il y a à l’intérieur de cet homme. Et je n’y trouve rien de bien différent de la mécanique des fluides qui m’anime. Nous sommes assis face à face, pareils à des animaux domestiqués, sans animosité réelle l’un envers l’autre, et sachant au fond de nous que nous sommes plus ou moins condamnés à nous entendre. Une sorte de couple occasionnel d’usage courant.
En pensant à l’étendue de ma tâche, j’éprouve une fatigue vertigineuse et demande à faire une pause.
Si l’enquêteur pouvait lire dans mes pensées, sans doute m’opposerait-il que sa tâche à lui est de mener un interrogatoire, non d’animer une conversation, et que, juridiquement, rien ne justifie que l’on puisse ôter la vie à un cadavre. Je poserais alors mon regard las sur ses yeux de mineur fatigué et je dirais simplement : « Bien sûr que si. »
La nuit en garde à vue
Que la nuit fut longue. Dans cette petite cellule individuelle où les heures écorchent le temps et torturent la mémoire, je me suis efforcé de conserver en moi le plus longtemps possible la douceur et la bienveillance du regard de mon frère. Il me manque depuis le premier instant, il m’a manqué toute une vie. Comme notre mère. Je n’ai jamais vu son visage et je ne sais absolument rien d’elle. Mon père a fait disparaître toute trace de son existence. Il n’a jamais voulu répondre à la plus innocente question de ma part la concernant. Il n’existe aucune photo d’elle, et dans les armoires, aucun vêtement, aucune paire de chaussures. Je n’ai pas la moindre idée de ce à quoi elle ressemblait ni de ce que fut sa vie avant de rencontrer Lanski. Mon père utilisa cependant la jeunesse suédoise de son épouse pour échafauder à mon intention un scénario vertigineux, incroyablement malsain, sans doute la pire histoire que l’on puisse raconter à un enfant orphelin. Tout cela sera consigné plus tard si nécessaire. La seule chose que je sache aujourd’hui de Marta c’est qu’elle est morte au moment de me prendre dans ses bras. Je ne sais même pas où elle a été enterrée et mon père n’a jamais fait le moindre effort pour guider ma recherche. Le corps de mon frère, sans existence légale ni prénom – car lui n’a jamais respiré –, a été jeté aux ordures hospitalières. Mon père ne s’est jamais intéressé à sa dépouille. J’ai du mal à croire que tout ceci ait encore un sens. J’ai du mal à croire que j’aie pu séjourner, ne serait-ce que quelques instants, dans les testicules et le scrotum de Thomas Lanski, mon père. J’ai du mal à croire que ma mère, Marta Sorensen, Suédoise native d’Uppsala, ait pu, un jour, pour quelque raison que ce soit, l’accueillir en elle et jouir de ses impatiences. J’ai du mal à croire que je sois parvenu à survivre à cet éjaculat. Et toujours je me demanderai pourquoi le destin ne m’a pas fait partager ce soir-là le sort de millions de mes frères emportés dans le vortex d’un vieux bidet d’aisances et le frottis vaginal d’un coton de linge de toilette.
À chaque tentative, une caille émet cinq cents millions de spermatozoïdes par millilitre. Un dindon, dix milliards. Mon père ? Allez savoir.
Mon frère jumeau et moi, gamètes aveugles de trois microns de large et soixante de long, éparpillés dans cette nuée brouillonne, avons survécu et sommes malencontreusement sortis du lot. Ce fut là notre péché originel.
Toute la nuit, dans cette cellule rectangulaire, mon esprit a tourné en rond. Comme un chien derviche essayant de se mordre la queue.
Je suis encore dans le ventre de Marta, tout à côté de mon frère jumeau. Nous avons toujours vécu l’un contre l’autre. Jamais nous n’avons éprouvé l’inquiétude d’être seuls. La voix de notre mère était douce et calme. Même si nous ne comprenions pas ce qu’elle disait, l’entendre, toujours, nous apaisait durant notre longue nuit commune. Je me souviens aussi de ceci, qui est parfaitement clair dans mon esprit: j’ai toujours aimé mon frère. Je ne l’ai jamais vu, mais je l’ai toujours aimé. Profondément.
Je pense que je suis né les yeux ouverts. Grands ouverts. En pleine nuit. Je suis né les yeux ouverts pour comprendre ce qui se passait. Ce qui était en train d’arriver autour de moi. J’en suis certain. On dit que les nouveau-nés ne distinguent pas la lumière. C’est faux. Je suis persuadé que dès la première seconde, dès les premiers instants, j’ai compris et senti que n’importe quelle lueur valait mieux que l’obscurité. L’enfant vient de naître. Il vient de naître d’entre les morts. Peut-être en a-t-il déjà conscience. D’ailleurs il ne crie pas, il ne dit rien.
Extraits
« Selon le compte-rendu du docteur Van Nuwenborg, la mort est due à une «ELA, embolie du liquide amniotique, complication imprévisible de l’accouchement associant un collapsus cardio-vasculaire sévère, un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une hémorragie avec une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). L’un des deux enfants que portait la patiente est également décédé sans avoir réellement vécu. Dépourvu d’identité, non enregistré, nous ne savons pas ce qu’est devenu son corps. Il a pu être traité en tant que “pièce anatomique” ou alors comme “déchet” selon les définitions en usage. Dans tous les cas il a été détruit. Son jumeau, lui, a survécu».
La mémoire médicale, clinique, s’arrête là. Ensuite j’ignore par quel mécanisme la mienne a pris le relais, comment j’ai pu ressentir ce froid glacial se plaquer sur ma peau sitôt que l’on m’a retiré du ventre de ma mère, comment l’absence soudaine de mon frère m’a plongé dans le vide et l’effroi. Je ne vais pas revenir sur les mécanismes mémoriels que j’ai déjà évoqués dans ma déposition, et qui ne sont qu’une hypothèse sans doute maladroite pour tenter d’expliquer les arcanes de cet archivage, mais ce dont je suis certain, c’est que depuis ce 20 février, depuis ce premier jour, il y a un trou en moi. Je ne sais pas l’exprimer autrement. Il y a un trou au fond de moi. Creusé à mes mesures. Suffisamment profond pour m’accueillir. Il habite en moi. Parfois je le sens, il bouge, change de position ou prend toute la place. Il patiente, il a tout son temps. Il attend que je tombe dedans. Et alors il se refermera. Pourquoi je dis cela? Parce que tout a commencé ainsi. À l’instant même de ma naissance, j’ai senti cette béance s’ouvrir en moi. » p. 61-62
« Une maladie à prions, dite Gerstmann-Sträussler-Scheinker. Maladresse, instabilité de la marche, difficulté pour parler, perte de coordination musculaire, démence progressive, atteinte des muscles respiratoires. En général le calvaire ne dépasse pas cinq années. «Votre mère souffre d’un GSS.» Le médecin m’a ensuite demandé si d’autres personnes de la famille en sont ou en avaient été affectées, car il s’agissait là d’une maladie héréditaire. Je n’osai pas lui dire que j’ignorais tout de cette famille, tant du point de vue génétique que généalogique. Je n’étais pas l’enfant de Rebecca, mais celui de Marta.
En apprenant la nouvelle, les premiers mots de ma mère furent : «Tu crois qu’il reviendra quand il saura?»
Par un de ses amis, en lui spécifiant bien les raisons de ma demande, j’obtins les coordonnées de mon père. Trois ans durant je lui ai téléphoné toutes les semaines. Écrit chaque mois. J’ai essayé de faire intervenir des proches. Mais pour lui, sa femme était déjà morte. Quant à moi, je n’aurais pas dû naître. » p. 81
« Il est quand même à noter, au-delà de l’aspect symbolique et maladroitement mythologique de cette histoire, que j’aurai passé toute ma vie professionnelle à travailler pour la mort et donc à être nourri par elle. Et je me dis que c’était peut-être cela les termes de l’échange initial et odieux: la vie de mon frère et de ma mère contre l’assurance d’un gîte, d’un couvert puis d’un rassurant bulletin de paye avec en prime, endormies au fond d’un tiroir du bureau maternel, une épaisse liasse d’actions de la Standard Oil, célèbre compagnie pétrolière appartenant à la galaxie rockefellerienne, dissoute depuis 1914 pour ne pas s’être conformée à la loi antitrust édictée par l’administration américaine. » p. 122
« L’amour s’apprend par capillarité. Au jour le jour. En un goutte-à-goutte silencieux qui se délivre sous nos yeux. L’enfant apprend avec les yeux. En reniflant les molécules qui flottent dans l’air, quand il voit la main de son père caresser la nuque de sa mère, la bouche de sa mère embrasser le cou de son père, quand il observe tout cela, il sait que c’est bien, que c’est bon, qu’on peut appeler ça l’amour ou comme l’on veut, mais que c’est agréable d’être avec quelqu’un qui un soir vous dit: « T’u es mon amour et moi le tien, ça tombe bien. » » p. 166
À propos de l’auteur

Jean-Paul Dubois est né en 1950 à Toulouse où il vit actuellement. Journaliste, il commence par écrire des chroniques sportives dans Sud-Ouest. Après la justice et le cinéma au Matin de Paris, il devient grand reporter en 1984 pour Le Nouvel Observateur. Il examine au scalpel les États-Unis et livre des chroniques qui seront publiées en deux volumes aux Éditions de l’Olivier: L’Amérique m’inquiète (1996) et Jusque-là tout allait bien en Amérique (2002). Écrivain, Jean-Paul Dubois a publié de nombreux romans (Je pense à autre chose, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi). Il a obtenu le prix France Télévisions pour Kennedy et moi (Le Seuil, 1996), le prix Femina et le prix du roman Fnac pour Une vie française (Éditions de l’Olivier, 2004) et le Prix Goncourt 2019 pour son livre Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (Source: Éditions de l’Olivier)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Tags
#loriginedeslarmes #JeanPaulDubois #editionsdelolivier #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #VendrediLecture #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie







 Sophie Bienvenu © Photo Annick MH de Carufel
Sophie Bienvenu © Photo Annick MH de Carufel

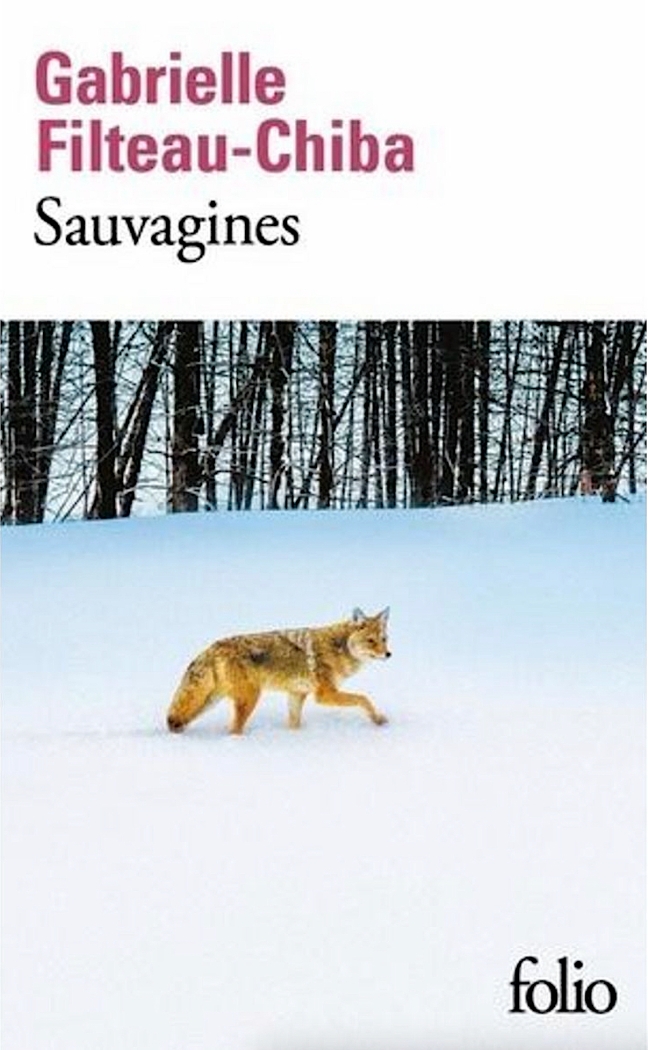




 Sophie Bienvenu © Photo Annik MH de Carufel
Sophie Bienvenu © Photo Annik MH de Carufel



 Nicolas Delisle-L’Heureux © Photo Chloé Vollmer-Lo
Nicolas Delisle-L’Heureux © Photo Chloé Vollmer-Lo

 J.D. Kurtness © Photo Sébastien Lozé
J.D. Kurtness © Photo Sébastien Lozé

 Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Véronique Kingsley
Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Véronique Kingsley




 Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Véronique Kingsley
Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Véronique Kingsley



 Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Jean-François Papillon
Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Jean-François Papillon