En deux mots
Durant l’été 1976, toute la famille Bévaro se retrouve chez Elias. Après 17 années passées en métropole, Daniel est de retour avec sa famille. Et quand les autorités, inquiètes des grondements de la Soufrière, décide d’évacuer le sud de Basse-Terre, de nouveaux invités se joignent à eux. L’occasion d’éclairer les zones d’ombre de la généalogie.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Un été 1976 en Guadeloupe
Dans son nouveau roman, Estelle Sarah-Bulle explore le destin d’une famille guadeloupéenne. Alors qu’en cet été 1976, on craint une éruption de la Soufrière, les Bévaro se retrouvent. De génération en génération, la romancière explore leurs secrets de famille.
Nous sommes en juillet 1976 en Guadeloupe. C’est le moment choisi par Daniel pour retrouver son pays natal après 17 ans d’absence. Il arrive de Châteauroux, où il vit désormais, accompagné de son épouse Marianne et de ses enfants Diego et Adèle. À l’aéroport l’attend son père Elias et son cousin Francelette que tous sur l’île appellent Gros-Yeux. Chez Elias, la famille retrouvera les cousins, les frères et les sœurs et les amis, venus voir quelle tête avait désormais Daniel et à quoi ressemblaient sa femme et sa progéniture.
Après les retrouvailles et la première nuit, Daniel cherche à se repérer, «il réapprend le paysage, bouche les trous des souvenirs. Les distilleries s’effondrent désormais en ruines rouillées au coin des chemins, les ponts de son enfance disparaissent sous la végétation, la plage a été éventrée par un promoteur immobilier. Les villes côtières se gonflent de touristes couverts d’huile bronzante. Et lui, il ne sait plus comment l’aimer, son île.»
Durant les trois semaines de son séjour, il ira aussi rendre visite à son frère Ange, interné en asile psychiatrique, du côté de Basse Terre où vulcanologues et scientifiques débattent sur les risques d’éruption de la Soufrière. Après une expédition durant laquelle Haroun Tazieff et Claude Allègre ont failli perdre la vie, ordre est donné d’évacuer la zone sud, celle où vit Eucate. La vieille femme avait choisi de construire sa case sur les pentes du volcan et était bien décidée à rester là et à braver les jets de lave et de soufre. Il faut dire que jusque-là, elle avait déjà surmonté bien des épreuves, perdant notamment l’un de ses fils, emporté par la rivière un soir de tempête. Anastasie, sa petite-fille, était la seule à être restée à ses côtés, avec l’envie de comprendre ce qui était arrivée à sa famille, à dévoiler les parts d’ombre qui l’accompagnait.
Génération après génération, Estelle-Sarah Bulle va lever le voile sur les secrets de famille, explorant par la même occasion l’héritage de l’esclavage, puis du colonialisme et enfin du post-colonialisme. Entre la métropole et le département d’outremer, on comprend aussi que les principes de la République ne sont toujours pas appliqués, à commencer par l’égalité de traitement.
Eucate «accepte enfin ce que la vie lui a donné puis repris, heureuse de retourner au volcan et d’y gratter encore un peu l’humus vivifiant, heureuse de survivre au mal, comme chacun sur cette Île sans cesse secouée par les ouragans, les famines, le progrès, l’avidité et l’incroyable sentiment de supériorité des Blancs.»
Le hasard des parutions fait qu’en cette rentrée ce roman entre en résonnance avec La vie privée d’oubli de Gisèle Pineau qui paraît simultanément chez Philippe Rey. Ce roman analyse lui aussi «les conséquences des traumatismes des générations précédentes sur les suivantes.» Deux voix qui s’inscrivent en dignes héritières de Maryse Condé et Simone Schwarz-Bart.
Basses terres
Estelle-Sarah Bulle
Éditions Liana Levi
Roman
208 p., 20 €
EAN 9791034908400
Paru le 4/01/2024
Où?
Le roman est situé principalement en Guadeloupe. On y évoque aussi Châteauroux, Aubervilliers et Sucy-en-Brie.
Quand?
L’action se déroule durant l’été 1976.
Ce qu’en dit l’éditeur
En Guadeloupe, les toussotements de la Soufrière font partie du quotidien des habitants de la Basse-Terre. Mais en ce mémorable mois de juillet 1976, les explosions s’intensifient, les cendres recouvrent impitoyablement la végétation et beaucoup se résignent à partir en Grande-Terre. Au cœur de cette saison brûlante, les bourgs se vident et les destins se jouent. De l’autre côté de l’isthme, chez les Bévaro, l’heure est aux retrouvailles: dans la case d’Elias, le patriarche, s’agglutinent la famille de son fils venue de métropole et une flopée de cousins déplacés. Eucate, en Basse-Terre, n’a plus que sa petite-fille. Elle a autrefois érigé sa case sur les pentes du volcan pour fuir les vilénies de son patron monsieur Vincent et elle est bien décidée à y rester. Même si elle devait être la dernière, seule avec ses souvenirs d’un passé doux-amer.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Les premières pages du livre
« I
Le cœur de cette longue année 1976, brillant comme une émeraude, est son mois de juillet. Un cœur qu’on ne peut arracher sans perdre la compréhension des choses.
Anastasie le verra luire dans le noir de sa mémoire. Elle saura que juillet fut le cœur de l’année 1976 parce que s’y étalèrent les semaines lumineuses où le volcan marqua
chacun de sa terrible empreinte. Et parce qu’en ce juillet-là, elle perdit quelque part le sac de capsules de Coca-cola qu’elle collectionnait pour la glacière qu’elle voulait offrir à Eucate (elle avait alors vingt-huit capsules marquées d’une petite étoile blanche; elle devait en réunir trente, ajouter trente francs puis se rendre à l’usine Coca-Cola de Jarry pour réclamer son lot). Elle ne comptait plus les nuits où elle avait rêvé de poser triomphalement la glacière devant Eucate sur la toile cirée.
Pour laisser derrière soi la maison d’Eucate, il fallait émerger de la ravine enfouie sous la végétation et gagner le sentier fraîchement goudronné, tassé par des milliers de pas. C’est pourquoi les enfants autour de la maison
avaient tous eu au fil des années les mollets fermes et les genoux noircis.
Accrochée au fond de sa pente glissante, la case était entièrement faite de bardeaux courts que les gens appelaient « essentes ». C’étaient de petites planches de bois sec, serrées, comme si le charpentier (la charpentière, car c’était Eucate qui avait construit les deux pièces
de sa case, morceau par morceau) ne s’était arrêté un instant que pour laisser deux trous de fatigue en guise de fenêtres. La case était grisâtre, délavée et dépourvue de fleurs.
Elle était assombrie par les grappes velues des cacaoyers sauvages et des coccolobes. Eucate en sortait, son vieux coutelas à la main, levait la tête vers le ciel, inspectait le sol. Puis le coutelas s’élevait généralement deux fois pour abattre en silence une branche feuillue. Les habitants du quartier n’y prêtaient pas beaucoup d’attention. Pour tout dire, en ces temps où l’île semblait connaître un semblant de progrès, tandis que la route de la Traversée venait d’être arrachée à la forêt à coups de bulldozers suivant les plans déroulés par des ouvriers revêtus d’une tenue orange vif, la case d’Eucate était une aberration, le béton ne l’ayant même pas effleurée. La mairie avait d’abord envoyé des lettres invitant Eucate à se rapprocher des services municipaux pour formuler une demande de relogement en ville. Puis un agent s’était déplacé jusqu’à la case, le cou en sueur et les pieds douloureux, pour lui remettre un courrier au ton comminatoire. Mais Eucate n’avait aucune intention de quitter la forêt et la mairie l’oublia, bien d’autres masures étant concernées par son plan de «réduction de l’habitat insalubre». Les voisins n’accordaient pas non plus spécialement d’intérêt à ceux qui vivaient dans la case d’Eucate. On voyait seulement émerger, à intervalles réguliers, un garçon ou une fille mutique en âge de faire la vie, qui empruntait le chemin sans se retourner. Et on disait «Voilà un autre rejeton d’Eucate qui part pour ne plus jamais revenir ». Jusqu’à ce qu’il ne reste au fond de la ravine qu’Eucate et sa petite-fille, Anastasie. Car Libert Darrieux, le mari d’Eucate, père de quatre de ses enfants et qui avait bien voulu donner son nom aux deux autres, était mort depuis longtemps, un premier janvier à l’âge de cinquante-deux ans, d’une péritonite déclenchée par la dose d’huile de ricin censée lui laver le corps pour bien démarrer l’année.
Bien qu’elles n’en parlent jamais toutes les deux, Anastasie sait que le souvenir préféré de sa grand-mère, celui qu’elle convoque chaque fois que l’intimité d’un moment à l’ombre le lui permet, remonte quelques années plus tôt, durant l’hivernage 1967. Anastasie n’était alors qu’une fillette galeuse et pourtant, comme
si elle partageait la mémoire de sa grand-mère, la jeune fille revoit parfaitement Ange, le merveilleux fils d’un certain Elias Bévaro vivant de l’autre côté de l’île, en Grande-Terre. Elle le revoit garant sa DS mordorée au bord de la ravine, à quelques mètres de la case. De tous les souvenirs qu’elle a engrangés durant sa longue vie, c’est celui que sa grand-mère chérit le plus, enfoui dans son cœur comme un remède pour obtenir un sommeil plus facile ou soulager son dos. «Système à suspension hydropneumatique», expliquait fièrement Ange aux adultes ébahis comme aux enfants agglutinés autour du véhicule dans toutes les communes où il s’arrêtait. Cependant, les témoins de l’époque, avec un soupçon d’orgueil teinté de mélancolie sur le visage, s’en tiendraient simplement, des dizaines d’années plus tard, à évoquer la « voiture qui monte et qui descend».
En 1976, tandis que l’angoisse submerge comme une marée sombre les habitants du sud de l’île – depuis la route qui mène chez Eucate comme par inadvertance, il suffit de lever les yeux pour apercevoir le dôme fumant du volcan –, la vieille femme, assise devant sa case, indifférente aux braises flottant autour de son visage, sirote avec délice le souvenir de cette matinée de 1967 où, depuis l’intérieur en cuir chocolat de sa DS, Ange actionna le levier qui soulevait en douceur les amortisseurs.
Dans un soupir d’aise, la voiture se dilata comme un crapaud buffle. Ange poussa dans l’autre sens: la voiture redescendit lentement sur ses roues en expirant. Il répéta plusieurs fois l’opération pour le plaisir des gosses qui entouraient le véhicule: descente, remontée. Les marmots hurlaient d’excitation. La molaire d’argent plantée dans la bouche d’Ange brillait fièrement au soleil. Les gamins les plus hardis, après avoir jeté un coup d’œil craintif vers Ange, se risquèrent à grimper sur le capot brûlant. «Ça doit faire comme ça dans les ascenseurs », assuraient-ils, le short collé à la tôle frémissante. Pieds nus et cambrés sur le goudron encore tiède avant la grande chaleur de l’après-midi, les autres hochaient la tête en croisant les mains sur leurs crânes tondus ou nattés et se bousculaient pour, à leur tour, «monter dans l’ascenseur ».
Eucate n’était pas sortie quand Ange avait garé la DS à moins d’un mètre de son poulailler délabré. Il lui suffisait d’apercevoir par la fenêtre ses souliers de cuir parfaitement cirés et les gants marron glacé, assortis à la couleur de la voiture. Elle savait qu’il entrerait pour boire un café. Elle savourait l’attente. Elle savait pourquoi les gants étaient importants. Elle suivit Ange des yeux lorsque, après avoir refermé la portière, jouissant de son claquement feutré, il entreprit de descendre prudemment dans la boue, toujours entouré de la marmaille comme un essaim de vonvons autour d’un pain de miel.
Eucate l’attendait.
Les larges dalles blanches veinées de gris que personne ne soupçonnait de l’extérieur de la case, sur lesquelles Eucate glissa dans ses chaussons avachis pour verser du café dans une timbale cabossée et la poser fumante sur la table, c’était Ange qui les lui avait offertes. Elles provenaient du surplus de l’un des chantiers où il travaillait. Les volets de bois, c’était aussi lui qui les avait apportés et fixés aux fenêtres sous l’œil attentif d’Anastasie à qui il montrait chaque clou, chaque vis, expliquant patiemment à la fillette ce qu’il allait en faire. «Celle du patron de Daniel est décapotable, c’est sûrement encore mieux. Mais lui ne porte pas de gants», déclara Ange en se présentant à la porte. Il s’essuya les pieds et tourna la tête une dernière fois vers le soleil avant de plonger dans l’ombre rafraîchissante de la case. La brise poussa son museau dans la pièce et ressortit aussitôt par-derrière. Les enfants du quartier disparurent, suivis de loin, timidement, par Anastasie. Ils ne s’intéressaient pas aux radotages d’Eucate dans son vieux fauteuil en skaï troué. Ils préféraient continuer à rôder autour de la DS.
Ce fut comme s’il avait fait exprès de lui présenter son meilleur profil avant d’entrer dans la pénombre. Les rayons du soleil ne perçaient pas la végétation, la case restait fraîche jusqu’à trois heures de l’après-midi au moins. Ce matin-là, le coq perché sur le lourd bidon rouillé qui servait de citerne avait néanmoins chanté dans un poudroiement d’or. Ce poudroiement dansait encore autour d’Ange.
Son visage à la beauté évidente. Lèvres de filles posées sur la timbale au goût métallique. Sourire plissant ses yeux noisette sous les paupières légèrement tombantes.
Il s’assit face à elle. Entre les pieds d’Eucate, les poules menaient une guerre impitoyable aux ravets trapus dont les longues antennes paniquées tâtonnaient le carrelage à la recherche des fentes disponibles.
«C’était le patron de Daniel mais ce temps-là est terminé. Ça fait bien six ans que Daniel est parti.
– Dit comme ça, il n’y a pas de raison que tu le considères encore comme le patron.
– Ça n’a jamais été le mien. Il n’a pas payé Daniel pour ses heures supplémentaires. On ne peut pas faire confiance à un patron blanc d’ici. C’est ce que je dis toujours à mes ouvriers.
– Les patrons noirs valent mieux, peut-être ?
– En tout cas, mon entreprise vaut autant que la sienne.
– C’est dans l’électricité qu’il était ?
– Électricien, oui. Son patron a monté l’entreprise depuis la France. Il n’est venu ici que lorsqu’il a commencé à obtenir de gros contrats. Daniel n’était qu’un apprenti de rien du tout pour lui. À l’époque je l’ai traité d’idiot, mais il a eu raison de partir. Il a un bon métier maintenant.
– Toi, ça te plaît la peinture?
– Pas plus mal qu’autre chose. J’ai trois gars en ce moment. Ça marche bien, à cause du sel qui ronge les façades. Et l’humidité n’est pas bonne non plus pour le ciment. Les églises d’Ali Tur ont besoin d’être ravalées dans toute l’île. C’est pour ça que je peux me payer ce voyage en France. Je verrai comment vit Daniel, là-bas.
– Lucette part avec toi ?
– Le bateau, c’est pas indiqué dans son état. Il vaut mieux qu’elle reste chez ses parents. Mais je vais faire une grande fête avant mon départ. »
Il n’en avait pas raconté davantage. La voiture était repartie sous les vivats des enfants, dans une gerbe de terre noire. Eucate avait rincé la timbale dans la bassine et l’avait mise à sécher sur la fenêtre. Deux modèles dans toute l’île, pensa-t-elle fièrement, mais seul Ange avait des gants assortis à la carrosserie. «Pourquoi tu n’achètes pas deux tasses ? De la porcelaine blanche, qu’on ait au moins quelque chose de propre quand il est là. »
Plantée devant l’entrée, exactement là où se tenait Ange cinq minutes auparavant, Anastasie fixait sa grand-mère d’un air accusateur. « Il se fiche complètement d’avoir une tasse de porcelaine.
– Et pourquoi il vient chez nous ? »
Eucate regarda sa petite-fille puis pencha en avant son corps devenu massif, dont la chair s’amollissait avec les années. Elle fouilla l’étagère cachée derrière un morceau de madras. Après le scandale du début, les gens continuaient à ne pas comprendre la nature de ces visites.
Adrienne Lorifat, la voisine, en parlait à tout le monde en s’esclaffant: « Je vous demande un peu, de quel genre de faim souffre un beau soldat comme lui pour aller renifler dans une vieille assiette? » Mais Eucate savait bien ce qu’Ange trouvait auprès d’elle. Lentement, elle ramena à la lumière une casserole et un cube jaunâtre qu’elle tendit à la fillette.
« Il vient pour se reposer.
– Se reposer ? Il ne reste même pas dix minutes.
– C’est fini tes questions ? En tout cas c’est pas ton père, je te l’ai déjà dit, pas la peine de te faire des idées. Va plutôt mettre ça dans la citerne et reviens avec l’eau.»
Anastasie courut jeter le bloc de soufre dans l’énorme tonneau posé sur deux parpaings. Le cube disparut lentement dans les profondeurs aveugles. Quand elle se pencha au-dessus, l’eau ne lui renvoya pas tout de suite son visage. Il y eut d’abord les grandes ondes charbonneuses, puis les minuscules tourbillons des larves qui
vivaient juste à la surface. Puis un rond de ciel bleu-noir.
Si elle se laissait happer par ce ciel inversé, pensa-t-elle, elle chuterait longtemps. Peut-être qu’elle finirait par arriver à la mer. Elle nagerait et ressortirait en France, trempée, blanchie par le sel. Sur le chemin, elle trouverait Treize et l’emmènerait avec elle. Ils seraient bien, ensemble. Elle lui sourirait tout le long du voyage. Ils trouveraient alors Espérance sous la neige et retourneraient avec elle au fond de la ravine. Elle la reconnaîtrait tout de suite et caresserait avec amour son pied déformé. Elles formeraient toutes les deux un cercle avec Treize au milieu, souriant, sa peau de bébé aussi brune, lisse et douce qu’une graine de tamarin.
Quand elle rentra dans la case en faisant bien attention de ne pas renverser une goutte de la casserole, Eucate l’attendait avec un verre rempli de riz. «Faudrait que tu apprennes à cuisiner toute seule, Nana. L’école, ça va bientôt finir.
– Je ne suis qu’en huitième.
– Tu iras jusqu’en sixième, si je peux. Mais après, ce sera tout. Je te l’ai déjà dit et je te le redirai encore pour que tu t’y fasses.
– Je serai contente de ne plus aller à l’école. Je travaillerai et on achètera enfin de la vaisselle convenable.
– Très bien. Parce qu’après la sixième, ce sera fini. Je l’ai dit au directeur.
– Et l’argent de ma mère?
– Elle n’en gagne pas assez pour que je t’envoie étudier plus de deux ans encore. Et puis, faut la laisser souffler.
– Je me débrouillerai. Je n’aurai pas toujours besoin de toi. Et j’ai jamais eu besoin de ma mère, qu’elle continue donc à passer du bon temps en France. »
Anastasie avait déjà bondi vers la porte. Elle jeta un dernier regard aux bras tavelés de sa grand-mère, donna un coup de pied dans une grosse coquille vide d’escargot puis disparut. Eucate secoua légèrement la tête. Des gamins avaient sans doute encore rapporté à Anastasie qu’ils avaient vu son vrai père parader dans le bourg,
toute sa petite famille à son bras.
Neuf ans plus tard, Eucate pense la même chose: c’est toujours après des histoires concernant Santarèm qu’Anastasie affiche une drôle d’humeur. Songer à sa petite-fille lui procure un sentiment de tendresse impuissante. Mais contrairement à ce qu’elle a éprouvé pour Ange des années auparavant, ses pensées au sujet d’Anastasie demeurent teintées d’un peu d’optimisme. C’est ce qu’elle se dit alors que les pales d’un hélicoptère hachent le ciel cotonneux au loin, dans une tentative dérisoire de deviner ce que le volcan mijote pour les heures à venir.
En 1976, si Anastasie osait interroger Daniel, il lui parlerait de cette vieille DS de 1967 comme du premier signe que quelque chose s’était définitivement brisé dans le cœur de son frère. Et en effet, Ange avait commencé à sombrer bien avant que le volcan ne fasse définitivement voler en éclat ses rêves de France et de foyer uni avec Lucette et leur fille Coralie. Simplement, le réveil du volcan éclaire un instant le voyage qu’il a entamé dès l’enfance dans un enfer pavé de questions sans réponses, de solitude et de honte, tout bonnement de honte.
II
«Cette année-là, Ange a fait une fête à tout casser chez lui, à Saint-Claude», se remémore Daniel, assis à côté d’Elias, qui ne répond rien.
On ne voit pas le visage d’Elias sous son chapeau de feutre râpé, mais il écoute. Peu importe le sujet, il est heureux de converser avec son fils. Il n’en revient pas de parler à Daniel autrement qu’à travers un câble qui, d’après ce qu’on dit, court sous la mer sur des milliers de kilomètres avant de ressortir sur le corail blanchi de la côte. Il se demande comment il est possible de faire passer les mots au fond de toute cette eau sans que rien ne vienne fausser ce qui se dit. Il se demande si les mots passent mieux en ce moment, alors qu’il peut enfin toucher le bras de Daniel. Peu importe.
«Tu t’en souviens ? » insiste Daniel.
Elias hoche la tête même s’il n’a aucun souvenir de cette fête de 1967 de l’autre côté de l’île. Maintenant que Daniel est là, en ce rutilant mois de juillet 1976, tout va s’arranger. La première fois depuis dix-sept ans qu’il peut s’asseoir à côté de lui. Quand Daniel avait quitté l’île, son visage était encore rond avec l’opacité de l’adolescence renfermée. Il ne l’avait même pas vu en habit militaire, parce que Daniel était venu lui dire au revoir la veille, vêtu en civil. Ce n’était alors qu’un gamin de dix-sept ans.
Son plus jeune fils. Et le voilà revenu, marié avec deux enfants.
Elias mesure le temps passé au fait que pendant longtemps, il n’a eu des nouvelles de Daniel que par courrier. Une lettre tous les six mois environ. Parfois un an. Une année, une carte postale de Châteauroux, belle et grande cité comme on n’en trouve qu’en France. Il a soigneusement rangé la carte dans la petite commode au pied de son lit.
Quand Daniel lui a écrit pour lui annoncer son mariage avec une Blanche, les frères et sœurs d’Elias ont fait la moue. Campée sur le pas de la maison où elle a élevé ses cinq enfants, Atémise a serré les lèvres et calé son poing sur sa taille. Joël, celui qui vient juste après Elias, a secoué sa tête chauve d’un air écœuré: «Voilà ce que c’est de partir en France. » Elias a passé la main sur son crâne rasé et n’a rien dit, mais il a écrit le lendemain à Daniel pour lui dire son fait. Jamais, de son vivant, son fils ne gâterait le sang des Bévaro en épousant une Blanche.
Dix jours plus tard, il a reçu la réponse de Daniel, sèche et pugnace. Les frères et sœurs d’Elias ont continué à affirmer que ce n’était pas bon signe, mais Elias n’a plus jamais fait la leçon à son fils. Dans la lettre suivante, il lui parlait à nouveau de l’état des bœufs, des dernières colères de Berthe et des allées et venues incessantes des camions depuis qu’il avait autorisé le Kouli à extraire du tuf du morne dominant la partie la plus isolée des terres.
Dans sa dernière lettre, Daniel lui a écrit de se rendre le lundi suivant à quatorze heures précises au bureau de poste. Elias s’y est fait emmener par son neveu, le deuxième fils d’Atémise, qui conduit une mobylette. Il aurait pu y aller à pied, il l’a souvent fait. Une heure de marche à peine sans ces satanées chaussures qui lui font mal. Ils sont arrivés à la Poste bien avant la réouverture de l’après-midi. Assis sur les marches, Elias a attendu, ses larges orteils brun et ocre habitués à la terre écrasés dans ses chaussures de ville. Il n’avait rien emporté pour déjeuner. Il a eu le temps de saluer tous les hommes et femmes qui passaient par hasard devant lui. Parce qu’il est né là, au milieu de cette Grande-Terre plate et recuite comme un galet, il connaît tout le monde, depuis soixante-quinze ans qu’il sillonne les deux côtés si différents de la Guadeloupe. Il écoute ceux qui lui parlent de la Sécurité sociale et des droits qu’ils sont censés obtenir à égalité avec les Blancs. Ceux qui ont passé la journée à ramasser des bouts de ferraille pour les revendre au kilo mais font semblant d’avoir un bon job en ville. Les gens de sa génération comme les plus jeunes le saluent avec respect.
Lorsque le bureau a rouvert, il a expliqué son cas.
L’employée aux cheveux crantés avec du gel et au rouge à lèvres très brillant l’a mené jusqu’à l’un des téléphones accrochés au mur. Il a attendu encore une demi-heure en plaisantant avec les gens qui venaient timbrer des lettres,
recevoir des mandats ou téléphoner, comme lui.
À quatorze heures pile, l’appareil a sonné. Derrière les grésillements, Elias a entendu la voix de Daniel. Il a tenté de chasser l’idée de ces paquets d’eau par-dessus la voix de son fils et s’est mis à parler fort en agitant son bras pour ponctuer ses dires: la vache vendue au meilleur prix, le terrain où il a installé le fils d’Abeau sa sixième sœur.
Les reproches de Berthe au sujet de l’argent. Daniel lui a annoncé son arrivée en juillet prochain. Il lui a répété plusieurs fois l’heure et la date de son vol Air France. Il lui a dit de bien préparer leur venue à tous les quatre. Elias a promis que tout serait prêt et qu’il serait à l’aéroport du Raizet pour les accueillir.
Une fois qu’il a eu raccroché, Elias a clamé la nouvelle à la cantonade. Les gens du bureau de Poste lui ont serré la main ou tapé dans le dos. L’employée l’a félicité. «Ça fait plaisir de retrouver son enfant », elle a dit en hochant la tête d’un air satisfait comme s’il avait remis
quelque chose en place dans l’univers. «Vous allez lui réserver un bon accueil après tout ce temps. »
Elias compta que d’ici huit mois, en juillet, Daniel serait là, en vacances avec l’inconnue qu’il avait épousée et leurs deux enfants. D’après ce que son fils lui avait expliqué, comme ils avaient plus de quatre ans d’ancienneté, l’hôpital leur octroyait un mois complet de congé et la moitié du prix des billets d’avion. Pour la petite Adèle qui n’avait pas deux ans, ils ne payaient rien. Elias sortit de la Poste en repoussant son chapeau sur sa nuque, prêt à dérouler l’heure de marche. Il songeait à tout ce qu’il devait faire. D’abord, quitter la vieille case délabrée où il vivait seul depuis la mort des parents, son père en 1950, sa mère trois ans plus tard. Il était désormais le chef de la famille Bévaro, l’aîné de quatorze frères et sœurs. Il avait donc été normal qu’il prenne la minuscule case qui, d’après les habitants, était déjà là lorsque l’abolition de l’esclavage avait été déclarée, et personne ne lui avait disputé ce privilège. Mais rien ne l’avait poussé à entretenir l’endroit qui à présent se résumait à une ruine adossée à une autre ruine, près de l’école où ses trois enfants, Berthe, Ange et Daniel, avaient appris à lire et à compter.
Impossible d’accueillir là sa bru. Il savait où il allait faire construire la nouvelle maison.
Tous les habitants du bourg, surtout la flopée de Bévaro, le traitèrent à voix basse de fou quand il montra le terrain bosselé, perdu au milieu des champs de canne, suintant d’eau dans un migan de vert et de jaune à deux heures de marche du centre-ville. Pas de route digne de ce nom. Seulement d’énormes manguiers crépus, une galaxie de moustiques et une fois par jour entre juillet et octobre, au temps des récoltes de canne, des charrettes tirées par des bœufs d’une tonne qui encornaient le ciel fumeux en ahanant. Évidemment, il ne fallait pas compter sur l’électricité ou l’eau courante. Ce bout de campagne avait été oublié du développement poussif de l’île. La nuit dans ces empans à moitié en friches n’était qu’une béance emplie de criquets et de grenouilles hystériques. Elias n’en avait cure. Il tenait à vivre au milieu des terres héritées de ses parents. C’était lui qui les surveillait et attribuait une parcelle à chaque descendant en y plantant un gommier, si bien que là où un étranger ne voyait qu’un fouillis de mornes et de méplats jusqu’à l’horizon, Elias savait exactement ce qui revenait à chacun, tirant de cette charge une fierté bruyante. La plupart du temps, les frères et sœurs, cousins, neveux, parents plus ou moins éloignés, n’avaient rien d’autre à faire que lui apporter un litre de rhum ou un coui rempli de viande pour se voir attribuer un carré qu’ils se hâtaient de délimiter avec du fil et de louer à d’autres paysans. S’ils ne voulaient pas entendre parler
de la terre où avaient trimé leurs aïeux d’abord sous le fouet, puis dans l’espoir d’un avenir possible pour leurs enfants, ils pouvaient obtenir à la place une belle somme d’argent qu’Elias tirait du fond de ses poches. Dieu seul savait d’où il sortait ces poignées de billets froissés car depuis que la canne n’avait plus d’avenir, la terre ne rapportait quasiment rien, ne parlons même pas des bœufs aux côtes saillantes: les gens préféraient acheter des morceaux de charolaise ou de normande chez Prisunic.
Les autres Bévaro, agglutinés dans le bourg, étaient bien contents qu’il se charge de surveiller ces mottes glaiseuses où n’importe quel voisin attachait ses animaux en saluant de loin Elias, d’un geste vague mais toujours renouvelé, qui le remplissait de contentement. Les Bévaro l’encourageaient même, en lui rappelant souvent
qu’il était le chef de la famille. «Huit mois, ça ne sera pas suffisant », déclara Lormel, le quatrième frère d’Elias, en jaugeant l’endroit derrière ses lunettes de clerc de notaire.
Elias s’était frotté les mains sur son pantalon, les pieds enfoncés dans des bottes raccourcies au couteau. En ville, il avait posé, sur le bureau d’un entrepreneur recommandé par un ami, deux liasses chiffonnées assorties d’une poignée de main.
Les planches et le ciment arrivèrent la semaine suivante. Le travail se fit, lent mais régulier, interrompu seulement quand les pluies étaient trop abondantes, transformant le terrain en marécage, ce qui n’arrivait qu’en novembre et un peu avant Noël. En mars, la case (deux chambres et une pièce au milieu) était presque
achevée. Elle était posée sur une vraie chape de ciment, au bord du chemin emprunté par les charrettes, non loin de l’endroit où Elias, à la naissance de Berthe puis d’Ange puis de Daniel, avait planté dans la terre grasse mêlée au placenta un pied coco.
Les trois cocotiers s’élancent désormais à plus ou moins vingt mètres de hauteur. Le plus petit est celui de Daniel. « Il a fait une grande fête où il y avait une cinquantaine de personnes, reprend Daniel. Ses ouvriers et ses clients. Lucette, enceinte, mais ça ne se voyait pas encore. » Daniel parle comme s’il y avait assisté; c’est sa façon d’abolir le temps de son absence. « Il a embauché trois musiciens parce que la platine et les baffles installés dehors avec une rallonge, ça ne lui suffisait pas. Il voulait que tout le voisinage en profite. Au bout d’une heure, il était perché sur la DS. Celle qui était hydropneumatique. Tout le monde l’a vu danser sur le toit, dans ses chaussures pointues bien cirées et son costume cintré. La voiture tanguait. Il biguinait les yeux fermés, une main à plat sur l’estomac, l’autre en l’air. »
Elias hausse les épaules. Daniel continue parce qu’il veut bien faire comprendre l’enchaînement des choses à son père.
«Après la fête, il a pris le bateau pour Le Havre.
J’imagine que Lucette l’a accompagné à l’embarcadère et a agité son mouchoir. » Là, Daniel ne peut s’empêcher de penser que la femme d’Ange a été secrètement soulagée de le voir embarquer. Mais il ravale vite cette idée parce qu’être enceinte et voir son homme partir peut être une calamité comme une bénédiction. Il continue son récit d’une voix calme.
«Quand le bateau a fait escale à Porto Rico, il est allé se promener à terre et va savoir ce qu’il a fait pour rater le départ. Le voyage s’est arrêté là pour lui. Il a dû aller au consulat et raconter des salades. Là-bas ils ont tout de suite vu qu’il n’était pas dans son état normal. Ils l’ont rapatrié ici.
– Ouais ? fait Elias, en secouant la tête.
– Ensuite j’ai eu le coup de fil et il a fallu que je m’en occupe. Et puis que j’aille jusqu’au Havre récupérer ses affaires.»
Elias contemple la campagne tranquille. Daniel regarde son père puis lève les yeux vers le tumulte doux du vent dans les feuilles. Au loin, l’énorme trou creusé dans le tuf du morne offre sa blancheur douloureuse, marbrée de roux. Deux camions-bennes gisent au pied de la colline comme des éléphants au repos. Lorsque
Daniel est allé voir l’homme qui creuse ainsi les terres de son père et ne reverse qu’un maigre pourcentage de ses larges bénéfices, le type l’a toisé et a fini par déclarer : « Ici, on n’aime pas les étrangers qui viennent faire la loi. »
La remarque a électrifié Daniel. Une colère qui demandait à sortir depuis pas mal de temps s’est lovée juste au creux de sa poitrine. Il a répondu sèchement: « Je suis né ici, je vous signale.
– Ça fait longtemps, alors.
– Pas si longtemps.
– Alors c’est que vous avez oublié comment ça se passe.
– J’ai rien oublié du tout, justement. Vous devriez payer mon père beaucoup plus. »
L’homme s’est mis à agiter les poings, à éructer des mots en créole, mais comme Daniel ne bougeait pas et pire, semblait tenir à son idée, l’homme a essuyé son visage avec le chapeau qui écrasait ses cheveux raides et s’est dirigé d’un pas rapide vers le coffre de sa camionnette. Il en a sorti un coutelas. Le coutelas restait le long de sa cuisse mais rythmait de sa menace noire les paroles jetées à Daniel: « Je me suis mis d’accord avec Elias. Et parce que vous êtes là quelques semaines, vous voulez tout changer ? Je le redis, c’est pas un étranger qui va commander ici.
– Je parle pour mon père, né ici, comme ses parents et ses grands-parents. D’ailleurs, on était ici bien avant vous et vos familles qui ont débarqué d’Inde après l’abolition. »
Le Kouli a hurlé que lui n’avait jamais quitté la Guadeloupe, et sa voix résonnait dans tout le morne, suscitant une curiosité que Daniel pouvait sentir derrière les fenêtres aveugles des cases alentour. Elias est arrivé pour calmer les choses entre son fils et l’homme qu’il a laissé transformer le morne vert en carrière poussiéreuse contre quelques billets et une montre plaquée or. Les choses en sont restées là. Daniel a fini par tourner le dos à son père et au Kouli en haussant les épaules. Plus tard, il a eu honte de ses propres paroles. De leur inutilité surtout. Cette course à qui est plus guadeloupéen que l’autre, c’est absurde. Ça allait jusqu’au fonctionnaire blanc détaché dans l’île, qui avait un jour craché au visage d’Elias: « Ici, c’est chez nous. Si vous n’êtes pas content, retournez en Afrique. » Elias en riait encore en
le racontant à Daniel.
Daniel s’est juré de ne plus jamais répondre aux provocations qui peuvent surgir de partout. D’abord, pour préserver Elias. Ensuite, pour ne pas gâcher ses vacances. Car il doit se faire une raison: son retour dans l’île, après dix-sept ans d’absence, est un retour de « vacancier ».
Chaque matin et chaque soir désormais, et pour le reste des vacances, il salue de loin, d’un geste de la main, le Kouli qui lui répond de la même façon. Jusqu’au jour où l’homme se présente devant la case d’Elias et tend une bouteille de rhum à Daniel en disant: «Bon, sa ja fèt, laissé sa tombé : ça va, on ne va pas se fâcher pour ça. »
Extraits
« Depuis son arrivée, il réapprend le paysage, bouche les trous des souvenirs. Les distilleries s’effondrent désormais en ruines rouillées au coin des chemins, les ponts de son enfance disparaissent sous la végétation, la plage a été éventrée par un promoteur immobilier. Les villes côtières se gonflent de touristes couverts d’huile bronzante. Et lui, il ne sait plus comment l’aimer, son île. » p. 38
« La veillée dure quatre jours chez Elias, mais Eucate repart le matin suivant avec le car de six heures. Il lui faut trois cars différents et l’aide de deux ou trois automobilistes pour rejoindre sa case, et durant tout le voyage, elle ne cesse de revoir le sourire d’Ange, la première fois qu’il est apparu devant elle sur son vélo, les moments qu’ils ont passés ensemble. Les larmes qui lui viennent sont invisibles. Elle accepte enfin ce que la vie lui a donné puis repris, heureuse de retourner au volcan et d’y gratter encore un peu l’humus vivifiant, heureuse de survivre au mal, comme chacun sur cette Île sans cesse secouée par les ouragans, les famines, le progrès, l’avidité et l’incroyable sentiment de supériorité des Blancs. » p. 189
À propos de l’autrice

Estelle-Sarah Bulle © Photo Patrice Normand
Estelle-Sarah Bulle est née à Créteil d’un père guadeloupéen et d’une mère franco-belge. Elle a publié trois romans aux éditions Liana Levi, Là où les chiens aboient par la queue (prix Stanislas), Les Étoiles les plus filantes, et Basses terres. Elle écrit également pour la jeunesse. (Source: Éditions Liana Levi)
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#BassesTerres #EstelleSarahBulle #editionslianalevi #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #Soufriere #Guadeloupe #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie








 Aline Caudet © Photo Astrid di Crollalanza
Aline Caudet © Photo Astrid di Crollalanza


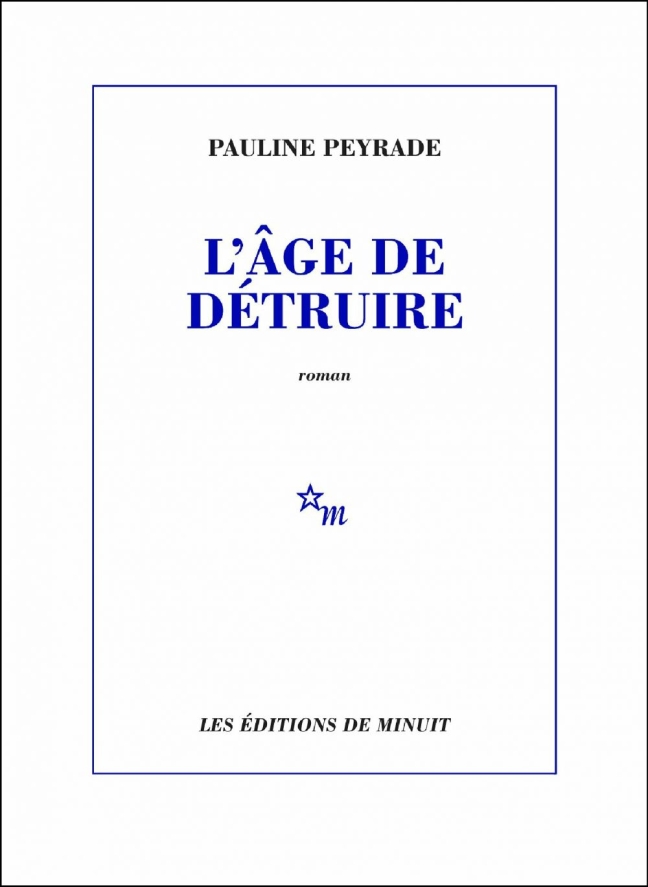



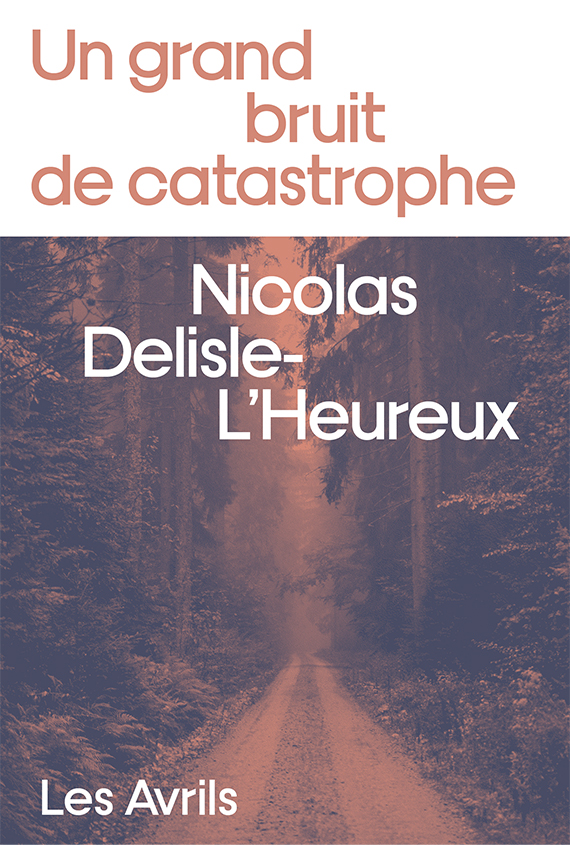


 Nicolas Delisle-L’Heureux © Photo Chloé Vollmer-Lo
Nicolas Delisle-L’Heureux © Photo Chloé Vollmer-Lo


 Sophie Wouters © Photo DR
Sophie Wouters © Photo DR

 Sigrún Pálsdóttir © Photo DR
Sigrún Pálsdóttir © Photo DR




 Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Véronique Kingsley
Gabrielle Filteau-Chiba © Photo Véronique Kingsley


 Elsa Fottorino © Photo DR
Elsa Fottorino © Photo DR
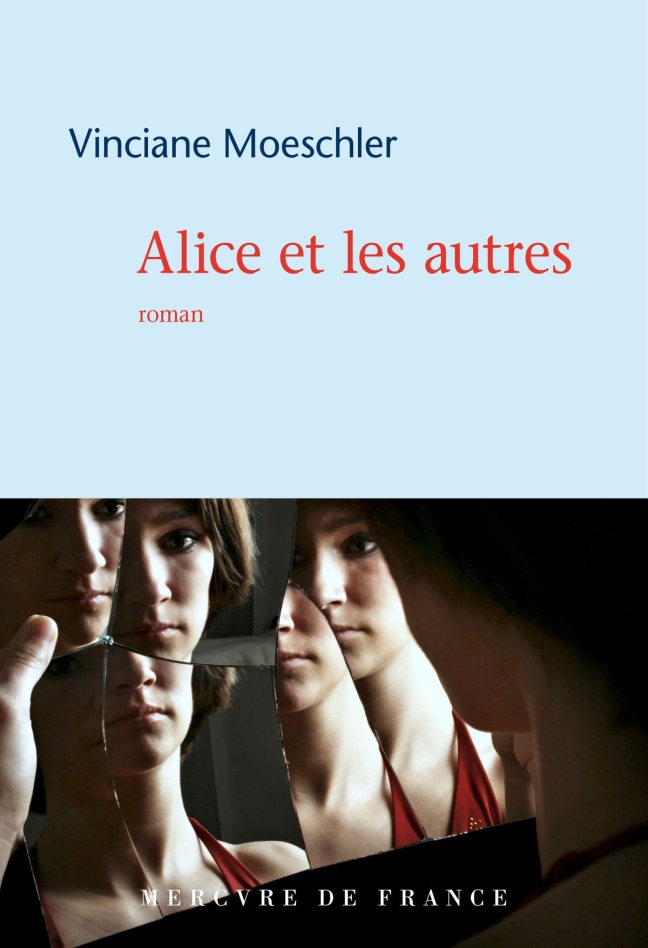
 Vinciane Moeschler © Photo Céline Lambiottez
Vinciane Moeschler © Photo Céline Lambiottez