
Finaliste du Prix de la Closerie 2024
En lice pour le Prix France Bleu – Page des libraires 2024
En lice pour le Prix Nice baie des Anges 2024
En deux mots
Parmi les pensionnaires de la Salpêtrière, 90 femmes sont choisies pour rejoindre la Louisiane, épouser les colons et peupler la colonie du Mississipi. Mais après avoir débarqué en Louisiane en 1721, Geneviève, Charlotte, Pétronille et leurs sœurs d’infortune connaîtront des destins très différents.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Trois femmes dans le Nouveau Monde
En explorant un pan méconnu de l’Histoire des colonies françaises, l’envoi de femmes pour peupler ces vastes territoires, Julia Malye réussit une admirable fresque autour d’un trio de femmes bien décidées à cesser de subir la loi des hommes. Documenté, dense et poignant.
En cette année 1720, John Law, le contrôleur général des finances voit son système s’effondrer avec les actions du Mississipi, l’obligeant à se retirer. Si la colonie est loin de regorger de l’or et d’autres richesses miroitées, le Roi Louis XV n’entend pas l’abandonner et décide de plusieurs expéditions. Il ordonne notamment l’envoi de femmes à Biloxi, situé dans un pays marécageux, aux eaux malsaines et au sol stérile, où il a à érigé un fort.
C’est à Marguerite Pancatelin, la Supérieure de la Salpêtrière, qu’échoit la tâche de dresser la liste des volontaires qui seront aptes à affronter un tel voyage et qui peuvent enfanter.
Ajoutons d’emblée que ses pensionnaires sont plutôt réticentes et qu’à part Geneviève, prisonnière à la Grande Force et qui n’a plus grand chose à perdre, personne ou presque n’est candidate pour cette mission. Alors elle choisit toutes celles qui lui semblent convenir, allant même jusqu’à désigner une enfant de 12 ans.
Encadrées par des religieuses, les femmes quittent Paris pour les bords de Loire avant de rejoindre la Bretagne et d’embarquer à bord de La Baleine pour un voyage périlleux.
Après bien des péripéties – le mal de mer, le confinement, une attaque de pirates – elles débarquent à Biloxi.
La seconde partie du roman raconte comment elles ont été mariées à peine débarquées et leur quotidien dans ces contrées hostiles, mais aussi combien le voyage leur a permis de mieux se connaître, de tisser des liens.
Charlotte, Pétronille et Geneviève vont toutefois connaître des destins bien différents. En les suivant au fil des années, Julia Malye nous raconte la vie des colons, entre les maladies, les ouragans, la guerre contre les tribus autochtones. Petit à petit, la région va tout de même parvenir à se développer avec l’arrivée d’une nouvelle génération, les enfants de ces femmes de la Salpêtrière.
Si ce roman est si réussi, c’est que ll’autrice s’est abondamment documentée, à la fois sur la Salpêtrière et sur la Louisiane, un territoire qui s’étendait alors jusqu’au Canada. Les conditions de vie, la faune et la flore, les populations autochtones et les esclaves, le climat, rien ne manque. Pas même le romanesque et ses rebondissements en cascade.
La Louisiane
Julia Malye
Éditions Stock
Roman
560 p., 23 €
EAN 9782234094116
Paru le 3/01/2024
Où?
Le roman est situé à Paris, puis au terme d’un voyage le long de la Loire jusqu’en Bretagne et plusieurs mois en mer, à Saint-Domingue puis à Biloxi. On y sillonne ensuite les contrées et villes de Louisiane.
Quand?
L’action se déroule de 1720 à 1739.
Ce qu’en dit l’éditeur
« Pour la première fois depuis trois mois, elles discernent enfin le sable que leur cachait l’eau lors de la traversée de l’Atlantique, ce fond de l’océan qu’elles ont brièvement aperçu ce matin en débarquant de La Baleine. Personne ne leur a expliqué où elles seraient logées ce soir, dans combien de temps elles seraient fiancées. On ne dit pas tout aux femmes. »
Paris, 1720. Marguerite Pancatelin, la Supérieure de la Salpêtrière, est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes «volontaires» qui seront envoyées en Louisiane afin d’y épouser les colons français.
Parmi elles, trois amies improbables : une orpheline de douze ans à la langue bien pendue, une jeune aristocrate désargentée et rejetée par sa famille ainsi qu’une femme condamnée pour avortement. Comme leurs compagnes à bord de La Baleine, Charlotte, Pétronille et Geneviève ignorent tout de ce qui les attend au-delà des mers. Et n’ont pas leur mot à dire sur leur avenir.
Ces étrangères réunies par le destin devront braver l’adversité – maladie, guerre, patriarcat –, traverser une vie faite de chagrins d’amour, de naissances et de deuils, de cruauté et de plaisirs inattendus. Et d’une amitié forgée dans le feu.
Un roman d’une profondeur et d’une émotion saisissantes, qui nous transporte au cœur d’une terre impitoyable, aux côtés d’héroïnes animées d’une extraordinaire soif d’amour et de vie.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France Inter
Quotidien
La Presse (Laila Maalouf)
Le Journal de Québec (Marie-France Bornais)
Le Devoir (Caroline Monpetit)
Culture tops (Cécile Rault)
RFI (Vous m’en direz des nouvelles)
Page des libraires (entretien mené par Linda Pommereul, Librairie Doucet, Le Mans)
Blog La Culture dans tous ses états
Blog de Médiapart (Patrick Le Henaff)
Blog Au fil des livres
Blog The Unamed Bookshelf
Blog Charlotte parlotte
Julia Malye présente son roman «La Louisiane» © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
En 1720, le navire La Baleine quitte la France, emportant à son bord des femmes élevées ou enfermées à l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris. Elles embarquent pour la Louisiane à un moment où les colons ont désespérément besoin d’épouses et rejoignent en 1721 ces contrées aussi connues sous le nom de « Mississippi ». Inspiré de leur histoire, ce roman est un hommage à toutes ces femmes qui, pendant trop longtemps, ont sombré dans l’oubli, en France comme aux États-Unis.
Partie I
À leur arrivée en Louisiane, elles sont aveuglées. Le soleil tombe sur Biloxi, étonnamment éblouissant pour un après-midi de janvier. Les femmes clignent des yeux dans la lumière d’hiver et bientôt la plage blanche et sa foule immobile apparaissent, des hommes hâlés et émaciés dressés sur la pointe des pieds. Dans les pirogues, les passagères se serrent les unes contre les autres. Les semelles de leurs chaussures sont si élimées qu’elles devinent les aspérités du bois. Quand les marins arrêtent de ramer, à quelques mètres du rivage, certaines tentent de se lever. Sous leur poids, les pirogues ondoient ; l’air humide colle à leurs gorges comme du pain mouillé.
Pour la première fois depuis trois mois, elles discernent le sable que leur cachait l’eau lors de la traversée de l’Atlantique, ce fond de l’océan qu’elles ont brièvement aperçu ce matin en débarquant de La Baleine. Personne ne leur a expliqué où elles seraient logées ce soir, dans combien de temps elles seraient fiancées. On ne dit pas tout aux femmes.
Certaines se penchent par-dessus le plat-bord. Roches, coquillages, poissons : leurs écailles brillantes, leurs mouvements vifs, un éclat argenté logé dans le coin du regard. Lorsqu’un cri retentit, les passagères s’agitent dans les canoës. Une jeune fille bascule dans la mer avec un bruit mat. La pirogue vacille dangereusement, ne se retourne pas, et plusieurs mains se tendent vers la naufragée. Sous l’eau, sa robe sombre se déploie comme de l’encre. Elle cesse soudain de se débattre. Contrairement à tout ce que les femmes ont toujours cru savoir des flots qui les ont menées jusqu’ici, elle ne coule pas. Elle a pied. Elles la regardent se redresser, le dos droit et le corps tendu, son souffle court balayant la surface, la tête tournée vers la plage où la rumeur des hommes se mêle au ressac de la mer. Ses compagnes l’imitent, l’air inquiet, enthousiaste, nerveux. Elle n’essaye pas de remonter dans la pirogue. Elle se dirige vers le rivage. Ses cheveux sont un masque noir plaqué contre ses tempes.
Les femmes font la seule chose qu’il leur reste à faire – elles attrapent la main la plus proche et sautent.
MARGUERITE
Paris, mars 1720
Marguerite doit dresser une liste. Elle replie la lettre de l’avocat général, s’efforce de trouver une meilleure posture pour sa jambe raide. Après la pluie de ces derniers jours, la douleur enfle de ses orteils à sa cuisse, bourgeonne jusque dans les articulations de ses mains. C’est l’heure où les filles ont quitté les ouvroirs, où les voix récitant les derniers psaumes se sont tues, où les sœurs officières lui ont remis leurs derniers inventaires. Les ateliers sont fermés et les artisans retirés dans leurs logements. On n’entend même plus les prisonnières des loges aux folles. Marguerite enlève sa coiffe. Elle ne devrait pas être à son bureau après le coucher du soleil mais dans son jardin, sous le mimosa en fleur, avec ses épais bouquets qui lui rappellent les perruques de certains hommes. Là, au milieu des pâquerettes et des asphodèles, elle parvient à oublier la véritable odeur de la Salpêtrière.
Elle ouvre un dossier presque vide. Ses mains sont devenues maladroites, agitées de tremblements soudains, et la liste de l’année précédente manque de filer sous le secrétaire. Depuis presque un an et demi, elle choisit les femmes envoyées au Mississippi. Sa première sélection a plu à l’avocat général ; dans son courrier, M. Joly de Fleury lui annonce que le gouverneur de Louisiane en personne réclame davantage d’épouses pour la colonie. Marguerite approche la bougie de la feuille. Ce soir, elle ne sait pas par où commencer.
Les choses étaient différentes l’hiver dernier. L’idée de transférer des détenues au Mississippi était la sienne : elle avait été libre de choisir les candidates idéales. À la Salpêtrière, il ne restait plus assez de lits pour celles qui avaient véritablement besoin d’un refuge. Les dortoirs étaient occupés par des filles qui ne changeraient jamais. Il lui avait suffi de décider de qui elle voulait se débarrasser en premier – des empoisonneuses, des libertines, des rebelles ou des sorcières.
Oui, cette première liste comprenait toutes sortes de prisonnières. Des deux cent neuf pensionnaires sélectionnées l’an passé, elle se souvient particulièrement bien de l’affabulatrice qui, depuis la prison des femmes, avait passé son temps à hurler des insultes sordides contre le roi. Mais cette fois, fini les filles enfermées à la Grande Force. M. Joly s’est montré clair : le gouverneur Bienville ne veut plus d’anciennes détenues, mais demande environ quatre-vingt-dix futures mères. Des femmes fertiles, compétentes, discrètes. Ce qui, pour Marguerite, signifie des repentantes de la Maison de Correction ou des filles de l’orphelinat de la Salpêtrière, la Maison Saint-Louis. Elle imagine aussitôt Charlotte Couturier, l’orpheline rousse de douze ans, embarquant pour la Louisiane, cette contrée inconnue et barbare qui lui inspire plus de crainte que d’admiration. Non, pas Charlotte. La fillette restera à la Salpêtrière, sauve ; dans quelques années, elle pourra y devenir sœur officière. Le Mississippi a besoin de femmes fortes.
Elle remue sa plume dans l’encrier. L’affabulatrice avait une sœur, plus jeune, pas encore corrompue. Marguerite essaye de se souvenir de son prénom, mais seul son nom lui revient. Sous le titre « Passagers de La Baleine », elle écrit : « 1) Étiennette (ou Antoinette ?) Janson – entre 15 et 17 ans. »
Plus que quatre-vingt-neuf noms à ajouter. Marguerite s’appuie contre le dossier de sa chaise, et la douleur galope de ses pieds à son cou. Dans le pot en porcelaine, l’encre se souvient des cercles dessinés par sa plume.
« Madame ? »
De l’autre côté de la porte, la femme répète le même mot d’une voix plaintive. Mlle Bailly sait qu’elle n’a rien à faire ici après complies, la dernière prière du soir.
« Qu’y a-t-il ? »
La porte en bois gémit lorsque sa nouvelle assistante entre dans la pièce. Ses gestes reflètent sa manière de penser – grossière, méticuleuse, timorée.
« Que voulez-vous ?
– La sous-officière de la Grande Force a signalé de nouveaux cas de morsures de rat. »
La peur qui transparaît dans ses yeux exaspère Marguerite. Une fois de plus, son assistante est incapable de se débrouiller seule.
« Dites-moi donc quelque chose que je ne sais pas déjà, Mlle Bailly.
– La démente. Émilie Le Néant. »
Marguerite touche sa mauvaise jambe du bout des doigts.
« Avez-vous appelé les gardes ? Où est la sœur officière ?
– Ils ont essayé, en vain. Elle refuse de se calmer. »
Évidemment. Même le fouet n’a rien donné avec Le Néant. Un mois plus tôt, Marguerite a ordonné que la fille soit tenue à l’écart de tout sacrement – il n’y a plus rien à espérer d’une femme se vantant de ne pas avoir fait le signe de croix depuis dix ans.
« Les autres prisonnières commencent à s’agiter. »
Marguerite prend appui sur son secrétaire pour se redresser. On ne peut pas se passer d’elle. Ces derniers temps, cette pensée lui vient de plus en plus souvent, et avec elle un sentiment de fierté, de soulagement. Puis lui succèdent l’épuisement et la peur.
« Dépêchons. »
Elles ne peuvent pas se dépêcher. Marguerite fait de son mieux pour traverser la cour Lassay d’un pas rapide, mais elles doivent s’arrêter devant le dortoir Sainte-Claire. La nuit est tombée, l’obscurité engloutit les quelques ouvriers qui se hâtent de rentrer chez eux, les sœurs vérifient que les pauvres sont bien couchés et qu’ils ont assez d’eau pour la nuit. Mlle Bailly scrute l’église Saint-Louis comme si elle venait de découvrir ses quatre nefs. Appuyée contre le mur, Marguerite attend que la douleur se résorbe avant de se remettre en marche.
Elles coupent par le bâtiment des Vieilles Femmes et Marguerite avance en regardant droit devant, jusqu’à ce qu’elles atteignent la cour Sainte-Claire. D’autres pavés ici, de petits pièges qui agrippent le bout de sa canne. La Salpêtrière, sa cité, lui semble immense ce soir. À leur droite, les bâtiments Saint-Augustin et Saint-Jacques sont silencieux – il ne reste plus qu’une seule fenêtre éclairée dans l’atelier des Jeunes Filles. Un éclat de rire transperce soudain la nuit, juste à côté de la prison. Alors qu’elles pénètrent dans la rue du Corps-des-Gardes, d’autres sons leur parviennent : les pleurs des logements des petits garçons, les grognements de l’enclos des cochons, les insultes du bâtiment des Archers. À gauche, la prison de la Grande Force se dresse dans la nuit. Il y a dans ce quartier quelque chose de vicieux qui affecte toujours Marguerite. Si elle avait eu la charge de la construction de la Salpêtrière, elle aurait fait bâtir les cellules des femmes à l’autre bout de la ville, où se trouvent actuellement les Cuisines et la cour des Chèvres. Elle aurait préféré garder les folles à la périphérie de l’hôpital.
« Par ici », lance Mlle Elautin.
Les gardes baissent la voix quand la sous-officière de la Grande Force apparaît sur le seuil de la prison ; leurs rires s’éteignent tout à fait une fois la porte refermée. Dans le couloir humide, l’odeur de renfermé, froide et écœurante, glisse dans la gorge de Marguerite.
« J’ai répété à Mlle Bailly qu’il était inutile de vous déranger, dit Mlle Elautin.
– Elle hurlait si fort qu’on l’entendait depuis le cimetière, explique Mlle Bailly.
– Il est grand temps que vous vous fassiez aux sons de cette institution, rétorque Mlle Elautin.
– Cela n’a plus d’importance. Racontez-moi ce qu’il s’est passé », intervient Marguerite.
À l’étage, on demande du vin, Pierre ou Jean, puis simplement de l’aide. La responsable croise les bras.
« L’une des prisonnières l’a calmée.
– Quelqu’un est entré dans la cellule de Le Néant ? » demande Mlle Bailly.
Marguerite lui jette un regard agacé.
« Bien sûr que non, répond Mlle Elautin. Si cela avait été le cas, vous auriez eu une bonne raison de déranger notre Supérieure.
– Qui l’a fait taire ? »
La bougie n’éclaire qu’une partie du visage de la sous-officière, et son profil aplati rappelle à Marguerite les têtes de carpes alignées dans un cageot.
« Une certaine Geneviève Menu. »
Habituellement, Marguerite se débrouille plutôt bien pour éviter de penser à sa sœur. Mais c’est pourtant Lucie qui a fait arrêter cette Geneviève Menu il y a deux mois, et qui l’a mise en garde contre les vices de son ancienne blanchisseuse. À cette occasion, sa sœur n’a pas manqué de rappeler à Marguerite ses liens avec des hommes puissants : avant que le fils de Lucie ne suive l’exemple de son père et ne devienne le nouveau chef de police, personne ne se souciait de contrôler les décisions de Marguerite. Elle n’avait eu aucun mal à déporter les femmes de son choix ; à présent, l’homme à la tête des autorités porte à nouveau le nom de sa sœur, d’Argenson, une famille de marquis et de comtes.
« Allons-y », déclare Marguerite et lorsqu’elle lève sa canne vers la prison, elle manque de peu la robe de Mlle Elautin. Penser à Lucie l’irrite.
Les deux autres femmes obéissent en silence. Elles traversent des antichambres désertes ; les murs aveugles donnent sur d’étroites cours, des cellules extérieures où le ciel n’est plus qu’un mince rectangle. Marguerite essaye de rassembler ce qu’elle sait de Geneviève Menu. À son arrivée à la Salpêtrière, elle était capable de retenir des centaines de noms et de visages. Elle se souvient encore de ceux des prisonnières enfermées aux loges aux folles il y a trente ans, des traits des jeunes protestantes qu’on lui avait confiées en 1700 après leur fuite avortée en Angleterre. Elle revoit les yeux de Charlotte, alors âgée de huit ou neuf mois, scrutant son visage puis celui de la responsable de l’orphelinat, un soir glacial de janvier 1709. Mais aujourd’hui, Marguerite est incapable de se remémorer précisément les accusations portées contre Menu.
La sœur officière se fige et le cliquetis de son trousseau de clés résonne dans le couloir. Mlle Bailly et un garde l’aident à ouvrir la porte.
« Le Néant est gardée à l’isolement, au fond. »
Marguerite se pince le nez. C’est le moment du mois où les dortoirs sentent le métal et la peau humide. Comme tous les hivers, le système d’évacuation qui longe le mur à l’est de la Salpêtrière a débordé quand les eaux épaisses de la Seine se sont mises à couler trop vite ; la prison trempe dans une odeur qui paraît aussi solide que de la boue séchée, de la fiente d’oiseau – une pestilence qui, Marguerite le sait, pénétrera le tissu de sa robe, se glissera sous sa coiffe. Dans l’obscurité, elle entend les corps remuer dans la paille, un sanglot sourd, une toux grasse, mais aucun des hurlements auxquels elle s’attendait. Elle s’arrête devant l’avant-dernière porte.
Au début, elle ne remarque rien d’anormal. La lumière de sa bougie traverse la première cellule, éclabousse la pierre d’une lueur jaune. L’air frais de la nuit coule depuis la lucarne, dissout momentanément les effluves fétides de la prison. Puis elle l’entend : un martèlement monotone et insistant. Marguerite connaît bien ce bruit – à la Crèche, elle a vu plus d’un bébé heurter son crâne contre son panier, se berçant avec de petits à-coups qui auraient dû être les caresses d’une mère. Le Néant gît immobile, endormie. Ses chevilles semblent plus maigres là où ses chaînes les encerclent ; la peau de ses bras est desséchée par le froid, son corps nu recouvert d’une couverture élimée. Le son ne faiblit pas.
En levant sa bougie vers la lucarne de la cellule mitoyenne, Marguerite y trouve une silhouette agenouillée, enveloppée dans une robe de tiretaine, les genoux enfoncés dans un matelas esquinté. Les doigts de la prisonnière sont rouges, abîmés par la pierre. Elle continue de taper du poing contre le mur, même lorsque Marguerite croise ses yeux délavés. La détenue la fixe juste assez longtemps pour que Marguerite aperçoive les vaisseaux sanguins qui tissent une fine toile autour de ses iris bleus. En rendant la bougie à la sœur officière, elle ne saurait dire qui a détourné le regard la première – elle, ou la femme qui travaillait pour sa sœur.
« Faites le nécessaire pour que cette pauvre créature soit vêtue », ordonne Marguerite à Mlle Elautin. « Et transférez Menu à la Maison de Correction. »
Mlle Bailly offre timidement son bras et cette fois-ci, Marguerite le saisit sans tarder. De retour à son bureau, elle ajoute un deuxième nom à la liste des futures passagères de La Baleine.
*
À l’arrivée de Marguerite à la Salpêtrière, l’Hôpital général avait treize ans, et elle dix-huit. Pour la dernière fois de sa vie, elle portait une robe bleu cyan, aux manches brodées de fil d’argent qui enserraient ses poignets comme des menottes. Ses cheveux avaient encore la couleur d’une pomme croquée. Marguerite n’avait pas choisi de devenir sous-officière mais elle était déterminée à ne pas rentrer chez elle, à ne pas se marier comme sa sœur.
On était en 1669. Molière était enfin autorisé à jouer sa pièce Le Tartuffe ; le comte de Grignan et Françoise-Marguerite de Sévigné venaient de célébrer leur union à l’église de Saint-Nicolas-des-Champs ; par un tiède après-midi d’avril, face à une foule silencieuse, Louis XIV embrassait les pieds de douze indigents. La veille du départ de Marguerite pour la Salpêtrière, Lucie ne parlait que de Paris. Assise à sa coiffeuse, elle étalait sur son visage un mélange d’œufs et de blanc de céruse, lissant les cicatrices creusées par la petite vérole qui avait ravagé sa peau claire. Elle avait dessiné des veines bleutées sur sa poitrine pour sembler plus pâle.
Marguerite se fichait des pièces de théâtre et des noces. Avant que son père décide qu’elle servirait un jour la cause du jeune hôpital, elle n’aurait pas non plus prêté attention aux pouvoirs guérisseurs du roi. Mais maintenant qu’elle était sur le point de s’installer à la Salpêtrière, elle écoutait avec intérêt les histoires d’indigents. Bientôt, elle vivrait parmi eux, les soignerait. En écoutant Lucie décrire les baisers royaux, Marguerite imaginait des orteils noirs et des ongles émaillés, les lèvres charnues du souverain. « Ne vous inquiétez pas », lui dit Lucie. « Là où vous allez, vous ne serez contrainte d’embrasser personne. Et je doute que vous touchiez qui que ce soit. »
Il s’avéra que sa sœur n’avait qu’à moitié raison. On ne s’embrassait pas à l’Hôpital général. Mais on se touchait. Après cinquante et un ans passés à la Salpêtrière, Marguerite ne saurait compter le nombre de mains malades qu’elle a dû serrer entre les siennes.
Enfant, son père lui parlait souvent des pauvres gens à Paris. Après la Fronde, il lui racontait des histoires de paysans dépossédés fuyant les campagnes, s’agglutinant dans des faubourgs si exigus que l’air et le soleil ne filtraient que par les cheminées. Il évoquait le quartier du Chasse-Midi où, la nuit, des garçons volaient des charognes aux abattoirs. En 1642, plus de trois cents hommes avaient été assassinés dans les rues de Paris ; son père répétait ces chiffres, émerveillé, comme s’il comptait des pièces d’or. Même après que la cour des Miracles avait été nettoyée, il continuait de lui décrire le faux soldat, celui qui enlevait les bandages de sa jambe soi-disant blessée après des heures passées à mendier. Son père parlait de lui comme s’il le connaissait personnellement ; sous l’hôtel particulier, la rivière charriait des os et des feuilles vers la Seine. Il fallut des années à Marguerite pour comprendre que son père ne connaissait rien à la condition des pauvres. Que les indigents n’avaient jamais été qu’un sujet de conversation pendant les conseils royaux, des fantômes derrière les rideaux de la berline qui le ramenait de Versailles.
Marguerite n’était pas le premier choix de son père pour travailler à la Salpêtrière. Quelques années après la création de l’Hôpital sur ordre du roi, il pensait y envoyer Lucie. L’idée n’avait surpris personne, pas même Marguerite. Lucie était vive et intelligente ; elle faisait preuve d’un entêtement que les gens prenaient pour de la patience ou de la détermination. Leur père était convaincu qu’avec ses idées et son audace, l’aînée ferait de l’Hôpital une institution moderne.
Il changea d’avis le jour où le futur lieutenant général de police demanda la main de Lucie. C’était un chaud matin d’hiver, le ciel orangé faisait fondre la neige. Il se tourna vers Marguerite ; il avait une façon de faire des propositions qui laissait ses interlocuteurs penser que l’idée venait d’eux. Il évoqua une fois de plus l’homme de la cour des Miracles jouant au soldat blessé, déclara que les gens comme lui avaient grand besoin de l’aide de filles comme elle.
Marguerite ignore toujours quel genre de fille elle est. Ce qu’elle sait, c’est qu’à soixante-neuf ans, elle essaye encore de prouver qu’elle aurait dû être le premier choix.
*
Les sœurs officières entreront bientôt dans le réfectoire et elles seront ravies de découvrir leur nouvelle mission. Depuis sa visite à la Grande Force, il y a cinq jours, Marguerite a décidé de demander aux responsables de chaque maison de composer une liste – une simple source d’inspiration pour l’aider à choisir les quatre-vingt-dix femmes qui partiront pour la Louisiane. Elle se penche près de la fenêtre. Elle pourrait décrire les yeux fermés ce qui se trouve de l’autre côté du bâtiment Mazarin et de l’atelier Saint-Léon : l’église Saint-Louis, et au-delà, un labyrinthe de cours, des dizaines de dortoirs et d’ateliers, suivis d’autres rues menant aux Cuisines, à la Lingerie et à l’Infirmerie, et enfin, au plus grand jardin de l’Hôpital, le Marais. Marguerite cherche du regard l’uniforme noir et blanc des sœurs officières mais l’heure du dîner approche et la foule grossit entre la Porte des Champs et l’Allée des Prêtres. Les apprentis chaudronniers et serruriers se hâtent de retourner aux ateliers de leurs maîtres. Au milieu des étals du marché, des garçons ramassent les pelures de légumes qui nourriront les cochons, des enfants de chœur sont rappelés à l’ordre par un prêtre. Quatre officières chargées de surveiller la distribution du repas se précipitent vers le bâtiment des Vieilles Femmes. Marguerite souffle. Elles sont en retard pour la bénédiction. Elle les imagine courir dans les escaliers ; elle voit les yeux vitreux qui les fixent, connaît le silence qui tombe au début de la prière. La Salpêtrière n’a pas de secret pour elle. Marguerite, mieux que personne, sait les devoirs de chaque quêteuse, veilleuse, palefrenier ou maîtresse d’ouvrage qui traverse les cours de sa ville.
« Madame. »
Elle se tourne juste à temps pour voir la responsable de la Maison de Correction se redresser de sa révérence. Mlle Suivit rougit en permanence, et Marguerite ne sait jamais si c’est à cause du froid, de la chaleur ou d’une autre émotion mystérieuse.
« Je voulais m’entretenir avec vous au sujet de la nouvelle pensionnaire. Geneviève Menu. Je doute qu’une femme comme elle soit capable de repentir. »
Marguerite avale une gorgée de vin. Il y a quelques années, personne n’aurait osé remettre en cause ses décisions – elle transférait les prisonnières d’un dortoir à un autre au gré de ses envies.
« Je crains ne pas être la seule de cet avis, reprend Mlle Suivit. Je pense que Menu devrait retourner à l’isolement.
– Auquel cas vous serez heureuse d’apprendre qu’elle ne restera pas dans votre maison bien longtemps. »
La sous-officière fronce les sourcils et Marguerite se rend aussitôt compte de son erreur. Elle s’est toujours efforcée de ne partager avec son personnel que le strict nécessaire ; ignorantes, ses équipes remettent rarement en cause ses choix. Dehors, les cloches de l’église sonnent sexte, la prière de midi, et trois gouvernantes entrent en chuchotant dans le réfectoire. La sœur officière de la Maison de Correction la fixe toujours – un regard plein de pitié et de nostalgie, de ceux qu’on lancerait à une poupée abîmée, un jour adorée.
De retour dans ses appartements, Marguerite n’est pas surprise de trouver une lettre de Lucie posée sur son secrétaire. Elle ne l’ouvre pas immédiatement, se dirige vers l’étagère où s’entassent les dossiers des pensionnaires. Les papiers les plus anciens ont pris la couleur brune des coquilles d’œuf ; le document qu’elle retire est d’un blanc laiteux. En haut de la page sont indiqués l’âge de l’accusée au moment de son arrestation (22), les noms de ses parents (Jacques Menu & Françoise Boisseau), la date de son incarcération (12 janvier 1720), la personne ayant demandé la lettre de cachet (Lucie de Voyer de Paulmy d’Argenson). Et, tout en bas, écrit si petit que Marguerite peine à déchiffrer les lettres tortueuses : avorteuse.
Elle sait ce qu’elle devrait faire : convoquer la sœur officière de la Grande Force, lui ordonner de ramener Menu dans sa cellule. Dans l’ouvroir le plus proche, les filles entonnent les litanies de la Sainte Vierge. Marguerite déplie la lettre de sa sœur. Lucie exagère tout. À douze ans, elle avait crié à l’empoisonnement le jour où une servante avait eu le malheur de lui servir une chopine de lait tourné. À soixante et onze ans, elle est capable de faire passer une débauchée pour une meurtrière.
Dans sa lettre, Lucie profère de pires accusations. Elle a appris que Menu est sortie de prison et demande qu’elle soit renvoyée à l’isolement sur-le-champ. Les paragraphes sont ponctués de questions rhétoriques et d’exclamations, typiques de son style. Marguerite s’attarde sur la dernière phrase : « Ayez pitié de ces enfants dont les mères savent l’art de ces meurtres barbares ! » Mais Marguerite n’éprouve aucune pitié. Elle est furieuse et déçue – furieuse contre Lucie qui ne peut jamais s’empêcher d’intervenir, déçue envers Geneviève dont les crimes rendent le pardon si difficile, pour qui la Louisiane demeure le seul espoir de sortir de prison. Elle revoit le regard déterminé de la détenue, accroupie dans sa cellule.
Marguerite déplace la fiche de Menu des archives de la Grande Force à la pile réservée à celles des pensionnaires de la Maison de Correction. Que Geneviève soit le monstre que sa sœur décrit a peu d’importance. Marguerite expliquera à Lucie ce qu’elle aurait dû comprendre il y a des années – que sous ses ordres, la Salpêtrière peut transformer une faiseuse d’anges en une mère dévouée.
*
Marguerite n’a jamais remis en question la mission de l’Hôpital. Elle n’en a douté qu’une seule fois, il y a onze ans, pendant l’hiver 1709. Cette année-là, quand la vague de froid s’abattit sur la France, personne n’était préparé. Au cours des premiers jours de janvier, un vent glacial balaya Paris. Les troncs des arbres du bois de Boulogne éclatèrent et des morceaux d’écorce gelée recouvrirent les sentiers. En l’espace de deux nuits, la Seine se mua en un lit de glace. Très vite, les dortoirs de la Salpêtrière se remplirent de nouveaux pensionnaires. Une foule désespérée affluait tous les jours aux portes de l’hôpital.
Un soir de cet interminable hiver reste gravé dans la mémoire de Marguerite. La nuit était déjà tombée lorsqu’on l’appela à l’orphelinat des petits enfants. Elle se souvient du froid qui avait traversé son corps une fois dehors, si brutalement qu’elle en avait eu le vertige. Elle entendit les hurlements des bébés, respira l’odeur nauséeuse de la laine souillée bien avant d’avoir atteint le dortoir principal. La moitié de la pièce était plongée dans l’obscurité. Les bougies manquaient ; un feu timide brûlait dans l’une des deux cheminées. Des sœurs officières, connues sous le nom de « Tantes » à la Crèche, nourrissaient, changeaient et berçaient les enfants. Dans leurs bras, les visages des petits semblaient anciens ; le regard des femmes, dur. Il fallut à Marguerite plusieurs minutes pour trouver la responsable de l’orphelinat.
Elle lui fit signe de la suivre dans le couloir qui menait à l’escalier de service. La sœur officière avait l’air si éreintée que Marguerite fut tentée de lui proposer de s’asseoir, mais il n’y avait aucune chaise. Elle s’apprêtait à suggérer que les nouveau-nés, ceux qui n’avaient pas de berceaux, soient envoyés à la Maison Saint-Louis pour dormir avec les orphelines plus âgées lorsqu’elles entendirent un bruit. On aurait dit un chaton, un chiot, un être blessé. C’était une petite fille, âgée d’à peine un an.
Comme la sœur officière ne bougeait pas, Marguerite prit l’enfant dans ses bras. Sa tête semblait énorme ; le bébé était si maigre qu’elle sentait ses omoplates rouler sous son pouce. Elle releva la tête juste à temps pour voir la sœur officière se précipiter dans le dortoir, sans un regard pour la fillette. Marguerite considéra la petite – des yeux gris, bleutés, des cheveux fins qui se révélèrent être roux à la lumière orange du dortoir. Elle avait été abandonnée, puis oubliée. Marguerite ne pouvait rien pour les gens qui mouraient dans les rues de Paris. Mais la Salpêtrière était différente de la capitale. Dans sa ville, Seine gelée ou non, on s’occupait des tout-petits.
Elle se rendit à l’orphelinat le lendemain, et le jour qui suivit. Traverser l’hôpital lui rappelait ses vingt ans, les journées passées à courir d’un dortoir à un autre. À cinquante-huit ans, elle se disait qu’elle retournait à la Crèche pour s’assurer du bien-être de tous les enfants, et non pas de celui d’une seule fillette. Elle avait appris à ses dépens, en tant que jeune sœur officière, que ses pouvoirs étaient limités : la femme épileptique aurait fini par succomber à l’une de ses crises, la libertine de treize ans avait toujours été trop fragile pour survivre à un accouchement. Mais son institution, son personnel pouvaient sauver des gens.
Marguerite ne tint plus jamais la petite contre elle. Comme n’importe quel autre pensionnaire, elle pourrait être morte à sa prochaine visite. On la baptisa Charlotte, pour une raison que Marguerite ignorait ; on lui donna le nom de « Couturier », à cause du tissu brodé qu’elle serrait dans son poing le jour de son admission à l’Hôpital. Marguerite ne saurait jamais rien d’autre d’elle. Ça n’avait pas d’importance. La Salpêtrière était l’avenir de cette enfant, le seul qu’elle et les autres orphelines aient jamais eu.
*
En avril, les sœurs officières lui annoncent que leurs listes sont prêtes. Les plantes du Jardin des Pauvres gouttent entre deux averses ; on devine du jaune et du rouge dans les poings encore fermés des bourgeons. La semaine dernière, une grande messe a rassemblé une foule ébahie dans les nefs de l’église Saint-Louis. Le parloir n’a pas désempli de la journée. Quatre jours après Pâques, Marguerite se rend à la Maison Saint-Louis.
Elle sait qu’elle ne trouvera pas Charlotte parmi la quarantaine de pensionnaires alignées dans le dortoir. La nouvelle responsable de l’orphelinat a été prévenue ; Charlotte n’ira pas en Louisiane, son nom ne doit pas figurer sur la liste. « Elles reviennent tout juste de Sainte-Claire », lui chuchote maintenant Mlle Brandicourt, enthousiaste. Elles y passent la matinée, jusqu’à tierce, elles y apprennent à coudre et à broder. Elles connaissent la Bible. Les plus brillantes savent lire et écrire. La sous-officière continue de parler à l’oreille de Marguerite, comme si elle, la Supérieure, n’avait pas conçu l’emploi du temps des orphelines. « De précieux atouts pour notre colonie », conclut la jeune femme.
Marguerite choisit une enfant au hasard. Elle lui demande si elle est disposée à partir en Louisiane et, bien que sa voix soit un simple murmure, l’expression fière de Mlle Brandicourt confirme ce que Marguerite veut entendre. Elle tapote le bras de la fillette. Au dernier conseil du Bureau, l’avocat général du roi a bien insisté : les passagères doivent, dans une certaine mesure, se porter volontaires. Si elles le sont, a ajouté M. Joly de Fleury, il ne sera pas nécessaire de les enchaîner pendant le voyage comme les femmes précédentes. Plus d’archers du guet payés pour arracher des enfants et des vagabonds aux rues de la capitale. Le mois dernier, les Parisiens, rendus furieux par ces arrestations, se sont soulevés contre les bandouliers du Mississippi – certaines rumeurs disent que plusieurs ont été tués par la foule révoltée.
Cette image hante toujours Marguerite. La réaction de ces habitants suggère qu’ils avaient pressenti, d’une façon ou d’une autre, ce qu’elle craint. Que l’or caché dans les rivières de la Louisiane n’est peut-être rien d’autre que le reflet aveuglant du soleil sur l’eau ; que les forêts de ce pays immense, inhospitalier regorgent de bêtes assez féroces pour vous avaler tout entier.
Mlle Brandicourt la raccompagne ; Marguerite a fait son devoir. Leurs maris les protégeront. Elle jette un dernier regard aux orphelines. Au milieu de la pièce, Charlotte se précipite vers l’une des pensionnaires rassemblées. Elle est frêle, même pour son âge. Ses traits ciselés, presque abrupts, s’adouciront sûrement. »
À propos de l’autrice

Julia Malye © Photo Astrid di Crollalanza
Julia Malye est née à Paris en 1994. Elle a publié son premier roman, La Fiancée de Tocqueville (éditions Balland), à l’âge de 15 ans. Diplômée de Sciences Po et de la Sorbonne en sciences sociales et lettres modernes, elle est également titulaire d’un Master of Fine Arts en creative writing de l’Université d’État de l’Oregon. Elle est traductrice de l’anglais pour Les Belles Lettres et, depuis 2018, elle enseigne l’écriture de fiction à Sciences Po. Son quatrième roman, La Louisiane, écrit parallèlement en français et en anglais, est en cours de traduction dans plus de vingt pays et sera adapté en série. (Source: Éditions Stock)
Page Facebook de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice
Tags
#lalouisiane #JuliaMalye #editionsstock #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #NetGalleyFrance #Louisiane #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie









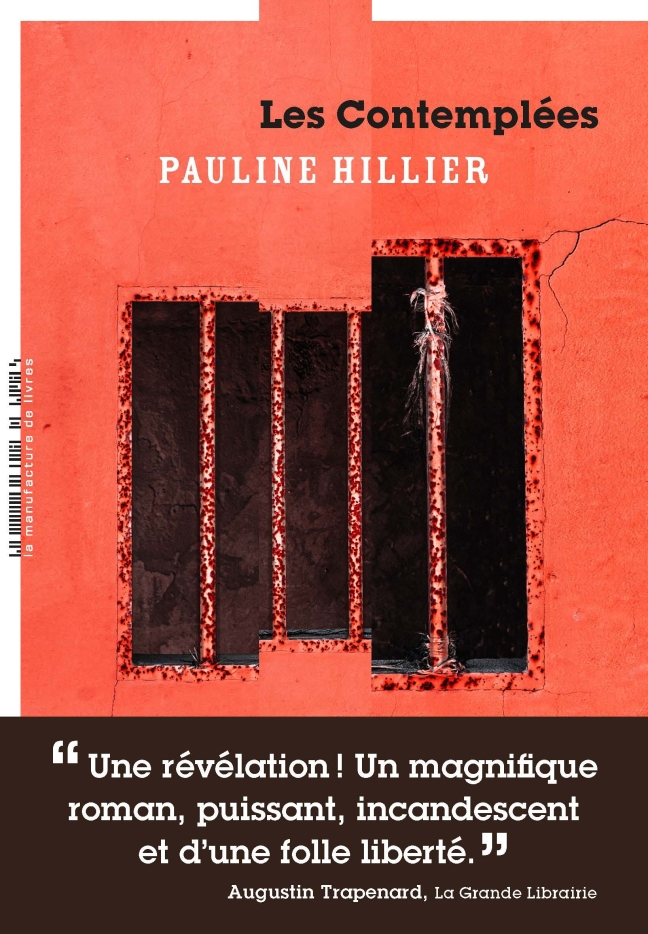


 Pauline Hillier © Photo Vincent Loison
Pauline Hillier © Photo Vincent Loison


 Manon Hentry-Pacaud © Photo DR
Manon Hentry-Pacaud © Photo DR
 Christiana Moreau © Photo DR
Christiana Moreau © Photo DR






 Nesrine Slaoui © Photo Charlotte Robin
Nesrine Slaoui © Photo Charlotte Robin
 Camille Froidevaux-Metterie © Photo DR
Camille Froidevaux-Metterie © Photo DR

 David Medioni © Photo Anna Laillet
David Medioni © Photo Anna Laillet