En deux mots
Madame Moreau a été retrouvée morte dans son lit, la tête fracassée par un gros galet. Pour les voisins, c’est la stupéfaction, car les Moreau étaient une famille sans problèmes. C’est en fouillant le passé des protagonistes que l’on va découvrir les clés de ce drame.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Un féminicide qui cache bien des secrets
On retrouve Barbara Abel au meilleur de sa forme. Dans ce thriller qui démarre par la découverte d’une femme assassinée avec violence, elle explore les liens entre les différents protagonistes ce cette affaire bien mystérieuse.
Barbara Abel nous offre avec Comme si de rien n’était un thriller-modèle. Je veux dire par là qu’elle réussit à la perfection à agencer tous les éléments du parfait suspense. En ce sens, ce roman est aussi idéal pour ceux qui n’auraient pas encore lu cette autrice et peuvent la découvrir avec ce nouvel opus.
Il s’ouvre sur une scène-choc avec à la clé ce que les anglo-saxons appellent le Hook (le crochet), c’est-à-dire les lignes capables de ferrer le lecteur. À partir de ce moment, il ne voudra plus lâcher cette histoire.
Dans un quartier bourgeois sans histoires, une employée de maison découvre sa patronne, Mme Moreau, « étendue sur le lit, inerte, le visage en bouillie (…) Les draps étaient maculés de sang. À proximité de sa tête, un galet de la taille d’une noix de coco, sur lequel un enfant avait dessiné la gueule d’un monstre effrayant, éclairs dans les yeux et dents pointues ».
Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter dans le passé de la famille Moreau. Bertrand a épousé Adèle. Avec leur fils Lucas, ils vivent dans une belle maison dans le quartier chic d’une ville de province. L’emploi du temps de la famille est parfaitement réglé. D’ailleurs ce soir, Adèle doit récupérer Lucas à la sortie de son cours de solfège. C’est à ce moment que la mécanique se détraque, presque imperceptiblement. Hugues Lionel, le prof remplaçant, n’en croit pas ses yeux en la voyant. Pour lui, il n’y a guère de doute, c’est Marie, un amour de jeunesse, qui réapparaît.
Si Adèle esquive – non, il fait erreur – elle est pourtant troublée. Car sous ses airs de femme respectable, elle cache un autre visage quand elle cherche un homme pour assouvir son besoin de sexe. C’est alors qu’elle se fait appeler Marie, afin de rester la plus anonyme possible.
Bien entendu, Bertrand ne se doute pas de l’infidélité de son épouse, lui qui ne jure que par la droiture, la rigueur, la franchise. Mais à bien y regarder, il n’est peut-être pas non plus sans aspérités.
Hugues, quant à lui, consacre beaucoup de son temps à son père atteint de la maladie d’Alzheimer. Ce qui ne l’empêche pas de chercher à en savoir davantage sur cette superbe femme qui – il en est persuadé – lui ment. Ce qu’il va découvrir va totalement le déstabiliser.
Reste Lucas, le petit garçon discret qui n’affiche guère ses émotions. Il va se retrouver au centre d’une affaire dont les enjeux le dépassent. Comme dans ses précédents romans, Barbara Abel réussit parfaitement à rendre la psychologie des personnages, leurs doutes et leurs certitudes, et leurs Fêlures.
De rebondissement en rebondissement, les secrets que cachent tous les protagonistes vont éclater au grand jour. Habilement, les pièces de ce puzzle familial vont trouver leur place jusqu’au Twist final.
J’ai retrouvé dans ce roman une construction qui s’apparente à celle de Joël Dicker qui avec Un animal sauvage, jouait aussi beaucoup avec les temporalités et des personnages aux aspects extérieurs bien sous tous rapports, alors qu’en réalité… Avec moins de circonvolutions et davantage de fluidité, Barbara Abel nous offre un nouveau thriller qui, à n’en pas douter, devrait intéresser les producteurs de cinéma au même titre que pour Derrière la haine, dont l’adaptation, portée par Jessica Chastain et Anne Hathaway, est actuellement sur les écrans.
Comme si de rien n’était
Barbara Abel
Éditions Récamier
Thriller
368 p., 21 €
EAN 9782385770433
Paru le 11/04/2024
Où?
Le roman est situé dans une ville de province, sans beaucoup plus de précisions. Certains indices permettent toutefois de penser que nous sommes en Belgique.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Dans l’existence d’Adèle, chaque chose est à sa place, toujours. Elle règne sur sa vie, parlemente avec le destin, orchestre le hasard qu’elle a appris à dompter mais qui – elle ne le sait pas encore –, est sur le point de lui exploser au visage.
À la sortie du cours de musique de son fils, elle rencontre le nouveau professeur de solfège, Hugues Lionel. Leurs regards se croisent. Lui, semble troublé et dit la reconnaître. Qui est cet homme, et pourquoi l’appelle-t-il Marie ?
Contrairement à Adèle, chez Hugues rien n’est sous contrôle, et le retour de cette femme qu’il pensait ne jamais revoir pourrait être le cadeau de la vie qu’il attendait depuis si longtemps. Quand bien même cette dernière prétend ne pas le connaître…
On peut tous se rassurer par de petits arrangements avec la vie, avec les erreurs du passé, avec ce que l’on n’aurait jamais dû voir ni même entendre. Mais peut-on indéfiniment faire comme si de rien n’était ?
Barbara Abel, considérée comme la reine du thriller psychologique, n’a pas son pareil pour faire basculer les vies ordinaires de ses personnages dans les pires cauchemars. Avec un naturel implacable, elle joue avec les petits secrets et les failles de tout un chacun. Attention, dans son prochain roman, elle pourrait bien raconter votre histoire…
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
RTBF (Entrez sans frapper)
Blog Les chroniques de Koryfée (Karine Fléjo)
Blog Tranches de livres
Blog Musemaniasbooks
Les premières pages du livre
« Prologue
L’avenue des Martourets rappelle ces larges allées des banlieues huppées, bordées de pelouses grasses. Les trottoirs ressemblent à un feston, entre dalles et gazon, sur lequel des cerisiers du Japon se dressent à intervalles réguliers. Durant la floraison, quinze jours par an, c’est une explosion de roses, en bouquets d’abord, chaque arbre projetant ses pétales vers le ciel, avant que ceux-ci ne tombent à terre et ne recouvrent le sol d’un tapis de fleurs. Les enfants du quartier s’amusent à les ramasser à pleines mains pour en faire des petits tas dans lesquels ils sautent à pieds joints, éparpillant tout autour les tendres corolles dans un tourbillon incarnat.
Le quartier du Logis, c’est un peu Brooklyn à l’européenne, ses habitations élégantes juchées sur leur perron, quelques marches qui mènent au seuil des demeures datant du siècle passé. On s’y promène volontiers, poussant un landau ou tenant une laisse. Il y fait bon vivre, écrin préservé du chaos citadin pourtant tout proche. Les maisons sont jolies, de belle taille, toutes différentes. Elles dégagent chacune leur personnalité, à l’image de leurs propriétaires. On remarque par exemple la façade dépouillée et bien entretenue des Charpentier, un couple de retraités qui a conservé un rythme de vie immuable, tout le contraire de leurs voisins immédiats, les Boutonnet, une famille recomposée pleine de bruit et de fureur, dont la maison déborde de jardinières fleuries, de plantes grimpantes, de linge et de jouets.
Parmi ces habitations, l’une d’elles est au centre de toutes les curiosités. Elle se situe au milieu de l’avenue, à droite en venant de la ville. Une courte allée conduit à un escalier, quatre marches en briques menant à la porte d’entrée sous un porche un peu vieillot. La bâtisse en pierre s’élève sur deux niveaux, sans oublier les combles. Les fenêtres sont hautes, ornées de châssis peints en bleu, eux-mêmes agrémentés de volets de même couleur.
Un gentil couple y habite, les Moreau, parents d’un petit garçon.
Du moins, on le trouvait gentil jusqu’au drame.
Le quartier est en ébullition, les voisins sont sous le choc. L’horreur s’est invitée parmi eux, hôte indésirable dont personne ne soupçonnait la présence. C’est la femme de ménage qui a constaté la terrible tragédie, lundi dans la matinée, en montant à l’étage après avoir passé trois heures à récurer le rez-de-chaussée. En pénétrant dans la chambre parentale, elle s’est étonnée de l’obscurité : en général, chaque matin à son réveil, Mme Moreau aère la pièce. L’employée de maison a rejoint la fenêtre dont elle a tiré les rideaux d’un geste ample, avant de l’ouvrir en grand. La lumière a inondé la chambre en même temps qu’un courant d’air frais s’y est engouffré. La température est encore basse à cette époque de l’année, charriant avec elle les derniers frimas. L’employée ne les craint pas, elle a profité de la vue durant quelques secondes. Puis elle s’est retournée.
Vision d’épouvante. La pauvre femme s’est figée dans un cri d’effroi, le cœur soulevé jusqu’à la gorge, prête à vomir. Puis elle s’est enfuie en poussant une longue plainte affolée.
Depuis, on ne parle que de ça.
On raconte que Mme Moreau était étendue sur le lit, inerte, le visage en bouillie, à peine reconnaissable. Son corps n’avait pas été épargné, meurtri en plusieurs endroits, tacheté d’ecchymoses. Les draps étaient maculés de sang. À proximité de sa tête, un galet de la taille d’une noix de coco, sur lequel un enfant avait dessiné la gueule d’un monstre effrayant, éclairs dans les yeux et dents pointues. Une épaisse couche de sang dissimulait leurs traits, ceux du monstre et ceux de Mme Moreau. Au pied du lit, une valise ouverte, à moitié remplie de ses effets, comme une réponse à la penderie, juste en face, ouverte également, à moitié vide.
L’affaire fait grand bruit. Les Moreau sont bien connus dans le voisinage et l’annonce du décès de madame provoque un émoi sans précédent. Les circonstances de sa mort ajoutent encore à l’incompréhension générale, d’autant que, très vite, les soupçons se portent sur… M. Moreau.
En cherchant à le joindre, les policiers dépêchés sur place apprennent qu’il ne s’est pas présenté au bureau ce matin-là. Plus inquiétant encore, le petit Moreau n’est pas à l’école. L’alerte est aussitôt donnée, sans savoir s’ils sont en fuite ou en danger.
Il faut une journée entière pour les localiser d’abord, appréhender M. Moreau ensuite. L’arrestation se fait dans le sud du pays, sur le quai d’une gare. M. Moreau s’apprête à prendre un train en partance pour ailleurs. L’enfant l’accompagne, en bonne santé physique. Ils sont emmenés puis remis, l’un aux services sociaux en attendant qu’un membre de sa famille vienne le chercher, l’autre entre les mains des autorités. M. Moreau est placé en garde à vue.
Cinq heures plus tard, il passe aux aveux.
Les premiers éléments dévoilent une dispute conjugale qui a mal tourné. Il est question de divorce. On ne connaît pas encore les détails du drame, mais il semble que la décision de Mme Moreau de reprendre sa liberté lui ait été fatale. Détail macabre, le meurtre s’est produit le jour de la fête des Pères.
Selon les rumeurs, M. Moreau est terrassé par son geste. Il ne nie pas. L’enquête est vite bouclée, énigme résolue à peine quarante-huit heures après la découverte du corps. Les policiers se félicitent. Voilà une affaire rondement menée.
Malgré tout, beaucoup de questions restent en suspens. Les ragots peinent à émerger, tant l’image de cette famille sans histoire est lisse, dépourvue d’aspérités. Ils vivent là depuis des années, personne dans le quartier n’a jamais eu à se plaindre d’eux. Le voisinage n’en revient pas.
Depuis deux jours, la maison Moreau est dans toutes les conversations. Des curieux ralentissent à son niveau, s’y arrêtent parfois, s’aventurent jusqu’aux fenêtres, se dévissent la tête pour sonder l’intérieur. Quelques journalistes traînent dans le quartier, ils font du porte-à-porte et interrogent les voisins.
Ce soir encore, on parle de l’affaire au journal télévisé, sujet émaillé d’une série de témoignages. Les voisins succèdent aux collègues. Ils expriment leur stupéfaction, ils ont du mal à réaliser : une famille si gentille, un couple tellement discret, souriant et disponible. Tous s’accordent à dire que les Moreau étaient des gens bien.
Au terme des confidences, un journaliste achève le reportage, en direct devant la maison, un micro à la main.
— De l’avis général, M. Moreau était un homme au-dessus de tout soupçon, apprécié de ses collègues, de ses voisins et de ses proches. On le décrit comme quelqu’un de poli, une personnalité bienveillante, toujours prêt à rendre service. Avec sa femme, ils formaient un couple en apparence heureux, respecté de tous. Personne n’aurait pu prédire une telle tragédie. Alors, forcément, on s’interroge : comment un homme ordinaire et sans histoire peut-il se transformer du jour au lendemain en bête sanguinaire ? Comment le monstre peut-il se cacher si longtemps sous un tempérament à ce point courtois ?
Le journaliste marque une courte pause avant de reprendre d’un ton grave :
— Ici, dans le quartier du Logis, c’est la question que tout le monde se pose.
Chapitre 1
Les notes résonnent de toutes parts, elles ricochent contre les murs de l’école, se cognent les unes aux autres dans un dialogue de sourds. Cacophonie. À mesure qu’on dépasse les classes, les sons se succèdent comme des sentinelles éméchées. Un piano maladroit, la voix d’un professeur, des bribes d’arpèges, l’éclat d’une cymbale. Il règne dans les couloirs de l’école de musique un désordre nécessaire, l’indispensable chaos qui précède l’harmonie. Adèle Moreau aime cette ambiance, celle d’un fervent labeur, quand l’âme tout entière fait corps avec l’instrument et qu’il s’agit d’apprivoiser la partition.
Alors qu’elle se dirige vers le cours d’initiation au solfège, elle se rappelle son propre apprentissage lorsque, petite fille, nattes négligées et genoux crottés, elle suivait les leçons de Mme Pierraert, enseignante autoritaire au premier abord, en vérité une main de velours dans un gant de fer, aussi impitoyable que généreuse. Les cahiers de solfège volaient à travers la classe quand la partition n’était pas apprise. Mais si les gammes étaient justes, l’élève était chaleureusement félicité, parfois même récompensé d’un morceau de chocolat.
Sans cesser d’avancer, Adèle sourit à ce souvenir. Un bref instant, elle regrette de ne pas avoir persisté dans l’apprentissage de la musique. Elle n’était pas mauvaise. Elle avait même réussi à intégrer le groupe des cracks, les meilleures élèves du cours, cinq filles douées qui rehaussaient le niveau de la classe. Elle se rappelle Lise, Claire, Dominique…
Comment s’appelait la dernière ?
Perdue dans ses pensées, Adèle arrive devant la porte de la classe de solfège d’où s’échappe le chant des enfants, accompagnés du piano dont les accords s’adaptent au tempo décousu des jeunes apprentis. Elle consulte sa montre. Elle a quelques minutes d’avance, un laps de temps qu’elle met à profit pour, smartphone à la main, répondre à deux ou trois mails. Ses doigts courent sur l’écran avec une grâce aérienne, ils volent d’une lettre à l’autre, d’une virgule à un point.
Tandis qu’elle adresse ses sentiments distingués au terme du dernier message, la porte de la classe s’ouvre, laissant des grappes d’enfants se répandre dans le couloir. Adèle range son smartphone, puis elle scrute les minois à la recherche de celui de Lucas. Son fils est souvent le dernier à sortir, jamais pressé pour rien, une lenteur de vivre qui parfois la déconcerte. Toujours dans la lune, Lucas. Ailleurs. Un enfant contemplatif, dont il est difficile de comprendre ce qui l’anime. Tout le contraire de ses parents, en permanence sur le qui-vive, dont l’emploi du temps ne laisse rien au hasard. Ils apprécient et recherchent la compagnie de leurs semblables, leur présence est remarquable et remarquée.
Lucas, lui, aime la tranquillité, cultive la discrétion, désire la solitude. Il vit dans un autre monde. Un monde dont Adèle ne peut que deviner les contours, et dont elle ignore sans doute la profondeur. Elle l’observe souvent à la dérobée, dans le rétroviseur de la voiture quand elle conduit, ou lorsqu’elle passe devant sa chambre et le découvre assis par terre, face à ses jouets mais la tête dans les nuages. L’enfant est immobile, on le sent ailleurs. Comme s’il avait déposé là son enveloppe charnelle pour s’évader loin. Faire illusion. Elle se demande alors ce qui se passe dans son esprit. À quoi pense-t-il, à quoi rêve-t-il ? Il est capable de rester ainsi de longs moments, inaccessible.
Pour autant, s’il est solitaire, il n’est pas isolé. Pas tout à fait, du moins. Il a quelques camarades, dont Louis, qu’il considère comme son meilleur ami, ce qui rassure Adèle.
Le voilà d’ailleurs qui apparaît à la porte du local. Lucas la rejoint et lui adresse un sourire serein, comme s’il avait une bonne nouvelle à lui annoncer. De fait, en parvenant à sa hauteur, il se plante devant elle dans une posture de satisfaction.
— J’ai eu dix à l’exercice de lecture des notes ! déclare-t-il en gonflant la poitrine.
Adèle ne cache pas sa fierté : elle ouvre de grands yeux admiratifs avant de féliciter son fils.
— Tu n’as fait aucune faute ? s’exclame-t-elle, impressionnée.
— Si, j’en ai fait… se trouble l’enfant. C’était sur quinze.
— Oh…
— Mais c’est bien quand même ! ajoute-t-il précipitamment.
— Bien sûr ! réagit Adèle. C’est même très bien ! Mme Gosset doit être fière de toi.
— Ce n’est plus Mme Gosset, précise Lucas. On a un nouveau monsieur.
Comme pour confirmer les dires du garçon, un homme sort à son tour de la classe. Adèle n’en voit que le dos tandis qu’il referme la porte derrière lui.
— Mme Gosset a eu son bébé ? demande-t-elle, plus enthousiaste qu’en apprenant les bons résultats de son fils.
Lucas hausse les épaules en signe d’ignorance. Par réflexe, Adèle pivote vers le nouveau professeur afin de reformuler sa question, ce qu’elle fait d’une voix plus forte. Celui-ci achève les deux tours de clé pour verrouiller la porte de sa classe et semble devoir s’y reprendre à plusieurs reprises. Puis il se retourne à son tour.
Il s’apprête à lui répondre au moment où leurs regards se croisent.
Aucun son ne sort de sa bouche.
Comme si le silence le saisissait à la gorge.
S’ensuit un moment suspendu dans un souffle, de ces secondes qui figent le temps.
Adèle se voit contrainte de répéter sa question.
— Vous remplacez Mme Gosset, n’est-ce pas ? Elle a eu son bébé ?
L’homme reste interdit quelques instants encore, puis on dirait qu’il s’ébroue de l’intérieur. Il sourit et s’approche.
— Marie! Ça alors ! Qu’est-ce que tu fais là ?
Sa voix, ample et expressive, a la tonalité d’un cantabile. Il avise ensuite Lucas qui se tient à côté d’elle, dont la présence est la plus éloquente des réponses.
— Oh, c’est… C’est ton fils ?
En face de lui, Adèle le considère, surprise. Jeune quadra, il est plutôt grand, de corpulence mince, les tempes légèrement grisonnantes. Elle détaille sa physionomie, ses traits réguliers dont il se dégage une douceur naturelle, dénotant un tempérament paisible, dépourvu d’ambition. Le genre d’homme que, en temps normal, elle ne remarquerait pas. C’est la première fois qu’elle le voit. S’ils se sont déjà croisés, elle n’en garde aucun souvenir. La façon dont elle le dévisage trahit son embarras, qui se faufile entre eux à la manière d’une mélopée, entêtante, un peu pesante.
— Tu ne te souviens pas de moi ? demande-t-il encore, et le cantabile glisse vers un lamento.
— Vous devez me confondre, s’excuse-t-elle aussitôt.
À son tour, l’homme ne cache pas son étonnement. Il la considère avec circonspection, puis la scrute plus attentivement, en proie au doute.
— Je ne m’appelle pas Marie, précise-t-elle.
L’argument est imparable.
— Désolé, vous ressemblez à quelqu’un que j’ai connu…
Elle acquiesce d’un mouvement de tête et lui sourit, compréhensive. Le silence menace de reprendre possession des lieux, alors le professeur s’empresse d’ajouter :
— Je me présente : je suis…
Il s’interrompt et la mange des yeux, happé par son regard. Elle est ravissante, de ces femmes dont on se souvient : chevelure épaisse et sombre qui fait ressortir le vert de ses yeux, pommettes saillantes de part et d’autre d’un joli nez retroussé. Elle attire les regards et provoque la sympathie.
De plus en plus intriguée, Adèle lui adresse un nouveau sourire, l’invitant à poursuivre, mais l’homme reste muet. Le silence s’installe pour de bon, traînant dans son sillage un embarras palpable, d’autant que le professeur continue de la fixer avec insistance. Au loin, une mère rappelle sa fille à l’ordre, elle crie : « Emma, ne court pas, s’il te plaît ! », et Adèle se souvient que la cinquième crack, celle dont elle avait oublié le prénom, s’appelait précisément Emma.
Au moment où elle décide de battre en retraite, il achève sa phrase :
— … je suis M. Lionel, le nouveau professeur de solfège de votre fils.
Il lui tend une main qu’elle ne peut refuser. Il la regarde toujours, et quelque chose brûle dans ses yeux. Adèle cherche à se soustraire à l’échange, et retire sa main un peu trop vite.
— Enchantée, dit-elle d’un ton qui trahit tout le contraire.
Chapitre 2
La première leçon ne s’est pas trop mal passée. Hugues a eu le temps de faire connaissance avec les élèves, et même s’il n’a pas encore retenu tous les prénoms, le contact a été plutôt encourageant. Il a assez vite repéré les bons éléments, ceux qui viennent de leur propre chef, par réel intérêt pour la musique. Les autres, ceux qui font plaisir à papa-maman, paraissent conciliants pour la plupart.
Tandis qu’il rassemble ses affaires, il jette un rapide coup d’œil à sa montre : 17 h 04, il est encore dans les temps, mais il s’agit de ne pas traîner. Il ne peut pas prendre le risque de faire attendre son père. À cette heure-ci, le trafic est dense dans le centre-ville. Il faut compter vingt minutes de trajet. Il ferait mieux de partir tout de suite.
Le dernier élève vient tout juste de quitter la salle, Lucas, si ses souvenirs sont bons, un enfant plutôt réservé qu’il n’est pas encore parvenu à bien cerner. Pas mauvais en tout cas. L’enfant s’est distingué à deux reprises à la lecture de notes, trahissant quelques dispositions pour la musique. Hugues se dirige à la suite du petit garçon, sort de la classe et referme la porte derrière lui. Il perd quelques secondes à comprendre le mécanisme de la serrure, parvient enfin à donner deux tours de clé en maintenant la poignée à la verticale, et s’apprête à remonter le couloir jusqu’à la sortie de l’école. Au moment où il se retourne…
Une femme lui parle, de toute évidence la maman de Lucas. À l’instant même où leurs yeux se croisent, quelque chose l’empoigne, on dirait qu’une main glacée l’agrippe. Aussitôt, une image s’impose à son esprit, elle le happe. Un souffle chasse ses pensées, le visage de la femme prend toute la place dans sa tête.
— Vous remplacez Mme Gosset, n’est-ce pas ? Elle a eu son bébé ?
Les couloirs de l’académie reprennent possession des lieux. La femme se tient devant lui, ses traits se remettent en place, elle attend sa réponse. À l’évidence, elle ne le reconnaît pas. Alors il s’approche d’elle et lui sourit.
— Marie ! Ça alors ! Qu’est-ce que tu fais là ?
Son joli regard se fronce. Elle l’observe un peu plus attentivement mais ses traits trahissent sa perplexité. Juste à côté d’elle, Lucas le considère lui aussi d’un œil inquisiteur. Il comprend qu’elle n’a aucune idée de qui il est. Le moment est gênant, à l’image d’une émotion que l’on dévoile à un étranger. Il tente de se rattraper, gauche, presque pathétique, comme un promeneur pris dans des sables mouvants : plus il essaie de s’en sortir, plus il s’enfonce.
Quand enfin elle prend congé, il reste là dans le couloir et la regarde s’éloigner. Il s’en veut, agacé par sa propre apathie. Des gens passent et le dépassent, on rit de lui, ou alors n’est-ce qu’une impression. Son père le lui dit souvent : les gens ne s’intéressent qu’à eux, c’est triste mais c’est comme ça, inutile de s’encombrer la tête avec des inquiétudes sur le qu’en-dira-t-on. Son père…
Son père !
Il consulte sa montre et l’heure lui fait office d’électrochoc, retour brutal à la réalité. Quinze minutes viennent de passer sans qu’il en ait pris conscience. Il est en retard. Déjà il imagine le vieil homme sur le trottoir, à l’attendre, seul et vulnérable, au milieu d’un trafic indifférent. Hugues détale, le souffle serré, les pensées en vrac. Il se précipite vers la sortie de l’école, déboule sur le trottoir sans savoir s’il doit prendre à droite ou à gauche, tourne en rond, cherche à rassembler ses souvenirs, où a-t-il garé sa voiture ? Celle-ci est un vieux modèle qui ne répond à aucune télécommande ni verrouillage à distance. Il est condamné à avoir une bonne mémoire, ou à parcourir les rues avoisinantes à la recherche de son véhicule.
Quelques instants plus tard, alors qu’il s’insère dans le flot de la circulation, il tente de contacter son père au téléphone. Peine perdue, celui-ci ne répond jamais, sans doute même n’entend-il pas la sonnerie. Son portable lui sert davantage à joindre le monde qu’à être joignable, et tant pis pour ceux qui cherchent à lui parler. À son âge, les besoins des autres disparaissent dans la brume des souvenirs opaques, ceux qui étouffent toute velléité de compassion ou de générosité.
Comme Hugues l’avait prévu, les embouteillages l’accompagnent une bonne partie du trajet. Il doit se faire violence pour ne pas klaxonner et, cette fois, c’est l’inertie des autres qui l’agace. Les voitures se traînent. Les feux se succèdent, les uns trop longs, les autres trop courts. Les minutes défilent à défaut des rues. C’est lent, c’est interminable.
Enfin la rue des Oliviers est en vue. Hugues se dévisse le cou pour apercevoir la silhouette familière. Il était convenu qu’ils se retrouvent sur le trottoir, juste devant la porte de l’immeuble. Hugues consulte sa montre : il a vingt minutes de retard, son père devrait être là. En passant devant l’entrée du bâtiment, il doit pourtant se rendre à l’évidence : personne ne l’attend. Il observe les environs, le vieil homme doit avoir fait quelques pas en patientant…
Aucune trace de lui.
Hugues soupire, il se gare en double file un peu plus loin, sort de la voiture, tente d’appeler son père, on ne sait jamais. Tombe sur la messagerie. Il consulte sa montre en pressant le pas, étouffe un juron, ils devraient déjà être à l’hôpital…
Alors qu’il anticipe toutes les conséquences de leur retard, il l’aperçoit plus loin, dans une des rues transversales qu’il traverse au carrefour.
— Papa !
Pas de réaction. Hugues ne s’en étonne pas : son père est sourd. Du moins, il entend certaines choses et d’autres pas. Il le rejoint en quelques enjambées et l’aborde sans cacher son soulagement.
— Salut papa ! Qu’est-ce que tu fais là, on avait rendez-vous devant chez toi…
Le vieil homme laisse échapper un mouvement de surprise qu’il contient aussitôt.
— Bonjour fiston, rétorque-t-il d’une voix autoritaire.
Sans perdre plus de temps, Hugues saisit son père par le bras et l’entraîne vers la voiture.
— Faut pas traîner, papa, on est en retard.
— En retard pour quoi ?
Hugues laisse échapper un soupir contrarié.
— On a rendez-vous avec le professeur Mistral, je te l’ai dit.
Au silence qui suit, il comprend que le vieil homme n’a aucune idée de ce dont il parle.
— On doit recevoir le résultat de tes analyses, ajoute-t-il la gorge serrée. Tu te souviens ?
— Naturellement ! répond le père sur le ton d’une évidence forcée.
Chapitre 3
— Il te voulait quoi ? demande Perrine après qu’Adèle lui a relaté sa brève rencontre avec le nouveau professeur de solfège de Lucas.
À la terrasse du Roi de pique, les deux amies terminent leur prosecco.
— Aucune idée, répond Adèle en tirant sur sa cigarette.
— Le coup de foudre… rigole Perrine. Le vrai. Celui où le temps s’arrête. Comme dans les films.
Adèle lève les yeux au ciel, exprimant le peu de crédit qu’elle accorde à cette hypothèse.
— « M. Lionel »… se moque-t-elle ensuite. Comment peut-on s’appeler soi-même « M. Lionel » ?
— Quand on s’appelle Lionel… répond Perrine sur le ton de l’évidence.
— Tu ne fais pas précéder ton prénom de « monsieur » quand tu te présentes ! C’est débile !
— C’est comme ça que les enfants l’appellent, je suppose.
— OK, mais tu t’adresses autrement aux parents.
— Tu vas raconter ça à Bertrand ?
La réaction d’Adèle est immédiate.
— Certainement pas ! Jaloux comme il est…
— Donc tu reconnais qu’il y avait quelque chose de sexuel dans sa façon de te regarder, en conclut Perrine.
— Je ne reconnais rien du tout, se défend Adèle, sans toutefois maîtriser un sourire aux lèvres.
Elle écrase sa cigarette, puis vérifie l’heure sur son portable.
— Je file, dit-elle en cherchant son portefeuille.
— Laisse, c’est pour moi, l’arrête Perrine.
Adèle ne discute pas et remercie son amie. Elle continue néanmoins de fouiller dans son sac. Elle en sort un chewing-gum qu’elle fourre aussitôt dans sa bouche.
Perrine se marre.
— Avant, on fumait en cachette des parents. Maintenant, on fume en cachette des enfants.
— Et des maris, ajoute Adèle.
Elle gratifie Perrine d’un sourire entendu tout en mastiquant vigoureusement. Puis elle s’éloigne sans traîner.
Le jeudi est une journée marathon : Lucas enchaîne les activités, solfège jusqu’à 17 heures, puis natation de 17 h 30 à 18 h 15. Adèle s’octroie une pause pendant que l’enfant barbote dans l’eau, une demi-heure de répit en compagnie de Perrine, qu’elle connaît depuis la fac. Elles ont instauré ce rituel apéritif depuis qu’elles se sont croisées à cette même terrasse, quelques semaines auparavant, après s’être perdues de vue pendant des années. Elles se retrouvent chaque jeudi et prolongent, le temps d’un verre, la frivolité de leurs bavardages d’autrefois.
Le reste de la journée s’achève selon une routine immuable. Adèle récupère son fils à la sortie du bassin, échange quelques mots avec le maître-nageur, passe chez Tony pour récupérer les traditionnelles pizzas du jeudi. Elle rentre ensuite dare-dare à la maison, met les pizzas au four, prépare la table. Tout est prêt quand Bertrand rentre. Il n’a que trente minutes pour dîner, puis il partira à sa séance de tennis, 20 heures tapantes sur le court.
« Dans trois kilomètres », comme dirait Adèle.
Adèle a un rapport au temps qu’elle matérialise en surface. Temps et espace se confondent dans son esprit, le trajet d’une matinée, la distance d’une heure, la direction d’un instant. Ses journées passent comme des itinéraires qu’elle emprunte : certaines sont des expéditions, d’autres des balades. Ses différents horaires ont pour elle l’image d’un circuit, un tour de piste, des étapes à franchir, des niveaux à atteindre. Aujourd’hui, par exemple, elle a la sensation d’avoir monté une pente abrupte. Hier, en revanche, la journée est passée comme une promenade.
La soirée se déroule comme chaque jeudi : courir, courir, jusqu’au départ de Bertrand, et même un peu plus loin, quelques centaines de mètres, jusqu’à la mise au lit de Lucas. Après seulement, Adèle ralentit le pas et passe la fin de soirée à flâner. Bertrand rentrera tard, la partie de tennis étant immanquablement suivie d’un verre au bar du club, même si Adèle a tendance à penser le contraire : c’est le verre au bar du club qui est immanquablement précédé d’une partie de tennis. En attendant, elle poursuit la soirée à son rythme, ce dont elle s’accommode parfaitement.
Accommodante est d’ailleurs un terme qui lui convient plutôt bien, sa vie, sa relation aux autres, son rapport au monde. Constante, aussi. Elle franchit les années d’un pas égal, sans dévier d’une trajectoire rectiligne, une route toute tracée qui court loin devant, un horizon dégagé. Pas de virage, ou très peu, de ceux qui s’amorcent de loin et dont la courbe est large. Quelques pentes à négocier, quelques sommets à franchir. Et lorsqu’un obstacle se dresse, elle le surmonte parfois en l’affrontant, la plupart du temps en le contournant. Une manière de se véhiculer dans l’existence, à l’image de sa profession : Adèle est décoratrice d’intérieur. Ses journées sont consacrées à ordonner un espace, à l’investir, à le rentabiliser. Elle a le chic pour tirer le meilleur parti d’une surface, d’un point de vue pratique d’abord, esthétique ensuite. Elle a le goût sûr et le contact facile, deux qualités indispensables pour s’adapter aux clients autant qu’aux projets. Mieux encore, elle sait parfaitement imposer sa vision des choses tout en donnant l’illusion d’obéir à celle des autres. Adèle regarde, écoute, analyse. Surtout, elle ordonne, dans la maîtrise autant que dans l’harmonie. Car dans l’existence d’Adèle, tout est à sa place, toujours. Elle règne sur sa vie, elle parlemente avec le destin.
Elle orchestre le hasard.
Ce hasard qu’elle a appris à dompter pour mieux le dominer.
Et qui, aujourd’hui, elle ne le sait pas encore, est sur le point de lui exploser au visage.
Chapitre 4
Le verdict est tombé.
Alzheimer.
Le nom tant redouté.
Hugues a accusé le coup. À côté de lui, son père était absent, déjà lointain, déconnecté de ce qui se jouait dans le cabinet du professeur Mistral. Hugues a demandé des précisions, quel stade, la vitesse d’évolution, ce dont son père était conscient. Le professeur Mistral, un homme grand et maigre au visage émacié, a pris le temps de décrire la situation avec clarté. Ses mots étaient simples, ses phrases concises, son ton se voulait rassurant, même si ses traits trahissaient une certaine préoccupation. Il s’est d’abord adressé directement au vieil homme, lui expliquant que la maladie était déjà bien installée. Regard désapprobateur vers Hugues en regrettant qu’il ne soit pas venu consulter plus tôt. Puis il a évoqué la suite : il fallait sans traîner organiser l’avenir.
Hugues a senti un nœud se former dans sa gorge. Assommé par la nouvelle, il ne parvenait pas à ordonner ses pensées. Alors que Mistral abordait quelques-uns des aspects qui allaient modifier la vie de son père, lui ne pensait qu’aux conséquences que la maladie allait occasionner dans sa propre existence. André vivait seul depuis la mort de son épouse, Maryse, quinze ans auparavant. Fils unique, Hugues avait toute la responsabilité du vieil homme.
En y repensant à présent, tandis qu’il cuisine pour son père après l’avoir raccompagné chez lui, il a honte. Pendant une bonne partie de la consultation, il ne s’est inquiété que de son propre sort. Mistral se tenait devant lui, l’abreuvant d’informations d’où s’échappaient des mots comme altération, trouble, apraxie, agnosie, des mots qui terrifient, des mots qui mordent. Hugues cherchait à fuir la nouvelle, prendre ses jambes à son cou, se cacher, disparaître. Sensation d’être face à un fauve qu’il fallait tenir à distance, sans le lâcher des yeux, avec cette peur viscérale vissée au ventre, quand vous savez que le combat est inégal et que vous êtes perdu. Qu’il n’y a plus rien à faire. Que la fin est inéluctable.
Le plus dur, c’est de l’intégrer. Il y a ce refus impérieux, ce rejet absolu. L’esprit se cabre, l’âme se révolte, on se braque, on s’insurge. On se raccroche à la possibilité d’un malentendu, on négocie avec l’erreur humaine. On se cramponne de toutes ses forces au fol espoir qu’il suffit de nier la réalité pour l’anéantir. On se dit que c’est un cauchemar et qu’on va se réveiller, forcément. On se dit que ce n’est pas possible.
— Vous comprenez ce que je dis, monsieur Lionel ?
Le médecin l’observait. Hugues a acquiescé. Puis il a tourné la tête vers son père et l’expression inscrite sur le visage du vieil homme lui a brisé le cœur. Ses traits étaient marqués par une détresse insondable, la mâchoire crispée, ses fines lèvres serrées l’une contre l’autre, comme si elles craignaient désormais de se dissocier et de se perdre à jamais. Ses yeux étaient creusés, dans lesquels la peur prenait toute la place. Et là, au centre de ses pupilles, brillait une inéluctable solitude.
Hugues ne se rappelle plus avec précision la façon dont ils ont pris congé. Il sait juste qu’ils ont convenu d’un prochain rendez-vous, dont il a noté la date et l’heure dans son téléphone. Ce dont il se souvient également, assez nettement d’ailleurs, c’est son père et lui dans la rue, côte à côte, avec ce silence compact entre eux et ce précipice tout autour, au bord duquel ils se tiennent, et grande est la tentation de s’y laisser tomber. Ils ont marché au gré des rues, sans but précis, comme s’ils apprivoisaient déjà le chaos à venir. À plusieurs reprises, Hugues a essayé de parler, de dire quelques mots, comme pour empoigner le cauchemar, lui donner des formes, un contour, et donc des limites. Mais les sons s’agglutinaient dans sa gorge, tout au fond, incapables de franchir la barrière de ses lèvres. Il s’agaçait de son mutisme ainsi que de celui de son père, comme si le vieil homme revêtait le costume du malade et en épousait déjà les caractéristiques. Hugues avait envie de le secouer, de le supplier de ne pas porter sur le monde ce regard déconnecté. Pas maintenant, pas tout de suite.
Ils ont fini par prendre le chemin du retour. Hugues a reconduit son père chez lui, rue des Oliviers, et s’est assuré qu’il ne manquait de rien. Il restait de la nourriture dans le frigo, de quoi se faire des pâtes, ce qu’il fait à présent, l’esprit perdu dans l’eau bouillonnante, toujours dans un silence obstiné, juste entrecoupé de questions pratiques. Tu les aimes al dente tes pâtes ? Je te mets du fromage direct dans la casserole ? Tu préfères le gruyère ou le parmesan ?
Sensation de fuite, combler l’absence d’avenir par les impératifs du présent, se prouver que la vie continue.
— Tu as toujours été très gentil.
Hugues sursaute. La voix de son père le ramène à la surface. Il lance vers lui un regard intrigué et reconnaissant à la fois.
— Petit garçon, tu étais d’une gratitude surprenante, continue André avec calme. Plus que les enfants de ton âge, je veux dire. Je me souviens de ce jour, à la plage, il se faisait tard, nous devions rentrer. Maman commençait déjà à rassembler les affaires. Il fallait te rhabiller, mais tu étais couvert de sable mouillé, celui qui colle à la peau et dont il est si difficile de se débarrasser. Tu devais avoir trois ou quatre ans, pas plus…
Hugues tend l’oreille. Penché au-dessus des fourneaux, il lui tourne le dos. Pourtant, son être tout entier est rivé aux paroles du vieil homme. Elles emplissent l’espace, elles racontent le passé et, pour la première fois, les échos qui s’en dégagent prennent des allures de trésor. Un souvenir dans la bouche de son père, c’est désormais une lueur dans la nuit. Et même s’il connaît cette histoire par cœur, Hugues l’écoute en retenant son souffle.
— La mer était à marée basse, il fallait marcher loin avant de l’atteindre, continue André. Je t’ai accompagné puis je t’ai aspergé pour rincer le sable, avant de t’emmitoufler dans une serviette. Ensuite, je t’ai pris dans mes bras en te frictionnant, tandis que nous remontions la plage pour rejoindre maman.
Il marque une pause dans laquelle traîne un élan de tendresse.
— Tu grelottais, blotti contre moi, alors je t’ai serré encore plus fort pour te réchauffer. Juste avant d’arriver près de maman, tu t’es légèrement écarté de moi, tu m’as regardé et tu m’as dit…
Nouveau silence. Hugues attend la suite. Il sait très bien ce qu’il a dit, il connaît chaque mot de cette histoire, il en prévoit l’intonation, la façon dont son père imite sa voix d’enfant, le sourire doux et fier qui ponctue l’anecdote. Il est prêt à en mimer chaque syllabe.
Pourtant le silence s’éternise, dans lequel se faufile une pointe d’embarras. Intrigué, Hugues se retourne.
André se tient debout au milieu de la pièce, immobile, le corps aux aguets. On dirait qu’il retient son souffle. Ses traits sont également figés, à la façon d’un chasseur qui attend sa proie.
Hugues l’encourage à continuer.
— Je t’ai dit…
Mais ce qui devait relancer la machine semble la bloquer plus encore. André porte sur son fils un regard surpris, comme s’il le découvrait seulement.
Hugues réalise que son père a perdu le fil.
André, lui, constate que son fils a compris. Il a compris que sa pensée s’effilochait comme des nuages défaits par le vent.
Ce vent qui désormais souffle dans sa tête.
Les deux hommes se dévisagent. Chacun devine dans le regard de l’autre cette détresse qui l’étreint.
Chapitre 5
— Alzheimer ?
Linda est sidérée. Le soleil inonde le feuillage qui les surplombe, le brouhaha des conversations les isole des oreilles indiscrètes, eux-mêmes se fondent dans l’anonymat d’une terrasse bien remplie. Le temps est à la quiétude.
En face de Linda, Hugues confirme d’un hochement de tête.
— Il l’a pris comment ? demande-t-elle encore.
Hugues lui raconte l’entrevue avec le médecin, leur accablement, puis le silence qu’ils ont gardé l’un et l’autre pour ne pas affronter le monstre. Ses mots sont pesés, il parle d’une voix lente, prend le temps de construire ses phrases, comme on érige un rempart contre l’affolement.
Linda l’écoute avec gravité.
— Tu vas faire quoi ?
Cette fois, il trahit son désarroi.
— Je n’en sais rien.
Il hausse les épaules, s’apprête à dire quelque chose, se ravise. L’émotion le saisit soudain, la douleur le prend de court, il grimace, ravale un hoquet, assiste, impuissant, à l’assaut d’une peine féroce. Aussitôt, il tente de se maîtriser. Non pas pour Linda, leur amitié lui permet ce genre de franchise. C’est plutôt la terrasse environnante qui le gêne, les gens tout autour. Même si personne ne lui prête attention, Hugues a la sensation que tout le monde scrute son chagrin.
Linda ne le quitte pas des yeux. Elle le connaît bien et mesure la profondeur du gouffre qui le happe.
— Tu vas devoir le placer ?
— Je n’ai pas le choix, murmure-t-il à regret.
Elle hoche la tête, navrée.
— Hugues…
Elle avance sa main sur la table pour saisir celle de son ami.
— Ça va, toi ?
La question à ne pas poser. Il fait oui du menton et sourit, de ces rictus qui menacent de se rompre à tout moment, de ces masques trop fragiles pour mentir.
— Je suis désolée…
Rien d’autre à dire.
Elle lui serre la main plus fort, cherche son regard qui se dérobe, du moins le pense-t-elle, car Hugues remarque quelque chose derrière elle et reprend aussitôt contenance. Le serveur apparaît alors à sa droite et dépose sur la table les deux bières commandées. Il demande à encaisser, il a fini son service.
— Laisse, c’est pour moi, dit Hugues en retirant sa main qu’il plonge dans la poche intérieure de sa veste.
— Hors de question !
À son tour, elle saisit son sac et en sort son portefeuille. Hugues le lui arrache des mains.
— Viens le chercher si tu veux payer.
Linda ébauche un mouvement en direction du portefeuille, qu’elle sait pourtant hors d’atteinte. Puis elle abandonne dans la foulée, sans livrer de combat.
— Traître ! grommelle-t-elle avec tendresse.
— Handic ! rétorque-t-il sur le même ton.
Hugues paie les consommations, laisse un pourboire. Le serveur parti, tous deux saisissent leur verre qu’ils tendent l’un vers l’autre. Pas vraiment pour un toast, rien à fêter. Juste, dans leurs yeux, l’adresse d’un soutien, la promesse d’être là si besoin. Amis depuis toujours, ils partagent l’intimité de ceux qui se connaissent par cœur, témoins réciproques de situations gênantes, ces moments d’embarras que seule l’enfance engendre. Tenues repoussantes, coiffures abjectes, ils se sont vus en pleurs, en sang, en sale, le ridicule en bandoulière et la honte au front. Ils sont l’intégrité de l’autre, la vérité devant Dieu, « croix de bois croix de fer, si je mens je vais en enfer ». Entre eux, ni bluff ni fanfaronnades, ils ne se la font pas, ils n’ont rien à prouver. Ensemble, ils ont connu les sommets autant qu’ils ont touché le fond. Ils ont ri, ils ont pleuré, se sont engueulés, réconciliés, tiré la tronche, adressé des reproches, complimentés, félicités. Ils sont l’âme sœur de l’autre.
— Sinon, il y a cette femme que j’ai revue, enchaîne Hugues.
Il est urgent de parler d’autre chose, rien de plus à ajouter au sujet de son père. Il faut maintenant digérer. Linda saisit la balle au bond.
— Quelle femme ?
— Une femme que j’ai rencontrée en boîte il y a pas mal d’années. Elle m’avait bien allumé, on a fini par s’envoyer en l’air chez moi. Elle s’est sauvée, sans me laisser son numéro. Et là, il y a une semaine, je la retrouve à la sortie du cours de solfège. C’est la mère d’un de mes élèves.
Courte pause.
— Elle ne m’a pas reconnu, ajoute-t-il avec une pointe d’humilité amusée. Enfin… C’est en tout cas ce qu’elle m’a soutenu.
Linda lui adresse un sourire compatissant.
— Bon, je me suis planté sur son prénom, admet Hugues. J’avais le souvenir qu’elle s’appelait Marie, mais elle a prétendu le contraire…
— Et elle s’appelle comment ?
— Aucune idée, elle a écourté nos retrouvailles.
— Tu m’étonnes ! Elle ne peut décemment pas reconnaître un coup d’un soir devant son fils.
Hugues confirme d’une moue d’évidence.
— Ou alors elle ne t’a vraiment pas reconnu, ajoute Linda.
— C’est possible, convient Hugues. On était aussi bourrés l’un que l’autre. Et c’était il y a longtemps.
— Mais toi, tu t’en souviens… fait-elle remarquer, le sourire en coin.
Hugues lui répond par un silence un peu las. Sa vie sentimentale est un interminable désert : à l’aube de ses quarante ans, soit ses aventures sont sans lendemain, soit ses lendemains sont sans aventure. Il a connu trois histoires d’amour dans sa vie, de celles qui comptent. La première à l’adolescence, il avait quinze ans, elle aussi, Élodie, qu’il appelait Mélodie – contraction de « mon Élodie » –, car déjà la musique rythmait ses loisirs et ses rêves de carrière. C’était une adorable brunette, une gamine délurée qui n’avait pas sa langue dans sa poche et jurait comme un charretier, un garçon manqué comme on les appelait à l’époque. Non pas que la grossièreté fût l’apanage de la gent masculine, encore que, c’était un temps où la vulgarité passait mieux dans la bouche des hommes, sorte de virilité admise. Élodie s’affichait fièrement à son bras et lui roulait des pelles à en faire rougir le monde. Elle ne craignait ni les moqueries ni le qu’en-dira-t-on, clouait le bec à ceux qui la jugeaient et était imbattable pour mimer la remontée mécanique de son majeur, qu’elle exhibait et présentait sans complexe à ses adversaires. Elle était fantastique ! Elle lui fut arrachée quelques mois plus tard au profit de la carrière de son père. Hugues n’a jamais compris dans quelle branche il travaillait, un secteur commercial lui sembla-t-il, quoique, à la réflexion, ce pût aussi bien être celui des affaires. Toujours est-il que le bonhomme fut appelé sous d’autres cieux, emmenant femme et enfant. La distance eut très vite raison de leur amour.
Sa seconde histoire prit ses vingt-cinq ans en otage. Virginie. Aujourd’hui encore, à ce seul prénom, le cœur de Hugues tressaute par réflexe. Une passion débordante, vampirique, dévorante, qui le priva de sa raison plusieurs mois durant. Une période enchanteresse, car il n’est rien de plus fou que l’amour quand il est partagé, celui qui fait briller de l’intérieur, qui transforme tout, les choses et les gens, les contingences et jusqu’aux souvenirs. Elle était danseuse, brindille longiligne aux formes ondulantes, pleine de grâce et de souplesse, de corps et d’esprit, et leurs deux talents s’accordaient à merveille, musique et danse réunies dans les draps d’une valse. Au bout d’un an, le quotidien reprit ses droits et ils entamèrent le difficile combat contre la routine. Installés dans un petit appartement de la rue des Limiers, à deux pas du centre, ils vécurent ensemble quatre années au cours desquelles l’émerveillement fit place à l’habitude, l’indulgence à l’agacement, l’amour à la lassitude, les rires aux pleurs. Histoire banale s’il en est, plus encore quand on sait qu’une fois séparés, Hugues réalisa à quel point il était encore amoureux de Virginie et qu’il ne pouvait pas vivre sans elle. Il tenta de la récupérer. Trop tard. Aujourd’hui, il regrette toujours sa négligence, reconnaissant qu’il a eu sa part de responsabilité dans la dissolution de leur couple. Fin de l’histoire.
Sa dernière conquête remonte à cinq ans. Vanessa. Une folle. Il crut retrouver avec elle la passion enivrante vécue avec Virginie. Hélas ! Cette passion-là s’est vite révélée trop violente à son goût. Ébats torrides, débats orageux, hurlements, scènes de ménage, jalousie extrême : Vanessa était prête à tout pour lui prouver son amour et, surtout, recevoir en retour celui qui lui était dû. Ce que Hugues ne parvint jamais à lui offrir. À bout d’arguments, il dut mettre fin à leur histoire, mais ça lui prit quelques mois supplémentaires, tant la fougueuse Vanessa refusait la défaite. Aux dernières nouvelles, elle a mis le grappin sur un autre bonhomme qui semble s’en tirer pas trop mal. Ce qui fait penser à Hugues que…
— Laisse tomber, ce n’est pas grave. Tu ne lui as pas laissé un souvenir impérissable, voilà tout.
— Pardon ?
Linda précise sa pensée :
— Ça a l’air de te tracasser, cette Marie qui ne s’appelle pas Marie. C’est si important pour toi ?
— Non… répond Hugues, reprenant pied dans la conversation.
Puis il ajoute d’une voix plus ferme :
— Non, pas du tout en fait. C’était juste histoire de raconter quelque chose.
Cette simple phrase les ramène à la maladie d’André, et le ciel s’assombrit, au propre comme au figuré : quelques nuages passent et privent un instant la terrasse des rayons du soleil.
Cette fois, Linda l’assure de sa présence durant l’épreuve qui s’annonce. Elle sera là, à ses côtés. Il n’est pas seul. Elle l’épaulera, du moins autant que possible, elle l’aidera à trouver une maison de retraite correcte, par exemple. Hugues la remercie, il sait pouvoir compter sur elle. Ils terminent leur bière en partageant d’autres réflexions, quelques souvenirs et des paroles pour ne rien dire. Puis ils s’apprêtent à partir.
Hugues se lève, fait le tour de la table et saisit les poignées du fauteuil roulant de Linda. Il tire d’abord son amie vers l’extérieur de la table, lui fait faire demi-tour, puis la pousse jusqu’à la rue. Il la raccompagne ensuite à son bureau, avant de prendre la direction de l’académie.
* * *
À présent, il longe les couloirs de l’école, pressant le pas vers la salle de solfège. Il a quelques minutes de retard et, déjà, les élèves sont installés en classe. Son entrée calme le chahut. Il rejoint son bureau sans un mot, y dépose sa partition, puis se tourne vers les enfants.
— Ouvrez votre cahier de dictée. »
À propos de l’auteur
 Barbara Abel © Photo Marc Bailly
Barbara Abel © Photo Marc Bailly
Née en 1969, Barbara Abel vit à Bruxelles. Pour son premier roman, L’Instinct maternel, elle a reçu le prix du Roman policier du festival de Cognac. Aujourd’hui, ses livres sont adaptés à la télévision, au cinéma, et traduits dans plusieurs langues. Le film Duelles, adapté de son roman Derrière la haine, a reçu neuf Magritte du cinéma en 2020, et a été réadapté aux États-Unis avec Jessica Chastain et Anne Hathaway dans les rôles principaux (Mothers’ Instinct). Comme si de rien n’était est son quinzième roman. (Source : Éditions Récamier)
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte Twitter de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#commesideriennetait #BarbaraAbel #editionsrecamier #hcdahlem #thriller #litteraturepoliciere #RentréeLittéraire2024 #coupdecoeur #litteraturecontemporaine #Rentréedhiver2024 #rentreelitteraire #polar #rentree2024 #RL2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict






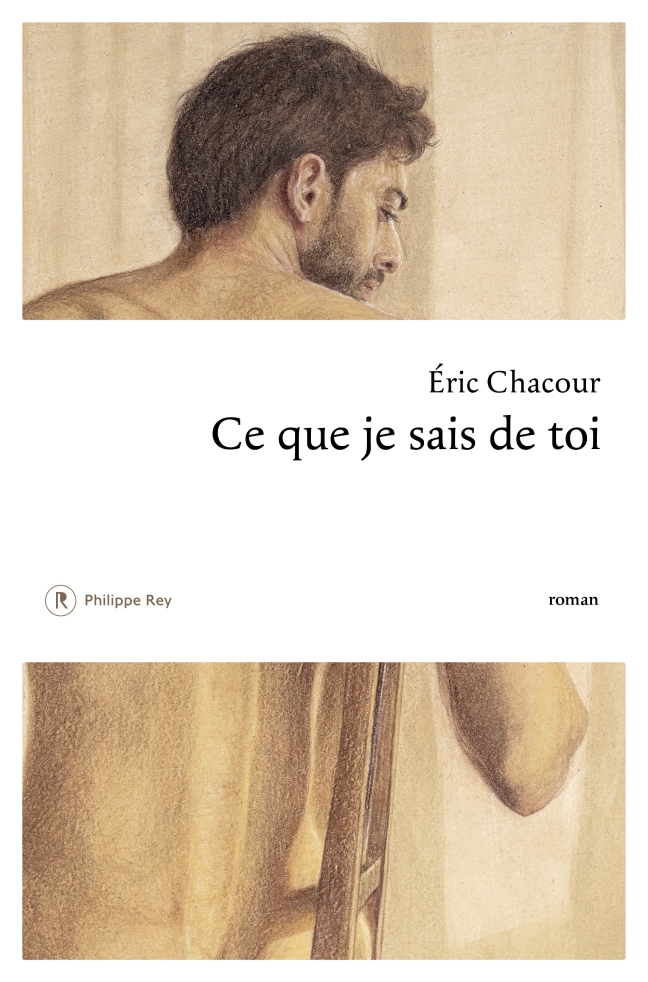


 Éric Chacour © Photo Justine Latour
Éric Chacour © Photo Justine Latour

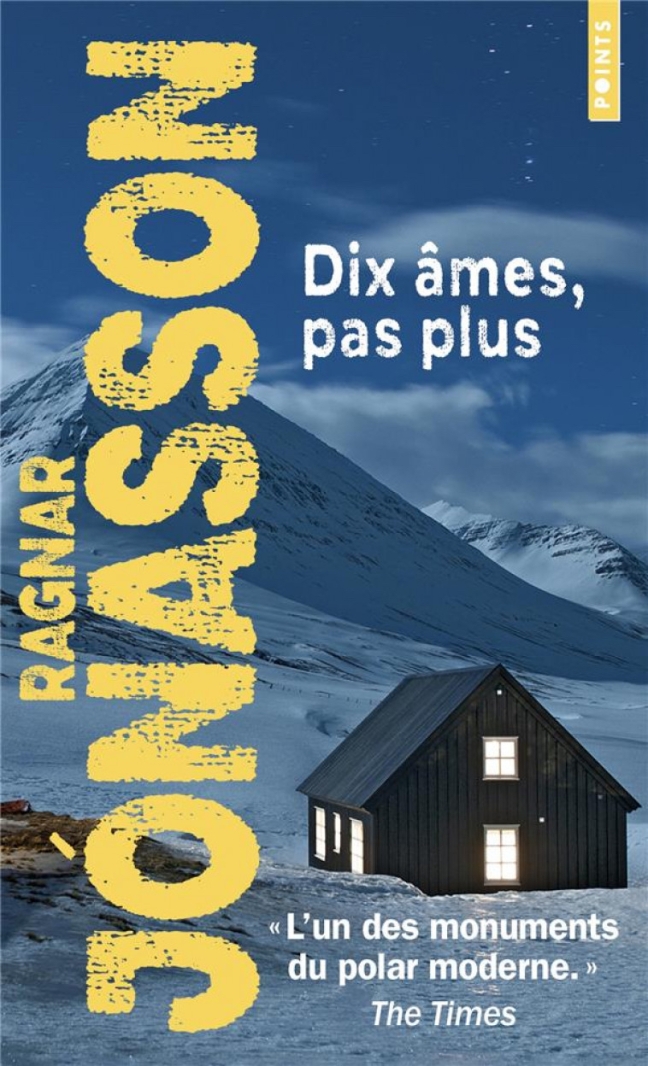









 Le jury du Prix Jean Anglade 2022, sous la présidence de Pierre Vavasseur à Clermont-Ferrand © DR
Le jury du Prix Jean Anglade 2022, sous la présidence de Pierre Vavasseur à Clermont-Ferrand © DR

 Ragnar Jónasson © Photo DR
Ragnar Jónasson © Photo DR



 Emmanuel Chaussade © Photo Guillaume Noth
Emmanuel Chaussade © Photo Guillaume Noth



 Cécilia Castelli © Photo DR
Cécilia Castelli © Photo DR





