En deux mots
Après l’achat d’une maison en Drôme provençale, Hervé Le Tellier découvre une inscription sur le crépi: André Chaix. Intrigué, il retrouve ce même nom sur le monument aux morts du village. Il décide alors d’enquêter, puis de raconter la vie de ce résistant mort à vingt ans.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Vie et mort d’un résistant
Alors que l’on commémore les 80 ans du débarquement et des combats de la libération, Hervé Le Tellier a choisi de retracer le destin d’un résistant, choisi presque au hasard, André Chaix. L’occasion de revenir sur l’occupation, l’engagement, la résistance, l’idéal de liberté.
Hervé Le Tellier a acheté une maison «vieille de deux siècles, aux murs épais, au cœur du hameau de La Paillette, à Montjoux, tout près de Dieulefit.» Un havre de paix qui va offrir au Prix Goncourt pour L’Anomalie le sujet de son prochain livre. Mais n’allons pas trop vite en besogne.
Cette maison appartenait à une céramiste qui avait décoré les murs de plaques qu’elle a retirées avant son départ. «Lorsque la dernière plaque, la plus à droite, a été retirée, un nom est apparu, gravé à la pointe en lettres majuscules dans le crépi grège : ANDRÉ CHAIX».
L’auteur ne le sait pas encore, mais ce nom va l’occuper durant de longues semaines. Il le retrouve d’abord sur le monument aux morts, avec ce complément d’information: mai 1924 – août 1944. «Les dates disaient tout: Chaix était un résistant, un maquisard sans doute, un jeune homme à la vie brève comme il y en eut beaucoup.»
Nous étions en 2020 et comme le confinement décrété par les autorités serait plus agréable dans la Drôme qu’à Paris, l’occasion était tout trouvée d’en savoir davantage sur la vie de cet illustre inconnu.
«J’ai posé des questions, j’ai recueilli des fragments d’une mémoire collective, j’ai un peu appris qui il était. Dans cette enquête, beaucoup m’a été donné par chance, presque par miracle, et j’ai vite su que j’aimerais raconter André Chaix. Sans doute, toutes les vies sont romanesques. Certaines plus que d’autres.»
Voilà pour le projet esquissé durant le chapitre initial.
Les archives militaires vont livrer les premières informations sur ce destin brisé: «André Chaix est l’un des 13 679 FFI (Forces françaises de l’intérieur) tués au cours de la guerre. Les deux tiers sont tombés entre juin et septembre 1944.»
Une plaque commémoratives apposée à Grignan en dira davantage: «Ici, à Grignan, le 22 août 1944, un détachement FTP du 3ème bataillon Morvan se dirigeant sur Montélimar s’est heurté à une colonne de chars allemands. Au cours de cet engagement, sept jeunes combattants furent tués. Les combats de Nyons et de Grignan furent cités à l’ordre de l’armée. Vous qui passez souvenez-vous.»
Les archives de la Drôme permettront de retrouver sa famille, ses parents et son frère Marcel.
Mais c’est un coup de chance qui va nourrir le livre-hommage qui prend alors forme. Une petite boîte renfermant des objets personnels d’André Chaix qu’Hervé Le Tellier nous détaille avant de poursuivre avec les digressions dont il a le secret.
Le roman prend alors un tour plus personnel, revient sur l’Occupation et la Résistance, sur des exactions et des faits d’armes avec, entre les lignes, cette question : qu’aurions nous fait dans de pareilles circonstances ? Le seul petit bémol que j’apporterai à ces réflexions sont celles concernant l’Alsace qui méconnaissent le lourd tribut payé par cette région et les résistants qui ont bel et bien existé dès le début du conflit. Alors oui, «le nazisme n’est pas une page comme les autres de l’histoire de l’humanité. Tant mieux s’il est impossible d’en parler sereinement, et serein, ce chapitre ne le sera pas.»
Des souvenirs et des émotions personnelles viennent tout au long du livre s’ajouter à l’évocation de ce jeune résistant, comme la projection de Nuit et brouillard d’Alain Resnais au ciné-club de son lycée. «Les images de ces monceaux de cadavres charriés dans des fosses par des bulldozers m’interdisaient soudain l’insouciance. J’avais douze ans et je n’étais plus que questions et colère. J’ai trouvé certaines réponses. La colère, la rage, même, ne sont jamais retombées. Il est bon qu’elles restent intactes.»
Livre engagé, Le Nom sur le mur fait aussi le parallèle avec l’actualité et nous met en garde. Je souscris entièrement à son analyse à laquelle je ne retirerai aucune virgule : «On ne débat pas de telles idées, on les combat. Parce que la démocratie est une conversation entre gens civilisés, la tolérance prend fin avec l’intolérable. Quiconque sème la haine de l’autre ne mérite pas l’hospitalité d’une discussion. Quiconque veut l’inégalité des hommes n’a pas droit à l’égalité dans l’échange. La formule lapidaire de l’historien et résistant Jean-Pierre Vernant me convient: « On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. »»
Signalons la rencontre avec Hervé Le Tellier organisée par la Librairie 47° Nord à Mulhouse le 16 mai à 20h
Le nom sur le mur
Hervé Le Tellier
Éditions Gallimard
Roman
176 p., 19,80 €
EAN 9782073061539
Paru le 18/04/2024
Où?
Le roman est situé principalement en Drôme provençale, du côté de Dieulefit.
Quand?
L’action se déroule de nos jours, avec des retours en arrière pendant la Seconde guerre mondiale.
Ce qu’en dit l’éditeur
Je ne suis pas l’ami d’André Chaix, et aurais-je d’ailleurs su l’être, moi que presque rien ne relie à lui ? Juste un nom sur le mur.
Chaix était un résistant, un maquisard, un jeune homme à la vie brève comme il y en eut beaucoup.
Je ne savais rien de lui. J’ai posé des questions, j’ai recueilli des fragments d’une mémoire collective, j’ai un peu appris qui il était. Dans cette enquête, beaucoup m’a été donné par chance, presque par miracle, et j’ai vite su que j’aimerais raconter André Chaix. Sans doute, toutes les vies sont romanesques. Certaines plus que d’autres.
Quatre-vingts années ont passé depuis sa mort. Mais à regarder le monde tel qu’il va, je ne doute pas qu’il faille toujours parler de l’Occupation, de la collaboration et du fascisme, du rejet de l’autre jusqu’à sa destruction. Ce livre donne la parole aux idéaux pour lesquels il est mort et questionne notre nature profonde, ce désir d’appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire. H. L. T.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Le Point (Laetitia Favro)
France Inter (Grand canal)
Marianne (Solange Bied-Charreton)
Huffington Post
France culture (Les midis de culture)
Les Inrocks (Nelly Kaprièlan)
Page des libraires (Stanislas Rigot, Librairie Lamartine à Paris)
Actualitté (Hocine Bouhadjera)
Blog Culture 31
Hervé Le Tellier présente «Le Nom sur le mur» à la Grande Librairie © Production France Télévisions
Les premières pages du livre
« LA MAISON NATALE
Je cherchais une « maison natale ». J’avais expliqué à l’agent immobilier : pas une villa de vacances, pas une ruine « à rénover », pas une « maison d’architecte », pas un « bien atypique », ces bergeries ou magnaneries transformées en habitations où l’on se cogne dans les chambranles de portes à hauteur de brebis.
Non, je voulais une maison où j’aurais pu m’inventer des racines, et aussi une maison dans un village vivant, où l’on fait ses courses à l’épicerie et boit l’apéro au café, dans cette Drôme provençale où j’avais des amis, depuis longtemps. Alors, j’ai visité cet ancien relais de poste, fait quelques pas dans le petit jardin potager à l’arrière, avec sa perspective sur les pics de Miélandre et du Grand Ruy, j’ai gravi l’escalier de pierre qui desservait les chambres et un grenier poussiéreux. Bien sûr, j’avais trouvé, c’était elle, ma maison natale. Une bâtisse de deux étages, solide, vieille de deux siècles, aux murs épais, au cœur du hameau de La Paillette, à Montjoux, tout près de Dieulefit.
Tina, la propriétaire, était céramiste. Elle était aussi allemande. Elle avait vécu là près de deux décennies, jusqu’à ce qu’elle estime, à soixante-cinq ans, que le métier exigeait trop de ses muscles et de son dos et qu’il était temps pour elle d’aller peindre des aquarelles à Granville. Son travail sur la matière évoquait un Nicolas de Staël amateur d’émail, et sur la façade côté rue, des plaques de céramique vernissées, vissées à hauteur d’homme, couvraient une bande horizontale. À son départ, elle les avait toutes emportées sauf une. C’était son cadeau et sa trace, que je lui ai promis de préserver.
Lorsque la dernière plaque, la plus à droite, a été retirée, un nom est apparu, gravé à la pointe en lettres majuscules dans le crépi grège : ANDRÉ CHAIX. Le R d’André, à mieux regarder, est une grande minuscule. Lorsque l’on déjeune dans cette cour, au frais, à l’ombre du grand platane, on distingue à peine les lettres. Je doute que le crépi, qui s’est ici et là détaché de la pierre, ait été repris jamais. Je me suis habitué à ce nom sur le mur, et j’ai fini par l’oublier.
Je connais quelques Chaix. Marie Chaix, surtout, la romancière et traductrice : Marie fut la compagne de Harry, Harry Mathews, l’écrivain oulipien, le grand ami de Perec. Mais Chaix est le nom de son premier mari Jean-François, originaire de Savoie, qu’elle a gardé comme patronyme. Elle a refusé, tout comme sa sœur aînée Anne Sylvestre, de porter celui de son père Albert Beugras. Beugras, le bras droit de Doriot, qui avait fui en Allemagne à la fin de la guerre, qui avait été fait prisonnier par les Américains et que leurs services secrets avaient protégé. Lorsqu’ils avaient enfin accepté de le livrer à la justice française, Beugras avait échappé de peu à la peine de mort. Tout cela, Marie le raconte dans son roman Les Lauriers du lac de Constance, sous-titré Chronique d’une collaboration. C’est une digression, la première de nombreuses, mais elle prendra bientôt son sens.
Nous étions début mars 2020. Avec quelques amis, nous avions organisé une résidence d’écriture à La Paillette quand la menace d’un confinement s’est précisée. Nous avons décidé de ne retourner ni à Paris pour certains, ni à Nantes pour d’autres, mais de poursuivre ici nos travaux. Les épreuves de L’Anomalie m’arrivaient par coursier masqué, les réunions virtuelles se multipliaient, on inventait le mot « présentiel » et tout le monde se fabriquait des masques en tissu. À quoi bon rentrer ?
Sur la petite place du village, à côté de la boulangerie et à quelques mètres de chez moi, il y a un monument « à la mémoire des enfants de Montjoux morts pour la France ». Les guerres sont loin, ces morts sont oubliés et en ces matins de l’étrange printemps 2020 où la pandémie avait suspendu le temps, j’ai dû passer devant vingt fois, chargé de pain et de croissants, indifférent et pressé. Un jour de mai, je crois, un nom a accroché mon regard : CHAIX ANDRÉ (mai 1924 – août 1944). Les dates disaient tout: Chaix était un résistant, un maquisard sans doute, un jeune homme à la vie brève comme il y en eut beaucoup.
Je ne savais rien de lui, et plusieurs mois ont passé sans que je l’envisage comme sujet d’un livre possible. J’ai posé des questions, j’ai recueilli des fragments d’une mémoire collective, j’ai un peu appris qui il était. Dans cette enquête, beaucoup m’a été donné par chance, presque par miracle, et j’ai vite su que j’aimerais raconter André Chaix. Sans doute, toutes les vies sont romanesques. Certaines plus que d’autres.
Dans les Lettres à Lucilius qui disent l’essence du stoïcisme, Sénèque parle d’un homme qui se trouve au chevet d’un malade. Est-ce son ami qui veut être là dans ses derniers moments, ou bien un vautour qui convoite l’héritage ? « Le même acte est honteux et honorable », répond Sénèque. Seule l’intention compte. Je me suis interrogé sur la mienne. Je ne suis pas l’ami d’André Chaix, et aurais-je d’ailleurs su l’être, moi que presque rien ne relie à lui ?
Juste un nom sur le mur.
En laissant tomber cette courte phrase à la ligne, je me sens mal à l’aise. L’alinéa est toujours une décision littéraire, elle est parfois esthétisante, et je crains soudain l’insincérité derrière l’effet de style, quand le meilleur style doit se faire oublier. Pardonnez-moi par avance s’il m’échappe une phrase trop grosse, une tournure indécente, affectée, une métaphore s’échouant dans le lyrisme ou la grandiloquence. J’ai essayé de ne pas, même si j’ai parfois eu envie de.
Je n’ai pas écrit un « roman », le « roman d’André ». Je ne me suis pas adressé à lui comme s’il vivait, je ne l’ai pas tutoyé au fil du livre comme si c’était un ami. L’exercice aurait été artificiel, l’artifice aurait été indécent. Parfois, c’est vrai, je laisse l’imagination parler, mais il m’aurait paru obscène d’inventer, et j’ai préféré voyager dans cette époque que je n’ai pas connue, mais qui m’a constitué. J’ai désiré vous y emmener, partager avec vous ce que j’ai appris en écrivant. J’ai aussi voulu que le livre contienne des images, des photographies, afin qu’André, son amie Simone et quelques autres aient un visage et un corps pour vous puisqu’ils en ont pour moi. Des cartes postales, des affiches, pour rendre les lieux et l’époque. Si j’avais un enregistrement d’André, je le donnerais à entendre.
Je ne suis pas non plus historien et pourtant l’Histoire est forcément là, puisque André en fut à la fois acteur, héros et victime. Je n’ai pas écrit une thèse, je ne me suis pas plongé dans des archives secrètes, et je remercie tous ceux et toutes celles qui m’ont aidé à trouver des réponses à des questions parfois naïves. J’ai ici et là redit avec mes propres mots ce que j’ai lu dans des livres et des journaux, entendu dans des reportages radiophoniques, vu dans des documentaires. Je cite peut-être trop souvent, mais c’est pour m’approprier, ou ne pas paraphraser, ce qui a été fort bien formulé par d’autres.
Pardonnez-moi aussi les quelques erreurs, car bien sûr il y en a : parfois les mémoires vacillaient, les récits se contredisaient. Croyez-moi malgré tout, j’ai essayé de ne pas tricher.
L’année 2024 est celle du centenaire de la naissance d’André Chaix, et quatre-vingts années ont passé depuis sa mort. Mais à regarder le monde tel qu’il va, je ne doute pas qu’il faille toujours parler de l’Occupation, de la collaboration et du fascisme, du racisme et du rejet de l’autre jusqu’à sa destruction. Alors, je n’ai pas voulu que ce livre évite le monstre contre lequel André Chaix s’est battu, ne donne pas la parole aux idéaux pour lesquels il est mort et ne questionne pas notre nature profonde, notre désir d’appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire.
Je n’écrirai pas que ce texte était une « évidence », une « obligation », ou une « obsession ». À son ami Oskar Pollak, Franz Kafka dit qu’« un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». Il parle de lectures, plus que d’écriture. Disons que pour moi, parler avec simplicité d’André Chaix est devenu nécessaire.
Je n’arrive pas à penser la mort, ma mort, à l’apprivoiser, à donner enfin un sens à une vie qui n’en a pas. J’ai dû espérer qu’un livre respectueux, honnête et pudique sur ce jeune homme et ce que je crois savoir de lui comme de moi serait une borne sur ce chemin.
ANDRÉ CHAIX
Les auteurs de jadis commençaient sereinement leurs histoires à la naissance du héros. Ce procédé en vaut beaucoup d’autres, aujourd’hui de grand usage. Pourtant, c’est par sa mort que l’on commencera, puisque c’est elle qui donne naissance à ce livre.
Cette cote AC 21 P correspond aux dossiers individuels des déportés et internés résistants de la Seconde Guerre mondiale. On y trouve 55 788 dossiers. André Chaix est l’un des 13 679 FFI (Forces françaises de l’intérieur) tués au cours de la guerre. Les deux tiers sont tombés entre juin et septembre 1944.
Une plaque, apposée à Grignan, au chemin des Lièvres, en raconte un peu plus :
Ici, à Grignan, le 22 août 1944, un détachement FTP du 3ème bataillon Morvan se dirigeant sur Montélimar s’est heurté à une colonne de chars allemands. Au cours de cet engagement, sept jeunes combattants furent tués. Les combats de Nyons et de Grignan furent cités à l’ordre de l’armée.
Vous qui passez souvenez vous.
Un ami a pris la photographie pour moi. Yves habite tout à côté du chemin des Lièvres, et il n’y a jamais prêté attention. La plaque, enfin disons cette plaque, ne dit pas le nom des résistants. On ne peut pas tout écrire sur une plaque, c’est vrai. Ils s’appellent Jean Barsamian, Aimé Benoît, André Chaix, Gabriel Deudier, Jean Gentili et Robert Monnier. Des civils sont également tués : Paul Martin et Raoul Dydier. André est un combattant parmi d’autres, un « anonyme » comme on dit parfois, mais pas un « sans nom », puisqu’on le retrouve à La Paillette gravé dans le marbre d’un monument.
Les archives de la Drôme nous enseignent que son père Jean Chaix est né en 1900, à Vesc, un village à quelques kilomètres au nord de La Paillette, et sa mère Marcelle « née Sourbier » en 1903 à Montmeyran, au sud-est de Valence. Le premier mourra à l’âge de quatre-vingts ans, en 1983, la seconde dix ans plus tard. Ils vivront quarante et cinquante ans dans le deuil d’un fils.
Autour de Dieulefit, Chaix est un patronyme courant. D’ailleurs, sur les cinq mille Chaix de France, un sur quatre vit dans la Drôme. Le x final se prononce, comme dans Aix, ou pas, comme dans paix, mais pour André Chaix, plutôt un peu, sans trop l’appuyer : ɑ̃dre ʃɛks, donc, comme mari ʃɛks l’écrivaine. Chaix serait la forme régionale de l’ancien occitan cais – « machoire » –, un sobriquet pour un homme à la mâchoire proéminente, mais dans les Alpes, le mot désigne aussi une variété de genévrier dont on fait un sirop, le chaï.
Lors du recensement de 1931, Jean Chaix est inscrit comme boulanger à La Paillette – la boulangerie d’aujourd’hui est d’ailleurs au même endroit. C’est dans ce bâtiment que Marcelle et lui travaillent et habitent. Peu après la guerre, ils revendront le bail, incapables de continuer à vivre dans cette boulangerie hantée par le souvenir d’André. Ils ont un deuxième fils, Marcel, son cadet de quatre ans. Une photographie aux tons sépia, protégée par un verre et un cadre d’aluminium, réunit les deux frères. Ils ont sans doute huit et douze ans, sont coiffés comme il convient, ils sourient au photographe.
Si j’ai pu tenir ce cliché entre mes mains, c’est grâce à quelques-uns. En août 2023 avait lieu à Taulignan une exposition sur la Résistance dans la Drôme. Le site internet mentionnait l’affrontement de Grignan, ce bref combat où André Chaix et d’autres maquisards ont trouvé la mort, et le nom d’André apparaissait. J’ai contacté les organisateurs, et nous avons pris rendez-vous dans la salle polyvalente. Entre une jeep de l’armée américaine et une scène reconstituée de la vie au maquis où un poste à galène diffusait les messages de Radio Londres, ils m’ont tendu une petite boîte en carton, de la taille d’une carte postale, haute d’un centimètre, fermée par un ruban gris. Scotché maladroitement, un bout de papier où est simplement indiqué « André ». La famille leur avait légué tout ce qui pouvait rester d’un grand-oncle disparu, afin que sa mémoire ne se perde pas totalement. J’ai aussitôt ouvert la boîte et ce cadre où André et son frère sourient est apparu au-dessus d’enveloppes et de photographies. Comme honteux de profaner une sépulture, je n’ai pas osé fouiller davantage, j’ai refermé la boîte avec précaution, et j’ai attendu d’être rentré à La Paillette pour étaler sur mon bureau le contenu du petit coffret.
Il s’y trouvait beaucoup de choses, toutes précieuses et minuscules : la carte d’identité d’André, son certificat de travail comme apprenti aux « Céramiques de Dieulefit », l’article du Dauphiné libéré annonçant ses funérailles le 12 octobre 1949 au cimetière de Montmeyran, la page d’un livre pliée en quatre, un tract des Francs-tireurs et partisans, deux enveloppes contenant des lettres envoyées par André à ses parents, une dizaine de photographies aux bords dentelés, comme c’était la mode, une petite boîte métallique et rouillée de bonbons laxatifs purgatifs « Fructines-Vichy » – ça ne s’invente pas –, « traitement rationnel de la constipation et de ses conséquences » (la pharmacopée existe encore, j’en ignore l’efficacité), boîte remplie de minuscules clichés, bien sûr des planches-contacts qu’André a découpées. Il y a aussi une broderie de fil rouge aux initiales entrelacées A.C., un petit portefeuille de cuir marron, et enfin, objet incongru, terriblement intime et vivant, son fume-cigarette.
Ces poussières de la vie d’André Chaix, je les avais devant moi. Sur une photo, le jeune homme se tient debout sur un cheval, en équilibre ; sur une autre, il skie entre les tilleuls de la départementale enneigée qui mène à Dieulefit et où se trouve ma maison ; sur une autre encore, sa fiancée et lui marchent, enlacés : elle s’appelle Simone, si j’en crois les quelques mots amoureux que lui écrit André au dos du cliché. Mais j’en parlerai plus tard.
C’est étrange, mais je n’avais jusqu’alors jamais voulu, ou osé, imaginer André, ses traits, sa silhouette. Aujourd’hui encore je ne me représente pas le timbre de sa voix, son accent. Sur ces images d’hier, André a quoi, dix-neuf ans, mais il en paraît bien plus. Une maturité dans le regard, une assurance dans la stature. Il semble grand, il est athlétique, son visage est franc, ses yeux clairs, il a « une gueule », aussi. Une tête d’acteur, même. Quelque chose d’un Jean Gabin jeune, ou de Burt Lancaster, pour les choisir dans cette époque, ou d’un Marlon Brando, qui fêterait ses cent ans lui aussi cette année. Marcelle devait être si fière de son aîné.
Un certificat de travail dit qu’en avril 1943 « Chaix André » entre comme apprenti « dans la catégorie 7 » aux « Céramiques de Dieulefit ». Document signé par le gérant, André Le Blanc, le 20 avril, le jour où Hitler fête ses cinquante-quatre ans. L’apprenti André n’a que dix-huit ans, le destin peut encore basculer cent fois, mais le fils de boulanger veut déjà une autre vie, et il commence par troquer un four à 260 degrés contre un four à 1 200. L’atelier se situe rue du Savelas, au bord du Jabron, la petite rivière qui traverse Dieulefit. André, venant de la place Chateauras où se trouve le temple, remontait l’animée rue du Bourg et tournait à gauche, juste après l’église.
L’école communale de Montjoux est à quelques pas de la boulangerie, elle fait face au relais de poste et à ce mur au nom gravé.
J’ai voulu retrouver les bulletins scolaires du petit André, mais un siècle ou presque, c’est trop pour que l’Éducation nationale en ait gardé aucun. L’aurait-elle fait qu’un tel conservatisme m’eût quelque peu inquiété. Sur les lettres, ou au dos des photographies, l’écriture d’André peut sembler vacillante, mais les fautes ne sont pas si nombreuses, et les tournures sont élaborées. Et puis, les taches en témoignent, allez écrire proprement avec une plume Sergent-Major.
À La Paillette, …
Extraits
« Quand un événement fait basculer notre existence, c’est souvent des années plus tard qu’on en prend la mesure. J’ai été éjecté de l’enfance par un film, Nuit et brouillard d’Alain Resnais, vu au ciné-club du lycée. Les images de ces monceaux de cadavres charriés dans des fosses par des bulldozers m’interdisaient soudain l’insouciance. J’avais douze ans et je n’étais plus que questions et colère. J’ai trouvé certaines réponses. La colère, la rage, même, ne sont jamais retombées. Il est bon qu’elles restent intactes.
Le nazisme n’est pas une page comme les autres de l’histoire de l’humanité. Tant mieux s’il est impossible d’en parler sereinement, et serein, ce chapitre ne le sera pas. » p. 67
« On ne débat pas de telles idées, on les combat. Parce que la démocratie est une conversation entre gens civilisés, la tolérance prend fin avec l’intolérable. Quiconque sème la haine de l’autre ne mérite pas l’hospitalité d’une discussion. Quiconque veut l’inégalité des hommes n’a pas droit à l’égalité dans l’échange. La formule lapidaire de l’historien et résistant Jean-Pierre Vernant me convient: « On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. »» p. 80
À propos de l’auteur
 Hervé Le Tellier © Photo Francesca Mantovani
Hervé Le Tellier © Photo Francesca Mantovani
Né à Paris le 21 avril 1957, Hervé Le Tellier est l’auteur de romans, nouvelles, poésies, théâtre, ainsi que de formes très courtes, souvent humoristiques, dont ses variations sur la Joconde. Mathématicien de formation, puis journaliste — diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris (promotion 1983) —, il est docteur en linguistique et spécialiste des littératures à contraintes. Il a été coopté à l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) en 1992 par l’intermédiaire de Paul Fournel (simultanément au poète allemand Oskar Pastior) ; il soutient en 2002 une thèse de doctorat consacrée à l’Oulipo sous la direction de Bernard Cerquiglini et publie en 2006 un ouvrage de référence sur l’Ouvroir, Esthétique de l’Oulipo : il est depuis 2019 le président de Oulipo, le quatrième depuis la fondation de l’Ouvroir. Il a participé à l’aventure de la série Le Poulpe, avec un roman, La Disparition de Perek, titré en hommage à La Disparition, et adapté également en bande dessinée.
Éditeur, il a fait publier plusieurs ouvrages au Castor Astral comme What a man! de Georges Perec, et Je me souviens de Roland Brasseur. Avec d’autres artistes et écrivains, comme Henri Cueco, Gérard Mordillat, Jacques Jouet et Jean-Bernard Pouy, il a participé de 1991 à 2018 à l’émission Des Papous dans la tête animée par Françoise Treussard sur France Culture, ainsi qu’à l’émission de Caroline Broué, La Grande Table.
Chroniqueur de 1991 à 1992 sous le pseudonyme de « Docteur H » à l’hebdomadaire satirique français La Grosse Bertha, il a collaboré quotidiennement, de 2002 à 2016, à la lettre électronique matinale du journal Le Monde, par un billet d’humeur intitulé Papier de verre (en 2003, il publie sous le titre Guerre et plaies : de Chirac à l’Irak, un an de chroniques en tandem dans Le Monde.fr ces billets, avec les illustrations de Xavier Gorce), ainsi qu’à la revue Nouvelles Clés, où il a animé depuis 2009 la page Retrouver du non-sens. Il collabore à Mon Lapin quotidien, revue de L’Association, maison d’édition française de bande dessinée. Il est avec Frédéric Pagès, journaliste au Canard enchaîné, l’un des fondateurs en 1995 de Association des amis de Jean-Baptiste Botul, philosophe fictif. Il a reçu en 2013 le Grand prix de l’humour noir pour sa traduction factice des Contes liquides de Jaime Montestrela, un auteur portugais dont il a inventé la biographie. L’Anomalie, publié aux éditions Gallimard, obtient le prix Goncourt le 30 novembre 2020. En 2022, il participe à la conception d’un ouvrage de jeunes engagés pour la paix en Ukraine. En effet, celui-ci est membre du comité de lecture de l’ouvrage De l’encre pour la paix, ouvrage sorti en 2023 au profit de l’Unicef. En 2024, il publie Le Nom sur le mur, roman-hommage au résistant André Chaix. (Source: Wikipédia)
Page sur le site de l’Oulipo
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte X (ex-Twitter) de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur
Tags
#lenomsurlemur #HerveLeTellier #editionsgallimard #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

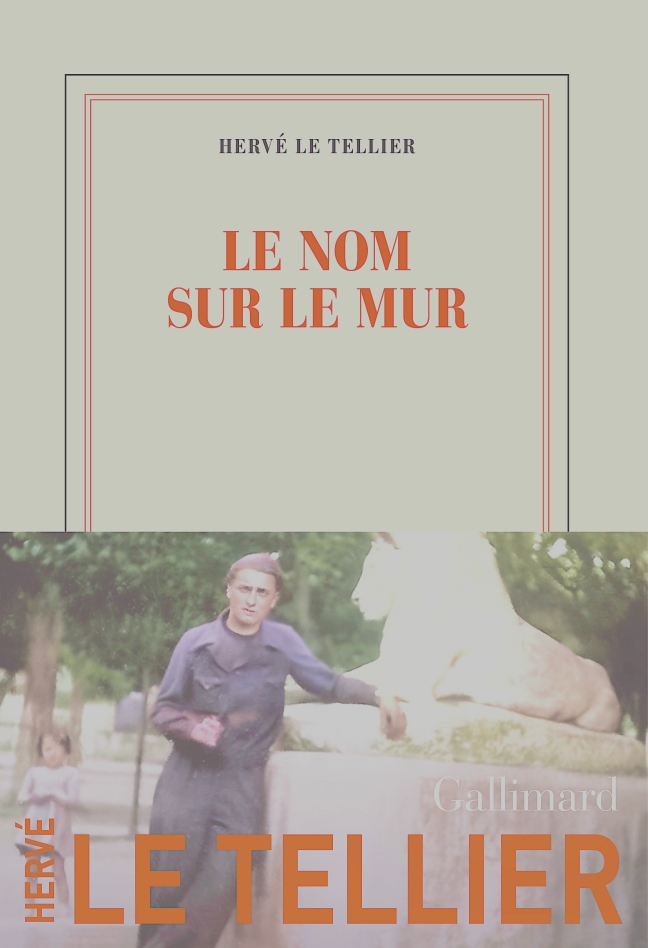



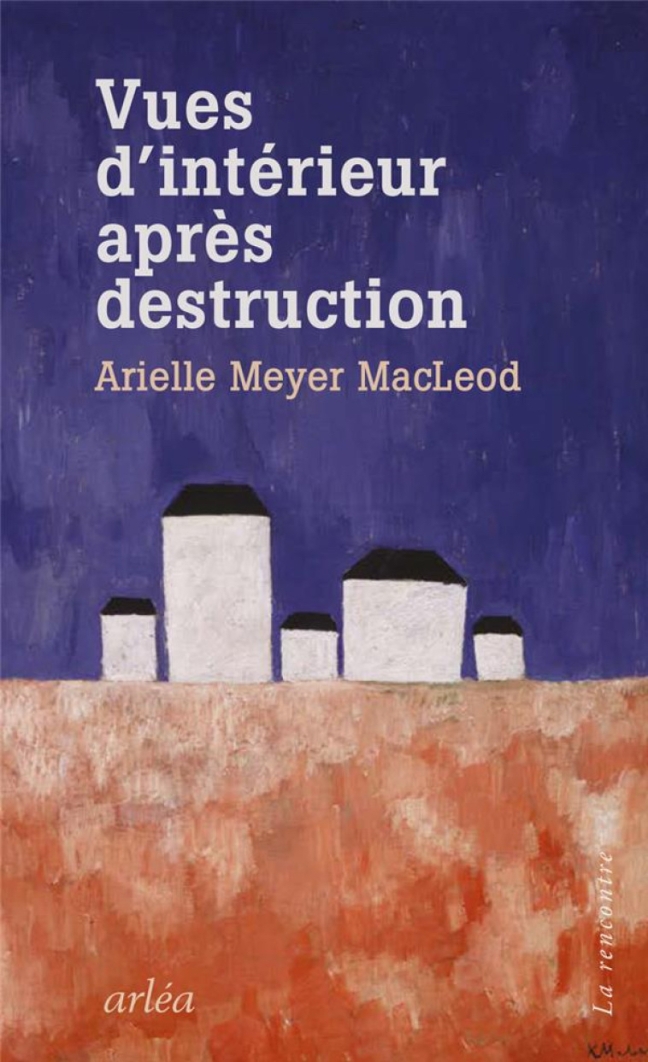


 Arielle Meyer MacLeod © Photo DR
Arielle Meyer MacLeod © Photo DR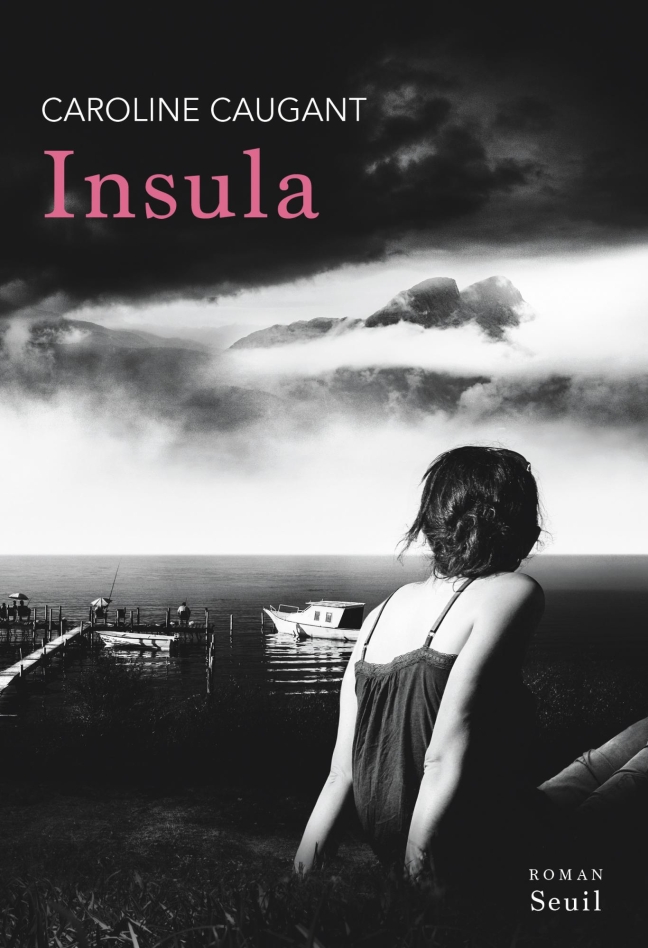
 Caroline Caugant © Photo Astrid di Crollalanza
Caroline Caugant © Photo Astrid di Crollalanza
 Violaine Huisman © Photo Beowulf Sheehan
Violaine Huisman © Photo Beowulf Sheehan





 Peter Stamm © Photo Gaby Gerster
Peter Stamm © Photo Gaby Gerster



 Pierre Chavagné © Photo DR
Pierre Chavagné © Photo DR

 Gaëlle Nohant © Photo Jean-François Paga
Gaëlle Nohant © Photo Jean-François Paga




 Brigitte Giraud © Photo DR
Brigitte Giraud © Photo DR


 Anne Serre © Photo Francesca Mantovani
Anne Serre © Photo Francesca Mantovani