En deux mots
Pendant les années qui ont suivi la mort de son mari Jean-Pierre Marielle, Agathe Natanson a pris la plume pour lui écrire. Elle retrace des souvenirs, dit les moments de chagrin et de solitude, les quelques rayons de soleil dont elle profite. Elle dit aussi sa gratitude et son combat contre la maladie qui l’a privée de derniers moments de bonheur: Alzheimer.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
«Les mois d’avril sont meurtriers»
Jean-Pierre Marielle est mort il y a cinq ans, le 24 avril 2019. Depuis ce jour sa veuve, Agathe Natanson, lui écrit régulièrement. Une correspondance qui lui permet de poursuivre leurs conversations, de dire son chagrin et son amour, mais aussi sa solitude et ses combats. Un bouleversant bréviaire anti-deuil.
«Une heure du matin, dormir. Essayer de ne pas voir qu’il fait tout noir (…) lutter du mieux qu’on peut contre l’angoisse, ignorer le silence, le grand silence, fermer les volets, les fenêtres, écouter son cœur battre un peu trop fort, sentir la vie s’envoler, ne pas savoir la retenir, ne plus pouvoir pleurer.» Perdre un être cher est une souffrance. Toujours. Agathe Natanson ne masque pas cette réalité et trouve les mots pour le dire. Des mots qui sonnent juste. Des mots qui bouleversent.
Tout juste espère-t-elle, en publiant sa correspondance post-mortem avec Jean-Pierre Marielle que ce petit livre vivra, «peut-être que d’autres veuves reconnaîtront les mêmes méandres douloureux, peut-être qu’elles se diront Ah oui, je ne suis pas toute seule, peut-être qu’elles se souriront. Si toutes les veuves du monde pouvaient se donner la main.»
Il y a les courtes missives, lancées come un cri de douleur ou de rage, plus rarement pour partager un moment de grâce et il y a les plus longues missives, celles qui reviennent sur certains épisodes de leur vie commune, des voyages à l’autre bout du monde ou des anecdotes de tournage. Mais il y a toujours cette volonté farouche de maintenir un lien que l’on sent d’autant plus fort qu’il a été construit sur le tard – leur rencontre date de 2003 – avec le souci d’oublier ce qu’il y a pu avoir avant pour construire quelque chose de neuf, de beau.
Alors oui, il y a de l’exaltation quelquefois et de l’amour toujours. Il y a des lieux et des musiques, des phrases et des odeurs, un bonheur qui s’est renforcé dans l’attention renouvelée à l’autre. Il y a aussi la maison et le jardin, témoins d’une belle complicité et dont il a fallu se séparer. «Avant de la quitter pour toujours, j’ai glissé dans une petite fente, entre deux pierres du mur, une photo de nous deux, elle nous permet d’exister encore un peu ensemble en secret, présence illusoire et dérisoire mais qui réconforte ma naïveté d’enfant triste et orpheline de toi, mon tout.»
Mais il y aussi cette réalité dont on ne peut se défaire et qui, comme une mer déchaînée, vient sans cesse briser la falaise. Alors «ce qu’elle veut, la veuve, c’est qu’on lui rende son amour, son rire, sa joie, sa vie. Son homme.»
Des instants de tristesse quand s’abat le poids de la solitude, quand on ne retrouve plus le goût de la vie, quand on dîne d’une boîte de sardines ou «quand on se met au lit à vingt et une heures avec une série sur son iPad et qu’on ne dort toujours pas à deux heures du matin».
Puis vient un rayon de soleil, un coup de fil, l’envie de se battre contre cette maladie qui fait si peur, à tel point qu’il est si difficile de l’écrire: Alzheimer. Un combat mené à travers une Fondation qui, elle aussi, les rassemble.
Agathe n’oublie pas non plus les proches, la famille et le chien Roméo. Tous ceux qui tentent de l’apaiser et la soutenir, avec plus ou moins de bonheur. Pour cela, ils auront droit à toute sa gratitude. «Merci pour votre présence, pour ces moments de grâce que vous m’avez offerts, déjeuners, dîners, spectacles, week-ends, voyages. Merci pour votre attention, votre bienveillance et votre légèreté. Merci pour les moments heureux où le ciel devient rose pâle couleur pétale.» Alors les mois d’avril sont un peu moins meurtriers.
NB. Tout d’abord, un grand merci pour m’avoir lu jusqu’ici! Sur mon blog vous pourrez, outre cette chronique, découvrir les premières pages du livre et en vous y abonnant, vous serez informé de la parution de toutes mes chroniques.
Chantons sous les larmes: lettres à Jean-Pierre Marielle
Agathe Natanson
Éditions du Seuil
Roman
168 p., 16,50 €
EAN 9782021548242
Paru le 22/03/2024
Ce qu’en dit l’éditeur
« Je rêve de vous, je dis vous parce qu’il me semble que nous devons de nouveau faire connaissance, vous m’intimidez maintenant que vous êtes dans votre nouveau monde. Sortons, allons prendre le thé et refaisons le chemin inverse, ce sera amusant, je suis prête, j’ai retrouvé la station debout, vos yeux peuvent croiser les miens. Venez, j’ai des choses à vous dire. C’est ainsi que débute la correspondance d’Agathe Natanson, avec l’homme tant aimé, à présent disparu. Des lettres, comme autant de rencontres, pour lui raconter ses jours et ses nuits dans la solitude révoltante du deuil qui est désormais la sienne. Dans ses mots, où se mêlent larmes et éclats de malice, chagrin et éclairs de joie, il y a tout le charme déployé pour tromper la tristesse, la capacité à chérir le souvenir d’une vie extravagante aux côtés du formidable comédien qu’était son mari. Et bien sûr ce goût irrésistible pour le jeu, qui les liait si fortement et qui fut tellement précieux quand la maladie fatale s’est immiscée dans la grande histoire d’amour de ce couple magnifique Agathe Natanson, comédienne, a été la dernière épouse de Jean-Pierre Marielle.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France Inter
CNews (Anne Fulda)
Les premières pages du livre
« Jean-Pierre chéri,
On devrait écrire un manuel qui s’intitulerait « Veuve mode d’emploi ». Comme pour un appareil ménager très sophistiqué. Un mode d’emploi pour sécuriser les veuves, les rassurer, les mettre sous grande protection. C’est très fragile, une veuve, ça peut se casser comme une boule de Noël. Une veuve, c’est une poupée qui a perdu son enfant roi, son protecteur, son tyran parfois. Une entité qui a perdu son référent, un croyant qui a perdu sa foi, un voleur qui a perdu son larcin, un chien qui a perdu son maître, ou tout simplement une femme qui a perdu son amour, son homme.
Jeunes, vieilles, toutes ont en commun le chagrin d’avoir pour toujours cette absence à porter, à chérir, ce rêve évanoui, cette histoire qu’elles ne peuvent plus partager et dont la fin s’écrit toujours trop tôt. Sans prévenir, sans crier gare, une force maléfique, venue ruiner un avenir qu’on croyait naïvement éternel.
Oui, un mode d’emploi pour apprendre à vivre la fin et surtout l’après. Un poème peut-être, ou une chanson. Une prière, un credo, quelque chose pour endiguer le désarroi et la grande tristesse qui habillent la veuve de brume et de grisaille. Les dix commandements de la veuve, un petit livre rose que je garderais pour qui un jour en aurait besoin.
Éventuellement, on pourrait le mettre en ligne, ce mode d’emploi, le déposer au pied des immeubles, prospectus refusé dans les boîtes aux lettres des habitants sans veuve, on pourrait le distribuer dans le métro ou le TGV. Il ferait partie de la vie et ce ne serait pas dramatique à lire, il ferait partie de notre quotidien, comme le mode d’emploi d’une cafetière. Et les veuves n’auraient qu’à ouvrir un tiroir de leur psyché pour se sentir accompagnées dans cet inconnu qu’est le veuvage, volage, voyage, élagage, grand âge…
Agathe
Attention violent
J’ai été enceinte pendant vingt-cinq ans. J’ai fait mieux que l’ourse, mieux que l’éléphante. Mon bébé à moi a mis tout ce temps avant de déclarer officiellement sa venue. Alors ces mots doux sont pour lui, mon incroyable nouveau-né. Je n’aime pas la vieillesse, et ce bébé tardif est le bienvenu, il me fait me sentir si jeune encore ! Je régresse, un vrai bonheur, le soir pour me rassurer je prends mon nounours dans les bras. Être mère à…, c’est quand même angoissant. Cette nuit mon bébé a cassé tous mes joyeux souvenirs, mes boules de Noël, mes boules de neige, mes boules de rêves. Il a tout cassé. J’ai pleuré, oui, j’ai pleuré sur ce bébé malvenu, mal foutu, à moitié autiste, à moitié pervers, à moitié mort-né. J’avance à reculons dans le monde de la folie, de la maladie, avec ce vieux bébé, j’avance et je sais que la partie désormais est perdue. Je suis dans l’univers carcéral de la démence, inapte à vivre cette explosion de violence, malgré les petits bonheurs quotidiens, bonheurs à la coque, bonheurs frivoles couleur au bonheur des dames. J’ai résisté à toutes sortes de tentations, l’étouffer, le malmener, le bercer, le materner, mon bébé d’amour, et j’ai choisi de l’aimer envers et contre tout, envers et contre tous. Je suis en attente dans les starting-blocks de l’abandon. Je m’empresse de rire de tout, de crainte d’être obligée d’en pleurer. Seule, si seule avec ce bébé monstrueux sans père, sans berceau, sans papiers, sans pedigree, ce bébé ange qui m’obsède, me dévore, me détruit et me sacralise. Hier tellement joyeuse, joueuse, légère, amoureuse, rêveuse. Aujourd’hui, toute petite souris qui n’arrive plus à se cacher, à tricher, à déjouer cette vérité absurde, je ne sais plus quoi faire de ce bébé, épuisée par une fatigue dévastatrice. L’oublier derrière une porte, le déguiser en clown triste ou le réduire façon Jivaro ? Non, je choisis de l’aimer follement. Sainte Agathe, priez pour moi s’il vous plaît. Le soir dans mon lit, position fœtale pour retrouver ma maman, ses douceurs, sa tendresse. Help, maman, si froid dehors si doux dedans. Une chanson douce…
Chagrin
Chagrin, quel joli mot. C’est doux, chantant, lumineux. Chagrin, c’est un doudou qu’on retrouve dès le matin en ouvrant les rideaux de la chambre. Chagrin, c’est une petite chanson qui trotte dans la tête dès le petit déjeuner. Chagrin, c’est un leitmotiv étrange, retranché dans tous les recoins de la maison, qui joue à cache-cache avec les sentiments fluctuants qui m’habitent. Chagrin, c’est ton absence, ton fauteuil vide dans le salon, ta veste en tweed, posée, inutile, sur le dossier d’une chaise abandonnée. Chagrin, c’est toutes les questions sans réponse. Chagrin, c’est la chanson sans paroles qu’on ne peut plus fredonner. Chagrin, c’est mon visage défait devant la glace quand les larmes se sont taries. Chagrin, c’est les repas sans appétit. Chagrin, c’est l’absence de projets pour la soirée. Chagrin, c’est les souvenirs qui reviennent en flot continu. Chagrin, c’est l’envie de te serrer dans mes bras. Chagrin, c’est le besoin de sortir avec toi, de marcher dans les rues sans but, pour le plaisir de sentir nos corps s’accorder. Chagrin, c’est l’impossibilité de rentrer avec toi à la maison. Chagrin, c’est ce mot qui contient tant de fragilités, tant de drames, tant de renoncements.
Je pourrais m’appeler madame Chagrin, bonjour, comment allez-vous ce matin, madame Chagrin ? Bien, je vous vois tout auréolée de chagrins divers et variés. Le chagrin vous va fort bien, madame Chagrin, c’est un véritable et précieux trésor ! Quelle chance ! Si vous êtes porteuse de chagrin, c’est que vous avez été heureuse, aimée, et que ce chagrin petit porte-bonheur est à l’aune de ces grands sentiments. Oui, c’est un joli mot décidément, le mot chagrin, il faut juste bien en comprendre le sens caché, l’apprivoiser avec tendresse et vivre avec comme avec un compagnon, certes un peu oppressant, mais auquel on peut s’habituer. Chagrin, c’est une fleur épinglée à la boutonnière d’une veuve qui a gardé le goût du bonheur. Chagrin, c’est un trèfle à quatre feuilles.
Progrès
J’avance bien dans ma nouvelle vie en solitaire, fière de moi. Je me tiens droite, je règle mes problèmes informatiques, je paie mes impôts, mes contraventions, je range mes photos, mes papiers d’intermittente de la vie, j’honore mes rendez-vous, je n’en décommande presque plus ! Je souris, je ris, je dors, je fais des projets loin des cimetières et des cercueils de carton destinés à la crémation, j’ai des envies de restaurant, de voyage, de plage, de neige, de concert, de musique sauf le jazz encore trop bouleversant. Je rêve de vous, je dis vous parce qu’il me semble que nous devons de nouveau faire connaissance, vous m’intimidez maintenant que vous êtes dans votre nouveau monde. Sortons, allons prendre le thé et refaisons le chemin inverse, ce sera amusant de revivre le charme de la rencontre, je suis prête, j’ai retrouvé la station debout, vos yeux peuvent croiser les miens, je suis forte de ces mois sans vous et l’inconnu ne me fait plus peur. Venez, j’ai des choses à vous dire, le temps n’a plus d’importance, il se dissout, et la force de notre amour forge un nouveau mode d’emploi… du temps. Je me lasse du je, du jeu, passons au nous, nous allons mieux, nous allons bien même, nous allons décrocher la lune et faire un pied de nez à la vie en continuant d’être celle que vous aimiez. Ma plus belle histoire d’amour c’est vous… N’oublions pas les paroles, le refrain est éternel et vous êtes là près de moi, près de nous. Merci de m’avoir tant aimée.
Les chansons se sont tues
Les chansons, ces chansons : La Ballade des gens heureux, non je ne peux pas écouter La Ballade des gens heureux, Françoise Hardy non plus, Tous les garçons et les filles, Reggiani peut-être, pour la tristesse du répertoire, ou Barbara, Dis quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout ce temps perdu…
J’avance pourtant, tu pourrais être fier de moi et me le dire. J’ai de nouveau l’air vivante, la voix gaie, le cheveu ébouriffé comme aux jours de fête. Je trouve même du plaisir à m’habiller, me maquiller, exister comme avant. Je vais rejouer bientôt, donc sourire, faire l’actrice, je vais être en représentation, je vais retrouver la loge, la scène, le superficiel de la vie, c’est aussi cela, ce travail, parfois. Je vais te revoir en coulisses, ton ombre va m’accompagner, je vais faire en sorte que tu sois fier de moi. « Joue bien, tu me l’as promis », disais-tu, et je me sentais des ailes pour être à la hauteur, je ne dis pas à ta hauteur.
Mais les chansons que tu aimais, je ne peux plus les écouter. Monsieur mon passé, laissez-moi passer, tu aimais tellement ces paroles de Léo Ferré. Je ne peux plus écouter de jazz, non plus, trop de souvenirs à fleur de peau, à fleur d’âme, à fleur de cœur.
Des fleurs, j’ai acheté des fleurs, je fleuris ta maison, ta photo, je fleuris ma vie, je deviens terriblement personnelle, je ne dis plus nous mais JE. Est-ce le début d’un égotisme forcené ? Il faudra que je me surveille, ce je je je, je devrais peut-être dire elle, elle va mieux, elle a des projets, elle cherche à être très occupée, elle veut voyager, cuisiner, s’instruire, elle vit, elle a un chien, elle… À quoi bon, tu es parti, mon amour. Tous les garçons et les filles de mon âge, mais il n’y a pas d’âge pour aimer. Et elle te cherche pour te dire je t’aime. Dis quand reviendras-tu ? Monsieur mon passé, laissez-moi passer. Merci d’avoir été là.
T’écrire
Oui, c’est devenu un rendez-vous capital ou indispensable pour moi. C’est une façon de se rencontrer inhabituelle, mais cette idée de te retrouver clandestinement, un peu au bonheur de la dame, me charme tant. Il n’y a pas d’heure, pas de jour, pas de tenue, pas d’obligation. C’est doux, c’est adorable, c’est secret, personne pour juger, blâmer ou critiquer. Personne pour se moquer ou s’attrister, juste toi et moi dans un dialogue ou plutôt un soliloque bienheureux. Je peux même faire revenir les mauvais moments, cela ne reste qu’entre nos murs. Je peux les exorciser, ces dernières semaines, ces dernières douleurs, ces angoisses incessantes, obsédantes, ce chagrin incurable, qui étaient la toile de fond de mes jours, et de mes nuits surtout. Je peux maintenant m’opérer à cœur ouvert, je ne te ferai pas de peine, tu me prendras peut-être dans ton aura lumineuse et j’irai mieux, j’irai bien, j’irai avec toi où tu voudras quand tu voudras. »
Extraits
« Une heure du matin, dormir. Essayer de ne pas voir qu’il fait tout noir, oublier qu’il faut éteindre la lumière, se relever pour rallumer, ne pas supporter l’obscurité, faire l’enfant, réclamer une veilleuse, se relever, ne pas prendre de somnifères, lutter du mieux qu’on peut contre l’angoisse, ignorer le silence, le grand silence, fermer les volets, les fenêtres, écouter son cœur battre un peu trop fort, sentir la vie s’envoler, ne pas savoir la retenir, ne plus pouvoir pleurer. Demain matin il fera jour, ça ira mieux, ça ira bien, c’est mercredi, c’est joyeux le mercredi, je les vois, c’est la vie, c’est de nouveau des envies de pizzas et de frites, c’est régressif, c’est l’avenir, la lumière, c’est la musique, les projets. Peut-être que ce petit livre vivra, peut-être que d’autres veuves reconnaîtront les mêmes méandres douloureux, peut-être qu’elles se diront Ah oui, je ne suis pas toute seule, peut-être qu’elles se souriront. Si toutes les veuves du monde pouvaient se donner la main. » p. 51
« En fait, elle se moque de tout. Ce qu’elle veut, la veuve, c’est qu’on lui rende son amour, son rire, sa joie, sa vie. Son homme. » p. 61
« On s’aperçoit qu’on est vraiment seule, quand on ferme la porte de la maison et qu’on n’a personne à qui dire: «On n’a rien oublié?», quand on rentre seule à la maison et qu’on s’attend à une exclamation de contentement : «Ah ah ah, ma chérie, tu es là!» Ou à toute autre réaction, humaine en tout cas, quand on fait les courses, dites de première nécessité, sans trop de stockage intempestif. Seule on consomme peu de tout, voire rien du tout, quand on se dit: Oh j’irais bien dîner dehors ce soir, pas pique-niquer, non, faire un vrai dîner en tête à tête au restaurant, et qu’on reste finalement à la maison à déguster les fameuses sardines, très bonnes d’ailleurs, quand on se dit: À quoi bon se maquiller, se coiffer, pour qui, pour quoi? Bon, ça c’est le 24 avril, jour de ton abstention définitive, quand on se met au lit à vingt et une heures avec une série sur son iPad et qu’on ne dort toujours pas à deux heures du matin, quand… » p. 62
« La maison est toujours là derrière le grand portail et elle abrite nos secrets et nos joies. Je l’aime toujours autant, je l’embellis sans doute dans mon souvenir et c’est tant mieux. Nos ombres se cachent sûrement dans le jardin. Avant de la quitter pour toujours, j’ai glissé dans une petite fente, entre deux pierres du mur, une photo de nous deux, elle nous permet d’exister encore un peu ensemble en secret, présence illusoire et dérisoire mais qui réconforte ma naïveté d’enfant triste et orpheline de toi, mon tout. » p. 68
« Je me sens un peu trop sentimentale à jouer avec ce petit chien qui n’attend que cela, le lancer de balle. Son regard attentif, demandeur, intense, pour m’inviter dans son jeu, cette balle qu’il dépose sur mes genoux ou au creux de mon bras pour que je réponde à son attente, l’importance de cette balle qui va et qui vient entre sa gueule et ma main qui la lance, sont comme le reflet de mes sentiments balançant entre le bonheur des souvenirs heureux et le chagrin de l’absence. Il me provoque, comme pour me dire que je ne suis pas seule, que l’on peut encore jouer, rire, trouver un certain plaisir à partager l’excitation d’une baballe qui rebondit.
Merci à toi pour cette joie de vivre, Roméo. Merci aux amis qui m’entourent. Merci pour votre présence, pour ces moments de grâce que vous m’avez offerts, déjeuners, dîners, spectacles, week-ends, voyages. Merci pour votre attention, votre bienveillance et votre légèreté. Merci pour les moments heureux où le ciel devient rose pâle couleur pétale. Merci pour les endroits aimés où l’on boit un Bellini en pensant à toi. Merci de m’avoir donné votre amitié et votre temps. Merci d’avoir été là, toujours là. Merci. » p. 72
À propos de l’autrice
 Agathe Natanson © Photo Max Colin
Agathe Natanson © Photo Max Colin
Agathe Natanson, nom de scène de Nicole Andrée Natanson, est une actrice française née le 14 novembre 1946 à Paris 12e. Grâce à Claude Gensac qui la découvre au théâtre, Agathe Natanson fait ses débuts à l’écran dans Oscar (1967), où elle joue le rôle de Colette, la fille de Louis de Funès et Claude Gensac. Elle tourne encore pour le cinéma dans Quelqu’un derrière la porte, mais c’est le théâtre et, surtout, la télévision qui lui apportent la notoriété: Les Saintes Chéries, Barberina ou l’Oiselet vert, Le Jeune Fabre, Le Fol Amour de Monsieur de Mirabeau, La Maison des bois. Après une interruption, elle reprend sa carrière sur les planches. Divorcée d’Henri Piégay, elle épouse Jean-Pierre Marielle le 14 octobre 2003 ; leurs noces ont lieu à Florence en Italie. Elle est mère d’une fille (journaliste) et d’un fils nés d’une précédente union. À la télévision, elle joue entre autres dans quatre épisodes de la série Capitaine Marleau, où elle incarne quatre personnages différents selon les épisodes. (Source: Wikipédia)
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#chantonssousleslarmes #AgatheNatanson #editionsduseuil #hcdahlem #correspondance #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #lettres #litteraturecontemporaine #MardiConseil #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

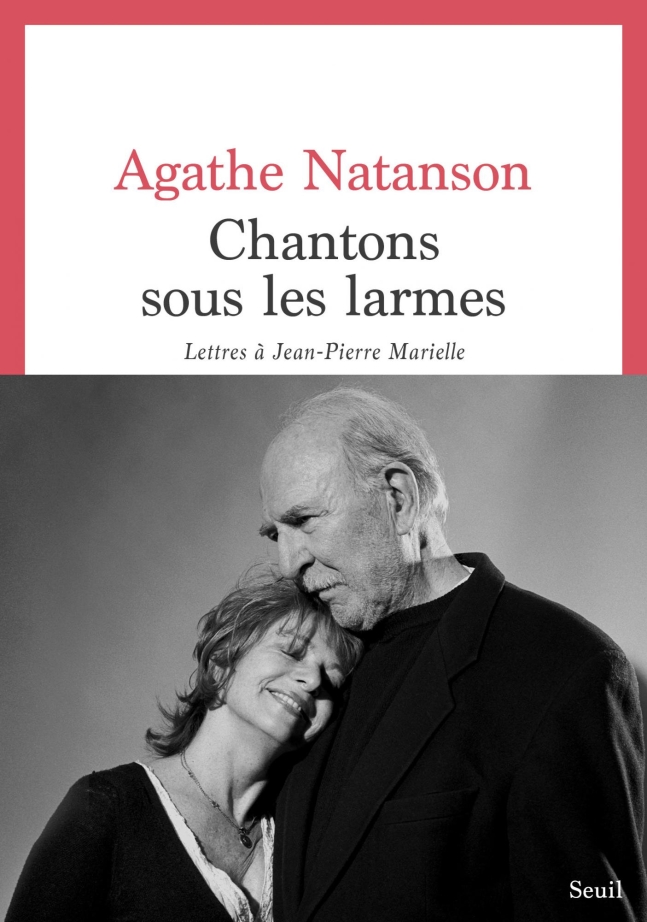




 Arièle Butaux © Photo Lyodoh Kaneko
Arièle Butaux © Photo Lyodoh Kaneko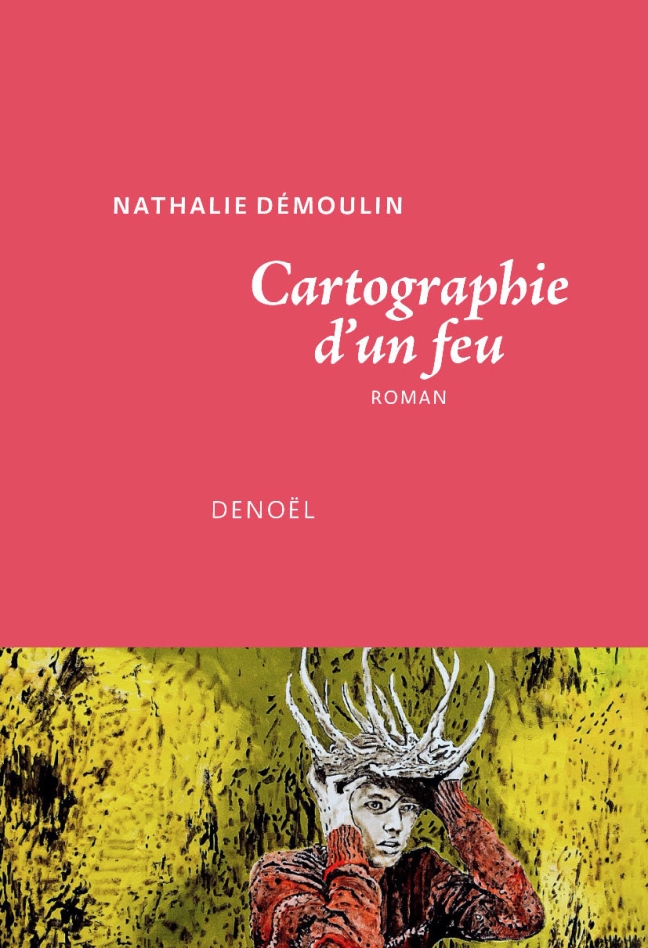

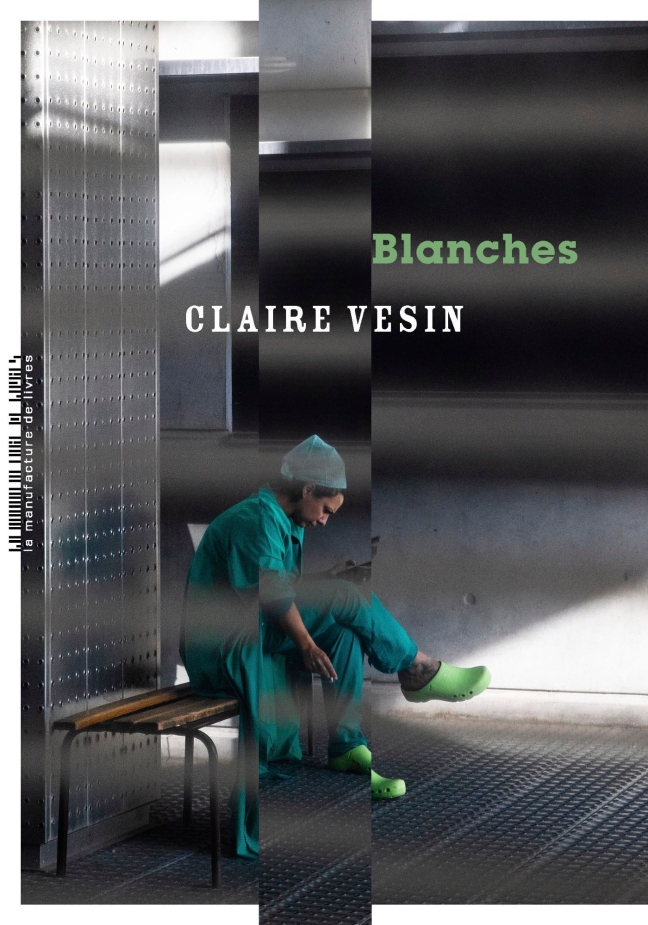


 Claire Vesin © Photo Pascal Ito
Claire Vesin © Photo Pascal Ito







 Sylvie Wojcik © Photo DR
Sylvie Wojcik © Photo DR

 Adeline Dieudonné © Photo DR
Adeline Dieudonné © Photo DR



 Mathieu Persan © Photo Arnaud Journois
Mathieu Persan © Photo Arnaud Journois
 Stéphanie Dupays © Photo DR – Librairie Mollat
Stéphanie Dupays © Photo DR – Librairie Mollat




 Brigitte Giraud © Photo DR
Brigitte Giraud © Photo DR