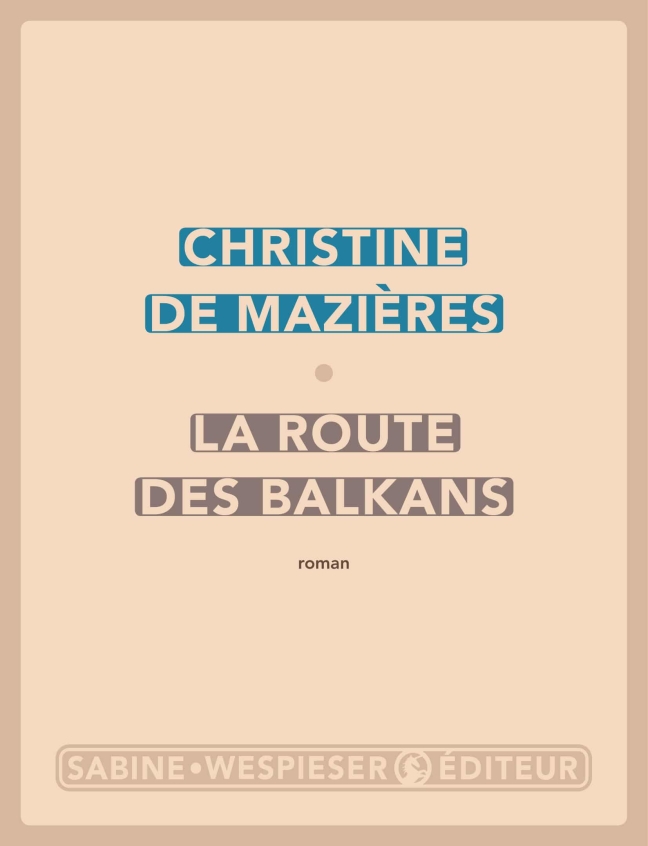Présélectionné pour le prix «Coup de cœur de la 25e Heure»
En deux mots
Deux chirurgiens en fin de carrière, une étudiante en médecine qui décide de faire son stage d’interne aux urgences d’un hôpital de banlieue, une infirmière débordée et des patients qui patientent. Cette plongée dans le milieu médical, autour d’un drame qui aurait pu être évité, retrace de manière poignante des destins individuels et la naufrage d’un système.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Un drame au service des urgences
Pour son premier roman, Claire Vesin a choisi de nous faire vivre de l’intérieur un milieu qu’elle connaît bien, celui de l’hôpital. En suivant notamment une jeune interne et une infirmière, elle décrit avec acuité la dégradation de notre système de santé et l’usure de ses personnels. Bouleversant et édifiant.
Jean-Claude est chirurgien à l’hôpital de Villedeuil, en proche banlieue parisienne. À 57 ans, il se retrouve désormais seul. Son aîné, Arnaud, a plongé dans la drogue avant de disparaître. Son épouse Nathalie a choisi de s’exiler au Canada avec son fils Vincent. Fort heureusement, il peut compter sur son ami Gilles, qui l’avait pris en charge durant leurs études, pour lui éviter de trop déprimer. C’est lors d’un dîner chez son collègue qu’il lui avait annoncé qu’Aimée, l’une de ses trois filles, avait choisi les urgences de Villedeuil pour son internat. «On voulait te prévenir, pour que tu ne sois pas étonné, si tu la croises ou si tu entends parler d’elle. Et puis peut-être que vous aurez l’occasion de travailler ensemble. Je suis certaine que ça lui ferait plaisir.»
En fait, Aimée a fait ce choix en souvenir du combat mené par Jean-Claude pour Arnaud, dont elle était tombée amoureuse et qu’elle avait rêvé de faire sortir de sa dépendance.
Mais les débuts de la jeune fille à Villedeuil vont s’apparenter à un chemin de croix. Très vite, elle va devoir constater l’énorme fossé entre la théorie et la pratique. «Les journées s’apparentaient à une course sans fin pour diminuer la pile des dossiers en attente (…), les échelles de gravité ne semblaient plus exister. On ne savait jamais à l’avance ce qu’on allait découvrir en ouvrant un dossier.» Les files d’attente ne cessaient de croître, tout comme le stress. Sans compter les absences ou les démissions.
C’est dans ce climat de tension extrême que les équipes vont se retrouver réduites à la portion congrue durant les congés de fin d’année. Laetitia gérera l’accueil, Aimée posera un diagnostic, médecins et chirurgiens ne seront prévenus qu’en extrême urgence. C’est alors qu’un drame va se produire et que l’hôpital va essayer de protéger ses employées en travestissant les faits. Derrière un décès qui aurait pu être évité, reste la froideur implacable d’un engrenage infernal. «C’est tout l’hôpital qui s’est dégradé. Il y a trop de monde, pas assez de lits, pas assez de personnel. et les premiers à en pâtir, ce sont les habitants. Mais là, ça devient carrément criminel. On ne peut pas continuer comme ça.»
Le constat que pose Claire Vesin est nourri de son expérience et des chroniques de sa vie de médecin, ce qu le rend d’autant plus accablant. Et sans aucun doute plus touchant que des dizaines d’articles et d’études sur l’état de notre hôpital public. Car, comme le montre avec force ce drame, derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Des hommes et des femmes dont ‘abnégation force l’admiration.
Blanches
Claire Vesin
Éditions La Manufacture de livres
Premier roman
304 p., 18,90 €
EAN 9782385530549
Paru le 1/02/2024
Où?
Le roman est situé principalement en France, à Paris et dans la ville imaginaire de Villedeuil. Située au bout de la ligne 10, on peut imaginer qu’il s’agit de Boulogne. On y évoque aussi Montréal, l’Indre-et-Loire.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Villedeuil, aux portes de Paris. Ses tours, ses habitants, et son hôpital. Jean-Claude y a passé toute sa carrière – jours comme nuits – au sein du service de chirurgie. Mélancolique et désormais solitaire, il reste passionné, par cette ville comme par son métier. Laetitia y est née et y travaille, infirmière trop tendre pour l’âpreté de son poste à l’accueil des urgences. Aimée, jeune femme brillante autant que perdue, débute l’internat et décide d’effectuer son premier stage à Villedeuil, mue par des loyautés invisibles. Fabrice, médecin au SAMU, sera bientôt père mais fuit sa vie personnelle. Lors de ces mois vécus ensemble, leurs destins vont s’entremêler. Au sein d’un hôpital qui se fissure de toute part, ils partageront joies et échecs, détresse et amour du métier. Malgré les difficultés, ils tiennent, jusqu’à ce qu’une nuit, cet équilibre soit remis en question, bouleversant leurs vies à jamais.
Avec ce premier roman poignant, Claire Vesin nous fait entendre la voix vibrante de celles et ceux qui font l’hôpital public et sont marqués par le combat ordinaire mené pour soigner dignement.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Blog Ce que j’en dis…
Les premières pages du livre
PROLOGUE
19 août 2012
Il n’est pas encore dix heures, et des gouttes de sueur coulent déjà le long de ses flancs. Trente-quatre degrés sont prévus aujourd’hui; elle a ouvert les deux fenêtres de l’appartement, mais l’air reste immobile, comme figé.
Aimée lit une nouvelle fois le SMS d’Arnaud.
Salut Beauté
Je t’attendrai dimanche à 11 h à la gare du Nord, devant les quais des trains de banlieue. J’ai un endroit génial à te montrer.
Love you Beauté.
Elle l’entend le dire avec ce mélange irrésistible de dérision et de tendresse.
Elle voudrait se convaincre qu’il ne s’est rien passé pendant ces jours à l’attendre, dévorée par l’angoisse. Il est là, de nouveau, et il veut la voir. Il n’y a que cela qui compte. Il ne lui est sans doute rien arrivé. Rien de grave en tout cas.
Ces derniers mois ont été éprouvants. Leurs heures ensemble devenaient pesantes: elle travaillait ses cours, et il restait là à s’ennuyer, feuilletant un livre sur le lit. Et puis, le soir arrivant, il commençait à s’agiter. Il fixait le plafond, lui disait qu’il étouffait lentement, chez elle, et partait se perdre dans la nuit.
Le lundi précédent, il n’est pas rentré. Elle n’a rien dit à personne. Elle a eu raison finalement: il est revenu. De toute façon, Arnaud n’a jamais été un garçon stable.
Aimée baisse machinalement la tête pour entrer dans la salle de bains. Le chambranle de la porte est juste assez haut pour elle. L’appartement entier semble inadapté pour des adultes: deux petites pièces au plafond bas, percées
de deux fenêtres, l’une sur cour, l’autre sur rue, au travers desquelles on n’aperçoit jamais le ciel, ce qui accentue encore l’impression d’exiguïté du lieu.
Elle y vit depuis quatre ans. Elle et ses sœurs étaient toutes petites quand leurs parents ont acheté l’appartement en prévision de leurs années étudiantes. Elles en rient ensemble
aujourd’hui : ils avaient sans doute imaginé qu’elles ne grandiraient jamais. Aimée s’y sent bien. À l’abri. Elle sort de la douche, s’enroule dans une serviette et observe dans la glace ses longs cheveux blonds – les mêmes que sa mère – et ses yeux verts, qu’elle ne tient de personne.
On lui a toujours répété que la plus grande des politesses, lorsque l’on a rendez-vous, est d’être présentable : on se maquille, on s’habille correctement, on soigne ses ongles.
Sa mère pense que c’est important, les ongles: des mains abîmées, ça gâche toute la silhouette. Aimée s’imagine se laissant aller à lui confier qu’Arnaud ne voit rien de tout cela, et la devine incrédule. Elle se maquille quand même, les larmes au bord des paupières: la famille, la maison, soudain tout lui manque.
En réalité elle est terrifiée à l’idée de découvrir dans quel état il est.
Elle enfile une robe d’été sans manches, une de ses préférées, en popeline rayée jaune et blanche. Elle n’a pas mis de soutien-gorge. Arnaud va le remarquer, ça, quand même. Sa mère n’approuverait pas. Elle rit nerveusement en s’observant une dernière fois. Merde, ça va aller.
Elle prend son sac, ses cigarettes. Claque la porte et descend l’étage par l’escalier de pierre qui reste frais malgré la chaleur du mois d’août. Elle ouvre la lourde porte cochère et sort en plein soleil sur le trottoir brûlant. À ses pieds la rue dévale vers Jussieu et, comme à chaque fois, elle est submergée par la beauté de Paris.
Elle s’élance, il est dix heures trente-cinq, et elle est en retard.
*
Elle monte les escalators en courant. La foule se presse dans l’immense hall, et la chaleur y est suffocante. Elle avance peu à peu, frôlant d’autres corps moites, et s’approche des trains en le cherchant au loin. Elle finit par le repérer, assis par terre, devant le quai 12. Il porte son sweat bleu, un jean crasseux, ses vieilles baskets. Il a le regard perdu, ses cheveux sont trop longs, et leurs boucles noires lui caressent
les oreilles. Il est si beau! Avec ses coudes sur les genoux, les paumes en coupe sous le menton, on dirait que ses doigts caressent ses joues, rehaussant ses pommettes et lui redonnant l’air juvénile qu’il avait encore il y a quelques mois.
Elle plisse les yeux, et c’est l’Arnaud de quatorze ans qui apparaît. Celui de l’été de la canicule. Ils avaient passé cinq jours en Indre-et-Loire, en famille. Qui avait été à l’origine de ce voyage? Il n’y en avait plus eu d’autres ensuite.
Aimée et lui se connaissaient depuis toujours, leurs parents étaient amis. Mais au printemps, des histoires avaient été murmurées entre adultes, dans les cuisines. On parlait de lui, l’enfant à problèmes, et les dîners s’étaient espacés.
Au cours du séjour, cet été-là, les filles étaient restées entre elles, comme averties du danger. Arnaud leur avait à peine adressé la parole.
Quand elle repense aux journées de ce voyage, il ne lui reste que la chaleur extrême, des châteaux oubliés, et ses insomnies, le soir, dans la chambre étouffante, en pensant à lui. Il avait le charme des mauvais garçons, la moue boudeuse, le regard sombre derrière sa frange et fumait des cigarettes d’un air blasé. Il venait d’être renvoyé du collège, ses parents s’inquiétaient. Mais Aimée n’écoutait plus les discussions, trop occupée à le dévorer des yeux.
Tout l’été ensuite, elle avait rêvé de peaux nues et d’étreintes brûlantes. Son désir l’avait poursuivie longtemps.
Il suffisait qu’elle aperçoive Arnaud pour que de nouveau il flambe pendant des mois.
Lorsqu’ils s’étaient enfin embrassés, elle avait vingt-deux ans, et il avait déjà de sérieux ennuis. Les parents d’Aimée avaient défailli en apprenant la nouvelle. Ils avaient tenté de la raisonner: en s’obstinant elle courait à sa perte. Et puis comme ils l’avaient prédit, il s’était volatilisé quelques semaines plus tard, et elle avait cru mourir de chagrin.
Mais il était revenu, avait accepté de passer quatre mois à l’hôpital, en cure comme disait sa mère, et à sa sortie il avait emménagé chez elle, rue des Boulangers. Alors elle avait vraiment cru à leur bonheur.
Elle avance, décidée.
«Arnaud!»
Il tourne la tête et la regarde. Il sourit. Elle sent son cœur battre sous sa robe. Elle l’aime tellement! Elle se penche pour l’embrasser alors qu’il est encore assis. Il est sale, amaigri. Ses lèvres sont sèches, gercées. Ces détails s’additionnent malgré elle dans son esprit. Il se lève et l’enlace.
Il lui chuchote à l’oreille «Tu sens bon». De nouveau elle sent les larmes qui lui brûlent les yeux.
*
La pièce est vaste et haute de plafond. Elle correspond sans doute à une salle commune ou un réfectoire : on distingue une autre porte, au fond, menant à ce qui a dû être une cuisine, autrefois. Il s’en dégage une odeur de pourriture terreuse.
Aimée frissonne. Le lieu est interdit d’accès. Ils ont escaladé les barrières, traversé la haie en se griffant, et elle a déchiré sa robe. Le bâtiment va être en partie démoli, les plafonds ne risquent-ils pas de s’effondrer sur eux? Ils avancent en contournant les gravats, observant les pièces de mobilier abandonnées, le papier peint moisi, les détritus qui jonchent le sol.
Un arbre imposant est tombé, éventrant dans sa chute une partie du toit. Des branches pénètrent dans la pièce. Dehors, ses racines dénudées semblent implorer le ciel. L’endroit est lugubre, Aimée imagine les gémissements des malades, les hurlements des fous, mais tout est silencieux, incommodant.
Elle sort, et l’extérieur lui fait l’effet d’un four. Elle manque de s’évanouir. Alors elle s’assied dans les herbes folles, adossée au mur de l’hôpital, pose sa tête contre la brique et ferme les yeux. Elle finit par fouiller dans son sac et en sort ses cigarettes.
Arnaud la rejoint.
«– Ça ne va pas ?
– J’ai mal à la tête, je vais t’attendre ici.»
Il la regarde avec sollicitude. «Tu es sûre ?» Elle acquiesce en souriant.
«J’explore encore un peu. Laisse-moi dix minutes.»
En chemin, Arnaud lui a raconté sa nouvelle passion, sans préciser comment il s’y est initié. Il a passé ses derniers jours à explorer des bâtiments abandonnés. Usines, hôpitaux, cités-jardins: il visite tout. Ce monde-là disparaît sous nos yeux, lui a-t-il expliqué. En être le dernier témoin lui procure une émotion incroyable.
«Tu n’imagines pas ce que ça fait, de découvrir à quel point le temps avant l’oubli est compté. C’est… addictif».
Ils ont éclaté de rire. «Désolé, je trouve pas d’autre mot, pour décrire ça. C’est kiffant, c’est tout.»
Au départ de la gare du Nord, ils ont vu se succéder les immeubles haussmanniens, la petite ceinture, les tours, et puis progressivement le train a pris de la vitesse, et les jardins sont devenus des champs écrasés de soleil derrière lesquels l’horizon s’étendait à perte de vue. Ils sont descendus en rase campagne, et après une centaine de mètres le trottoir a laissé place à un talus herbeux derrière lequel se dressaient les épis du champ voisin. Ils ont marché longtemps, accompagnés par le bourdonnement des insectes, avant de voir
apparaître l’enceinte de l’hôpital.
Le bâtiment principal formait un arc de cercle au sein d’un parc redevenu sauvage. Une fontaine était enfouie sous les herbes hautes, et, tout au fond, à l’orée du bois, se dressait une chapelle en pierre blanche. L’endroit a dû être superbe. Maintenant, on ne remarque plus que les fenêtres aux montants arrachés, les portes béantes, l’abandon et le vide. Il n’y a pas encore de graffitis, l’hôpital est désaffecté depuis peu.
Avant d’entrer, ils ont lu l’avis de démolition et les travaux envisagés. L’ensemble va être transformé en résidence privée.
Maisonneuve, le plus grand asile psychiatrique du département, logera bientôt des familles heureuses. Arnaud la rejoint dehors et s’assied à côté d’elle.
«Je peux te prendre une cigarette ?»
Ils restent là, silencieux, les yeux mi-clos.
Il la regarde, incertain. Elle lui sourit, il se penche vers elle et l’embrasse. Ils s’enlacent, et Arnaud passe délicatement une main sous sa robe. Aimée se déshabille sans le quitter du regard, lui ôte son pull, son tee-shirt sale. Elle colle son corps contre le sien et se sent enfin complète : il lui a douloureusement manqué.
Plus tard ils fument une autre cigarette, allongés dans l’herbe. Elle se sent bien, la peur a presque disparu. Il ne reste que l’odeur grasse de la végétation et les pépiements des oiseaux.
Arnaud se redresse et sort de son sac une pièce de deux francs: «Regarde, c’est une pièce de 1989. Elle a notre âge. On explorait une école abandonnée l’autre jour, et je l’ai trouvée au fond d’un pupitre.»
Aimée le fixe sans comprendre.
« Je ne t’ai jamais raconté ? Ça me rappelle mon père, quand il rentrait de garde. Il allait directement se coucher, mais j’inventais toujours une excuse pour le réveiller. Un jour, il m’a dit de regarder dans les poches de son pantalon, que si j’y trouvais une pièce de deux francs elle serait à moi. C’est devenu une tradition, ensuite. Il faisait en sorte d’avoir toujours des pièces de deux francs. Et puis un jour j’ai tout pris, même les billets. Il a fait comme si de rien n’était. Mais bon, ça n’a plus été aussi drôle après.»
Il lui glisse la pièce dans la main: «Garde-la pour moi». Aimée finit par demander: «Pourquoi tu as choisi cet endroit ? C’est sinistre !»
Il rit en regardant le ciel.
«C’est vrai. Mais bon, un hôpital, la médecine, tout ça, je me suis dit que ça te plairait.»
Il reprend, sérieusement cette fois: «Ce qui me frappe, c’est à quel point l’endroit est sublime.
Tu imagines ce gâchis? En faire des appartements? Tu peux avoir passé ta vie à y souffrir, et à la fin il n’en reste rien. »
Il se tait, le regard dans le vague.
«J’aurais pu être hospitalisé ici, l’an dernier. Et on aurait tout rasé ? Tout oublié ? Le pire, c’est que ça me fait penser à mon père et son hôpital merdique, à Villedeuil. Seul comme un con à vouloir sauver le monde.»
Elle répond en riant à moitié : «Mais de quoi tu parles ?»
Elle n’a pas envie de discuter du père d’Arnaud.
Elle s’est bien gardée de le lui dire, mais elle admire Jean-Claude. Il a toujours été là quand il fallait récupérer son fils dans des endroits pas possibles, chez les flics ou dans le caniveau. C’est lui aussi qui s’est démené quand il a fallu lui trouver une place, pour le sevrage. Mais Arnaud n’a jamais rien voulu voir de tout cela. Il nourrit des rancœurs à son encontre, qu’il ne lui confie pas.
Aimée meurt de faim. Elle lui demande s’il a apporté à manger, mais non, son sac à dos est vide. Il a l’air épuisé, perdu dans ses pensées. Il écrase sa cigarette et essuie plusieurs fois ses mains sur son jean. Elle remarque de nouveau le tremblement de ses doigts.
Elle se lance, le cœur battant.
«Tu as recommencé, c’est ça ?» Il la regarde et hausse les épaules avec un petit sourire d’excuse.
«Il fallait bien que ça arrive un jour.»
Ils retournent vers la gare dans une chaleur accablante. L’orage est prévu pour la fin de journée, le ciel se couvre déjà. Ils n’ont pas vérifié les horaires, il y a plus d’une heure d’attente avant le prochain train. Les minutes passent lentement; elle lui prend la main, la serre trop fort dans la sienne en répétant Ça va aller, ça va aller.
Lorsqu’ils arrivent à la gare du Nord, il est dix-neuf heures. Ils ont passé le trajet collés l’un à l’autre, leurs mains entremêlées, elle, le nez enfoui au creux du cou d’Arnaud.
Il est d’accord pour rentrer rue des Boulangers, alors ils se dirigent vers le métro et elle lui tient la main pour franchir les tourniquets, puis dans les escaliers et sur le quai. La foule se presse à l’arrivée de la rame, et quand les portes s’ouvrent Aimée est bousculée à l’intérieur du wagon.
Quand la sonnerie retentit, Arnaud a disparu.
2013
Octobre
Le jour touchait à sa fin quand Jean-Claude Pouillat sortit de Cosmos d’un pas rapide, sans prêter attention à son environnement. Il prit une cigarette du paquet rangé dans la poche intérieure de son blouson, se figea un instant pour l’allumer et repartit. Depuis le temps qu’il travaillait ici, il ne remarquait plus les bâtiments. Parfois, quand arrivaient de nouveaux étudiants, il tentait d’observer d’un œil neuf son univers quotidien en se persuadant qu’on pouvait lui trouver du charme, mais ça devenait rare : il s’était lassé de
constater que les internes ne se fiaient qu’aux apparences.
On lui avait déjà soutenu que la laideur de l’endroit était rédhibitoire. D’ailleurs, une fois leur stage terminé, ceux-ci ne revenaient plus. Comment auraient-ils pu comprendre que, pour lui, Villedeuil incarnait la beauté torturée des
banlieues ouvrières ? Rien, ici, n’entrait dans les canons bourgeois, et c’était cela, précisément, qui l’émouvait. La partie la plus ancienne de l’hôpital était composée de six pavillons de brique ocre dont les noms rendaient hommage aux éminences médicales de l’époque. Ils avaient été construits au début du siècle, dispersés au sein d’une vaste étendue herbeuse parsemée de massifs arborés, reliés les uns aux autres par des chemins de gravier. Aujourd’hui, il
n’y avait plus qu’au printemps qu’un agent passait encore la tondeuse pour tenter de contenir la végétation qui envahissait tout. Pendant quelques heures alors, l’air était saturé de l’odeur champêtre du foin coupé. Le reste de l’année, la nature retournait à l’état sauvage, comme les vieux pavillons qui n’accueillaient maintenant plus que l’administratif et les archives.
À l’origine, un parterre fleuri s’étendait derrière la grille d’entrée, traversé par une allée de tilleuls qui reliait le portail à une fontaine autour de laquelle les six bâtiments se déployaient harmonieusement. La perspective était majestueuse, les clichés de l’époque en témoignaient. Mais dans les années soixante-dix, avec l’explosion démographique des banlieues, il avait fallu agrandir l’hôpital. Cinq tours étaient alors sorties de terre, parallélépipèdes dressés vers le ciel et recouverts de céramique blanche, à l’image des grands ensembles qui avaient poussé partout dans la ville.
Cosmos, dans laquelle il travaillait depuis trente ans, était l’une d’elles. Lors de la construction, aucun détail n’avait été négligé – rampes d’accès pour les ambulances, monte-malades, couloirs souterrains reliant les services: tout y était à la pointe du progrès. Le mur d’enceinte, en revanche, n’avait pas bougé, et il avait fallu sacrifier le parterre, l’allée et les tilleuls pour ériger les nouveaux bâtiments.
Au sein de cet ensemble disgracieux, la fontaine marquait désormais la frontière entre la brique et le carrelage, l’ancien et le neuf. Plus tard, le bassin avait été comblé, puis surmonté d’un arceau en béton sur lequel était gravé Centre hospitalier de Villedeuil, encadré par deux drapeaux français.
Les tours avaient prématurément vieilli. En réalité, rien n’avait été pensé pour durer. Les faux-plafonds fuyaient, les murs se fissuraient. Les carreaux de céramique se décollaient par dizaines. Les pigeons avaient colonisé les couloirs souterrains et lâchaient leurs fientes sur les malades en brancard. Des travaux étaient prévus depuis des années, et une troisième génération de bâtiments devait voir le jour, mais ce projet était sans cesse repoussé, faute de budget. C’était cela que découvraient les nouveaux internes en arrivant à Villedeuil, après leurs quinze minutes de marche depuis la gare : cinq tours recouvertes de filets antichute, enserrées dans le vieux mur d’enceinte. Et à qui s’aventurait entre celles-ci apparaissaient la fontaine condamnée, l’arche en béton et les vieux bâtiments. C’était laid, les internes n’avaient pas tout à fait tort, Jean-Claude en convenait. Mais lui n’arrivait pas à trouver cela repoussant. Il leur répondait toujours, à ces ingrats, que c’était ça, le baroque hospitalier, aujourd’hui.
Officiellement, Jean-Claude Pouillat avait terminé sa journée de travail. Il était dix-huit heures trente, le chirurgien de garde avait pris la relève. Il n’avait plus que ses comptes-rendus opératoires à dicter. Chaque jour c’était pareil : le poids de la journée s’effaçait d’un coup, il se sentait libre, et juste après, comme un réflexe, venait l’envie de boire.
Dépassant la fontaine, il prit l’allée goudronnée qui menait à l’entrée des urgences, au rez-de-chaussée de Neptune, puis franchit le portail. Sur l’avenue, la lueur chaude du Manhattane lui faisait face. Il pouvait voir Manuel, le patron, affairé derrière le bar. Il traversa.
En terrasse, toujours à la même table, se trouvaient les habitués. Œil flou, nez turgescent, voix traînante qui se perdait dans les méandres d’une argumentation dont l’objet était oublié en cours de route, ils tenaient leur rôle, soir après soir. Dès dix-sept heures, et plus tôt les jours d’ennui, ils s’asseyaient, serrés dans l’air froid et la fumée, enquillant les consommations jusqu’à ce que le bruit du rideau métallique les éparpille comme des moineaux. Pouillat les salua. Il avait toujours un petit sursaut de soulagement, en ouvrant la porte pour entrer: lui n’y était pas encore, au stade de la terrasse.
Il faisait bon, à l’intérieur. Manuel le héla, à peine la porte franchie : «Jean-Claude, salut! Ça y est, fini la journée ?»
Il sentait déjà la chaleur du lieu le détendre. Il sourit.
«– Oui, quasiment. Deux trois bricoles avant de rentrer.
Tu me sers une Stella ?
– Elle arrive !»
Manuel ne devançait pas sa commande, alors qu’elle ne variait jamais. Il lui laissait la possibilité du doute, et c’était suffisant. Dans la seconde, Jean-Claude vit le liquide doré couler sous la tireuse. Il s’installa au bar, but deux grandes gorgées, et le verre fut déjà presque vide. Il le posa pour se retourner face à la salle, les coudes sur le comptoir. Il n’y avait pas grand monde, ce soir. C’était bien. Il était tranquille.
Le Manhattane était le seul café à proximité de l’hôpital.
Sinon, il fallait pousser jusqu’à la gare pour espérer autre chose que des points chauds et des kebabs. Et encore, les deux bars-tabacs qui s’y trouvaient le faisaient fuir, avec leur salle vide et sombre, à l’exception des écrans géants qui surmontaient la caisse et devant lesquels se massait toujours la même foule de joueurs fébriles et désespérés.
Manuel, lui, s’était contenté de garder une activité traditionnelle. En dehors du nom, rien n’avait changé depuis les années cinquante. Dès sept heures, il servait cafés et petits blancs. À midi il proposait un plat unique ; les vendredis, c’était couscous. Ça marchait bien, la clientèle s’étendait des pavillons de l’avenue Allende aux tours de la ZUP un peu plus loin. Et puis il y avait l’hôpital, évidemment: chez lui, on attendait les malades, on fêtait les fins de stage, on soignait les matins difficiles. On y perdait aussi le temps
qu’on ne voulait plus passer chez soi.
De là où il était, Jean-Claude pouvait voir, se découpant dans la nuit à travers les vitres du café, les contours de l’hôpital, Neptune et Météore au premier plan. L’obscurité envahissait à présent le haut des tours, masquant leur silhouette. Par les fenêtres illuminées, on devinait l’activité du soir dans les services. C’était l’heure du dîner, et les portes des chambres s’ouvraient l’une après l’autre, laissant entrer les chariots des plateaux-repas qui refroidissaient déjà en dégageant cette odeur écœurante qu’il aurait reconnue entre mille. D’où il se trouvait, tout semblait familier, confortable.
Il était à sa place à Villedeuil: depuis le temps qu’il y passait ses jours et ses nuits, il appartenait à cette ville. Il tentait de faire le compte, parfois, de ceux qu’il avait opérés, mais c’était simple : tous, ici, le connaissaient.
Manuel, voyant son verre vide, l’avait rempli sans mot dire. Quand Jean-Claude se retourna pour le remercier, il leva son eau, et ils trinquèrent au week-end qui s’annonçait. Manuel ne faisait pas exception à la règle : à lui aussi Jean-Claude Pouillat avait recousu les entrailles.
Il tendit le bras vers Neptune, en se penchant pour murmurer:
«Il paraît qu’il y a encore eu du bordel, cette nuit, aux urgences ? Le vigile s’est fait agresser, c’est ça ? J’ai entendu que la police avait embarqué des jeunes au poste ? Les gens sont fous.»
Pouillat haussa les épaules.
«M’en parle pas. Le problème c’est le sous-effectif. Même en chirurgie, ça devient compliqué. Le poste d’interne n’a encore pas été pris, pour le prochain semestre. À partir de novembre je n’ai personne. Heureusement que la semaine est terminée !»
Il rit, comme pour démentir ses paroles. Il sentait de nouveau la tension dans sa nuque. Tant pis pour les comptes-rendus, il les ferait dimanche avant sa garde, il n’aurait qu’à venir un peu plus tôt. Retourner à l’hôpital maintenant lui semblait insurmontable. Il voulait juste rentrer chez lui. Il remit son blouson en cuir et fit mine, comme à chaque fois, de sortir son portefeuille.
«– Allez, je file, dis-moi combien je te dois.
– Laisse, je le mets sur ta note ! Passe un bon week-end, Jean-Claude !»
Manuel lui fit un clin d’œil tout en continuant d’essuyer les verres. Jamais il ne l’aurait laissé payer ses consommations.
Jean-Claude sortit du bar à grandes enjambées. Sa haute taille, sa silhouette mince et sa démarche souple le rendaient reconnaissable de loin. L’air froid déclencha la toux sèche qui ne le quittait plus depuis quelques mois.
Il s’arrêta, hors d’haleine, puis reprit sa descente, plus lentement cette fois-ci, vers le RER. En dix minutes il arriva sur l’esplanade noire de monde, remplie de travailleurs fatigués qui sortaient du train. Depuis la baisse des températures, les abords de la gare étaient éclairés par des braseros autour desquels la foule se pressait pour acheter des épis de maïs à un euro. Les vendeurs à la sauvette le frôlaient discrètement en susurrant Marlboro, Marlboro, l’œil aux aguets: une descente n’était jamais loin.
Avant de passer les tourniquets, il regarda les écrans d’affichage. Le train arrivait. Il serait à Paris dans sept minutes, il avait déjà changé de monde. Même si personne ne l’attendait, il rentrait chez lui, et il fallait s’en réjouir.
*
Cela faisait presque deux mois que Nathalie et Vincent étaient partis. Il aurait dû commencer à s’habituer à ces samedis sans fin. La première fois, le matin, il avait pris machinalement le chariot de courses près de la porte d’entrée et acheté fruits et légumes au marché, puis un poulet chez le boucher. Ce n’est qu’en rangeant ses achats, une fois chez lui, qu’il avait pris conscience de sa bêtise : il était seul désormais, à tous les repas. Les légumes avaient lentement pourri au fond du frigo, il n’était plus retourné
au marché. Maintenant il passait au Super U le soir, de temps en temps, quand il n’y avait vraiment plus rien à manger à la maison.
Il ne savait jamais quoi faire de cette journée d’oisiveté. Le plus souvent il restait chez lui, désœuvré. Vers onze heures, il téléphonait à sa mère. Ces appels le laissaient morose, entre pitié et nostalgie. Tout au long de leurs menus échanges entrecoupés de silences, il l’imaginait, assise à la cuisine devant la table en formica. Rien n’avait bougé depuis son enfance dans l’appartement étriqué face à la voie ferrée.
À peine avait-elle décroché qu’elle lui disait d’attendre, et posait le combiné pour se servir un café. Elle le sirotait ensuite tranquillement, entre deux hochements de tête, en l’écoutant raconter sa semaine. À intervalles réguliers lui parvenait le bruit assourdi d’un train qui passait, et ce son qui avait bercé sa jeunesse le rassurait.
Après avoir raccroché, il commençait à boire, chaque semaine un peu plus tôt, laissant errer ses pensées en observant le boulevard depuis la fenêtre du salon. Au début, il avait continué à fumer dehors, les bras appuyés sur la rambarde, comme si Nathalie avait encore son mot à dire. Et puis peu à peu, il avait repris possession des lieux. Maintenant, même dans la chambre il y avait un cendrier.
L’appartement était silencieux, et Jean-Claude pouvait entendre le chuintement des pneus sur le goudron humide, trois étages plus bas. Il observait les passants qui se pressaient sur le trottoir brillant de pluie. Sous les parapluies, il les devinait, bras chargés, ramenant leur butin du samedi. L’air était saturé d’humidité froide, et il n’avait aucune envie de sortir ce soir.
Pour tout dire, l’invitation l’avait surpris. Il n’avait pas revu Évelyne depuis la disparition d’Arnaud, et sa dernière soirée avec Gilles remontait à l’hiver précédent, quand ils avaient dîné au White Horse, face à la faculté de médecine.
Année après année, ils y retournaient, par manque d’imagination plus que par véritable envie, pour passer quelques heures ensemble. Ce soir-là, malgré les efforts de Gilles, ils n’avaient échangé que des banalités. Jean-Claude n’était alors qu’une boule de chagrin, il n’avait plus de place pour les vieilles amitiés. Leurs vies divergeaient depuis si longtemps que chacune était devenue le négatif de l’autre, comme une réponse aux doutes qui surgissaient parfois, la nuit.
Ils s’étaient quittés incertains, et Jean-Claude avait pensé qu’il n’y aurait plus d’autre fois. Mais Gilles était un garçon fidèle, qui finissait toujours par prendre de ses nouvelles, et la semaine précédente lui et son épouse l’avaient invité à dîner chez eux. En fin d’après-midi il se décida à prendre une douche. Il avait sorti une chemise blanche de son placard. Elle était propre et pas trop froissée ; avec un jean ce serait parfait.
Quand il avait trente ans, il lui suffisait d’arriver habillé ainsi n’importe où pour que les filles se mettent à lui tourner autour. Et si d’aventure il précisait qu’il était chirurgien, la soirée pouvait virer à l’émeute. »
Extraits
« Les arrivées aux urgences ne s’arrêtaient jamais. La salle d’attente était saturée en permanence. Elle l’apprendrait au fil des mois, il n’y avait guère qu’aux petites heures que les sièges étaient vides. Les journées s’apparentaient à une course sans fin pour diminuer la pile des dossiers en attente, en passant d’une otite à un diagnostic de tumeur cérébrale, d’une dépression à un paludisme. Les échelles de gravité ne semblaient plus exister. On ne savait jamais à l’avance ce qu’on allait découvrir en ouvrant un dossier. La difficulté, ensuite, résidait dans la gestion des patients déjà examinés. La plupart restaient sur un brancard à attendre pendant des heures les radios, les prises de sang, les résultats, et enfin, pour les plus chanceux, le diagnostic. Venait alors, quand il fallait les hospitaliser, la recherche d’un lit disponible. » p. 82
« C’est tout l’hôpital qui s’est dégradé. Il y a trop de monde, pas assez de lits, pas assez de personnel. et les premiers à en pâtir, ce sont les habitants. Mais là, ça devient carrément criminel. On ne peut pas continuer comme ça. » p. 173
À propos de l’autrice
 Claire Vesin © Photo Pascal Ito
Claire Vesin © Photo Pascal Ito
Claire Vesin est née en 1977 à Champigny-sur-Marne. Après une adolescence aux États Unis et des études de médecine à Paris, elle décide d’exercer en banlieue parisienne, où elle vit aujourd’hui. Blanches est son premier roman. (Source: La Manufacture de livres)
Tags
#Blanches #ClaireVesin #lamanufacturedelivres #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #roman #sante #hopital #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #primoroman #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

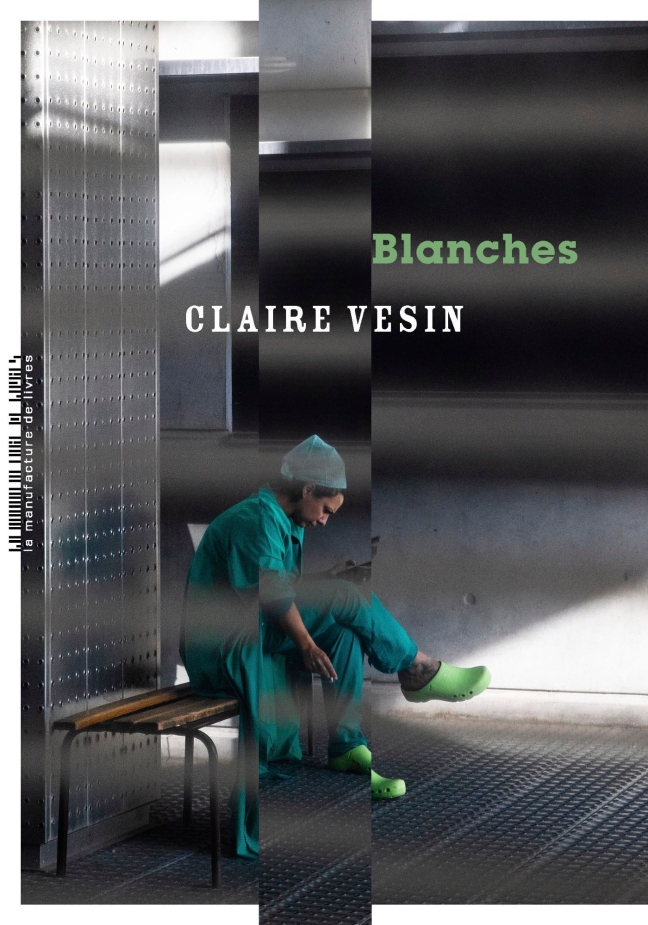




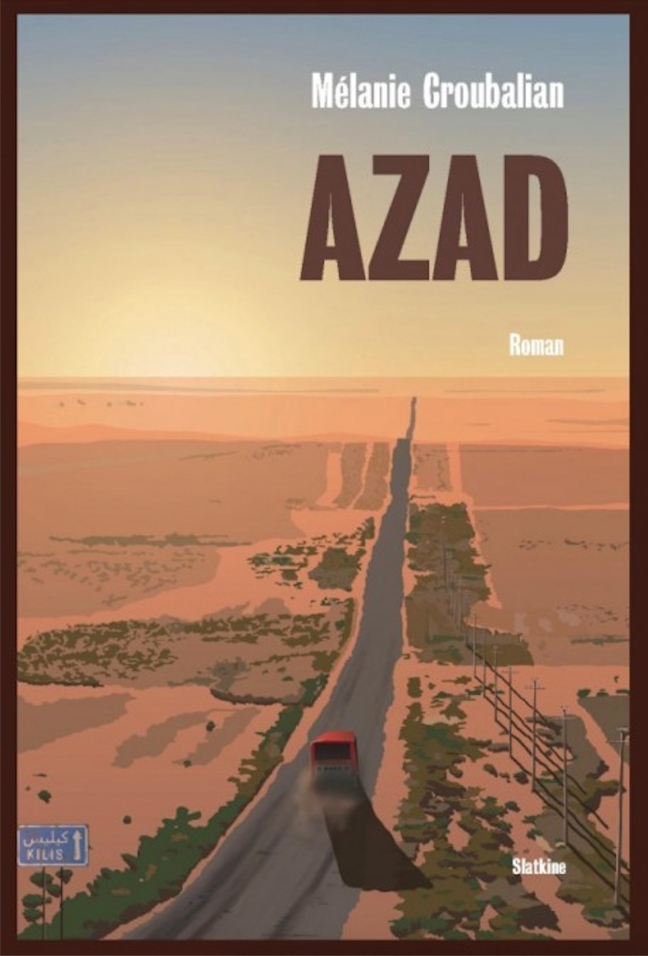

 Mélanie Croubalian © Photo DR
Mélanie Croubalian © Photo DR