En lice pour le Prix du premier roman 2023
En deux mots
Gilles, pilote de ligne, part pour quelques jours à Detroit. Il retrouve la ville qu’il a connu au temps de sa splendeur et qui se bat désormais pour ne pas mourir. Une ville qu’il va parcourir avec Luc, son nouvel amant, dans un temps hors du temps. Une parenthèse désenchantée.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
«Detroit est comme un conte et un abîme»
Dans son premier roman, Antoine Vigne raconte la vie de Gilles, pilote d’avion, qui atterrit à Détroit. Cette ville décadente, dans laquelle il déambule avec son Luc, son nouvel amant, est à l’image de sa vie.
Gilles n’est plus dupe. En prenant les commandes de son long courrier, il sait que ses rêves d’enfant se sont évanouis, que l’aventure et la découverte du monde se sont dissous dans une société consumériste qui voyage toujours plus, qui enfile les destinations comme les photos dans leurs smartphones, sans véritablement chercher un sens à ses déplacements. Aujourd’hui il retourne à Détroit, ville qu’il a découverte au temps de sa splendeur dans les années 1990 et qu’il retrouve balafrée, défigurée par le déclin de l’industrie automobile.
«Cette friche n’en est pas une
Cette campagne n’en est pas une
Ces étendues vertes au long des avenues — il y avait des maisons là et là, partout, sur tous ces espaces vides, ces terrains
vagues, ces pelouses improvisées
Des populations, des tramways, des cafés, des théâtres, des familles, des histoires sordides ou gaies ou solitaires, des parades des véhicules, des amoureux, des enfants courant après un chien
La vie
D’une métropole
décomposée»
Au hasard de ses déambulations, il croise les stigmates d’une destinée, échange quelques mots avec des habitants désabusés et finit dans un bar où il trouve Luc, un autre Français venu convoyer des œuvres d’art. Il finira la nuit en sa compagnie. Puis partagera avec lui les quelques jours qui lui restent dans le Michigan.
«Ils parlent
longtemps
du Michigan d’abord puis de Trump, de l’Amérique contemporaine,
de ses travers, de ses errements,
du capitalisme mondial,
le désastre écologique,
et la violence,
les grands combats de l’époque».
Ensemble, ils revisitent la ville, parcourent les musées, se dévoilent. Pourtant ils pressentent que leur liaison ne durera pas, savent que le temps des belles promesses est terminé. Que l’avenir s’assombrit. Que cette parenthèse est désenchantée.
Ce choix de composer son roman en vers libres permet à Antoine Vigne de séquencer son texte en impressions, sentiments, émotions. Mais ce travail sur la langue lui permet aussi de trouver des images fortes – des punchlines, comme on dit aujourd’hui – qui résument en quelques mots cette Amérique divisée, cette ville qui est passée en quelques années de la grandeur au désastre, et sa vie construite autour de la figure du père parti trop vite et dont il a sans doute plus fantasmé les leçons que réellement apprises.
«Les bars en Amérique sont des gueuloirs»
«L’homme est une dérive, un virus,
tout ce que nous touchons est abîmé»
«Sans le doute il n’y a que la violence».
Après Là où nous dansions de Judith Perrignon, nous voilà une nouvelle fois invités à arpenter les rues de Détroit, devenue malgré elle la ville symbole des excès du consumérisme et de ses conséquences. Mais là où la romancière mêlait les voix et les époques, Antoine Vigne préfère les images et les sensations. Comme cet étage d’un étage qui s’effondre et ne laisse derrière lui, après un instant de sidération qu’un nuage de poussière. Cette poussière où nous retournerons tous…
Mais en filigrane, un second thème apparait, l’homosexualité, qui semble être un sujet récurrent en cette rentrée littéraire avec notamment Un empêchement de Jérôme Aumont, Plexiglas d’Antoine Philias ou encore La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascot, sans oublier La vie nouvelle de Tom Crewe. Ici le romancier l’aborde avec tendresse. Mais il paraît qu’il faut prendre garde à la douceur des choses…
Tout s’écoule
Antoine Vigne
Éditions Bartillat
Premier roman
164 p., 20 €
EAN 9782841007554
Paru le 17/08/2023
Où?
Le roman est situé principalement à Détroit. On y évoque aussi les bords de Loire, entre Tours et Angers puis Paris et de multiples voyages et escales dans le monde et notamment à New York.
Quand?
L’action se déroule des années 1990 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Ce roman raconte l’histoire de la rencontre entre deux hommes à Détroit au cours d’un week-end. L’un, Gilles, est pilote, l’autre, Luc, conservateur de musée, ils ont vingt ans d’écart, ils ne se reverront peut-être pas mais c’est dans ce creux que se joue leur intimité furtive. Autour d’eux, il y a Détroit, l’architecture, le monde, les questions de l’enfance et de la perte, du corps et de la religion, du doute aussi.
Écrit en vers libres, Tout s’écoule évoque les blessures du temps, les souvenirs qui remontent à la surface, l’immensité architecturale d’une des plus grandes villes américaines. Antoine Vigne a su créer un univers d’une tonalité particulière qui confère à ce roman son originalité, pleine de charme. Tout en grâce, il a su exprimer le mystère d’une relation faite de différence et d’incommunicabilité dans une mégalopole américaine à l’histoire mouvementée.
Détroit joue ici un rôle essentiel dans l’amitié complice entre les deux protagonistes. Tout s’écoule, aussi bien le fleuve, le temps que l’amitié ou l’amour.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Les premières pages du livre
« Cette histoire n’est rien. Un moment volé au temps. Quelques heures entre l’Atlantique et Détroit, suspendues dans la chaleur de l’été au-dessus de l’asphalte désagrégé des rues. Le rêve d’une ville en décadence, la vitrine de nos échecs et de nos faillites, le fossé dans lequel on ne cesse de jeter les corps dépecés des exclus et des abandonnés. Le monde tel qu’il est. Un chaos perpétuellement renouvelé que nous cherchons sans cesse à rationaliser pour lui donner un sens et satisfaire notre fantasme d’équilibre, Et au creux duquel nous inventons nos vies.
Les gros porteurs sur le tarmac
Le soleil moite et vitreux dans la chaleur du matin
L’été
Les camions qui passent sur l’autoroute, larguant leur lot de pollution qui décolore le ciel
Les avions qui descendent vers Roissy, arrivant de partout
De Madrid, Sydney, New York, Toulouse ou Conakry, de Rome et de Düsseldorf, de Tunis et du Caire,
Ces vols qui parlent de l’Europe et d’ailleurs, de notre société mondiale, des échanges et du tourisme, de ce que nous sommes devenus, des voyageurs que rien ne peut contenter, aveuglés par leurs miles
Oui, on dit miles, tout le monde le dit, la langue elle-même s’est liquéfiée
Gilles, assis dans le cockpit
Aux commandes du Boeing
La machine lourde, impensable, qu’un levier suffit à emporter dans les airs
Comment sommes-nous arrivés à ce degré de technicité ?
Ce rêve de l’homme qui ne fait plus rêver
Devenu évident, commun
Abîmé par l’argent lui aussi, les profits indécents des compagnies aériennes qui vendent des slogans aguichants, promettent l’horizon et n’offrent que des sièges chaque jour plus exigus
Et des écrans
Des écrans pour tous alors qu’à l’extérieur il y a le ciel, les nuages, l’Océan, la vision de la Terre, des plaines, des rivières, des villes, l’ouate lourde et dense dont on ne sort pas toujours
Gilles donc
Pilote de ligne
Abîmé dans sa routine
Les derniers réglages, les données du fret, des passagers, la météo sur le parcours, le plan de vol, long couloir invisible qu’ils suivront pendant dix heures
Et là-bas
De l’autre côté de l’Atlantique
La destination, le point d’arrêt
Détroit
Cité fantôme dont ne restent que des ruines
Un copilote absent ou presque
Quelques mots échangés
Des vérifications encore
Et toujours le soleil en suspension derrière le pare-brise de l’avion, lourd et épais,
Un astre de plomb tombé dans une mare translucide
Les pistes bondées
Des véhicules qui vont et viennent entre les portes et les ponts entre les avions, embarquant et débarquant des passagers
Et puis l’attente derrière les parois de verre des terminaux
Par groupes, par famille, par destination
Les voyages organisés, les touristes solitaires, Les hommes, les femmes d’affaires,
Ceux qui attendent en lisant sur leur siège et les autres
Tous les autres
La foule grouillante et piétinante
La fourmilière d’individus
Nous sommes ces corps, ces planètes minuscules, ces univers entiers enfermés dans la chair,
Toujours inquiets de nous-mêmes, nos destinées,
le temps qui passe, la vie promise
comme une épiphanie,
Brûlure indélébile
Qui pourtant nous entraîne
Gilles les regarde
Tous, derrière la paroi de verre
Il suffira d’un mot et ils s’engouffreront dans le sas
S’installeront
Coussins, oreillers, iPads, iPods, écouteurs
Jeunes, vieux, grands, gros, tranquilles ou énervés
La foule du quotidien
La foule qui vole et qu’il observe chaque fois
Il fait partie du tout, il le sait, le système
L’immense chaîne qui tourne chaque jour un peu plus vite
Enserrant la Terre
Cordon d’asphalte, de câbles, de drones, d’avions, d’immeubles,
De villes et de frontières, lignes invisibles, balafres sanglantes sur lesquelles viennent se briser les destins des plus pauvres
On dit toujours «les plus pauvres» comme s’ils étaient un tout étranger à nous-mêmes
Et l’assemblage tourne, il emporte ses passagers
Pour propulser des ventes, des rendez-vous, des vacances, des images d’Instagram, des achats, toujours plus d’achats
Un tourbillon insensé dont tout le monde sait qu’il faudrait
l’arrêter
Entraîné par les rires des puissants, des ayants,
Les décideurs du temps,
Nos guides, nos prêtres suprêmes
Qu’on entend sur les radios, les réseaux
Exhibant leurs vies, leurs succès, leurs visages cadrés
sur des séjours idylliques que nous ne nous lassons pas d’observer, de commenter, d’envier, d’imiter
Nous sommes assoiffés de leur or
Des messages échangés avec la tour de contrôle puis l’attente
sur la piste
La chaleur qu’on perçoit à travers la vitre
La lumière change, transperce la pesanteur de l’air, scintille
sur l’aile
Le métal blanc
Les avions avancent un à un comme de gros animaux allant à la pâture
Suivant les lignes aux sols
Les marquages du béton
Nos sociétés sont ainsi, des couloirs arrangés entre des pelouses rousses où gambadent des lapins rescapés
Enfin vient l’envol
Les roues se détachent du sol
Les ailes tanguent
La matière résiste, cabre, s’étonne, s’apaise
On entend le bruit des soutes se refermant sur les trains d’atterrissage
Suit le silence
À l’intérieur, la vie reprend – les écrans s’allument, les sièges s’abaissent, les oreillettes se branchent, le personnel de bord va et vient – mais est-ce la vie quand tous se ruent sur la même chose, que les hublots se ferment, et se répète à l’infini la comédie des slogans publicitaires censés nous expliquer que notre sécurité prime, tout est fait pour nous
Juste pour nous
Et nous savons, nous acceptons le mensonge
Nous le laissons traîner, rôder autour de nous
Pensant qu’il n’est rien, une nuisance tout au plus,
Un murmure qu’il est possible d’ignorer, d’oublier
Mais il reste là, il nous assiège, il nous traque
Il nous pénètre, nous salit
Boue quotidienne
Résignation
Compromission
Renoncement à tout ce qui nous fait
humains
Les côtes de Normandie, la botte inversée du Cotentin Gilles aime ces premiers moments
La première heure
La montée dans l’azur
Les champs qui diminuent
Le pays se dévoile avec ses routes, ses rivières, ses villes, ses forêts, le grand kilt agricole aux couleurs dorées ou vertes — c’est encore la France
Et puis la mer, le premier saut
Le moment où le panorama change, l’horizon s’agrandit Nous sommes plus haut, l’air est plus vif
Il reste l’Angleterre, les bocages se succèdent, la côte de Cornouailles,
Précédant l’appel du large, l’Irlande
Les détails s’estompent
Et le dernier saut, le grand cette fois,
L’écume autour des roches, du granit, des falaises, du monde
C’était le monde pendant des siècles, des millénaires
qui s’arrêtait là, se jetait
là
dans le vent
dans le bouillonnement des vagues
dans l’éclatement de l’Océan
sur l’élément solide
Les mêmes impressions
Fugaces
Mouvantes
Exaltantes
Répétées à chaque vol, chaque décollage
Il a essayé de les livrer, les expliquer au copilote
Lui exprimer ce qu’il voit, ce qu’il sent au contact du monde par le dessus
Ce n’est pas la première fois
Il lui vient toujours cette tentation, ce désir, mettre en mots la vision, les images en lui,
la puissance du vent contre la carlingue, la sensation de l’impondérable, la fièvre d’être aux commandes,
le vertige de suivre les pas de Mermoz, John Glenn, Armstrong et tous les autres
Il a essayé
Souvent
Écouté aussi, ses copilotes, ses amis, des passagers,
Ceux qui racontent leurs visions, leurs émotions, les mêmes exacts moments du décollage, la Terre s’éloigne, on perd les champs de vue, la lumière se répand, devient évidente
Ceux qui savent le formuler
Ou n’ont pas peur de se raconter
Sa mère disait que c’est impudique
On ne s’exhibe pas lorsqu’on est un homme,
On garde en soi, c’est mieux
Elle avait tort mais il est trop tard pour se défaire des habitudes, les habitudes apprises trop tôt, le tout machiavélique de l’éducation qui impose ce que d’autres ont déduit de leur expérience,
les frustrations, les peurs, le mal-être,
les désirs aussi mais l’équilibre est trop précaire
Il sait pourtant qu’il n’est pas le seul
à ressentir ces émotions, les attendre, les désirer, les vivre comme un appel, un accomplissement, une pause qui force à regarder, à intégrer, ingérer le monde, la vision
— Toujours Ce mot
Nous sommes les mêmes
Tous
Y compris et surtout dans la manière dont nous nous pensons uniques, dont nous pensons avoir une sensibilité que n’a nul autre, des dons, des idées, des enthousiasmes, des ivresses,
des perceptions de la réalité
Nous nous persuadons avoir une destinée
Un destinée…
On nous a trop promis
On nous a trop dit «tu es choisi», «tu es enfant de Dieu qui t’aime comme nul autre»
On nous a gavés de cette idée de l’unicité qui porte, emporte, nous fait lutter, chercher, résister mais nous écrase aussi, nous impose une conception trop grandiose
De ce que nous sommes vraiment
Cette idée de nous-même magnifiée, glorifiée, déifiée
Un destin à accomplir, nous trouver, nous éloigner de la masse
Alors que c’est dans La masse, la chair, la communauté, la banalité de nos émotions et de nos angoisses
Que nous sommes vraiment
Ce que nous sommes
Il y revient souvent
Là
Dans le cockpit
Ou ailleurs, le soir, face à l’écran, dans le tumulte incompressible des messages, des textes et des images postées sur Internet,
sur les réseaux,
Tous et toutes les mêmes dans nos fascinations, nos enthousiasmes, nos exagérations,
Des troupeaux transportés par avion d’un point à l’autre
Et qui, peut-être, parfois, par intermittence, apercevons le sublime,
Soulevons le voile aurait dit Hegel
Puis le reposons,
Retombons dans la trivialité de nos vies, l’anonymat des corps, le travail, la paresse, la fatigue, l’insatisfaction
Des étoiles aux feux clignotants
La Chèvre dans le ciel d’été
Un message de contrôle
Le copilote lui parle, le tire de sa rêverie
Les ailes tanguent, ajustent la trajectoire
Le parcours se dessine sur leur écran — encore un mot qui revient
Il ne reste rien
Rien
Que le ciel
Le ciel sans fin »
Extraits
« Cette friche n’en est pas une
Cette campagne n’en est pas une
Ces étendues vertes au long des avenues — il y avait des maisons là et là, partout, sur tous ces espaces vides, ces terrains
vagues, ces pelouses improvisées
Des populations, des tramways, des cafés, des théâtres, des familles, des histoires sordides ou gaies ou solitaires, des parades des véhicules, des amoureux, des enfants courant après un chien
La vie
D’une métropole
décomposée » p. 26
« Ils parlent
longtemps
du Michigan d’abord puis de Trump, de l’Amérique contemporaine,
de ses travers, de ses errements,
du capitalisme mondial,
le désastre écologique,
et la violence,
les grands combats de l’époque
— Nous sommes des monstres, des parasites Gilles écoute, sent Luc en train de s’enflammer tout seul,
entend des mots auxquels il songe souvent lui-même mais qu’il préfère généralement ne pas employer
Il a les mêmes instincts, la même colère vis-à-vis de ce qu’il voit,
L’idée inepte que la richesse constitue le but ultime des sociétés, et tout ce qui en découle implicitement, toute la folie du monde contemporain, ses aberrations et ses compromissions,
Les ventes d’armes que personne ne peut arrêter parce qu’il faut bien rester au top, parce que la technologie qui en résulte est garantie de domination » p. 65
À propos de l’auteur
 Antoine Vigne © Photo Jean Poderos
Antoine Vigne © Photo Jean Poderos
Antoine Vigne est un auteur français. Né en 1973, il habite à New York depuis 1999. Historien et spécialiste des questions d’art contemporain et d’architecture, il a publié des ouvrages et des articles ayant trait à ces domaines, notamment un essai consacré à Le Corbusier, ainsi que deux romans pour la jeunesse. Tout s’écoule est son premier roman. (Source: Éditions Bartillat)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Tags
#toutsecoule #AntoineVigne #editionsbartillat #hcdahlem #premierroman
#RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #Detroit #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #primoroman #roman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie








 Wilfried N’Sondé © Photo Legattaz
Wilfried N’Sondé © Photo Legattaz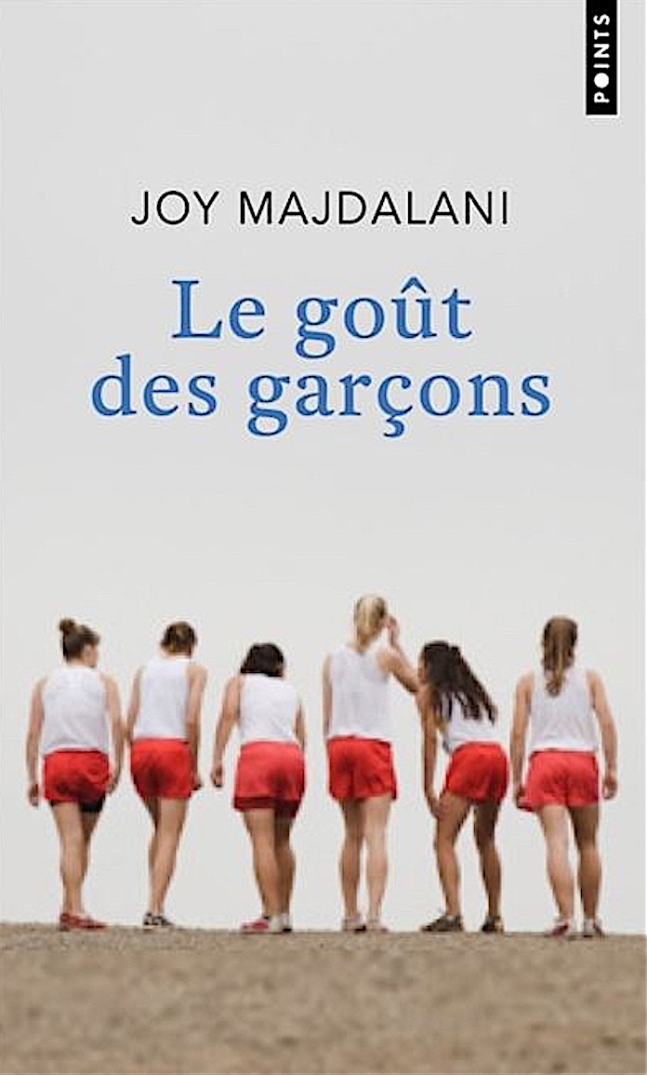


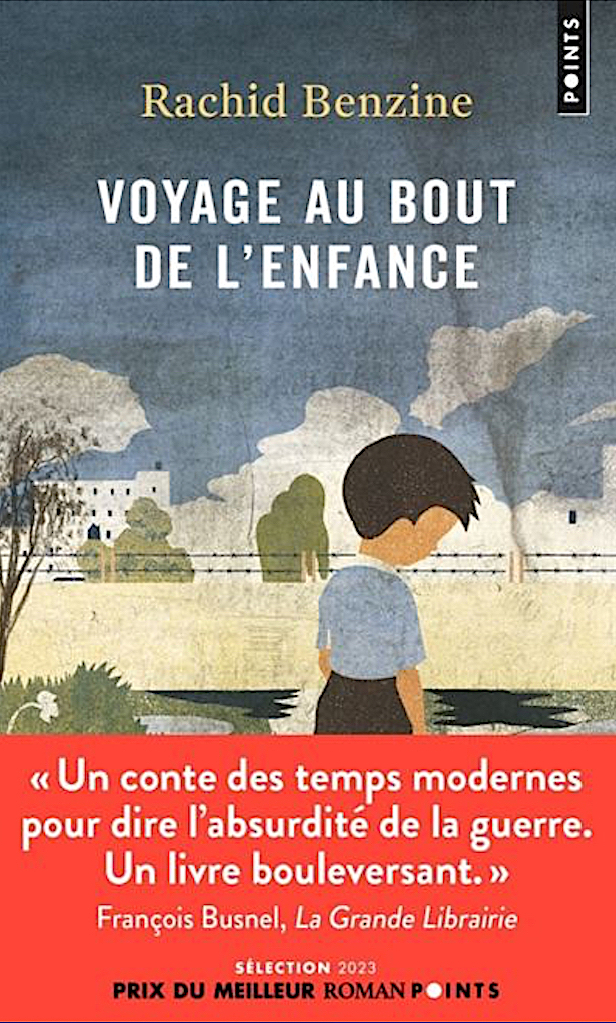





 Alexandre Feraga © Photo Astrid di Crollalanza
Alexandre Feraga © Photo Astrid di Crollalanza


 Aurélien Delsaux © Emmanuelle Lescaudron
Aurélien Delsaux © Emmanuelle Lescaudron


 Gérard Adam © Photo DR
Gérard Adam © Photo DR

 Guillaume Lebrun © Photo DR – Librairie Mollat
Guillaume Lebrun © Photo DR – Librairie Mollat

 Michel Douard © Photo DR
Michel Douard © Photo DR