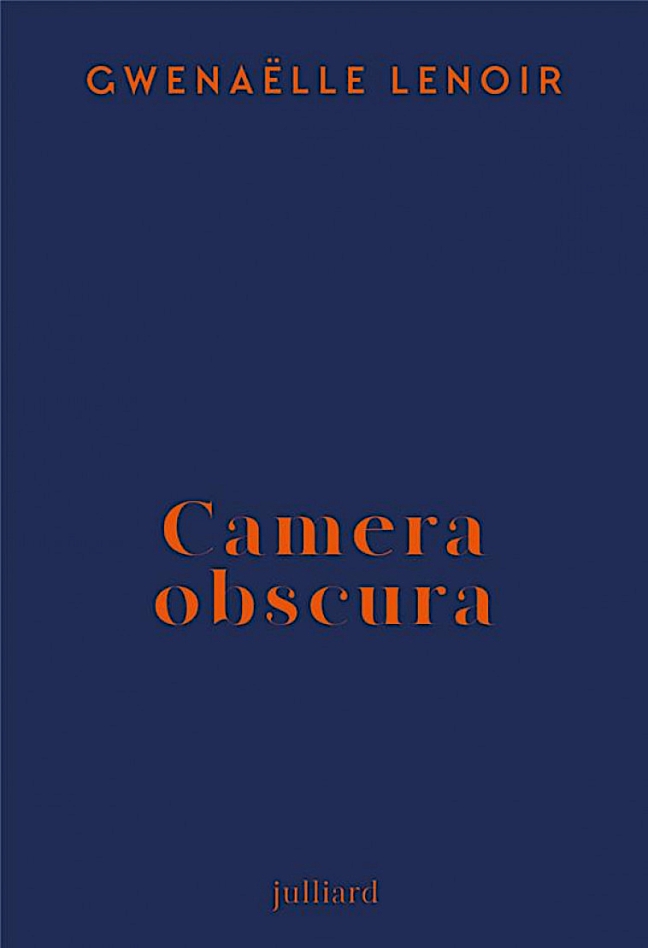
En lice pour le Prix Régine Deforges 2024
En lice pour le Prix littéraire des Sciences Po
En deux mots
«César» est photographe militaire, chargé de documenter les victimes d’accident qui arrivent à la morgue. Mais au fil des jours, il comprend que les blessures et mutilations des cadavres ont une autre cause. Alors, il enregistre les noms et dresse des listes au péril de sa vie, de son épouse Ania et de ses enfants Najma et Jamil.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Les atrocités dans l’objectif
Gwenaëlle Lenoir fait une entrée fracassante en littérature. Pour son premier roman, la journaliste a choisi de nous raconter les exactions du régime syrien à travers l’œil d’un photographe chargé de faire cinq clichés de chaque cadavre arrivant à la morgue. Très vite, il ne va plus supporter ce que les morts lui disent. Mais il a aussi une famille à préserver.
Les premières lignes du livre, comme un photographe effectuant sa mise au point, nous expliquent que le personnage principal du roman est bien réel. «Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne.» Si le pays et le président ne sont jamais cités, on comprend à la lecture et aux détails que nous sommes en Syrie sous le régime Bachar el-Assad.
On comprend aussi très vite que ce choix de discrétion est ici une question de vie ou de mort. Au fil des années, l’emprise du régime sur sa population s’est accentuée au point de rendre suspect tout regard un peu appuyé, toute remarque un tant soit peu critique. C’est dans ce contexte que le narrateur, photographe militaire, chargé de réaliser cinq photos règlementaires des cadavres livrés à la morgue, va comprendre que ses clichés racontent une histoire bien différente de celle qui figure sur les dossiers. Les blessures et les hématomes documentent la torture et l’homicide. Ce qui dans le service n’émeut plus personne, chacun ayant appris à ne jamais poser de questions et à détourner le regard. Tony et « moustache frémissante » vont même plus loin, entonnant un hymne à la gloire du régime dans l’espoir d’un avancement ou de privilèges.
César quant à lui se tait. Mais ce qu’il voit à travers son objectif s’imprime dans sa mémoire. Alors le soir, quand il rentre chez lui, il emporte avec lui toutes ces images perturbantes. Si Najma et Jamil, ses enfants, ne s’aperçoivent pas de ses doutes, Ania, son épouse, comprend très vite ses tourments et sa volonté de tout faire pour préserver les siens jusqu’à lui cacher la vérité: «Je ne parle pas des morts à Ania. Je les ramène pourtant à la maison, soir après soir. Au début, j’ai essayé de les semer. J’ai pris des chemins détournés pour rentrer. Mais ils m’ont suivi. Les morts sont des gens têtus. Ils m’accompagnent dans l’escalier de l’immeuble, rentrent dans l’appartement, dorment dans notre lit et commentent les informations à la télévision. Ils font les gros yeux quand Najma ou Jamil chantonnent leurs nouvelles comptines à la gloire du président.»
Aussi est-ce presque malgré lui qu’il enregistre ses photos sur une puce, qu’il note les noms sur une liste qui ne va cesser de s’allonger.
Gwenaëlle Lenoir réussit à merveille à rendre le dilemme qui l’assaille, entre son éthique et l’envie de protéger sa famille, entre l’envie de dénoncer les exactions de ce régime et le besoin quasi viscéral de ne pas abandonner les victimes aux mains de leurs bourreaux. «Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestrée par les employeurs des Tony de ce pays.»
Il va alors prendre de plus en plus de risques, se rapprocher d’un groupe de résistants et ainsi précipiter un épilogue d’une haute densité dramatique.
Si Gwenaëlle Lenoir s’est appuyée sur une histoire vraie, son écriture tout en ellipses et sa volonté de ne pas situer son récit dans le temps et l’espace, donnent à ce premier roman une valeur universelle. C’est le combat contre toutes les dictatures, la volonté de résistance, la soif d’humanité qui en font un bréviaire pour les temps troublés. C’est fort et émouvant. C’est une histoire bouleversante qui ne vous laissera pas indifférents.
Camera obscura
Gwenaëlle Lenoir
Éditions Julliard
Roman
224 p., 20 €
EAN 9782260056249
Paru le 4/01/2024
Où?
Le roman est situé principalement en Syrie, mais le pays n’est pas nommé.
Quand?
L’action se déroule de 2011 à 2013.
Ce qu’en dit l’éditeur
Un matin, un photographe militaire voit arriver, à l’hôpital où il travaille, quatre corps torturés. Puis d’autres, et d’autres encore. Au fil des clichés réglementaires qu’il est chargé de prendre, il observe, caché derrière son appareil photo, son pays s’abîmer dans la terreur. Peu à peu, lui qui n’a jamais remis en cause l’ordre établi se pose des questions. Mais se poser des questions, ce n’est pas prudent.
Avec une justesse troublante, ce roman raconte le cheminement saisissant d’un homme qui ose tourner le dos à son éducation et au régime qui a façonné sa vie. De sa discrétion, presque lâche, à sa colère et à son courage insensé, il dit comment il parvient à vaincre la folie qui le menace et à se dresser contre la barbarie.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France TV info
L’Éclaireur Fnac (Léa Boisset)
Orient XXI (Nina Chastel)
Blog de Karen Lajon
Blog Baz’Art
Blog L’Œil noir
Blog Le temps de la lecture
Blog Les livres de Joëlle
Blog Bibliofeel
Blog En lisant, en écrivant
Les premières pages du livre
« Ce livre est un roman dont le personnage principal est réel. Ce photographe existe et vit caché quelque part en Europe. Son nom de code est César. Les atrocités décrites sont avérées, les faits sont documentés, mais sa voix est la mienne.
UN
Ania dort et elle sait que je suis mort. Elle a lu le communiqué. Tout le monde a lu le communiqué. Tout le monde sait que je suis mort, mes amis aussi bien que mes ennemis.
Ania fronce les sourcils, ses paupières battent, ses lèvres se tendent. Son épaule gauche tressaute en petits mouvements saccadés puis s’arrête, s’affaisse, calme et blanche au-dessus de la couverture bleue. Alors ce sont ses doigts qui se mettent à danser, ceux de la main gauche, toujours, le majeur et l’index. Peut-être l’alliance est-elle trop lourde pour permettre à l’annulaire de se joindre aux autres.
Je suis mort. J’ai été abattu comme un traître sur cette route grise et droite.
Je me rappelle bien comment je suis mort. Je suis en voiture. Je roule et je roule. La route express vers le nord est défoncée par endroits. J’évite un cratère de justesse. Une roquette, sûrement. La radio n’a pas parlé de combats par ici. La radio ne parle pas de ce genre de choses. Je chantonne.
Les deux voitures devant moi ralentissent, je vois leurs feux stop rougir. Je devine quelque chose sur la route, mais trop loin encore pour que je distingue ce que c’est. Je me rapproche vite, même si je lève le pied. C’est un barrage. Les deux voitures arrêtées sont entourées par des hommes armés. L’un d’eux fait de grands gestes avec son fusil dans ma direction, je pile. Les uniformes que portent les hommes du barrage ne sont pas réglementaires. Leurs vestes et leurs pantalons ne correspondent pas. Ils ont des baskets aux pieds et les cheveux longs. L’un d’eux a une queue-de-cheval, à la mode chez les jeunes Occidentaux. Un autre arbore une barbe fournie et des cheveux bouclés qui descendent dans sa nuque. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des rebelles.
Je suis soulagé. Je préfère un check-point de la résistance à un barrage de l’armée du président. Un des hommes s’approche de ma voiture. J’ouvre la vitre. Il me dévisage. Il me demande mes papiers, je lui tends ma carte d’identité. Je sens le soulagement me quitter, il reflue, il va se nicher tout au fond de mon estomac et commence à former une boule d’angoisse. Le type ne sourit pas. Il me fait signe avec son revolver : « Descends. » J’obéis. Je coupe le moteur et sors de la voiture. Il appelle un autre homme, me désigne d’un signe de tête. Ils me poussent vers une baraque en tôle à moitié brûlée sur le bas-côté. Ça devait être un abri pour des vendeurs à la sauvette de boissons et de fruits, il y en a tout le long des routes express du pays. Nous passons derrière. L’homme qui me suit sort son revolver et tire. Le monde explose sous le bruit de la détonation.
DEUX
Ma vie est morte bien avant moi.
Mon enfance était belle. J’habitais la même impasse qu’Ania. Ania était déjà plus importante pour moi que les jeux de cerceaux et les ballons tirés dans la poussière. Pour sortir de chez elle, pour rentrer chez elle, elle devait passer devant ma fenêtre. Elle était jolie dans son uniforme d’écolière, sa jupe au-dessous du genou, sa chemise blanche et sa veste grise. Elle secouait ses tresses aux rubans verts et blancs quand je prenais son cartable trop lourd pour elle. Elle me disait : « On voit que le printemps arrive, il y a des fleurs aux arbres et tu n’as plus peur de marcher dans les flaques d’eau, que tu es valeureux, dis-moi ! » Elle avait, quoi ? neuf ans, dix ans, et moi un peu moins. J’aimais presque autant qu’elle les gâteaux à la fleur d’oranger que sa mère nous servait au retour de l’école.
L’hiver, les ornières dans le sol se remplissaient d’eau et de boue, l’été d’un sable décoloré. Les feuilles des arbres n’étaient jamais vraiment vertes, toujours un peu grises. Le bruit de la ville parvenait à nos fenêtres, étouffé et doux. À l’adolescence, vivre ainsi à l’écart du vacarme de la ville me pesait. Je l’aurais bien fait sauter, notre impasse. Mais le doux bruit des talons d’Ania sur le sol et le léger balancement de ses hanches d’un bout à l’autre de la rue la rendaient unique.
J’ai pourtant quitté notre impasse sans regret, du moins je l’ai pensé à l’époque. Lorsque je me suis marié avec Ania, nous avons emménagé dans un autre quartier, dans un appartement rien qu’à nous. Les fenêtres donnaient sur une belle avenue sans ornière, aux hauts arbres couverts de feuilles plus vertes que dans l’impasse. On voyait la montagne en se penchant un peu sur le balcon. Il y avait même un petit jardin au pied de notre immeuble. Je trouvais que ce serait bien pour les enfants, sans le dire encore à Ania.
Mes parents aussi ont quitté la rue. Ils sont devenus vieux, ils ont pris leur retraite, sont retournés au village et ont fini tranquillement leur vie entre leur potager et leur champ d’amandiers. Je ne suis pas allé sur leur tombe depuis longtemps. Je n’aime pas déranger les morts. Et puis ça n’aurait pas été prudent.
TROIS
Après, bien après, notre pays s’est abîmé dans les flots de sang.
Je me souviens des premiers suppliciés. Je me souviens du matin où ils sont arrivés. Ils étaient quatre. Il faisait beau, la pluie de la nuit avait lavé le ciel et les rues. Elle m’avait mis d’humeur joyeuse et légère, je n’avais pas envie d’aller travailler, je voulais continuer à regarder Ania courir après les enfants, les presser pour avaler le petit déjeuner, leur répéter qu’ils étaient en retard. Elle avait oublié sur la table du salon leurs gâteaux et leurs berlingots de lait pour la récréation. J’ai descendu les escaliers quatre à quatre, l’ai rattrapée avant que la voiture ne tourne au coin de la rue, puis je suis resté un moment sur le seuil de l’immeuble pour profiter des bouffées de printemps. La rue sentait bon. Le petit jardin au pied de notre immeuble était propre, prêt à accueillir les gamins, ses balançoires et son toboggan fraîchement brossés par le concierge. J’avais hâte de retrouver ces fins de journées printanières, d’observer depuis notre fenêtre Ania qui surveillait distraitement Najma et Jamil. Mes étoiles. Je regardais Najma et Jamil grandir depuis déjà huit et cinq ans. Ils me ravissaient chaque jour davantage. Ania aussi me ravissait davantage de jour en nuit. J’ai eu du mal à quitter la douceur de notre appartement. Mais mon supérieur ne transigeait pas avec les horaires, ni avec le reste d’ailleurs. « Le service de l’État ne supporte pas l’imperfection » était sa phrase préférée. Il m’avait prévenu dès mon premier jour de travail, la moustache frémissante : dans son service, pas d’à peu près, les horaires devaient être strictement respectés. J’ai lavé les bols des enfants et ma tasse de café. J’ai mis mon Canon dans ma sacoche, ajouté deux gâteaux secs à la fleur d’oranger confectionnés par la mère d’Ania, et je suis parti pour une journée de travail aussi banale qu’une autre.
La sentinelle à l’entrée de l’hôpital m’a salué comme tous les matins, sans chaleur. Les jeunes gens qui occupent ce poste ne m’aiment pas beaucoup, en général. Ils n’ont qu’une vague idée de mon métier, mais les ouï-dire leur suffisent. Je sens bien qu’ils hésitent tous entre dégoût et circonspection. Celui-là ne faisait pas exception. Il ne faisait exception en rien, d’ailleurs. Dix-huit ou dix-neuf ans, une veste kaki trop légère pour la saison, des chaussures impeccablement cirées, une kalachnikov aussi raide que la justice et une colonne vertébrale plus ou moins souple selon son interlocuteur. Avec moi, il ne savait pas trop comment la tenir. Je n’entrais pas dans la catégorie des pékins, mais ma profession ne me valait ni prestige ni honneur. À vrai dire, je m’en foutais, ce matin-là encore plus que les autres. Il faisait beau. C’était le printemps. J’étais heureux.
Les quatre étaient là quand je suis arrivé au bureau. Ils avaient dû être amenés juste avant l’aube. Parmi le personnel de jour, nul ne les avait vu arriver, je me suis renseigné plus tard, l’air de rien. Ils avaient en tout cas chamboulé le service. Moustache frémissante, mon supérieur, avait quitté son bureau et se tenait debout au milieu du service, une lettre officielle entre les doigts. Face à lui, son adjoint Salim tirait sur sa cigarette en apnée, son mauvais œil, le droit, tressautait sous sa paupière morte. Il m’avait raconté un soir qu’il avait pris un coup de poing vicieux alors qu’il essayait de protéger sa cousine d’une bande de voyous sur la promenade de la rivière. Les médecins n’avaient pas réussi à sauver l’œil, ni la paupière, il avait eu au moins la satisfaction de mettre en fuite les agresseurs et de sauver l’honneur de sa parente. Il déclamait son récit aussi fort que s’il s’agissait d’une épopée, tantôt sombre, tantôt facétieux, avec des phrases grandiloquentes. Nous fêtions le départ en retraite d’un collègue et avions tous abusé de l’arak qu’il avait apporté de son village. La vantardise de Salim traversait mon esprit embrouillé et je me retenais de rire. Je soupçonnais chez lui de longue date une susceptibilité à la hauteur de sa lâcheté. Je connaissais aussi sa capacité de nuisance. Mieux valait ne pas prêter le flanc au soupçon d’ironie ni laisser traîner le moindre sourcil dubitatif. Même si l’arak affaiblissait son acuité. J’avais donc fait semblant de le croire et m’étais exclamé comme il fallait. Depuis, il m’invitait de temps à autre à boire un verre dans un bar faussement branché tenu par un de ses amis, dans un quartier résidentiel à un jet de pierre de la vieille ville. Il épanchait sa soif et son manque de reconnaissance en me débitant ses conquêtes féminines, se lamentait sur son sort d’homme marié à une matrone frigide, m’assommait de ses certitudes footballistiques, le tout arrosé d’odes au président chantées à voix trop haute. Les deux premières fois, une Ania glaciale m’avait accueilli à mon retour. Elle avait inspecté mes vêtements et mon haleine. Elle avait fini par convenir que décliner ces invitations pouvait me porter préjudice. Désormais, je lui racontais par le menu les élucubrations de Salim et nous en riions ensemble, une fois Najma et Jamil endormis.
« Le service de l’État ne supporte pas l’imperfection, tu as trois minutes de retard », a lâché Moustache frémissante, en désignant mon bureau. Salim a tenté un clin d’œil complice et apaisant auquel je n’ai pas réagi. Je sais que toute protestation, toute justification, tout mouvement des lèvres sont dangereux quand on a affaire à un supérieur. J’ai posé ma sacoche, sorti mon appareil photo, ôté ma veste, l’ai suspendue au porte-manteau et j’ai saisi les actes de décès que Salim me tendait. Deux accidents de la route, une rixe et une chute du sixième étage. Quatre. Ça faisait beaucoup pour un matin de printemps.
QUATRE
J’accroche habituellement ma blouse à une patère à l’entrée de la morgue. Je ne veux pas qu’elle soit dans le bureau, qu’elle côtoie ma veste civile, mon paquet de cigarettes, ma sacoche et mes gâteaux à la fleur d’oranger. Ma blouse ne fait pas partie de ma vraie vie, elle fait partie de mon travail. Sa place est près des morts. J’ai instauré un rituel : enfiler le bras gauche en premier, laisser les pans flotter, tenir l’appareil photo du bras droit et pousser les battants de la porte avec l’épaule. Je l’ai respecté ce matin-là. Il faut maintenir les habitudes. C’est plus prudent.
Tony, l’assistant, s’est levé de sa chaise. Il n’avait pas son verre de thé habituel à la main. Il triturait sa manche. Salim est entré derrière moi. Je ne l’avais pas vu me suivre. Normalement, il ne vient jamais ici. « Commence par celui en bas à droite. » Je n’ai pas compris, mais j’ai acquiescé. Il faut toujours acquiescer au ton du commandement. Tony a tiré le tiroir le plus à droite. « La chute du sixième étage», a dit Salim.
Et il est resté là, juste derrière moi, à nous observer, Tony, moi et le corps. Le cadavre avait une étiquette au poignet droit, comme tous les autres. J’ai regardé le nom, j’ai pris le certificat de décès correspondant et je l’ai déposé dans le panier « départ ». J’agis de cette manière depuis que j’ai commencé ce travail. C’est une habitude que j’ai prise, de regarder le nom du mort avant de le photographier. Mon prédécesseur, Abou Georges, celui qui m’a appris le métier, faisait l’inverse. Il photographiait avant de jeter un coup d’œil à l’identité du défunt. « C’est plus facile, m’avait-il expliqué. Les visages des uns et les noms des autres se mélangent et on les oublie plus facilement. À la fin de la journée, je ne sais plus qui j’ai photographié, qui est mort de quoi, et je rentre chez moi l’esprit serein. Tu devrais faire pareil. » J’ai bien essayé de suivre son exemple, mais ça me perturbait. Je préfère connaître mes morts. Abou Georges n’a pas insisté longtemps. Il était compréhensif, Abou Georges, et las, surtout. Il avait hâte de me passer le flambeau. Il m’a formé en deux semaines et puis il a pris sa retraite. Je le vois de temps en temps dans un café près de la grande mosquée. Il joue au trictrac avec ses amis, il me salue de la tête, m’offre parfois un thé. Il me demande des nouvelles de l’hôpital, je sens que c’est pour la forme, je réponds brièvement et nous n’abordons plus ce sujet. De toute façon, nous ménageons nos mots.
La chute du sixième étage s’appelait Hassan Faysal al-Mouni. Sans le certificat, je n’aurais jamais deviné qu’il était mort à dix-neuf ans. Il était comme raccourci, la tête un peu rentrée dans les épaules, une hanche déviée, un bras, le droit, de travers. Il avait la tête cabossée. « Cabossée », c’est le seul mot qui m’est venu à l’esprit. La présence de Salim derrière moi me dérangeait, je ne réussissais pas à trouver la fluidité de mes gestes, ni de mes pensées. En général, le premier de la journée, je lui parle un peu, parce qu’il m’est moins indifférent que les suivants. J’ai une pensée pour ses parents, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa grand-mère, pour n’importe qui que je peux imaginer l’avoir aimé. Avec Salim derrière moi et Tony debout qui triturait sa manche, je n’y arrivais pas. Je n’avais que des questions dans ma tête. Pourquoi ce matin-là ne ressemblait-il pas aux autres ? Pourquoi fallait-il commencer par celui du tiroir en bas à droite ? Pourquoi je me pose des questions ? Ce n’est pas prudent de se poser des questions. J’ai vite collé mon œil au viseur et j’ai pris les photos, en m’efforçant d’agir comme d’habitude et de ne pas laisser mes interrogations transparaître. Il faut cinq ou six clichés par client. Abou Georges n’a jamais su m’expliquer pourquoi cinq ou six, et pas trois ou huit. Il n’a jamais su me dire qui avait décidé ça ni si la consigne était écrite quelque part, dans un cahier, dans un décret, dans un règlement interne ou national, ou dans une loi. « Ne pose pas trop de questions, fiston. » C’est grâce à ça qu’il a réussi à arriver jusqu’à l’âge de la etraite et au temps du trictrac, sans se laisser grignoter par les morts, ni dévorer par les vivants. À travers l’œilleton de mon appareil, j’ai saisi les arcades sourcilières, une orbite et une tempe enfoncées, le sang coagulé dans les cheveux, les lèvres éclatées sur des dents cassées, une oreille écrasée, des os brisés qui sortaient des chairs au niveau des articulations, des contusions violettes, des lambeaux de peau. Hassan Faysal al-Mouni était ma première chute d’un sixième étage. Ce n’est pas si fréquent, même ici, à la morgue de l’hôpital militaire. Même ici, les gens tombent rarement d’un sixième étage.
Salim a pressé Tony : « le suivant ». Tony a rangé Hassan Faysal al-Mouni et tiré le tiroir d’à côté. J’ai regardé l’étiquette, c’était la rixe et il s’appelait Mohammed Tabir. Il avait le même âge que le précédent. « Blessures à l’arme blanche et objet contondant », était écrit sur le formulaire. J’ai posé la feuille dans le casier « départ », ai collé mon œil au viseur et me suis appliqué. Peut-être qu’un chef, dans un bureau, avait trouvé que mes clichés laissaient à désirer et avait envoyé Salim vérifier que je ne bavardais pas avec Tony ou que je ne rêvais pas à Ania pendant le travail. Peut-être que Salim voulait s’assurer que je ne traînais pas. Peut-être qu’il cherchait à échapper à la surveillance de Moustache frémissante ou qu’il voulait un peu de silence. Peut-être qu’il était juste venu se distraire. Ou qu’il retardait l’écriture d’un rapport ennuyeux. Ou alors qu’il devait donner un cours à l’université sur le métier de photographe au service funéraire de l’armée, comme disent les bureaucrates de chez nous. J’ai essayé d’appliquer à la lettre l’enseignement d’Abou Georges. Pas de questions. Le cadre le plus neutre possible. La focale sur 50. La symétrie du corps. J’ai soigné comme ça Mohammed Tabir et les deux accidents de la route, deux frères, presque encore adolescents, Haytham Mahmoud et Bassel Mahmoud. Je me suis tant concentré que je n’ai pas bien remarqué les blessures des uns et des autres. Tony a refermé le dernier tiroir doucement, j’ai eu l’impression qu’il était soulagé de voir pendre mon appareil sur ma poitrine. Il a murmuré « de rien » quand je l’ai remercié avant de sortir, Salim sur mes talons.
J’ai enlevé ma blouse, l’ai suspendue à la patère et me suis dirigé vers mon bureau. Salim était toujours derrière moi. Il aurait pu marcher de front avec moi, le couloir est assez large pour deux personnes, mais il restait sur mes talons. Si je m’étais arrêté brusquement, il me serait rentré dedans. Je ne me suis pas arrêté, j’ai poussé la porte du service, Moustache frémissante était là. Il m’a fixé. Normalement, Moustache frémissante n’est pas là quand je reviens de la morgue en milieu de matinée. Il a regagné depuis longtemps l’ancienne chambre de malades qui lui sert de bureau, ou il est dans d’autres services, à boire le thé en compagnie d’autres chefs, ou il a quitté l’hôpital en prétextant une mission urgente à l’extérieur. En fait, il est rentré chez lui, est allé faire des courses pour sa femme, a rejoint sa maîtresse ou joue au trictrac en compagnie de ses amis. Je le sais parce qu’Abou Georges me l’a raconté. Abou Georges fait partie des compagnons de trictrac de Moustache frémissante, il l’a tellement fréquenté qu’il connaît tout de lui, jusqu’à la fois où il s’est emmêlé les pinceaux dans les cadeaux pour son épouse et sa maîtresse. Moustache frémissante aime beaucoup la lingerie, il a l’habitude d’en offrir. Un jour, en veine de générosité, il a acheté deux parures, une crème pour sa légitime, une violette pour son illégitime. Chacune enveloppée dans du papier de soie gris foncé et glissée dans un élégant sac cartonné. Seulement, il n’a pas pensé à mettre un sac sur le siège avant de sa voiture et l’autre sur le siège arrière, et il les a confondus. Le problème, c’est que sa femme a horreur du violet et qu’il ne peut l’ignorer tant elle s’en vante, jugeant que c’est une marque de distinction. Je ne sais pas comment Abou Georges a eu vent de l’histoire, en tout cas il en a ri pendant des jours.
Aujourd’hui, Moustache frémissante est debout devant mon bureau et je me retrouve coincé entre lui et Salim, toujours sur mes talons. « Tout s’est bien passé ? », me demande mon chef. Je hoche la tête en essayant de rester absolument impassible, je dois quand même avoir l’air étonné. « Il faut les envoyer vite, les photos, le bureau des décès les attend, les familles sont impatientes », il me presse. « Bien, bien », je réponds. Surtout ne pas poser de question. Ce n’est pas prudent.
CINQ
La procédure est simple et la routine apaisante. C’est un moment que je n’aurais jamais cru apprécier quand j’ai été embauché à l’hôpital militaire mais que j’ai aimé très vite, sans doute parce que j’ai toujours chéri le silence. La première fois qu’Abou Georges m’a emmené dans cette pièce exiguë, il m’a juste dit : « Maintenant, c’est le meilleur moment de la journée, prends ton appareil photo et n’oublie pas ton verre de thé. » Il a sorti une clé de sa poche, a ouvert une porte, tout au fond du couloir, à l’opposé de celle de la morgue. Ce n’est pas une pièce à proprement parler, plutôt un cagibi. Une seule fenêtre, très haute, une chaise, une table et un ordinateur à écran plat, l’un des très rares de l’hôpital. Ce jour-là, Abou Georges m’a montré comment insérer la carte mémoire de l’appareil photo dans le port de l’ordinateur et envoyer les photos au bureau des décès. « Elles arriveront avant les formulaires, eux, ils doivent attendre que la navette de fin de journée ait fini de remplir ses autorisations de sortie. »
Deux semaines plus tard, pour fêter mon embauche définitive et sa retraite, il m’a invité dans un petit restaurant de la vieille ville, près de la grande mosquée, à quelques rues de chez lui. Il y a ses habitudes depuis des décennies. Le patron, un de ses condisciples de l’école secondaire, a choisi son épouse pour ses talents de cuisinière et ses clients pour leur discrétion. L’intérieur est masqué de la rue par des voilages gris aux grosses fleurs rose passé. La peinture de la devanture tombe par écailles. Il n’y a pas d’enseigne, pas de pancarte, pas le moindre nom. « C’est le meilleur restaurant et l’endroit le plus tranquille de toute la ville », a assuré Abou Georges en posant son large postérieur sur une des étroites chaises en bois. « Aucune ligne dans aucun guide touristique. Pas un moukhabarat. Il n’y a plus rien à manger ni à boire quand il y en a un qui débarque. » Je me suis dit qu’il était vraiment en confiance dans cette gargote, qu’il m’avait pris en amitié ou alors qu’il voulait me piéger. Jamais jusque-là il n’avait prononcé le mot maudit à haute voix devant moi.
On ne parle pas des services secrets. Ce n’est pas prudent. Votre interlocuteur peut en être, des moukhabarat, et de la pire branche. Il peut boire avec vous, manger avec vous, jouer au trictrac avec vous et, le jour où il l’a décidé, vous faire enfermer là d’où on ne sort jamais. Abou Georges a bien remarqué ma réaction. Il a haussé les épaules, a grimacé un petit rictus et a fait signe au patron. « Abou Bassel, voici mon jeune camarade de l’hôpital militaire, c’est lui qui me remplace. Ce soir, je fête ma retraite. » Abou Bassel a souri et sa moustache est allée lui chatouiller les narines. Il a posé une main sur son cœur et l’autre sur sa bedaine. « Dans ce cas, Oum Bassel te fera marquer cette soirée d’une pierre blanche, mon ami ! » Et il s’est faufilé vers la cuisine par une porte deux fois moins large que son ventre. Il est revenu avec un grand pichet d’arak et deux verres pleins de glaçons. Abou Georges me regardait en plissant les yeux.
— Tu sais, la pièce de l’ordinateur, c’est le seul endroit où personne ne viendra jamais surveiller ton travail par-dessus ton épaule.
Extraits
« Je ne parle pas des morts à Ania. Je les ramène pourtant à la maison, soir après soir. Au début, j’ai essayé de les semer. J’ai pris des chemins détournés pour rentrer. Mais ils m’ont suivi. Les morts sont des gens têtus. Ils m’accompagnent dans l’escalier de l’immeuble, rentrent dans l’appartement, dorment dans notre lit et commentent les informations à la télévision. Ils font les gros yeux quand Najma ou Jamil chantonnent leurs nouvelles comptines à la gloire du président.
Les morts sont des gens discrets. Pendant longtemps, ni Ania ni les enfants ne se sont rendu compte de leur présence. » p. 73
« Je suis resté seul avec les morts. J’allais les quitter moi aussi, j’allais les abandonner à leurs souffrances, seuls sur les carreaux blancs, sans respect ni tendresse, aux mains de leurs bourreaux. Je ne pouvais rien pour eux, seulement les photographier. Seulement refuser de participer à la danse macabre orchestrée par les employeurs des Tony de ce pays. » p. 105
À propos de l’autrice
 Gwenaëlle Lenoir © Photo Charlotte Krebs
Gwenaëlle Lenoir © Photo Charlotte Krebs
Gwenaëlle Lenoir est journaliste indépendante, spécialiste de l’Afrique orientale et du Proche et Moyen-Orient. (Source: Éditions Julliard)
Page Facebook de l’autrice
Compte X (ex-Twitter) de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice
Tags
#cameraobscura #GwenaelleLenoir #editionsjulliard #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #Photo #Syrie #NetGalleyFrance #coupdecoeur #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie









 Karina Sainz Borgo © Photo DR
Karina Sainz Borgo © Photo DR





 Jean Michelin © Photo Céline Nieszawer
Jean Michelin © Photo Céline Nieszawer




 Christelle Périssé-Nasr © Photo DR – Ouest-France
Christelle Périssé-Nasr © Photo DR – Ouest-France

 Emmanuelle Heidsieck © Photo DR
Emmanuelle Heidsieck © Photo DR


 Guillaume Lebrun © Photo DR – Librairie Mollat
Guillaume Lebrun © Photo DR – Librairie Mollat

 Anne-Sophie Subilia © Photo Romain Guélat
Anne-Sophie Subilia © Photo Romain Guélat


 Nathacha Appanah © Photo Francesca Mantovani
Nathacha Appanah © Photo Francesca Mantovani




