En deux mots
Une jeune femme qui fuit son mari violent, un savant dont l’invention – une neige qui ne fond qu’à 36°C – lui échappe, un maire corrompu et un jeune homme placé en foyer, voilà quelques-uns des personnages de ce road-trip déjanté où il s’agit d’éviter de mourir sous des amas de neige incontrôlables.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Il nous en fait voir de toutes les couleurs
Frédéric Ploussard confirme toute l’originalité de sa plume avec ce second roman tout aussi déjanté que Mobylette. Cette fois, il imagine un savant débordé par son invention, une neige qui ne fond pas et va envahir la planète. Un roman noir tout blanc.
Longtemps elle aura retardé l’échéance – par peur, par honte ou par lassitude – mais cette fois tout est prêt. Blanche prend la fuite, quitte l’ouest et un mari violent. Ce n’était que «lorsqu’il n’était pas là ou trop saoul pour l’emmerder» qu’elle pouvait éviter les coups. Elle part pour les Alpes où elle espère retrouver son frère et se construire une nouvelle vie. Après une étape à Lyon chez Malika, une ancienne collègue, la voilà dans cette station qui dépérit et où pourtant elle espère pouvoir se construire une nouvelle vie, s’inventer un avenir radieux.
L’avenir radieux, c’est aussi ce qu’espère Arsène Tapelot, patron des textiles Tapelot, qui a investi dans l’invention de François Tapinski, le coton thermorégulé , c’est-à-dire qu’il permet au corps de rester toujours à la même température, peu importe le climat dans lequel se meut l’individu qui a enfilé cette invention. Si Arsène a très vite compris le potentiel de ces vêtements, les ventes ne décollent pas car «la couleur Allemagne de l’Est» de ce coton est rédhibitoire. Il faudrait trouver un moyen pour que l’on puisse teindre la matière. Alors le savant cherche…
C’est alors que le roman va basculer.
Ah, la figure du savant fou! On pense au Docteur Jekyll devenant Mister Hyde, à Mabuse, à Frankenstein ou encore au docteur Moreau de H.G. Wells. À cette liste, il convient désormais d’ajouter François Tapinski. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, le chercheur est animé de bonnes intentions, mais va se laisser entraîner dans une dangereuse spirale. Pour relancer Bourgevel, la station de sports d’hiver qui se meurt – le réchauffement climatique a fait disparaître son beau manteau blanc – Tapinski a l’idée de créer une neige artificielle qui ne fondrait qu’à 36°C. Autant dire que le maire du village accueille à bras ouverts l’idée et le savant. Son premier essai ira bien au-delà de ses espérances puisque son usine va produire, produire, produire… Devenue une boîte de Pandore incontrôlable, sa fabrique va non seulement transformer la vallée, mais s’étendre bien au-delà. La neige s’accumule partout et ne fond pas. Il faut désormais se mouvoir dans des mètres de neige qui recouvrent le pays et bientôt le continent, avant de s’attaquer à la planète tout entière. Seul un petit archipel du Pacifique a pu éviter le désastre. Au milieu de ce «tout blanc», il ne reste qu’à fuir!
Et nous voilà partis dans un road-trip totalement improbable, passant de la motoneige au chalutier, mais qui va nous réserver son lot de surprises. On y croisera à nouveau Blanche et son frère, un tueur à gages finnois, Arsène et son épouse Mélina – qui va révéler son vrai visage –, un éleveur de chiens, un survivant de la station spatiale ou encore la Présidente de la République. Bref, vous l’aurez compris, il y a là de quoi vous régaler.
Creusant le sillon entamé avec Mobylette, Frédéric Ploussard laisse son imagination débordante envahir toutes les pages – encore blanches – pour nous offrir un roman noir. Ce faisant , il n’oublie pas en chemin son humour corrosif. En s’amusant et en nous amusant, il nous offre ce conte apocalyptique qui est aussi une mise en garde contre les excès de la science, contre les atteintes à la nature. Un avertissement de ce calibre, on en redemande!
Tout blanc
Frédéric Ploussard
Éditions Héloïse d’Ormesson
Roman
320 p., 19 €
EAN 9782350878911
Paru le 17/08/2023
Où?
Le roman est situé principalement en France, de l’Ouest aux alpes, en passant par Lyon. On y voyage jusque dans le sud de la France avant de partir jusqu’aux îles Chatham, en Océanie.
Quand?
L’action se déroule dans un avenir plus ou moins proche.
Ce qu’en dit l’éditeur
Déjanté, outrageusement drôle, toujours plus givré!
Cette fois, c’est décidé, Blanche se casse pour de bon. Pas question de finir dans la rubrique « féminicide » d’un canard local. Déterminée, elle s’en va trouver refuge à la montagne, chez son frère. Là-bas, elle est embauchée comme vendeuse par Tapelot textiles, une marque de prêt-à-porter connue pour son invention révolutionnaire : le coton 19. Qu’importe la météo, les vêtements demeurent à température ambiante. Seulement voilà, le scientifique Tapinski à l’origine de cette trouvaille ne s’en tient pas là. Un nouveau projet, plus grandiose encore, tourne à la catastrophe. Son but ? Faire tomber la neige. Le hic ? La neige est tiède, elle ne fond pas et, à son contact, une partie de la population tombe malade avant de succomber. Sans le vouloir, avec son expérience, Tapinski a créé l’Apocalypse.
La France est à l’arrêt, mais pas seulement. Aucun des cinq continents n’est épargné. Pour s’en sortir, Blanche s’allie avec Anthony, son nouveau compagnon, et Mélina, sa patronne. Ensemble, ils vont déjouer le terrible Salvetat, un tueur à gages sans pitié et pas vraiment pétillant (bien qu’un peu poète), affronter des congères géantes (un lion aussi) et rejoindre le chalutier qui les conduira aux îles Chatham, dernière terre sauve en vue.
Avec son humour corrosif et son imagination débridée, Frédéric Ploussard s’amuse des excès de la science. Dans ce roman d’anticipation tout aussi extravagant que visionnaire, il déploie à loisir une écriture sur-vitaminée et désopilante.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Wukali (Émile Cougut)
Actualitté (Hocine Bouhadjera)
Positive Rage
Blog A l’écoute des livres
Blog L’Atelier de Litote
Blog Mic Mac dans la bibliothèque
Présentation de «tout blanc» dans «Toujours à la page». © Production France Bleu Drôme Ardèche
Les premières pages du livre
« Elle lisait le message qu’elle venait de recevoir sur son smartphone. Jérôme, son mari, dormait encore. Il s’était couché ivre au petit matin. Comme presqu’à chaque fois qu’il n’était pas d’équipe de nuit. Après avoir traîné au bar du port, il avait continué à boire à la maison, avec son pote, le gros Evan, celui qui avait perdu une jambe sous un container. Elle s’était pris une claque dans la nuit parce qu’elle leur avait demandé de baisser le son du match de baseball…Partir. Un thé infusait sur le plan de travail. Le message émanait de son beau-père. Il était en mer sur son chalutier à proximité des côtes anglaises et il avait pensé à elle. Blanche avait nettoyé et rangé le salon. Evan avait probablement dormi dans le canapé qu’il avait quitté à l’aube. Le salon, la cuisine, les chiottes. Un sac poubelle plein de merdouilles, puis elle s’était douchée, habillée, maquillée. Toujours un minimum de fond de teint à fort pouvoir couvrant pour cacher la misère, même s’il évitait son visage le plus souvent. Ce dont il se vantait. «Son cul et son visage, qu’est-ce qu’elle a d’autre?» Humour de docker.
Mais pas vraiment, pas cette nuit. Elle avait un bleu marbré sur la pommette en se levant.
Partir.
Il était dix heures. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçut la factrice devant l’immeuble alors qu’elle portait la tasse à ses lèvres. L’appartement était au troisième étage, les boîtes aux lettres au bord de la route, la fenêtre donnait de ce côté-là. C’était son anniversaire aujourd’hui. Le père de Jérôme le lui souhaitait dans son message. Trente-et-un-ans. Il lui demandait également des nouvelles de son frère. Blanche avait eu son frère au téléphone la veille au soir. Geoffrey lui avait annoncé avoir posté un cadeau. Il travaillait dans un atelier de confection à Bourgevel et chaque année, pour son anniversaire, il lui envoyait des grosses écharpes ou des moufles qui servaient peu dans le Finistère. Ça les faisait marrer avec Malika, sa meilleure amie. C’était l’intention qui comptait. Il l’avait appelée du standard de son foyer dans les Alpes, il avait perdu son portable, ce n’était pas la première fois. Elle avait toujours un pincement au cœur en pensant à son petit frère. Geoffrey ne s’était jamais complétement remis de l’accident de voiture qui avait coûté la vie à leur mère et dont Blanche était sortie indemne vingt ans plus tôt. Il avait été hospitalisé plus d’un an. Hébergé quelques mois avec elle en famille d’accueil à sa sortie pour ensuite être placé dans un premier foyer pour handicapés, puis un deuxième et, à sa majorité, un centre d’aide par le travail dans les Alpes qui l’hébergeait depuis onze ans. Elle le voyait peu. La dernière fois, c’était à son mariage. Son mari n’appréciait pas son beubeu de frangin, comme il l’appelait.
Blanche était restée dans la famille d’accueil. Leur père n’existait pas. Adolescente perdue et apeurée, une période tellement difficile, la pire. Quoiqu’aujourd’hui c’était la pire aussi, apeurée encore. Différemment.
Partir.
Elle le remercia pour son message. Le père de son mari, comme son mari, était un filou, mais lui n’était pas doublé d’un sale con. Elle frissonna en débouchant dans le hall. Son beau-père savait ce qu’elle endurait et il prenait toujours de ses nouvelles. Un filou délicat, le beau-père. Une fois dehors, elle se retourna pour regarder la façade de l’immeuble: la fenêtre de leur chambre, volets fermés, aucun mouvement derrière les vitres du salon, calme plat. Encore en train de cuver. Les meilleurs moments de sa vie de couple quand elle y réfléchissait.
Lorsqu’il n’était pas là ou trop saoul pour l’emmerder.
Au matin, elle ne craignait plus sa violence. Juste ses excuses ou son arrogance ; ce qui n’était pas moins douloureux. Elle se mit sur la pointe des pieds pour atteindre la boîte aux lettres. Capuche rabattue sur le visage, en sweat, ses longs cheveux auburn ramassés ; elle portait un jeans et des Vans bleues aux pieds. Une grosse enveloppe se trouvait bien à l’intérieur. L’écriture du petit frère en diagonale sur le papier, le cachet du foyer dans un angle. Elle s’en saisit. Geoffrey lui avait dit qu’elle serait fraîche, et c’était vrai. Elle la décacheta avant de remonter. Elle contenait un tee-shirt gris-noir qu’elle déplia. De taille 6XL au moins le maillot. Et un mot au feutre sur un papier à carreau qui lui glissa des mains : BONE ANNIVAIRSERE GRANDE SŒUR !
Entouré d’une trentaine de cœurs dessinés aux crayons de couleur.
Un tee-shirt toile de tente quasi-noir.
Il faisait chaud dans l’ascenseur mais le tee-shirt lui semblait bel et bien frais. Au téléphone, Geoffrey lui avait expliqué qu’ils ne produisaient plus de moufles pour les maisons de retraite. Les prisonniers leur avaient piqué le marché, moins chers, plus adroits et tout aussi disponibles. Eux cousaient désormais de la lingerie de corps dans un tissu fait d’une matière grise thermorégulée. De la matière grise, son frère en avait toujours eu à revendre mais l’accident avait tout rempilé autrement. Il avait ajouté qu’il avait eu super mal au ventre les jours précédents, parce qu’ils avaient mangé trop de nouilles chinoises pendant la semaine du goût. Elle était habituée à ses histoires sans queue ni tête. Elle ouvrit la porte de l’appartement et déposa le tee-shirt dans le vestibule en apercevant Jérôme assis à la table de la cuisine. Il s’était manifestement fait couler un café tout seul et c’était presque un deuxième cadeau d’anniversaire. L’apercevant, il lança :
– T’as une sale gueule Blanche !
Presque.
Un mois plus tard, Blanche faisait défiler les photos qu’elle venait de prendre sur l’écran de son smartphone. Son buste, son cou, son visage, pris en reflet dans le miroir.
Un bip se fit entendre. Un autre SMS de Jérôme. Il l’avait déjà appelée deux fois depuis qu’elle était dans la salle de bains. Elle n’avait pas décroché. Aucun bruit derrière la porte. Le verrou était tiré. Elle alluma la radio. Une journaliste interviewait Matthias Lescut, un cosmonaute français. Blanche lut le message: «Tu sais les couleurs de nos vies, celles qui demeurent. J’avais besoin du tee-shirt et j’ai oublié le psy. La nuit sucrée nous sortira de cette journée acide. Sors et maintenant et demain…»
Patati patata. Ses excuses.
Les couleurs. Ses couleurs à lui, mais ses couleurs à elle aussi. Elle les voyait bien, là, dans la glace. Violacées. Sa poitrine sur tout le côté droit, mélange d’ancien et de nouveau. Son sein gauche, toujours le gauche, avec la trace de ses doigts. Et son œil qui bleuissait déjà. Sa lèvre. Elle prit un pantalon, un sweat. Sa naïveté.
La raison n’était pas importante. Il y en avait toujours une. Ce soir, deux. D’abord celle de ne pas foutre la main sur le tee-shirt. Jérôme l’adorait ce tee-shirt. Elle aurait dû se taire, ne rien ajouter, mais elle avait commis la maladresse de lui demander ensuite s’il était passé chez le psy, c’était lui qui avait proposé, et les coups avaient commencé à pleuvoir.
Les insultes habituelles. Poussée, secouée, acculée contre la porte de la salle de bains. Une bonne dérouillée. Réfugiée à l’intérieur.
Il était resté derrière la porte un moment. Elle, immobile contre la baignoire, à serrer les dents, à écouter sa douleur pulser. Elle avait préparé un sac. Caché dans le vaisselier. Toujours une raison. Elle n’avait pas répondu. Alors il avait mis un coup dans la porte. Puis il avait essayé de lui téléphoner. Deux fois. Puis de la chambre le message : « Sors et maintenant et demain… »
Et demain tout continuera.
Elle n’avait jamais pensé le quitter, jamais vraiment pensé le quitter. Jusqu’à la mort de Brune. Ils étaient en couple depuis plusieurs années, mariés depuis deux. Il l’avait toujours battue. Peut-être pas les six premiers mois, ou c’était sa mémoire qui la trahissait. Une claque au début. « Oh ! chérie t’arrêtes! » Des pincements, des tapes du dos de la main. Et ces dévalorisations incessantes: «Ce que t’es conne!», «Tu me pousses à bout princesse», «Je m’en veux poulette, tu es tout pour moi, mais t’abuses!» Elle l’excusait. Elle s’excusait aussi. S’excusait de le pousser à bout. Excusait l’inexcusable pour tout encaisser. Tout recommencer. Se rabibocher. Pardonner.
Jusqu’à la semaine dernière, Brune Parchoie, première goutte, et hier, deuxième…
Hier, son frère l’avait appelée pour lui annoncer qu’on l’avait changé de foyer. Elle ne l’avait pas eu depuis son anniversaire. Un problème d’intoxication à cause des nouilles chinoises, il y avait eu deux morts. Qu’elle ne s’inquiète pas, il allait bien. Les projets individuels avaient été reconsidérés: le sien étant équitation, il allait probablement se retrouver à bosser dans un chenil parce qu’un haras, fallait pas rêver !
Il n’avait toujours pas de téléphone, mais il en aurait un dès qu’il aurait rejoint son nouveau lieu de vie. Geoffrey lui avait demandé si le tee-shirt lui plaisait. Il paraissait tellement heureux. Elle lui avait dit que oui et même avoué que c’était devenu le tee-shirt préféré de Jérôme. Geoffrey n’avait rien répondu. Il n’aimait pas davantage Jérôme que Jérôme ne l’appréciait.
Après avoir raccroché, elle avait repensé à l’article du journal paru la semaine précédente, celui qu’elle avait photographié, qui lui avait donnée envie de remplir un sac. Il concernait la mort d’une femme appelée Brune Parchoie quelques jours plus tôt.
Pour rien, pour tout, une autre couleur, Brune, Blanche, effacée l’une, l’autre…
Brune Parchoie avait été tuée par son compagnon lors d’une querelle dans leur appartement. Après l’avoir frappée, il l’avait jetée du deuxième étage devant leur fille. Un étage de moins que le sien dans un quartier tout proche. Parce qu’elle avait refusé ses avances. L’homme, comme Jérôme, travaillait sur les docks. Quelques affaires, du maquillage, un disque dur: Blanche avait préparé un sac. Partir avant. Brune était morte trois jours plus tard sans avoir repris connaissance. Avant l’inéluctable. Jérôme avait promis de consulter un psy. Son rendez-vous était ce matin. Il s’en voulait. Promis de bien se tenir mais…Pour ce que ça valait mais il n’avait même pas essayé.
Éviter de se faire balancer par la fenêtre, rester en vie, choisir. Ce que prononcent ses lèvres tuméfiées devant le miroir. Prendre le sac, franchir la porte avant qu’il s’en aperçoive. Aussi simple que ça. Partir maintenant ce soir tout de suite. Respirer prendre la fuite.
Prendre un train. Recommencer ailleurs. Aller chez Malika le temps de rebondir. Rebondir. Se rapprocher de son frère. Cela faisait si longtemps. Geoffrey dans un refuge pour animaux. Elle regarda son œil. L’ecchymose prenait forme. Heureusement, elle avait son fond de teint magique. Son humiliation. Ne pas fléchir.
Partir.
Prévenir Malika.
Elle ôta le verrou, entrouvrit la porte de la salle de bains. Le couloir était sombre, la cuisine au bout simplement éclairée par la veilleuse du four. Aucun autre bruit que la chaleur tournante. Il était en haut. Habitué à ce qu’elle le rejoigne. Ce qu’elle faisait toujours. Habitué aussi à la frapper pour clore certaines discussions. Tellement souvent. Habitué…
À l’étrangler, la cogner, la laisser gisante contre le carrelage. La balancer, l’insulter, la terrifier. Pas tous les soirs mais presque. Peut-être que c’était sa faute à elle, comme il disait. Trois fois cette semaine. Elle s’était pissée dessus ce soir.
Mécaniquement, elle acheva de remplir sa trousse de toilette. Derrière la panière à linge sale, elle le vit. En boule. Foutu tee-shirt frais. Elle avait mal au cou. Elle ferma la trousse, traversa le couloir à pas feutrés. Évita de renifler. La pizza était par terre devant le plan de travail, celle qu’elle préparait lorsqu’il s’était énervé. Elle faillit la ramasser, se retint. Elle récupéra le sac, y glissa la trousse de toilette. Nouveau message : « Ne traîne pas trop ma chérie!»
Il n’y avait plus rien pour elle dans cette maison.
La soirée s’étirait, Blanche se tirait.
Elle envoya un message à Malika: «J’arrive dans la nuit.» Malika savait, la seule à qui elle en avait parlé. Au magasin, ils ne faisaient que se douter. Malika était une ancienne collègue. Une amie qui habitait loin désormais. Suffisamment loin.
Blanche saisit au passage une photo. Une petite somme dans le cadre. Il devait imaginer qu’elle nettoyait la cuisine, qu’elle enfournait la pizza. Elle enfourna la bouteille de bourbon en fait, celle de son apéro. Bien au fond du four, le referma. Elle donna un coup de lingette sur le plan. Plus fort qu’elle. Elle se passa un doigt sur les lèvres et enclencha la pyrolyse. Un couteau traînait. Comme un point de non-retour. Elle enfila son manteau. Son bonnet alors qu’il ne faisait pas froid dehors. Mit le couteau dans une poche. Elle avait tout. Des rafales d’images assaillirent son esprit. Elle pouvait encore renoncer. Elle avait essayé d’éviter le deuxième coup. Parfois ça suffisait. Parfois il se contentait d’un coup. Parfois pas. Ce soir, cela n’avait pas suffi. „On t’attend» suivi d’une adresse à Lyon. La réponse de Malika. Pas davantage. Téléphone en mode silencieux. Pas de questions. Blanche referma le sac. Une part d’elle avait envie de baisser le thermostat du four. Une part d’elle avait envie de monter rejoindre son mari. Une part d’elle avait envie de mourir.
À la porte vitrée, nouveau message: «Tu ranges la cuisine?»
C’était sa vie. C’était normal ce qui venait de se passer. C’était normal de s’écrire d’une pièce à l’autre de la maison. De ranger la cuisine après s’être pris des gnons dans la gueule. De remonter avec le tee-shirt et une part de pizza. De se déshabiller. De se faire reprocher de marquer si facilement, d’avoir la peau si fine. De se faire pardonner. De s’appeler Blanche et d’être couverte de bleus. Puis de dîner en l’écoutant parler de la grue qu’il manipulait au boulot pour déplacer les containers, de ses collègues, d’Hervé que sa gonzesse menait par le bout du nez, ou encore de Corinne, la responsable containers du port de Tréboul, toujours bien roulée malgré ses deux grossesses. Des problèmes avec un chalutier en difficulté vers les grands bans à l’ouest de Guernesey…
«Ressers-moi un verre mon amour s’il te plaît.» Le resservir, débarrasser, le rejoindre devant la télé. Il sifflerait une bière ou deux ou trois ou dix. La main sur sa cuisse jusqu’au signal du coucher. Comme si elle ne s’était pas prise une branlée trois heures plus tôt. Comme s’il n’était pas bourré. Comme s’ils s’aimaient encore.
Maintenant ou jamais. Elle était prête. Elle s’approcha de l’écran 16 pouces et débrancha le câble qui le reliait à la box. Petite pulsion. Il lui avait tellement pris la tête au sujet de ce câble. Toujours une raison.
Elle observa le salon une dernière fois, avec calme. Elle enroula le câble autour de sa main. La dernière fois. Ses objets, ses doudous, la pendule de sa mère. Elle s’en passerait. Cinq ou six minutes depuis qu’elle était sortie de la salle de bains. Elle ouvrit la porte d’entrée doucement car elle grinçait. Elle se faufila, sac à l’épaule. Ascenseur. En bas de l’immeuble, elle jeta le câble de toutes ses forces. L’Acura, sa voiture, était devant les garages. Elle sentit le couteau dans sa poche. Lorsqu’elle l’avait pris, elle s’était demandé pourquoi, elle comprit. Elle creva la roue arrière en le plantant dans la gomme d’un seul coup. Elle ne put ressortir la lame du pneu. Le message était clair. Elle rabattit son bonnet pour masquer son œil marbré, l’étole dissimulait le reste. Elle se dirigea vers le bas de la rue. La gare était de l’autre côté de la rivière.
Lyon. Malika habitait à Lyon.
Une ville où il faisait bon mourir. Elle se souvenait d’une série dans laquelle une des actrices avait eu cette phrase étrange. Blanche marchait vite. Douarnenez n’était pas une ville où il faisait bon mourir. Elle s’arrêta pour retirer le maximum à un distributeur. Elle pensait payer son billet en liquide à une borne. Il allait la chercher. Ne serait-ce que pour son câble. Elle avait intérêt à brouiller les pistes en prenant une correspondance.
Une vibration. «T’as pas fini, qu’est-ce que tu fous ma belle?»
Belle, elle ne l’était plus, mais ça reviendrait.
Elle le connaissait si bien. Il s’énervait de ne pas pouvoir s’excuser, comme un con allongé sur leur lit, à mater n’importe quoi sur Netflix. Il s’impatientait. Il appellerait. De plus en plus fort. Est-ce que la bouteille allait exploser? Il finirait par descendre, s’étonnant de l’écran noir normalement toujours allumé le soir. Il hésiterait un instant peut-être. Il tenterait d’allumer l’écran – faut tout faire bordel ! –, il découvrirait l’absence du câble et…
BOUM ! la bouteille de bourbon lui chaufferait les miches dans l’idéal.
Il ouvrirait en grand la porte de la salle de bains.
Il ouvrirait en grand celle du couloir.
Le silence.
Le prochain train partait dans six minutes. Paris-Montparnasse. Blanche verrait pour la suite là-bas. Elle avait faim.
À l’autre bout de la France, un peu plus tôt cette même semaine, dans une pièce attenante à un atelier de confection, une pièce vaste, bien remplie, encombrée même, deux hommes: l’un était à son poste de travail derrière un microscope électronique, une centrifugeuse à sa gauche, l’autre franchissait le sas d’accès, sécurité renforcée et précautions d’usage.
– Que me vaut le plaisir petit poulet? minauda celui qui était assis.
Le petit poulet en question fit de gros yeux sans lâcher le renfort de la porte.
– On est seuls, ne flippe pas Arsène! François Tapinski souriait. J’espère que tu ne viens pas que pour me parler d’opaque couché ?
– Entre autres…
– Laisse-moi deviner! poursuivit Tapinski, dit le Taps, dit la Flèche, depuis son siège de gamer à l’entrée du laboratoire Tapelot. Tu passes m’annoncer que les ventes ont décollé malgré tes récriminations envers la teinte et qu’on va enfin pouvoir s’équiper de cette cuve que je réclame à cor et à cri.
Arsène Tapelot, patron des textiles Tapelot, parut comme désemparé une seconde. Une longue seconde. À croire qu’il s’était trompé d’endroit. Impression chaque fois répétée lorsqu’il se rendait au laboratoire. Drôle de truc.
Il franchissait les portes de cette pièce sécurisée réaménagée en laboratoire le plus rarement possible. Peut-être une dizaine de fois depuis l’embauche du chercheur. Lors de sa dernière visite, quelques semaines plus tôt, il avait quitté Tapinski allongé au sol. Une des soirées parmi les plus riches en connerie de toute la vie d’Arsène. Mais pas que…
La pièce était dans le prolongement du bâtiment en L. L’ancien entrepôt des ateliers Tapelot avait été reconverti en centre de recherche et d’application dans le domaine textile. À la suite du retour de l’autre farfelu. À l’intérieur, un cube de test à pression négative côtoyait un vivarium, une douche…L’espace était bien plus encombré que dans son souvenir.
– Je suis mort de rire, Taps.
– Tu as vu les souris? Viens voir les souris. En pleine forme. Hydratées à l’eau de rinçage depuis trois semaines et elles vont bien. Aucun décès façon poupée de cire. Ce qui s’est passé à l’atelier protégé est possiblement sans lien avec notre expérimentation.
– Le chef d’atelier a jugé bon de réorienter les autres quand même. Deux morts et huit cents tee-shirts géants.
– Oh arrête ! OK, ils ont déconné dans la production, mais les deux morts étaient hors du groupe témoin. Et même s’ils ont été en contact avec l’eau, le test est validé pour les dix participants recrutés. La mise de départ. Sur les cent soixante-dix pensionnaires. C’est bon, détends-toi !
– C’est bon? Tu y vas fort. Tu as vu le deuxième? Le chef de service m’a montré des photos avant de faire nettoyer. Pas mort d’une fausse route, le gars!
– Le panel des cobayes est indemne et les souris aussi. Avec la cuve, je vais vraiment pouvoir travailler sur la couleur du textile.
Les ateliers Tapelot avaient fourni l’eau de la semaine du goût organisée par l’institut d’aide par le travail qui sous-traitait une partie de la production de la collection Désir d’opaque. Arsène n’en avait été informé qu’au troisième jour. Cette eau était le résidu des dernières expérimentations du chercheur. Elle avait connu la haute pression de l’opaque profond et de sa bactérie vorace avant de cuire les pâtes à l’institut. Deux pensionnaires étaient décédés dans la semaine. Le premier assis dans son fauteuil, dur comme du bois. Le deuxième, dans l’escalier. Le chef de service avait dû faire scier la rampe.
– Une légère constipation pour les autres, le chef de service a flippé c’est tout, se justifia Tapinski. La mort fait pleinement partie de la prise en charge dans ce genre d’établissement. Que ça tombe la semaine du goût les a un peu embarrassés, mais pour ta gouverne, ils ont connu d’autres problèmes depuis, des soucis de canalisations dans les sanitaires. Les aléas du quotidien au crépuscule.
– Franchement je m’en tape de savoir qu’ils ne peuvent plus tirer la chasse. On peut dire que tu sais me rassurer François.
– Toi, tu profites mais moi je vivote Arsène, comme elles.
Tapinski désignait les souris.
– Tu plaisantes, j’espère? J’aimerais surtout ne pas couler la boîte avec tes conneries ! Le coton thermorégulé est une merveille, mais sa couleur Allemagne de l’Est est rédhibitoire. Tu sais cette couleur utilisée sur les paquets de clopes depuis plus de vingt ans. »
À propos de l’auteur
 Frédéric Ploussard © Photo Charlène Boirie
Frédéric Ploussard © Photo Charlène Boirie
Né en 1968, dans les Vosges, Frédéric Ploussard a longtemps exercé le métier d’éducateur spécialisé. Il vit aujourd’hui en Ardèche où il se consacre à l’écriture. Mobylette, son premier roman, prix Stanislas, prix du premier roman de la ville d’Angoulême, a paru en 2021. Tout blanc est son second roman. (Source: Éditions Héloïse d’Ormesson)
Page Facebook de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur
Tags
#toutblanc #FredericPloussard #editionsheloisedormesson #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #secondroman #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie






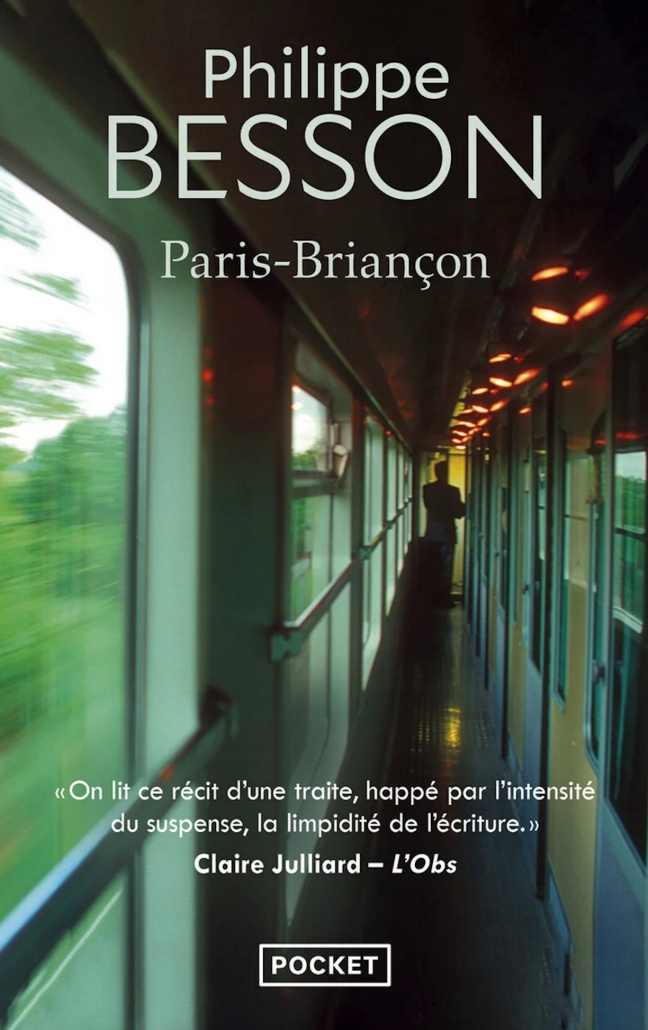











 Le jury du Prix Jean Anglade 2022, sous la présidence de Pierre Vavasseur à Clermont-Ferrand © DR
Le jury du Prix Jean Anglade 2022, sous la présidence de Pierre Vavasseur à Clermont-Ferrand © DR

 Gaëlle Josse © Photo James Weston
Gaëlle Josse © Photo James Weston


 Marion Roucheux © Photo Delphine Jouandeau
Marion Roucheux © Photo Delphine Jouandeau


 Maylis de Kerangal et Joy Sorman © Photo Renaud Monfourny
Maylis de Kerangal et Joy Sorman © Photo Renaud Monfourny



 Philippe Besson © Photo DR
Philippe Besson © Photo DR


 Jean-Christophe Rufin © Photo RTL
Jean-Christophe Rufin © Photo RTL


 Vincent Hauuy © Photo Ariane Galateau
Vincent Hauuy © Photo Ariane Galateau