En deux mots
De Los Angeles au Morvan et d’Oklahoma City à Paris, ce roman choral va nous raconter l’histoire d’un producteur hollywoodien, d’un ancien résistant, d’un fonctionnaire aigri, d’une jeune fille qui se rêve actrice, d’un clandestin ou encore d’un geek très doué. Le tout formant un beau tableau de notre époque de plus en plus angoissante.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Un panorama saisissant de notre époque
C’est avec un roman choral qu’Édouard Jousselin confirme son talent à construire des histoires foisonnantes. De Los Angeles au Morvan, il va peindre une riche galerie de personnages qui vont lui permettre d’analyser avec acuité nos sociétés contemporaines.
Le roman s’ouvre sur une scène d’accident mortel sur l’autoroute 101 aux abords de Los Angeles. Il a coûté la vie à un producteur de cinéma.
Puis on bascule en février 2012, dans l’église de Quarré-les-Tombes dans le Morvan où l’on enterre l’un des derniers résistants de la Seconde Guerre mondiale. Au sein de la maigre assemblée, on compte Dominique son gendre et ses petits-enfants Maxime et Marine. Attardons-nous un peu sur cette dernière. Elle a fait le voyage depuis Paris où elle travaille d’arrache-pied pour intégrer une classe préparatoire. Joignant l’utile à l’agréable, elle révise avec son amant Stéphane, mais elle sait déjà que leur histoire ne durera pas.
En parlant de révisions, Maxime laisse entendre qu’il a travaillé sa philo avec Clarice, alors qu’ils n’ont fait que baiser. Il faut dire qu’au sortir de l’adolescence, leur libido est un élément primordial de leur vie provinciale. Clarice se rêve actrice et remercie Max qui vient de lui affirmer qu’il a envoyé sa vidéo à son beau-père, producteur à Hollywood. Un mensonge qui lui permet de voir Clarice fondre d’amour pour lui. Le jeune homme, quant à lui, arrondit ses fins de mois sur internet. Le geek a mis au point un système d’arnaque qui permet à ses clients d’accéder à des sites pornos qu’il déverrouille et rassemble.
Pendant ce temps, à Tulsa en Oklahoma, les frères Steve et Tyler assistent à la projection du troisième film de la série The last Fighters, une franchise au succès planétaire dont on suivra la production jusqu’à l’opus 4 intitulé Aux racines de la colère.
Mais auparavant, on aura refait un voyage dans le temps, en avril 1995. L’occasion de découvrir les vies des parents et grands-parents des personnages si bien dépeints dans les chapitres initiaux. On y découvre notamment Isabelle que la naissance de Maxime traumatise, son père parti commémorer la fin de la Seconde guerre mondiale sur les Champs Élysées et croiser Mitterrand et Chirac qui vient tout juste d’être élu, tandis qu’aux États-Unis un attentat vient de souffler un immeuble fédéral d’Oklahoma City. Parmi les fonctionnaires blessés figure Bill, le père des deux frères, qui sera marqué à vie physiquement, mais surtout psychologiquement.
Si la galerie de personnages est loin d’être complète, elle permet cependant de bien comprendre l’intention d’Édouard Jousselin, tirer des fils entre les différents personnages et les différentes époques, développer cette géométrie des possibles –un excellent titre – et ce faisant explorer la complexité de notre époque. Car à l’image des acteurs de ce roman choral, on va constater combien les années vont les changer, que la vérité de l’instant n’est plus celle de ceux qui vont suivre. Et que l’analyse à chaud n’est pas forcément la plus pertinente. Le 11 septembre 2001 en est l’exemple le plus saisissant, parce qu’il «se vit en mondovision comme une finale olympique.» L’événement va saisir les personnages quasiment en direct. «Ben Crawford à Los Angeles, Jessica Dahlgren à Paris, Cándido Rincón dans sa loge de gardien de l’Arroyo Blanco, Isabelle et Dominique Richard à Quarré-les-Tombes, Lucien Michot sur son canapé, William et Lucy Smith dans le matin de l’’Oklahoma, Bruno Landisier quelque part sur la route d’un festival du film ou sur un plateau de tournage, tous reçoivent un flux d’ondes décrivant la trajectoire d’hommes se jetant d’une tour en flamme pour s’écraser à une vitesse folle sur la dalle new-yorkaise. Aucun ne peut détourner le regard ni éteindre son émetteur radio. Aucun ne comprend complètement ce qui se déroule. Aucun n’ose y croire.»
La géométrie des possibles
Édouard Jousselin
Éditions Rivages
Roman
608 p., 23,90 €
EAN 9782743661687
Paru le 3/01/2024
Où?
Le roman est situé en France, à Paris, Quarré-les-Tombes dans le Morvan et Auxerre, ainsi qu’à Lille, Dijon et dans le Bordelais, notamment à Saint-Julien-Beychevelle. Le second pôle est situé aux Etats-Unis, à Tulsa et Oklahoma City, Los Angeles, Hollywood et San Francisco, ainsi que Lakewood, au sud de Seattle. On y évoque aussi Tepoztlán au Mexique,
Quand?
L’action se déroule des années 1990 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Quel fil invisible relie un ancien résistant, une starlette de la téléréalité, un père de famille américain, un couple d’étudiants appliqués, un migrant mexicain et une jeune mère au bord de la crise de nerfs? Aucun en apparence, et pourtant. Des forces mystérieuses tressent leurs vies pour les plonger dans la tourmente, hantées par l’ironie de l’Histoire, son cours impitoyable. Leurs ambitions cohabitent avec le mensonge et la fatalité les attend au tournant. Des brumes du Morvan aux plages de Californie, des profondeurs du Darkweb aux paillettes d’Hollywood, espaces et temps se télescopent, selon les lois d’une énigmatique géométrie des possibles.
Dans ce deuxième roman, audacieux et addictif, Édouard Jousselin confirme son talent de narrateur, après Les cormorans, publié aux éditions Rivages en 2020. Sous sa plume se déploie une œuvre-monde foisonnante, chronique vertigineuse de notre époque.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Actualitté (Hocine Bouhadjera)
Les premières pages du livre
« Ça ne fait pas de bruit. Du moins ça n’en fait plus. Le fracas bref, puissant, s’est éteint aussitôt après le formidable craquement de tôle, éphémère comme un lacis de foudre. Sur la route, on ne perçoit pas la moindre trace d’un freinage. Rien. Pas de bandes de caoutchouc en lignes parallèles sur l’asphalte brûlant. Seulement le silence des débris.
La Maserati Quattroporte couleur Bronzo Montecarlo est pliée. Elle gît à moitié sur la bande d’arrêt d’urgence, éventrée sur son flanc gauche. Le capot expectore une fumée grisâtre et malodorante. Ses longerons sont si déformés que la bagnole semble se courber sur elle-même, arquée tels les arbres qui poussent aux vents et les enfants dans le ventre de leur mère. Sous le plancher coule un mélange d’huile de moteur, de liquide de refroidissement et de sang. Il coagule au contact de la chaussée, devenant brun et poreux.
Ça ne ressemble pas à un véritable accident. On dirait du cinéma. Ça donne l’impression d’une reconstitution bas budget. Une modeste production récupère une épave à la casse, la repeint grossièrement avant de la déposer au bord d’une route. L’acteur a le front sur le volant, il gémit quand la caméra s’approche, puis bave pitoyablement, jusqu’à la mort. L’ironie, c’est que jamais il n’aurait autorisé qu’on tournât une scène pareille dans un de ses films. Jamais. Il était, au contraire, des plus attentifs à ce genre de détails. Dès le scénario, il aurait demandé qu’on lui expliquât d’où provenaient les véhicules, et lequel était responsable de la collision. Il aurait juré que cela ne collait pas. La Honda Accord couleur Tiger Eye Pearl devrait être plus proche, peut-être encore encastrée dans la Maserati, plutôt que de ronfler quinze mètres plus avant. Il faudrait qu’il y ait davantage de verre sur le sol, que les pare-chocs branlent, qu’un panneau de custode repose, déformé, sur le macadam. Le mort pourrait geindre encore un peu, ou non, mieux, n’être que blessé. Il taperait à la vitre pour qu’on le sorte de là. Gueulerait. Finirait par perdre un morceau de jambe comme la belle blonde dans Amours chiennes d’Iñárritu.
La 101 est déserte, un comble à Los Angeles. Au loin, une sirène hurle. La police, peut-être une ambulance. Il est trop tard, le corps ne se réveillera pas. Le conducteur de la Honda essaie de prendre la fuite au volant de sa ruine. Elle produit un son de roulis métallique et de désespoir. Finalement, il se carapate à pied, tenant son avant-bras gauche contre sa poitrine.
Autour, la chaussée s’évapore. La nuit est douce, un vent océanique caresse le ventre chaud de la ville et charrie des monceaux de poussière. Une odeur de bitume flotte dans l’air et rejoint les notes de sucre, de gras, de café, de friture brûlante, le parfum des beignets à la banane, celui des gazons coupés ras, des fleurs de jardins municipaux et de la pisse des vagabonds.
PARTIE I
LA QUADRATURE DES PÈRES
FÉVRIER 2012
Au cœur de la France, comme une marque de charbon, sombre et imposante, le Morvan se dessine dans la brume. C’est un parc de Bourgogne aux charmes austères, semé de vallons, de rivières et de bois. La ligne à grande vitesse lui ampute l’oreille gauche, l’A6 prend soin de contourner par le Nord ses forêts de chênes pédonculés, de bouleaux verruqueux, d’érables, de sapins et d’épicéas. D’où qu’on l’aborde, le Morvan donne cette impression de bouche noire et avide, cette impression de gouffre. Les anciens en racontent bien des choses à son propos, vantent le magnétisme de sa dalle granitique qui combat leurs rhumatismes et les garde en longue santé, narrent ses récits d’antan qu’ils mêlent aux contes de sorcellerie, chuchotent des pans d’Histoire oubliés, ne manquent jamais d’évoquer le souvenir d’un père qui croisa le fer jadis avec l’occupant, dans une vallée encaissée.
Les anciens, ils sont là, une petite quinzaine, les bras croisés dans le dos, certains les mains dans les poches. On croirait des empereurs piétinant la banquise. Le froid de l’est a gagné la plaine. La terre gelée s’évapore lentement, exhalant une timide odeur d’herbe grasse et de pierres mouillées. Une vieille, sous son châle, essuie une larme avec un mouchoir beige brodé de ses initiales. Ils attendent sur le pas de l’église de Quarré-les-Tombes, serrés à l’abri du porche, tandis que le vent baffe le cercueil. Ils se reconnaissent, se saluent, patientent sagement.
Ils ont l’habitude des enterrements, enfin ils s’y sont habitués avec l’âge qui avance, s’y rendent habillés des vêtements du dimanche, résignés à voir partir les partenaires de clubs, celle-là qui était si bavarde, le vieux coureur de jupons qui avait été bel homme, cette malheureuse dont le mari était mort bien jeune, celui-ci qui en avait une sacrée santé pour avoir vécu si longtemps avec les murges qu’il se mettait, l’autre encore dont on disait qu’il ferait un vigoureux centenaire et qui claqua pourtant deux ans à peine après avoir pris sa retraite.
Aujourd’hui, c’est le tour de Lucien Michot de rejoindre la longue liste des amis d’outre-tombe. Pas n’importe qui, le Lucien. Un résistant. Quelques anciens en ont accroché des breloques, au revers de leur veste, que le soleil d’hiver fait scintiller. Le maire fera un discours pendant l’office, il évoquera le maquis, dit-on. Cela fait toujours plaisir, ces vieilles histoires d’héroïsme. Elles sont le sel de cette terre.
En attendant, le froid glace leurs os. Surtout à ce gros type qui s’affaire autour du cercueil, va et vient avec des gerbes, les dispose tantôt sur le sol, tantôt sur le pin de la bière, remet sa cravate droite, puis son col et de nouveau sa cravate, s’éclaircit la voix pour discourir mais ne dit finalement rien, ou juste une chuchoterie à l’oreille de son supérieur resté tranquillement au chaud, sur le siège passager du corbillard, et qui écoute une émission sportive de Radio Monte-Carlo.
La famille arrive, à petits pas depuis la place du village. Enfin, la famille… ce qu’il en reste. Dominique Richard, qui avait été son gendre, Maxime, le petit-fils, et puis Marine, bien sûr, la Parisienne, celle qui fait de grandes études et fera de grandes choses, qui est d’ailleurs assez grande et a l’allure d’une femme puissante dans sa belle robe noire, une femme du grand monde. À tous, elle rappelle sa mère, sa mère absente, absente de l’enterrement de son propre père, voilà qui donnera un sujet de discussion aux anciens, lesquels n’en demandent pas tant, eux qui entrent tête baissée dans l’église.
Et se signent.
Quelques minutes plus tard, tout le monde est assis. Le maire est finalement excusé, un empêchement de dernière minute l’oblige. Le préfet organise une réunion téléphonique relative à l’épisode neigeux, attendu la nuit prochaine. L’édile ne pouvait pas la manquer. Une jeune conseillère prononcera le discours sur le maquis à sa place. Elle est née dans les années 1970, mais évoque les Allemands de son enfance, les combats glorieux des résistants, le souvenir d’en avoir caché un à la maison. Elle lit un texte qui n’est pas le sien. Au dépourvu, elle endosse aussi une certaine Histoire de France.
Un moustachu s’amuse : « Elle nous fait une Hervé Morin. » Son voisin hoche la tête, il n’écoute pas vraiment le discours, ne saisit pas non plus la référence, lui dont pourtant le téléviseur est allumé du matin au soir, et qui a forcément entendu le candidat centriste élucubrer sur ses réminiscences du 6 juin 1944, lui qui ne vit le jour qu’en août 1961. À tous, ici, les croix blanches font partie de leur ADN, personne n’en tiendra rigueur à la conseillère, personne n’en tiendra rigueur non plus à Hervé Morin, lequel se rangera d’ici quelques jours derrière la candidature de Nicolas Sarkozy.
Marine prend la parole, elle parle de son grand-père, l’appelle Papi Lucien, elle parle d’elle, elle parle beaucoup d’elle. Puis au nom de son petit frère, au premier rang, de son père et – plus étonnamment – de sa mère, elle remercie l’assistance.
Vient le tour de l’éloge du prêtre. Il articule toujours les mêmes paroles, implore le pardon, appelle au recueillement, convoque les souvenirs et promet la vie éternelle. Il perd lui aussi un ami, s’en émeut. Il distribue l’hostie et s’autorise une rasade de vin de messe.
Les cloches sonnent.
Le croque-mort est devant l’entrée quand les portes de l’église Saint-Georges sont rouvertes et qu’une bourrasque chasse la prière et les feuilles mortes sur les sarcophages qui cernent l’édifice. Il se tient droit, arbore l’air triste et sérieux de circonstance. Ses cheveux sont désormais totalement plaqués sur son crâne. Une pluie fine et cinglante a verglacé la place pendant les trente-cinq minutes qu’a duré la cérémonie. Il serre la main du Dominique, de la Marine et du Maxime. Il dirige le cercueil jusque dans le corbillard, fourrage dans les gerbes pour leur redonner un peu de tenue, aide quelques anciens à grimper dans les voitures. Il monte enfin dans son fourgon, souffle à pleines joues dans ses paumes. Son chef démarre, prend la rue du Grand-Puits, puis, à gauche, voilà le cimetière de Quarré-les-Tombes. Il se gare devant.
Au niveau du portail, une rafale, chargée de gel et d’aiguilles, s’abat sur l’assemblée, mord les pommettes des femmes, givre la moustache des hommes, vient éteindre en chacun les derniers sentiments, la mélancolie et la tristesse.
Max se les caille. Rentre ses avant-bras sous son manteau et les place sous ses aisselles. Il est au premier rang. Il se penche. Contemple le trou. C’est une cavité sommaire, difficile d’en évaluer la profondeur avec cette brume. Le crachin s’est calmé mais tout reste froid et humide. Il se demande comment on a bien pu fouir un terrain si dur, regarde autour de lui, observe la pelle mécanique stationnée plus haut. Se gratte le menton. Tout s’explique.
Sur la pierre tombale sont déjà inscrits les deux années 1924 – 2012 et le nom du défunt en belles lettres capitales. Tout est prêt, l’au-delà n’a pas attendu. Ce n’est pas son genre.
Les anciens se serrent devant la tombe, emmitouflés dans le silence. Le curé convoque une dernière fois la Vierge, et on demande si quelqu’un veut ajouter quelque chose. Deux octogénaires s’avancent, saluent le mort et entonnent, du bout des lèvres, Le Chant des partisans. Le cercueil descend dans la terre, Lucien s’en va retrouver le monde des lombrics et des racines et, dans la ville, c’est comme si les sarcophages se scellaient un peu plus en un puissant claquement.
Sur l’un d’entre eux, un corbeau becquette un rameau de ronce.
*
À quelques cadavres près, cent milliards d’êtres humains sont morts depuis l’apparition de l’espèce. C’est un chiffre qui ne veut rien dire, qu’on trouve sur le Net, qu’un gars a calculé sur un coin de table, qu’on se jette à la figure et qui ne vaut guère mieux que son double, son triple ou son tiers. Mais mettons qu’il soit exact, mettons qu’on s’en contente, que l’approximation nous satisfasse. Alors, si on avait plié chacun de ces cent milliards d’individus dans une tombe d’un mètre carré, il aurait fallu un cimetière de la superficie de l’Islande pour les aligner toutes. Sans compter les allées, les monuments, les fontaines pour arroser les fleurs, quelques arbres pour faire de l’ombre, sans compter les statues de soldats, de rois, de penseurs. Sans compter les colonnes, les ornements, les mausolées.
Les prairies grasses, les pentes des volcans, les glaciers, les chemins côtiers, les sources chaudes et bouillonnantes, tout, chaque centimètre de lande islandaise, serait recouvert de croix, de croissants, d’étoiles de David, d’autels où on disposerait les cendres et l’encens, de bouddhas enduits de feuilles d’or. L’île se résumerait à une constellation morbide, à perte de vue, consacrée tout entière à la mémoire d’hommes qui furent. Organisée comme le cimetière de Montparnasse à Paris, lequel est relativement dense, l’humanité défunte s’agencerait en une nécropole si étendue qu’elle couvrirait entièrement la France, de la cime des Alpes jusqu’aux gorges étroites des Pyrénées, du granit breton au sol crayeux champenois en passant par les berges de la Loire, les mal plats des massifs érodés et les Flandres, l’Alsace, la Provence, le Pays basque.
Il faut bien que les marbres décrépissent, que les pierres se brisent, que les concessions dans les cimetières s’achèvent et que les derniers vestiges humains finissent en ossuaire pour laisser place à des morts plus frais, sur lesquels d’autres vivants pourront se recueillir ; il faut bien des charniers et des fosses, laisser quelques hommes se noyer plutôt que repêcher les dépouilles dans la mer, arrêter les recherches en montagne, abandonner quelques corps à la nature, entasser dans un même caveau tous les membres d’une famille, accepter que les chairs sourdent en panache par les cheminées des crématoriums.
D’autant que des morts, il y en a de plus en plus, on les produit à la chaîne, que certes pour l’instant couvrir un pays de tombes c’est acceptable, un pays s’oublie, se contourne, se survole, un pays s’emmure s’il le faut, mais bientôt, qu’en sera-t-il lorsqu’il faudra en coloniser un nouveau avec des pierres tombales, tapisser un continent de stèles de fleurs et de larmes, quand il faudra vivre dedans, s’abriter dans les tombeaux, habiter le cimetière, s’y préparer ses repas assis sur la sépulture d’un aïeul et dormir dans une crypte, comme les miséreux de la nécropole congolaise de Kimbanseke ?
À Quarré-les-Tombes, dans l’Yonne, une centaine de sarcophages sont disposés autour de l’église. Il y en avait plusieurs milliers un millénaire plus tôt. La ville leur doit son nom. C’est unique en France. Il n’y a guère que Tombebœuf dans le Lot-et-Garonne qui pourrait signifier « abattoir » et La Tombe en Seine-et-Marne qui doit son appellation à son relief et non à une sépulture, si bien qu’on aurait pu nommer cette ville plus prosaïquement « La Butte ».
Quarré-les-Tombes est seule campée sur un cimetière ancien, sur des tombeaux dont on ne sait même pas s’ils furent habités, sur des mystères.
Les sarcophages se sont éparpillés avec les siècles, certains servent d’auge pour abreuver les troupeaux quand ils paissent, d’autres furent cassés pour récupérer de la bonne pierre, d’autres encore sommeillent sous la terre et murmurent des secrets.
*
– Du coup, il en a pensé quoi de la vidéo ?
Clarice se cambre d’un coup. Son dos se cintre. C’est brusque. Elle gémit.
– Attends, ne te mets pas comme ça.
– Comment ?
– Comme ça, là, tes fesses.
Max lui saisit les hanches et la repousse sur le côté.
– Me pousse pas. Sois sympa, steuplait. J’suis pas ton jouet.
– Non. Excuse, t’as raison.
Il se retire.
– T’as pas l’air dans ton assiette. C’est nul, là.
Max se redresse et soupire. Il ne se sent déjà plus très dur.
– On a enterré Papi Lucien ce matin. C’est peut-être ça qui me trotte dans la tête.
– Putain, Max, je t’ai dit justement que je préférais pas venir aujourd’hui. C’est toi qui as insisté. T’abuses.
– Non, mais je suis content que tu sois là. J’avais super envie de toi pendant l’enterrement.
– T’es vraiment glauque.
Elle passe sa main dans ses cheveux humides. Ses tétons pointent délicatement.
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– J’aime pas quand tu te plies comme ça. J’ai l’impression de pas être en toi. Je sens rien. Ma bite fait pas un mètre de long, non plus.
Clarice rabat ses jambes contre sa poitrine et s’adosse à la tête de lit.
– Pourquoi tu réponds jamais à mes questions ?
– De quoi tu parles ?
– De ma vidéo. Il en a pensé quoi ?
– On en discutera plus tard, c’est pas le moment.
– C’est jamais le moment avec toi. Sauf pour le sexe…
– C’est bon, grommèle-t-il.
Max se lève et passe son caleçon.
– Remets ta culotte, de toute façon mon père va pas tarder. J’veux pas qu’il nous surprenne.
– Tu l’as mise où ? demande-t-elle en rigolant.
– Sous l’oreiller, et ton soutif aussi. Tu veux une clope ?
Elle vient se serrer contre lui. Il perçoit l’humidité de ses poils pubiens contre le haut de sa cuisse. Elle lui mord doucement l’oreille.
– Dis-moi juste qu’on en parlera. C’est important pour moi. C’est ma vie, tu peux comprendre, je mise tout là-dessus.
– Tu mises tout sur cette vidéo ? plaisante Max en allumant sa cigarette par-dessus son épaule.
– Oui, parfaitement !
Il se dégage, tire une bouffée.
– Je lui ai envoyé l’enregistrement. Le format que tu m’as passé, franchement… Il a fallu que je la charge sur un logiciel pour tout retraiter. Ça m’a pris du temps. C’est un monde où chaque détail compte. Tu ne mesures pas ça, c’est évident.
– Ah mince, et c’était bon avec ton logiciel ?
– Ouais ! J’ai fait du bon boulot.
– Merci, grand geek.
Maxime enfile un futal et s’étire. Le ciel est gris, les nuages bien dodus, solides comme du fromage frais, chargés de neige. Il se frotte les yeux. Il déteste ne pas aller au bout, mais qu’importe, elle s’en fout Clarice, elle reviendra dès demain s’il lui demande. Avec elle, c’est simple. Il écrase son mégot contre le rebord du vasistas.
– Il a regardé l’enregistrement. Il m’a dit que t’étais parmi ce qu’il avait vu de mieux dernièrement. Il m’a parlé de charisme, de spontanéité aussi, je crois. Il t’a trouvée super, mais faut pas s’enflammer, il en a plein des vidéos de meufs mignonnes comme toi, alors il doit réfléchir.
Clarice n’en revient pas. Le beau-père de Max, un grand producteur hollywoodien, la trouve spontanée et charismatique. C’est inespéré.
– Tu dis ça pour coucher avec moi !
– Qu’est-ce que tu racontes ? On couche déjà ensemble. Si tu deviens une star, je pourrai me vanter de nos petites soirées enflammées. Tous les mecs veulent coucher avec des grandes actrices, j’ai tout intérêt à ce que tu réussisses.
– Je sais pas quoi dire…
Clarice éprouve soudain une sensation totalement inédite, au niveau de la nuque et des épaules. Plus qu’un frisson. Comme une piqûre chaude, puis anesthésiante. C’est plaisant et inquiétant.
Elle s’y voit déjà, sur des affiches, placardée dans des chambres d’ados, en une de Cosmo, Grazia, Glamour ou Closer. Elle imagine le plateau, la maquilleuse, les objectifs des caméras pointés sur son visage. Elle imagine des questions compliquées auxquelles elle répondrait par une pirouette ou une punchline digne des meilleures répliques de cinéma. Ou non, elle s’imagine rougir, bégayer, soupirer qu’elle ne sait pas, qu’elle ne sait rien. Elle se sent soudain très fragile. Elle attrape la bouteille d’Évian sur la table de nuit, boit deux grandes rasades.
Elle veut lui demander d’insister pour elle, de prévenir son beau-père qu’elle peut envoyer de nouveaux clips, qu’elle a un projet de bande démo. Il suffit d’emprunter du meilleur matériel, parce qu’avec un vieux smartphone, sans micro ni spot lumineux, le rendu fait franchement amateur, c’est certain. L’émotion l’empêche de parler, elle se sent comme asphyxier, Clarice ne parvient même pas à ragrafer son soutif.
Maxime le perçoit, cela lui fait plaisir de la voir si émue, de contempler les mérites d’un simple mensonge.
– Écoute, la prochaine fois que j’appelle ma reum, je lui parle de toi. Y a des castings à Paris aussi, il connaît du monde partout de toute façon, son mec. Ça te fera sortir de ta campagne, tu verras la grande ville. Ça te changera des champs.
– Merci… Tu peux m’aider, balbutie-t-elle.
Il clipse les crochets d’un mouvement souple, tire légèrement sur le glisseur en plastique, remet la bretelle bien droite pour qu’elle se colle sur la peau légèrement transpirante.
*
Quelques minutes après le départ de Clarice, la porte de l’entrée s’ouvre. Dominique dépose son bonnet bleu de l’A.J. Auxerre et ses gants sur la commode. Leur doublure en acrylique est imbibée de sueur. Il revient du match disputé à l’Abbé-Deschamps, transi.
– Alors ? demande Max.
– Un partout. Contre Lorient. On prend le but à la dernière minute, ça fait chier. T’as pas suivi ?
– Non, je révisais, avec ma camarade, Clarice, tu vois qui c’est ?
Le père range sa parka et défait les lacets de ses pompes, le cuir est dur comme du bois. Heureusement, durant l’hiver, il porte deux paires de chaussettes quand il va au stade, sans ça il finirait par perdre un orteil.
L’A.J.A. est encore relégable et même si jouer le maintien est un leitmotiv du club depuis son accession à l’élite, Dominique commence véritablement à se faire du mouron. Sa vie est assez inintéressante pour ne pas avoir, en plus, à se coltiner des matchs de seconde division. Sont-ils seulement diffusés ? Pas qu’il sache. Sans télé, ce sont les oubliettes qui attendent son club. Décidément, cette saison l’inquiète. Il ira acheter L’Équipe demain à la supérette, s’assurer qu’il a assisté au même match que le journaliste chargé de le résumer, à savoir une purge frustrante qui augure mal la relégation.
– T’as ramené Marine ?
– Ouais, elle a pris le train de 13 h 30, après j’ai retrouvé Thierry.
– Thierry était au stade aussi ?
– Oui, c’est sa deuxième maison, pour ainsi dire. On a bu un coup après le match chez lui, et voilà.
Dominique se sert d’ailleurs un fond de Label 5. La bouteille est à moitié vide, d’une couleur caramel trop claire. Elle lui a coûté à peine 13 euros, sans compter la réduction valable dès sa prochaine visite au Super U d’Avallon. À ce prix-là, un whisky est un whisky. Il en boit deux gorgées et s’assied en bâillant.
– Marine m’a fait une leçon de morale dans la voiture.
Il secoue ses doigts pour faire circuler le sang jusqu’à la pulpe des extrémités.
– Comme quoi, aller voir un match le jour de l’enterrement de Lucien, c’était pas une chose à faire. Que j’aurais dû inviter les personnes présentes aux obsèques à partager un moment de fraternité avec nous. De fraternité, elle a dit. Tu parles de conneries. Qu’est-ce que ça peut bien lui foutre ? Et puis, ce n’était que mon beau-père. Mon ex-beau-père, même.
Dominique porte son verre à ses lèvres, l’alcool sirupeux lui réchauffe la gorge.
– Elle est comme sa mère de toute façon, on n’est pas assez bien pour elle, reprend-il. Enfin, surtout moi. Tout est bon pour me le signifier. Même sans match, elle aurait trouvé quelque chose.
– Ça… Sans doute.
– Et puis merde, le Lucien il aimait le club aussi. Dix ans qu’il perdait la tête. Ces derniers mois, il ne disait plus un mot, elle le saurait ça si elle était venue le voir un peu. On est tristes, oui, on est tous tristes, mais pas abattus, ça, non. Il faut s’attendre à voir mourir les mourants, c’est la vie.
– Ouais, acquiesce Max en sortant les pâtes du frigo.
– Avec ta mère, elles se sont téléphoné. Tu le savais ? Marine me l’a dit, juste en sortant de la voiture. Tu parles, elle allait pas me le cacher. Tu le savais, toi ?
Dominique secoue la tête.
– Pas se pointer pour enterrer son vieux, franchement, faut le faire… C’est aussi bien, remarque.
– Ouais, répond Max machinalement en plaçant le plat de coquillettes gratinées dans le micro-ondes. C’est bientôt prêt, papa.
– Merci, mon lapin, j’ai besoin d’un plat chaud. Quel courant d’air, ce stade. La ligue a bien fait d’avancer le match, avec la neige qui commence à tomber. L’enterrement était réussi, j’ai trouvé.
– Oui, carrément. Je mange vite fait, j’ai des trucs à faire sur l’ordi.
– Vous avez travaillé quoi, alors, avec Clarice ?
– Surtout la philo. Le bac est dans quatre mois, faut s’y mettre.
– Quatre mois ? Ah oui, tu as raison. C’est bien, c’est bien, mon grand.
Dominique plonge sa fourchette dans le grand récipient en Pyrex. Des lianes de fromage pendent jusqu’à son assiette. En commençant à mâcher, il regarde son fils avec fierté. Depuis son divorce, il se fie tout entier à ce qu’il lui raconte. Il le croit quand il lui dit qu’ils ont révisé avec son amie. Dominique est convaincu que Max fera de belles études, comme sa sœur, mais qu’en sus, il ne prendra pas la grosse tête, et n’adoptera pas ce dédain parisianiste si insupportable. Se figurer les choses ainsi rend le logis vivable, la cohabitation plus douce. Tant pis si son garçon n’en fout pas une, et récolte des notes médiocres dans un lycée au niveau lamentable.
Si une vérité en vaut bien une autre, Dominique se range derrière celle qui le désigne encore comme un bon père. Il ajoute du sel, un tour de poivre du moulin. Il y a la bonne quantité d’emmental, c’est délicieux. Il allume la télévision. Jour de foot commence dans pile cinq minutes.
Après une annonce sur la série événement de Canal+, Kaboul Kitchen, le journaliste Messaoud Benterki présente les affiches du soir.
Surprise, Caen a gagné à Lyon.
– C’est quand même une saison étrange.
*
Stéphane l’attend sur le quai U de la gare de Bercy, un gobelet frappé Brioche Dorée dans la main droite. Dans la gauche, un pochon en papier, imbibé de graisse, contenant des viennoiseries. Il est arrivé en avance, comme à l’accoutumée. Il a froid.
C’est son petit copain depuis la première année de prépa et Marine espère bien qu’en tandem, ils décrocheront la lune, à savoir l’admission dans une école de commerce au nom ronflant, formant l’élite financière, entrepreneuriale et managériale du pays. Le mot élite est important. Ils sont convaincus d’en être. Cette appartenance justifie les journées qu’ils endurent, le traitement que leur infligent des professeurs sadiques, leurs belles années sacrifiées ; elle justifiera bien des choses tout au long de leur vie.
Marine a des bonnes notes, les concours sont dans deux mois et demi, ça devrait bien se passer pour elle. Stéphane ne se débrouille pas mal non plus, montre de-ci de-là quelques lacunes mais rien d’insurmontable. Surtout, il élabore pour le couple d’excellentes fiches synthétiques parfaitement structurées et instruites, ce qui en fait, en plus d’un amant tout à fait correct, un excellent camarade.
– Salut, chérie.
Il la prend dans ses bras, respire son odeur sucrée, les notes envoûtantes du parfum Magnetism d’Escada. Il l’embrasse dans le cou. Ils ne se sont pas vus depuis deux jours. C’est une anomalie dans leur relation tant les élèves de classe préparatoire vivent les uns sur les autres, pour travailler, se détendre, comparer leur réussite, partager leurs doutes, et baiser quand ils trouvent le temps.
– J’espère que tout s’est bien passé. Enfin…, Stéphane se reprend, que ce n’était pas trop dur.
– Ça a été, souffle-t-elle.
– Encore désolé pour ton grand-père.
– C’est bon, je te dis. Il était sénile.
– Ton petit frère va bien ?
– On s’est à peine parlé. Pourquoi tu me parles de lui à chaque fois ?
– Je sais pas, je l’aime bien. On s’est vus deux fois, mais j’ai eu l’impression que ça collait entre nous.
Le visage de Marine se déforme en une moue dubitative.
– T’as pu réviser dans le train ? Ce matin, j’ai fiché le cours d’histoire de jeudi, j’ai fait une photocopie pour toi. Tu veux toujours qu’on passe la journée de demain à la BNF ?
Une semaine cruciale s’annonce. S’y tiendra le dernier concours blanc avant les véritables épreuves, hors de question de sacrifier un dimanche sur l’autel d’un deuil familial, ni laisser Quarré-les-Tombes polluer son esprit. Marine a le mors entre les dents depuis le début de l’année. Bien sûr qu’elle ira à la bibliothèque le lendemain, qu’ils y passeront la journée, courbés sur des manuels, à se saouler de connaissances. La parenthèse funèbre est déjà refermée. Ce soir, ils ne coucheront pas ensemble avant de s’être enquillé deux exos de maths.
*
Les premiers flocons tombent doucement, la météo ne s’est pas trompée, la Bourgogne est tout entière en vigilance orange à partir de ce samedi soir. La neige va tenir au sol. Le mercure n’a pas dépassé zéro de la journée. Les écoles seront certainement fermées lundi et mardi, et les routes risquent d’être impraticables, surtout celles du Morvan qu’on ne déneigera qu’après toutes les autres. Le journal télé emploiera les termes « paralysie » et « pagaille », des automobilistes dormiront dans leur voiture et le présentateur, depuis son studio de Boulogne-Billancourt, ironisera sur le fait que chaque année une bonne partie de la France se fait surprendre. Ensuite, il lancera le sempiternel reportage sur les déneigeuses canadiennes qui raclent les rues de Montréal de décembre à mars, comme s’il y avait lieu de comparaison.
Clarice s’en fout, elle se sent giga bien. Peu lui importe que ses tempes soient piquées par le vent, que le froid s’insinue jusque dans la maille de son écharpe, que la grande nappe nuageuse vire au bleu profond avec la nuit qui s’installe. Elle n’a qu’une envie, qu’une pensée, tourner sa bande démo. Elle ne travaille pas demain et passera son dimanche à peaufiner le script. Elle verra ensuite pour acheter du meilleur matériel. Après tout, elle gagne quelques sous au salon de coiffure, quinze balles par jour de pourboires en moyenne, et puis elle n’a pas besoin d’une caméra hors de prix. Il y a des promotions au Darty d’Auxerre, elle a vu une pub sur un prospectus à la maison. Un caméscope Canon, combien ça vaut ? Deux cents euros, peut-être plus ?
Max aime moquer son matériel et sa méconnaissance des nouvelles technologies. Il se donne le beau rôle avec ses traitements logiciels, ça le rassure, il se pense utile, juge-t-elle. Il est chiant parfois, mais c’est tellement formidable qu’il ait envoyé ma vidéo à son beau-père…
Clarice ne se rend toujours pas compte. Elle n’y connaît rien, n’est jamais allée aux États-Unis, ne sait pas comment les gens vivent à Los Angeles, ignore ce que c’est un producteur hollywoodien, combien ça gagne, comment ça occupe son quotidien, comment ça dort, ça parle, ça mange. Elle suppose tout de même qu’il s’agit d’une personne importante, sans temps à perdre. Max lui fait une sacrée fleur. C’est une véritable et puissante preuve d’amour, songe-t-elle. Clarice sourit. Spontanée et charismatique, qu’il a dit, ça ne s’invente pas.
Même s’il la traite parfois avec distance, même s’il peut être dur et rabat-joie, elle éprouve des sentiments forts pour Maxime. Elle est amoureuse. C’est son premier copain, le premier avec qui… Pour une fille, ce n’est pas rien. Elle s’arrête pour secouer son écharpe constellée de frimas. En fondant les flocons coulent en fines traînées jusque dans son dos. Quand ils se sont rencontrés, elle était en troisième, lui en seconde, c’était vraiment cool de se taper un lycéen. Ses copines étaient mortes de jalousie. De toute façon, Clarice s’est toujours sentie plus mûre que les filles de son groupe. Que diront-elles quand elle sera à l’affiche d’un film ? C’est fou d’être si différente, quand elle y pense.
Cela fait deux ans qu’elle le retrouve chez lui, certains soirs après sa journée au salon, quand il rentre de ses cours et que son père est absent. Des week-ends aussi. Ils baisent essentiellement. Ne sortent guère ensemble, ne vont jamais marcher dans le centre d’Auxerre ou d’Avallon, ni même d’ailleurs boire un Pago sur la place de l’église de Quarré-les-Tombes. Ne vont pas au ciné ni au Do-mac comme les couples normaux, ne discutent pas des masses non plus. Leur relation s’est développée autour de leur entente sexuelle, chacun exécutant les gestes avec plus d’assurance, jusqu’à expérimenter de nouvelles combinaisons que l’un ou l’autre puise dans l’insondable inventivité des sites pornographiques.
Elle est heureuse ainsi ; le reste viendra avec le temps.
La route se couvre d’une fine pellicule blanche. Clarice accélère le pas, elle est bientôt chez elle. Dans ses cheveux, la neige se fixe et fond lentement. Une légère fumée s’élève au-dessus de son crâne, en volutes élégantes. Si elle reste dehors encore cinq minutes, elle tombera malade, c’est sûr. Heureusement, elle dépasse déjà le portail sur lequel la plaque signalant la présence d’un chien méchant branle sur un côté. Évidemment, les Malcuit n’ont jamais eu de molosse, tout le village le sait. Mais son père y tient à cet écriteau. Il prétend que si des manouches voulaient les cambrioler, ça les dissuaderait. L’allée de pavés autobloquants gris s’est mouchetée à son tour. Clarice manque de glisser, se rétablit. Elle tourne la clef, pousse la porte, puis tape ses Pataugas sur le paillasson.
« J’suis là », crie-t-elle depuis l’entrée, tout en pendant son écharpe à un cintre.
Ses parents regardent 50’Inside, sur TF1. C’est une bonne émission. Divertissante et documentée. La famille a pris l’habitude de ne pas la manquer, l’érigeant en rituel du samedi soir.
Sur l’écran plat, acheté avant la Coupe du monde de rugby 2011, après le reportage retraçant la success-story de Bruno Landisier, un jeune Français audacieux devenu producteur influent à Hollywood, Sandrine Quétier interroge Loana. La star du Loft sort tout juste de l’hôpital après avoir tenté de mettre fin à ses jours pour la quatrième fois.
– Elle est méconnaissable, soupire la mère de Clarice.
– T’as passé une bonne journée ? demande le paternel sans quitter l’écran des yeux.
– Ouais, ça va, dit Clarice. J’étais chez Sarah.
– Ah ? Super ! Comment va-t-elle, la belle Sarah ?
– Bien, bien.
À la télévision, Sandrine Quétier, jambes croisées, veste noire sur top rouge : « Donc là, quand vous regardez devant vous maintenant vous avez des projets, expliquez-moi un petit peu. »
Loana, crinière platine, peinant à articuler, mais radieuse : « Je vais être chroniqueuse sur une chaîne câblée, faire une émission sportive, écrire mon livre sur… sur les dix dernières années. Donc ça va être tout ça. »
Sandrine Quétier : « Alors qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter maintenant, Loana ? »
Loana, souriante : « Que je rencontre le grand amour. »
Sandrine Quétier, adoucie, connivente : « Bah, écoutez, je vous le souhaite… »
– Tu vois, ma fille, toi qui aspires à la notoriété… Ça n’a pas l’air drôle tous les jours, souffle le père.
– La téléréalité ce n’est pas pareil, reprend la mère. Ces gamins, ils ne sont pas préparés à toutes ces choses qui leur tombent dessus, toutes les sollicitations. Ils deviennent stars du jour au lendemain… Pauvre Loana, c’était une fille charmante. Une carrière, ça se construit.
La mère ne sait pas trop ce que cette dernière phrase signifie. Elle a toujours cru en la réussite de sa fille et ne veut surtout pas la décourager avec ces histoires de gosses abîmés par la télévision.
– Et puis franchement, tous ces jeunes qui se montrent dans leurs émissions idiotes, avaient-ils quelque part une chance de connaître un avenir meilleur ? ajoute-t-elle, songeuse.
Clarice s’essuie les cheveux. Elle hésite. Elle veut garder son secret pour elle, ne rien dire du casting que Max lui a évoqué, ni mentionner que sa dernière vidéo de promotion fait son chemin à Hollywood. En même temps, elle crève d’envie de tout déballer. Elle tergiverse. Son père ferait sans doute le trouble-fête, comme à chaque fois. Sa mère se tairait, contente et envieuse. Elle saisit son téléphone, elle racontera tout cela à une amie.
– Je vais prendre une douche, on mange quoi ? demande-t-elle.
– Des croque-monsieur maison ! Papa en avait envie, et avec ce froid ça nous fera du bien de manger quelque chose de consistant.
– OK ! s’écrie Clarice, en montant à l’étage.
*
Le Big Tex propose une combinaison gourmande de deux enchiladas fourrées au jack cheese et de deux tamales au porc, recouvertes de chili con carne, accompagnées de riz et de haricots rouges. C’est le plat le plus riche de la carte d’El Guapo’s, un restaurant mexicain de Tulsa, métropole de l’est de l’Oklahoma. Bruce Taskys commande généralement la version trois piments et agrémente la recette de quelques gouttes de Tangy Jalapeno de la marque Heinz. Il s’assure ainsi que le plat lui arrache bien le palais. Il s’installe à une table située sous un cactus de néons verts et jaunes dans l’épiderme duquel clignote le nom d’une marque de cerveza. Les galettes de maïs baignent dans une sauce tomate mêlant délicieusement les saveurs du fromage, du sucre, des épices, de l’huile et de la viande. Bruce éponge la mélasse avec des tortillas chips saveur cheddar, ramollies au micro-ondes. Entre deux bouchées, il aspire une rasade de limonade industrielle glacée. Elle a un goût de liquide vaisselle mais la sensation de fraîcheur n’en est pas moins incroyable.
Dès qu’il aura terminé, il ira se poster devant le cinéma, passera tout l’après-midi dehors, dans la queue, pour s’assurer une place de choix. Le frère de Tyler a même juré l’autre soir qu’il serait le premier à entrer dans la salle, quitte à planter sa tente devant. Quel cirque ça va être, songe Bruce.
L’événement est d’ampleur ; la séance est tant attendue qu’elle a été reportée au samedi soir pour ne pas faire concurrence aux autres films qui sortent traditionnellement le vendredi aux États-Unis. Tous les jeunes du pays attendent le dernier volet de The Last Fighters, sous-titré The Survival of the Void, « la survie du vide ». CNN, Newsworld International et Fox ont dépêché des reporters devant des salles importantes du pays, El Captain et le Grauman’s Chinese Theatre à Los Angeles, le Coliseum et le Ziegfield Theater de New York et même dans le parc à thème Douglass’ World à Orlando, lequel prépare le mois prochain une attraction autour de l’univers de la saga. Des T-shirts et des masques à l’effigie des protagonistes sont en vente dans les rues commerçantes et les malls. Le pays tout entier retient son souffle. C’est à peine si les chaînes d’info évoquent encore les caucus du Minnesota et du Colorado, ou la récente victoire de Mitt Romney lors de la primaire du Nevada.
Un an, sept mois et vingt-deux jours que la scène finale du deuxième épisode – The Last Fighters, Burst of Heavenly Thunderstorm, « l’éclat de l’orage céleste » – s’est achevée sur la chute certainement mortelle de Kate « Angel Face » Swelton, dans un gouffre quadratique créé par un sbire d’Alktor, le démon solaire. Depuis, tout le monde ne pense qu’à une chose : la vengeance des derniers héros, en particulier celle de Neutron, devenu redoutable depuis son accession au grade de gardien stellaire. Des images de la bataille finale entre les quatre démons et les héros ont fuité sur la toile. Même si Bruce a tenu à ne rien regarder, il a entendu dire que les effets spéciaux n’avaient aucun égal, dans aucun autre film, dans aucune autre saga, pas même dans les meilleurs X-Men.
Il passe une serviette en papier sur son front. La version trois piments du Big Tex, c’est quelque chose.
Au milieu de la deuxième enchilada, Tyler se pointe. Il porte un bonnet du Thunder, un sac à dos Nike, un sweat à capuche duquel dépasse son maillot de Kevin Durant, bleu, numéro 35. Ses parents lui interdisent de porter ses habits de basket-ball au lycée, alors il se rattrape le week-end, en multipliant les logos à l’effigie de la franchise de l’Oklahoma. Les Kings de Sacramento ont battu OKC la veille, 106-101. C’est pénible, mais ça n’enlève rien à l’excellente saison de l’équipe, qui truste les premières places de la conférence ouest avec un KD en mode MVP. Ce soir, Tyler manquera le match contre l’Utah Jazz ; il s’en fiche, lui aussi attend depuis des mois l’épilogue de la trilogie.
– Salut Bruce. T’as pas fini ? Ça te dérange si je prends des tacos au poulet, rapidement ? On n’est pas en retard de toute façon.
– Non c’est bon, t’as le temps, répond Bruce.
Tyler mange à cent à l’heure, c’est à peine s’il prend le temps de mâcher. Cela explique sa drôle de carrure, son ventre gonflé, campé sur deux jambes fines et droites. »
Extrait
« À chaque nouvelle attaque, les victimes passées du terrorisme se voient remettre le nez en plein dans la merde qu’ils ont vécue, et dont la majorité d’entre eux n’est jamais sortie. Le 11 septembre 2001 se vit en mondovision comme une finale olympique. L’excitation des téléspectateurs est au moins aussi intense. Un savant allemand a qualifié cette journée de premier événement mondial historique au sens strict.
Ben Crawford à Los Angeles, Jessica Dahlgren à Paris, Cándido Rincón dans sa loge de gardien de l’Arroyo Blanco, Isabelle et Dominique Richard à Quarré-les-Tombes, Lucien Michot sur son canapé, William et Lucy Smith dans le matin de l’’Oklahoma, Bruno Landisier quelque part sur la route d’un festival du film ou sur un plateau de tournage, tous reçoivent un flux d’ondes décrivant la trajectoire d’hommes se jetant d’une tour en flamme pour s’écraser à une vitesse folle sur la dalle new-yorkaise. Aucun ne peut détourner le regard ni éteindre son émetteur radio. Aucun ne comprend complètement ce qui se déroule. Aucun n’ose y croire. p. » p. 261
À propos de l’auteur
 Édouard Jousselin © Photo DR
Édouard Jousselin © Photo DR
Édouard Jousselin est né à Montargis en 1989. Après Les cormorans (2020), son premier roman, il publie La Géométrie des possibles (2024). (Source: Éditions Rivages)
Compte X (ex-Twitter) de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur

Tags
#lageometriedespossibles #EdouardJousselin #editionsrivages #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

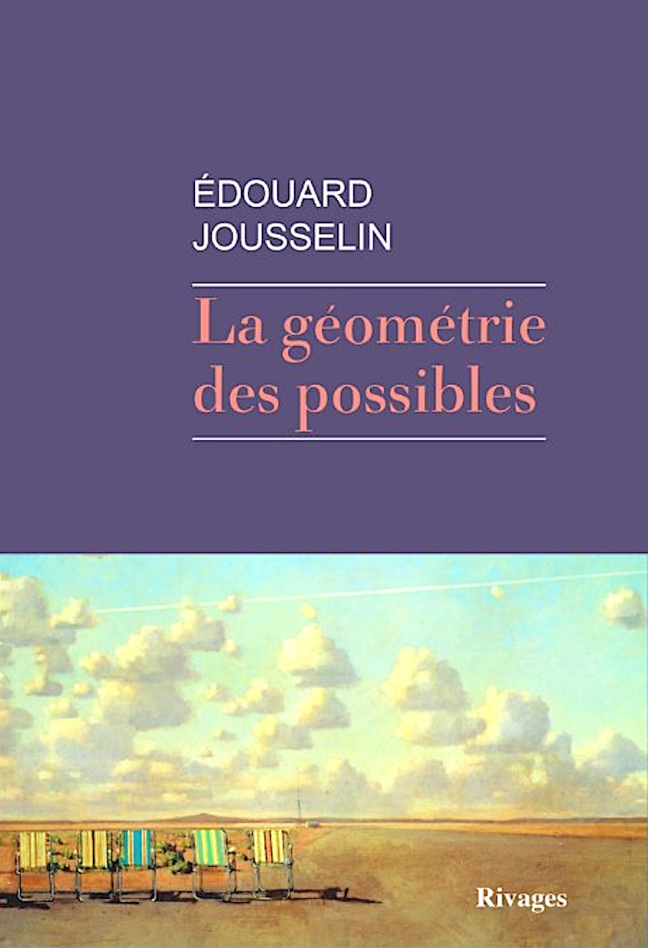









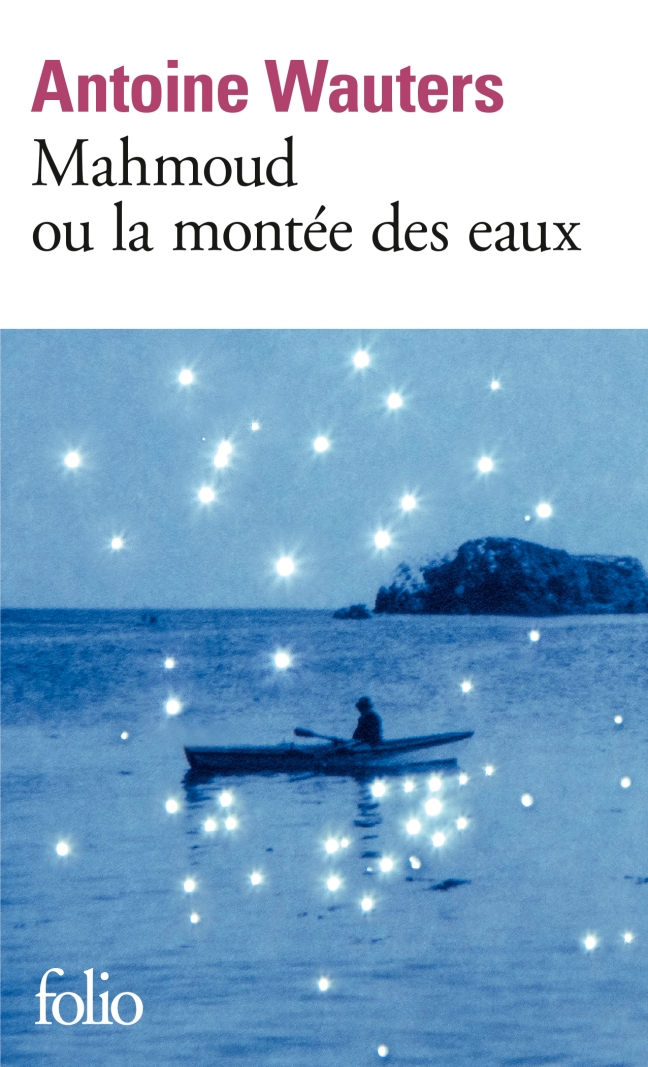



 Jean-Marc Parisis © Photo Astrid di Crollalanza
Jean-Marc Parisis © Photo Astrid di Crollalanza







 Karine Tuil © Photo DR
Karine Tuil © Photo DR


 Philippe Djian © Photo Witi de Tera
Philippe Djian © Photo Witi de Tera


 Julie Ruocco © lio-photography
Julie Ruocco © lio-photography



 Antoine Wauters © Photo DR – Lorraine Wauters
Antoine Wauters © Photo DR – Lorraine Wauters




