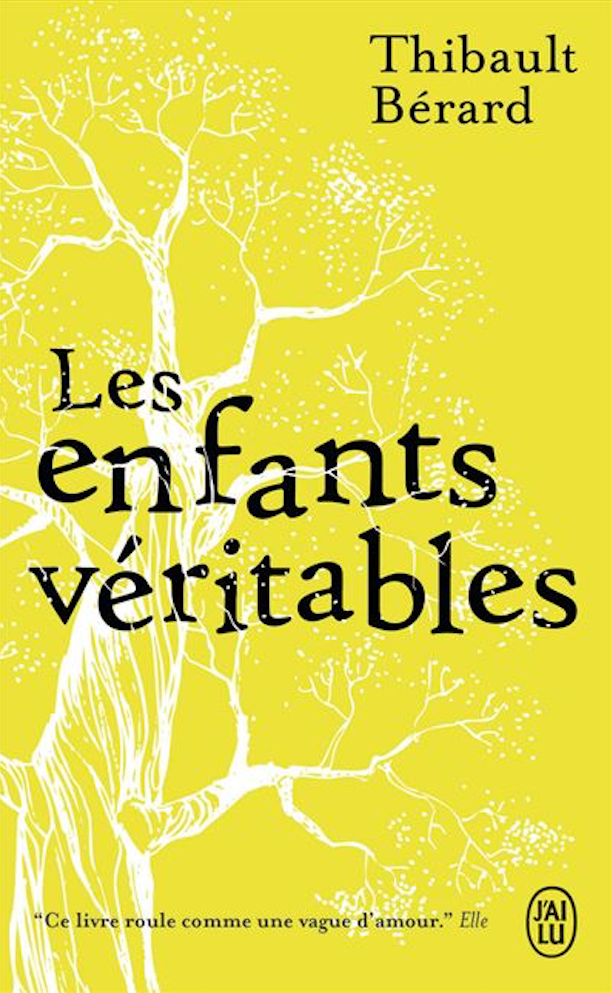

En deux mots
Théo se remet du décès de son épouse et tente de se reconstruire avec ses enfants Simon et Camille. Quand il rencontre Cléo, elle cherche à s’émanciper de ses parents, mais aussi de sa fratrie. Une famille composée et recomposée qui, dans un tourbillon d’émotions, demande beaucoup d’engagement et de ténacité pour survivre.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Si vous voulez en savoir plus…
Ma chronique complète publiée lors de la parution du roman en grand format : Les enfants véritables
Les premières pages du livre
« MAMAN PAR ACCIDENT (CAMILLE)
— Diane —
Les enfants véritables
11 juin 1995
— Mais Papa, on est d’accord, c’est moi ton enfant véritable ?
Paul sourit sous son bonnet. « On est d’accord. » Cette gamine, elle ne s’arrête jamais. Va savoir où elle est allée chercher cette histoire d’enfant véritable… Peut-être sur le dos d’un livre, dans la bibliothèque ? Ça lui dit vaguement quelque chose. De sa main gauche, il serre plus fort le morceau de bois qu’il sculpte et, de l’autre, il jette trois coups de canif rapides sur l’écorche tendre, afin de se donner une idée de la forme voulue, pour plus tard. Entre ses doigts de bûcheron, la figurine paraît minuscule… Il la fait tourner un moment sous le soleil d’été, devinant du coin de l’œil les montagnes qui les entourent, lui et sa fille. Sa Cléo.
Cléo s’est juchée sur un rocher plat bien chaud, au-dessus de lui, ses chaussures de randonnée délassées dans l’air – elle les agite comme deux petites balles au bout de ses mollets rondelets, pour faire sentir à son père qu’elle est impatiente d’entendre sa réponse. Il parle peu, elle le sait, mais quand les mots viennent, il faut se tenir prête. Car les choses qu’il dira, elle ne les entendra de personne d’autre.
Et certainement pas de moi. C’est-à-dire sa mère. Je ne suis pas dans le paysage, ni au sens propre ni au figuré : en ce moment, je dois me trouver quelque part entre Paris et Trouville, enfin à plusieurs centaines de kilomètres du petit village perdu dans la vallée de l’Ubaye où Paul élève notre fille.
Du reste, même si j’avais été physiquement présente, comme cela m’arrive quatre ou cinq fois par an (avec, à bien y réfléchir, une certaine régularité dans la saisonnalité de mes retours au foyer), je resterais étrangère au monde intérieur de Cléo. Je n’en suis pas fière – comment le pourrais-je –, mais je me targue au moins d’être lucide. Tout comme elle, du reste. Du haut de ses sept ans, elle a très bien compris qu’elle avait un père-chêne, sur lequel elle peut s’appuyer pour grandir, et une mère-herbe-folle, dont elle ne peut que suivre du regard les gracieux envols et les atterrissages en catastrophe, sans espérer beaucoup plus qu’une conversation sur le dernier roman qu’elle a lu ou des conseils sur la façon de se tenir à un dîner. Pour ce que Cléo connaît des dîners…
Je ne peux certainement pas dire que ma fille me comprenne ; à son âge, ce serait impossible. Et puis, me comprendre, c’est la spécialité de Paul. Tout, de ses bras immenses lorsqu’ils s’ouvrent pour encore une fois me recueillir à son front qui reste droit comme pour m’indiquer qu’il n’attend pas d’excuse ni même d’explication, semble dire cela de lui : Paul accepte tout, comprend tout, les bonnes et les mauvaises surprises de la vie – et cette femme bizarre qui est la sienne.
Je me dis parfois que, s’il avait eu le choix, il aurait préféré tomber amoureux d’une autre que moi, une personnalité plus à son image, stable, fiable ; mais voilà, ça ne s’est pas présenté ainsi.
En pur montagnard, Paul sait que la seule manière de survivre à un environnement hostile est de s’y adapter.
Contrairement à moi, sa fille n’a rien d’un environnement hostile ; aussi, s’adapter à elle ne lui cause-t-il aucune difficulté. Avec des gestes lents (la petite le soupçonne d’en faire un peu trop, pour coller à son image de Levine sculpteur), il repose la figurine de bois entre ses pieds nus, orteils en éventail.
Il a choisi de s’asseoir dans ce trou d’ombre, sous le rocher où trépigne sa gamine, pour la qualité de l’herbe qu’il offre ; cela lui fait un coussin de verdure acceptable pour travailler. Il n’aime rien tant que façonner au milieu de ses montagnes.
Un soupir, très doux. Il regarde ses mains, ses grandes mains qui le font vivre et lui permettent d’assurer la subsistance de son foyer, entre travaux de charpente, bidouillages divers, maçonnerie fine et traite des brebis, sans oublier la modique somme qu’il perçoit en tant que pompier volontaire. Il les regarde longtemps, ces mains dont il dépend, et puis il dit :
— « Véritable », qu’est-ce que ça signifie, selon toi ?
Cléo lève les yeux au ciel. Dans sa tête, du matin au soir, elle passe son temps à faire des paris.
Si je vois une marmotte, il y aura de la tarte aux mûres pour le dessert.
Si le voisin vient nous emprunter des œufs, l’école sera fermée demain.
Si je pose une question à Papa, il répondra d’abord par une autre question.
Elle attend, docile.
Pour tout ce qui compte, Paul est une personne assez irréprochable, mais je suppose que notre petite Cléo pourrait trouver qu’il lui fait un peu trop souvent gagner ce dernier pari avec elle-même. Au-delà du fait que ça la met en colère, cela vient précisément contrarier l’un des rares traits de caractère qu’elle tient de moi : son goût de l’inattendu. Sa passion pour l’aventure – celle qui l’attend peut-être, partout, au saut du lit, quelque part dans ces montagnes qu’elle connaît par cœur mais aussi, pourquoi pas, bien au-delà, « par-delà les vallées et les montagnes », comme disait ce conte que lui racontait son père !…
— Papa ! se contente-t-elle de dire d’un air faussement fâché, sachant bien que cela suffira.
Et en effet, ça suffit : Paul réprime un rire sec, une sorte de hennissement tranché à la racine, et plaque ses deux mains sur ses cuisses. En pensée, Cléo gagne un nouveau pari, mais celui-là la ravit : Si Papa pose les mains sur ses cuisses, il dira les choses que personne d’autre ne dit. La vérité, en somme.
— Cette famille compte trois enfants, Cléo, tu le sais. Et je peux t’assurer, gredine grenadine, que ton frère et ta sœur sont tout aussi « véritables » que toi.
Elle fronce son nez rond en signe de désapprobation muette. Cléo n’a rien d’une rebelle, et il ne lui viendrait jamais à l’esprit de s’opposer à son père, qu’elle vénère. En revanche, à vivre toute l’année dehors comme, disons, une sauvageonne, elle n’a guère l’habitude de camoufler ses impatiences.
Paul s’en rend compte, bien sûr ; il a choisi d’entrer dans le sujet en enfonçant la première porte ouverte, et il se doutait que Cléo s’en irriterait. Mais il feint de ne rien voir, sachant qu’il a le temps avec lui. C’est sa plus grande force : il a appris, Dieu sait comment, à faire du temps un allié. J’avoue que ce secret-là, j’aurais aimé le mettre en bouteille pour mes vieux jours, moi qui ai tant perdu de temps.
Mais chut, Paul reprend :
— Si tu dis « véritable » parce que c’est de mon sperme que tu es née, je ne peux pas te contredire, reprend-il de sa voix calme. C’est bien de moi que ce sperme est sorti, un jour que je faisais l’amour avec Diane, c’est-à-dire ta mère, et c’est dans l’ovule de ta mère qu’un spermatozoïde est allé se nicher, pour…
— Papa !
Ce « Papa » est différent du précédent. J’y perçois de la Cléo enjôleuse, cette fois, ou du moins théâtrale – ce qui, forcément, m’intéresse au plus haut point puisque cela nous fait un autre lien possible. Elle feint la gêne, et même l’agacement, pour ne pas dire ce que hurlent ses mignonnes chaussures délassées en se balançant en rythme avec le vent du soir : qu’elle est terriblement fière d’avoir un père qui l’éduque de cette manière-là, sans jamais rien lui cacher des choses de la vie, un père brut de fonderie. Quand elle évoque des sujets d’adultes, ses copines de l’école lui paraissent tellement gourdes, en comparaison !
Paul ne ment pas. Dire « jamais » serait excessif, cependant – mais nous y reviendrons.
— Bon, tu as compris ce que je veux dire. Donc, si c’est ça que tu entends par « véritable », alors d’accord, tu es la seule. L’unica, comme aurait dit ton grand-père !
Dans l’élan, il donne libre cours à cette joie de vivre qu’il porte en lui comme un trésor trop précieux pour être fréquemment dévoilé, se mettant à chanter de sa voix de marbre « Figlia ! Mio Padre ! » sur l’air de Rigoletto, un opéra qu’il adore depuis toujours. Main sur le cœur, il envoie à sa princesse des hauteurs quelques tonnantes bouffées de tendresse, jusqu’à ce qu’elle capitule en éclatant de rire.
— Voilà, reprend-il. En revanche, si, avec ton « véritable », tu emploies le mot pour ce qu’il est, comme un marteau qu’on utilise comme un marteau et rien d’autre, alors je dois te dire, ma fille, que tu te mets le doigt dans l’œil ». Et même pire !
— Je voulais juste dire…
— Je comprends ce que tu voulais dire. Maintenant, explique-moi : comment une petite tête si bien faite peut-elle abriter une question aussi stupide que celle qui consiste à savoir si elle est ma véritable enfant ? C’est une question à récolter une gifle, ça !
Ah, mon Paul. Je l’aime encore plus quand il tend ces piteuses tentatives de pièges, embuscades si naïves pour qui le connaît un peu et sait donc qu’il est incapable, parfaitement incapable, de la moindre violence envers sa fille…
La posture, il faut l’admettre, est soignée : sous ses sourcils fournis, ses yeux ont viré au noir et il a levé un long doigt de prêcheur vers le ciel, bandant au passage les muscles de son bras. Il est si colossal qu’on le croirait capable de fendre un fragment de la montagne d’une pichenette. Non, vraiment, c’est bien imité.
Tout au fond d’elle-même, Cléo sait que c’est du chiqué, mais ma fille est tout sauf idiote et, si elle ne peut pas soupçonner sérieusement son papa de la menacer d’une gifle, elle est très consciente du fait qu’une certaine brutalité vit en lui, menant une existence indépendante de la sienne, comme un feu qui couverait sans qu’on ait besoin de l’alimenter – et, surtout, sans qu’on puisse espérer l’éteindre. Gare à qui l’éveillera !
Aussi Cléo s’est-elle crispée sur son rocher plat, secouant la tête et faisant voleter du même coup ses bouclettes, ce qui ne manque pas de charmer son grand nigaud de père.
Lequel se radoucit aussitôt.
Il ramasse sa statuette, la brosse d’un nouveau coup de canif et dit :
— César est mon enfant véritable tout autant que toi, et tu n’es pas plus mon enfant véritable que Solène. Vous êtes tous les trois ce qui rend ma vie plus belle, et ce qui lui donne à la fois son sens et sa direction – c’est-à-dire sa vérité. Tu comprends ça, jeune fille myrtille ?
Cléo hoche la tête en mesure, même si je doute qu’elle ait bien suivi la fin de la phrase. Il faut dire que quand son propos s’aventure soudain sur ce genre de chemins de traverse, Paul est proprement déroutant. Nombreux sont ceux, au village, qui le prennent pour une simple brute douée de ses mains, voire qui le croient doté d’un talent d’origine plus ou moins surnaturelle… À mon avis, ils sont loin du compte : si Paul peint et sculpte avec autant de grâce, c’est parce que son esprit ne reste jamais en repos, jamais, et que c’est bien son esprit qui conduit sa main. Cet esprit peut paraître assoupi dans le refuge de son corps massif et calme, mais c’est un leurre.
Après tout, il fallait une belle dose d’intelligence à Paul pour apprivoiser César comme il l’a fait. Qui d’autre y aurait réussi ?
Cet enfant… C’était une ombre, un chat pelé. On ne pouvait pas le comprendre. Je n’aurais certainement pas pu. À partir du moment où il a commencé à tourner autour du chalet – à bonne distance, bien sûr –, je l’ai pris en grippe. Il avait sept ans, huit peut-être, des vêtements sales et déchirés, une silhouette un peu tordue. Il nous épiait, il venait voler des objets sur notre terrasse, il coulait sa carcasse jusque sous nos fenêtres et, dès qu’on le surprenait, il filait à toutes jambes.
Et puis il revenait. C’était juste avant que je ne tombe enceinte de Cléo ; à cette époque-là, j’étais plus sédentaire, et je pouvais rester presque toute une année aux côtés de Paul sans qu’il ait à redouter de trouver à l’aube un mot sous son oreiller, ma petite valise rouge envolée et moi avec.
Étant plus présente, j’avais aussi moins tendance à lui abandonner les rênes. J’ai essayé de savoir ce que nous voulait ce gamin, dont la vision m’inspirait presque de la répulsion. Je l’appelais, il s’enfuyait. J’en suis venue à le menacer d’appeler les gendarmes s’il continuait à nous importuner.
Oui, c’est ce que j’ai fait. Je ne suis pas quelqu’un de très bien, voyez-vous, et à l’époque c’était pire, bien pire qu’aujourd’hui. Du moins je l’espère.
Le petit, étonnamment, ne répliquait même pas à mes assauts. Il se contentait de m’opposer ce visage idiot, au regard vague et aux traits crispés par quelque terreur aveugle, avant de filer. Pour revenir le lendemain.
Paul, lui, ne disait rien. Il regardait aller et venir ce tout jeune garçon bizarre sans tenter quoi que ce soit. Il l’observait.
Un soir que, l’ayant vu surgir d’un buisson, je m’élançais pour le chasser, Paul m’a arrêtée d’un geste ferme. Il a souri. Il s’est tourné vers le garçon. Il a fourré ses mains dans ses poches, et il s’est mis à siffloter en marchant dans sa direction.
Comme si c’était très drôle, ce qui se passait. Comme si c’était l’occasion d’une bonne blague.
Et cela a suffi à mettre le petit César en confiance. Lui qui paraissait incapable de nouer un contact humain, et dont les yeux roulaient comme des billes dès qu’on cherchait à capter son attention, a observé Paul avec une expression calme, concentrée, qui m’a surprise.
Puis, sans le lâcher du regard, César s’est assis sur le tertre bordant notre chalet. Hypnotisé par l’air joyeux qui sortait des lèvres de mon homme.
Paul, toujours sifflotant, s’est installé à ses côtés.
Je n’ai jamais su ce qu’ils se sont dit, mais Paul m’a appris ensuite que le gamin vivait plus haut dans la montagne, seul avec son père, un ivrogne qui le maltraitait. Au fil de ses venues, il avait repéré notre chalet et, un soir, il avait entendu Paul jouer de l’harmonica.
— Et ça lui a donné envie de vivre dans une maison où on joue de l’harmonica, a conclu Paul.
Comme si c’était d’une logique implacable.
Moi, ça ne me paraissait pas du tout logique. Mais je n’étais pas au bout de mes peines, puisque je n’avais même pas compris que, par cette simple phrase, Paul venait de me signifier sa décision de prendre sous son aile cet oisillon déplaisant. Le gamin est venu nous rendre visite de plus en plus souvent, nous imposant sa vilaine mine et ses piaillements de souris. Il s’est assis à notre table, a partagé nos repas, a dormi parfois dans la couche que Paul avait aménagée pour lui.
Et quelques mois plus tard, quand l’ivrogne est mort au milieu de ses bouteilles, là-haut dans son antre répugnant, César est resté avec nous, tout naturellement. Très logiquement, disons. Selon la logique de Paul.
Moi, je suivais.
Pour dire la vérité, ça n’a pas été tout à fait aussi commode que cela – et je dois même ajouter que j’ai ma part de responsabilité dans l’adoption de César, même si c’était bien ma dernière intention. Je le voyais venir, mon Paul, avec sa manie de considérer le monde comme un endroit simple où les choses logiques se déroulent sans encombre, alors j’ai mis mon grain de sel, en lui rappelant que la toute première urgence était de contacter les services sociaux. Dans mon esprit, c’était une excellente manière de me débarrasser du problème sans en avoir l’air : on allait lui trouver un oncle ou un cousin oublié, à ce pauvre môme… Je n’aurais plus qu’à rappeler à Paul que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu’on veut.
Sauf que mon plan s’est retourné contre moi, et en beauté : l’assistante sociale qui a fini par débarquer nous a expliqué que le vieux n’avait aucun lien de parenté avec aucune personne vivante, rien, pas un chat, pas une ombre nulle part à la ronde ; et que pour tout dire, le cas de ce César était une embûche administrative dont elle se serait bien passée ; et qu’au fond, dans un petit village comme celui-là, on pouvait toujours s’arranger autrement, « flouter les lignes » en évitant que ça ne remonte trop haut dans les archives nationales, surtout quand quelqu’un d’aussi remarquable que Monsieur Paul Belcore, respectueusement surnommé « le peintre » par les villageois, pompier volontaire, offrait de devenir le tuteur légal de l’oisillon…
Bref, en moins de temps qu’il n’en a fallu pour le dire, et contre tout ce que j’avais cru savoir de l’administration française, l’affaire était pliée et le gosse à nous – enfin, à Paul. L’assistante a cru bon d’ajouter qu’on n’aurait pas à craindre de visites trop régulières de ses supérieurs.
J’ai laissé faire. J’avais d’autres soucis en tête, de toute façon : j’étais enceinte jusqu’aux yeux, et à ce moment-là…
Eh bien, je me dis souvent que j’aurais dû anticiper ce qui est arrivé. Que j’avais suffisamment d’éléments pour m’en douter. Mais, je ne sais pas, peut-être qu’on ne peut jamais prévoir ce genre de chose ? Les gens comme moi, les femmes comme moi, on se ment, dans cette situation, parce qu’au fond de nous, on aimerait tellement que ça fonctionne ! On rencontre un homme, c’est notre homme. Le désir d’être mère ne vient pas, mais on se dit qu’il faut parfois provoquer les événements pour qu’ils adviennent. J’étais tombée enceinte très facilement, en plus, et j’y avais vu le signe que, contrairement à ce que je sentais dans mes tripes, j’étais moi aussi faite pour être maman.
Et puis l’échéance approche, et rien ne change. Plus que deux mois, plus que quatre semaines, trois, plus que deux et on se ment toujours plus, on essaie de se rassurer, on se répète que rien n’est fatal ou définitif, que c’est le bébé qui, une fois là, fera de nous une mère. Voilà, oui : ce sera évident, limpide et désarmant, parfaitement naturel, et la lumière de notre rencontre chassera ces fichus démons qui nous rendent la vie impossible !
On s’accroche à cette image superbe, libératrice, de l’évidence qui s’impose. Après tout, combien de femmes se sont découvertes mères à l’instant précis où elles ont posé les yeux sur leur enfant ?
Je suppose que je comptais sur une épiphanie de ce genre. Ma réaction à la présence du chat pelé dans notre maison n’avait rien eu pour me rassurer, mais je me disais que ce serait différent avec mon enfant, mon enfant véritable.
J’avais tort. Trois mois après la naissance de Cléo, j’ai repris ma valise rouge après avoir laissé un mot sous l’oreiller de Paul. Je l’imagine très bien le lisant à la lueur du petit matin, tandis que notre bébé coassait dans son berceau, à côté de lui. Je le vois soupirant, seul dans son chagrin discret, une pensée navrée pour sa femme impossible, incapable de tenir en place.
Il savait que je reviendrais, c’est sans doute ce qui lui a évité de devenir fou de rage – même si c’est précisément cela qui aurait déchaîné la colère de tout autre. Mais Paul était décidément exceptionnel. Et même si j’ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il m’aimait à ce point, c’est un fait indéniable : il m’aimait plus que personne ne m’a jamais aimée. Alors qu’il me connaissait mieux que personne.
Comme il l’avait prévu, je suis revenue.
Quinze mois plus tard.
Enceinte de Solène, chose qu’il n’avait sans doute pas prévue. »
L’avis de… Sandrine Mariette (ELLE)
« Il n’y a pas d’âge pour les questions sérieuses ni pour la vérité. Du haut de ses 7 ans, Cléo, petite renarde des montagnes, au cœur généreux qui la porte à embrasser tout ce que lui offre la vie, cuisinerait bien son père « sur sa place » dans la famille : « Mais Papa, […] c’est moi ton enfant véritable ? » Paul lui explique que son frère et sa sœur sont aussi ses enfants « véritables ». C’est lui qui emploie toute son énergie à les élever, car Diane, la mère et narratrice, comédienne, part, revient, mais ne reste jamais. Alors Thibault Bérard lui donne la parole pour raconter Paul, son homme, César, son fils adoptif qui lui faisait peur, Solène et Cléo, qui ont failli se noyer sous son nez. Avec une sincérité désopilante, Diane rembobine une foule de souvenirs qu’elle alterne avec un présent empreint d’attention – le nec plus ultra du livre. Et tout à coup, cette femme, qui n’a brillé que par son absence, veille sa Cléo, devenue adulte, et amoureuse de Théo, de huit ans son aîné et papa de Camille et de Simon. On se délecte de la grâce qui infuse ces chapitres. De Cléo qui va tenter de « se faire une place » dans une famille où plane l’ombre d’une mère morte trop jeune, de reprendre peu à peu son rôle, de se consacrer au mieux à des petits au cœur lourd et qui ont déjà beaucoup pleuré : de devenir une « Maman absolument ». Thibault Bérard explore cette étoffe qu’est le lien maternel, sa construction, sa valeur, son accordage permanent, avec des ailes de papillon et une plume cristalline. Ce livre roule comme une vague d’amour. »
Vidéo
Rencontre en ligne avec Thibault Bérard pour son roman «Les enfants véritables». © Production Un endroit où aller
Tags
#lesenfantsveritables #ThibaultBerard #hcdahlem #jailu #roman #étéenpochedesblogueurs #livredepoche #jailu #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #68premièresfois #editionsdelobservatoire #secondroman

