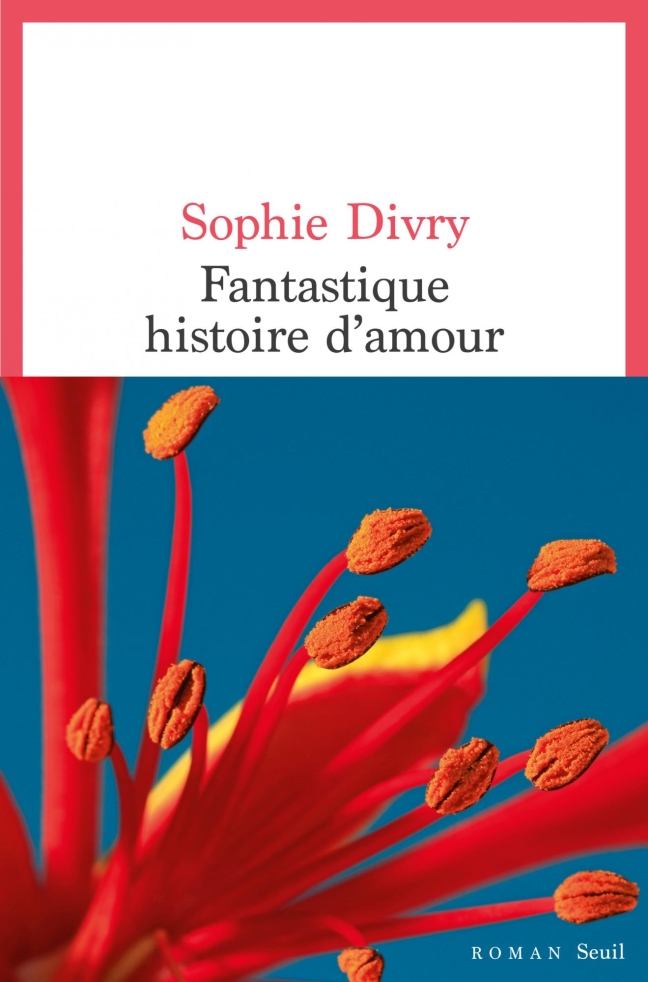En lice pour le Grand Prix RTL-Lire
En deux mots
Maïa est journaliste scientifique au sein d’un magazine qui périclite et un peu tête en l’air. Bastien est inspecteur du travail à Lyon et combat sa solitude avec ses collègues et l’alcool. S’ils se croisent au parc de la Tête d’Or à Lyon, ils vont se retrouver dans des circonstances très particulières.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
À la recherche du cristal scintillateur
C’est sous un air de thriller que Sophie Divry raconte la rencontre entre un inspecteur du travail et une journaliste scientifique. En embarquant les lecteurs dans une enquête riche en rebondissements, à la manière d’une série, elle n’oublie ni la satire sociale, ni l’histoire d’amour promise dès le titre.
Bastien Fontaine, 41 ans, est inspecteur du travail. Son addiction au tabac a détruit sa vie de couple et depuis deux ans, il se débrouille seul. Avant d’aller travailler, ce Lyonnais a pris l’habitude d’aller au Parc de la Tête d’Or où il observe une jeune fille donner à manger aux mésanges qui n’hésitent pas à se poser sur son bras.
Cette jeune femme s’appelle Maïa. À 38 ans, elle est journaliste scientifique pour le magazine Comprendre qui subit une érosion de son lectorat et se retrouve en difficultés financières. À la suite de la défection d’un pigiste, elle part au CERN retrouver sa tante qui doit l’aider à rédiger un article sur les «matériaux magiques» et plus particulièrement sur les cristaux scintillateurs . À son retour, elle est victime du mal qui l’affecte depuis bien longtemps, la «disparitionnite». Cette fois, c’est son ordinateur professionnel qui a disparu. Après le savon passé par son patron, elle décide d’agir, de lister dans un cahier tous les objets perdus. «Ce cahier était le début de sa reconquête. Elle avait l’impression de reprendre un peu de pouvoir. Chaque ligne écrite lui permettrait de circonvenir sa disparitionnite, de lui donner des règles. C’était comme si une autre dimension s’ouvrait à elle. Peut-être que tout
s’expliquerait.» Sauf que pour l’instant, cette bévue lui vaut d’être licenciée. Florence, son amie et ex-collègue, la soutient comme elle peut dans son épreuve.
C’est au moment où elle tente de rebondir en tant que pigiste, que sa tante Victoire vient lui confier un secret sur ses recherches et lui confier une mission un peu délicate.
Bastien aussi va être confronté à une mission délicate. Un accident du travail à Vénissieux a causé la mort d’un homme, retrouvé broyé par la compacteuse de la société Plastirec. Il se voit confier l’enquête sur ce tragique fait divers. Fort heureusement, il peut compter sur ses collègues pour l’aider, à commencer par Guilaine, qui va donner de sa personne pour lui remonter le moral. Henri, son ami libraire, quant à lui, reste un compagnon de beuverie irremplaçable, même s’il boit moins que Bastien ou en quantités plus étalées dans le temps. Mais la dépression le guette et le médecin va finir par lui prescrire un arrêt-maladie.
Sophie Divry, qui alterne les chapitres consacrés à Bastien (à la première personne) et à Maïa (à la troisième personne), va finir – on l’aura compris – par réunir ses deux personnages principaux. Sous des airs de thriller avec tentative de meurtre, cambriolage, pressions multiples et une touche de fantastique, – «Cette compacteuse, elle n’est pas normale, elle va vous rendre fou» – la romancière va remplir la promesse énoncée par le titre. Mais avant cela, que de rendez-vous manqués, d’atermoiements, de non-dits. Comme si l’évidence de l’amour le rendait aveugle.
En situant son roman dans le monde du travail et dans celui de la recherche scientifique, elle n’oublie de faire de donner à ce vrai-faux thriller une dimension de satire sociale, renouant ainsi avec Cinq mains coupées et sa vision du mouvement des gilets jaunes. On se régale des épisodes successifs de ce roman qui emprunte aux codes de la série. Jusqu’à l’épilogue tant attendu.
Fantastique histoire d’amour
Sophie Divry
Éditions du Seuil
Roman
512 p., 24 €
EAN 9782021538090
Paru le 05/01/2024
Où?
Le roman est situé principalement en France, à Lyon et environs, notamment à Villeurbanne, Vénissieux, Parilly. On y voyage aussi à Genève, Clermont-Ferrand, à Seyssel-Corbonod, à Arent dans l’Ain, à Draguignan ainsi qu’à Fribourg-en-Brisgau et Glottertal.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Bastien, inspecteur du travail à Lyon, est amené à enquêter sur un accident : un ouvrier employé dans une usine de traitement des déchets est mort broyé dans une compacteuse.
Maïa, journaliste scientifique, se rend au CERN, le prestigieux centre de recherche nucléaire à Genève, pour écrire un article sur le cristal scintillateur, un nouveau matériau dont les propriétés déconcertent ses inventeurs.
Bastien apprend que l’accident est en réalité un homicide. Maïa, elle, découvre que l’expérience a mal tourné. Sa tante, physicienne dans la grande institution suisse, lui demande de l’aider à se débarrasser de ce cristal devenu toxique.
Ce roman addictif qui emprunte aux codes de la série et du thriller est aussi une histoire d’amour. Une rencontre inattendue entre un homme, vaguement catholique et passablement alcoolique, et une femme, orpheline et fière, qui a érigé son indépendance en muraille.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France Culture (Les midis de culture)
La Vie (Marie Chaudey)
Culture vs News
Les premières pages du livre
Chapitre 1
Bastien
J’ai de la chance, ce matin elle est là. Le teint mat, un air sérieux, des cheveux bruns. Elle est protégée des pieds à la tête contre le froid, elle porte un bonnet. Pour ne pas la déranger, je me suis caché derrière un arbre. À vrai dire, ce n’est pas elle qui m’intéresse mais ce qu’elle fait. Oh, ce n’est presque rien,
un geste, un détail, mais il fait passer un brin de lumière dans la grisaille de ma vie. Alors chaque fois que je me rends tôt le matin au parc de la Tête d’Or, je viens voir près du cèdre du Liban si elle est là.
C’est comme une cérémonie, toujours la même.
De sa poche elle sort ce qui doit être des graines, qu’elle place sur sa main droite. Elle lève la main à hauteur de son épaule, elle ouvre la paume bien à plat. Puis elle se fige, le menton haut, sans bouger. Elle attend une ou deux minutes mais guère plus. Soudain une mésange jaillit du cèdre et vient se poser sur le bout de ses doigts. De son bec elle attrape une graine et repart. J’ai le cœur à l’arrêt, toutes pensées suspendues. Un autre oiseau s’approche. Il se sert et repart.
Cela dure à peine une seconde mais cette seconde me bouleverse. Peut-être que cette fille a un secret pour attirer ainsi les oiseaux. Au parc, les mésanges ne s’approchent jamais de moi ; elles sont sauvages et c’est bien normal. Avec cette fille, c’est différent. Je ne sais par quel mystère elles lui font confiance. Elle a dû mettre des années pour gagner cette seconde de contact. Quel contact il me reste, à moi, alors que plus personne ne me prend par la main dans un parc ?
Si je n’avais pas arrêté de fumer, Isabelle serait peut-être toujours avec moi. Mon sevrage tabagique rendit plus exécrable encore mon caractère. Mais je compris trop tard une chose trop simple : une femme qu’on ne rend pas heureux vous quitte.
L’aspiration au bonheur individuel est supérieure à la force de l’amour – peut-être pas à l’amour filial, mais à l’amour conjugal, c’est sûr. Pourquoi est-on amené à choisir entre le bonheur et l’amour ? Quand cela a-t-il commencé pour nous ? Depuis deux ans, je suis seul et je n’ai pas de réponse à ces questions. Les placards de mon appartement sont restés à moitié vides ; ils ressemblent à ces nids secs qu’on trouve sur les branches basses des arbres. Je me suis fait plaquer. Je mange des plats surgelés.
Mais je n’ai pas repris la cigarette, je suis un homme fier. Maintenant je bois.
On a tous besoin de drogues. Les gens paraissent normaux comme ça, mais ils ne le sont pas. L’un dort avec des couteaux sous son oreiller, l’autre est persuadée que dans trois ans les élections seront interdites en France, le troisième a des sueurs froides si un placard reste entrouvert. Dès qu’on gratte un peu, on s’aperçoit que les gens ont des failles terribles, des béances qui les rongent et qu’ils essaient de contenir. Ils y arrivent à peu près tant qu’ils sont jeunes mais, au fil des années, la résistance s’affaiblit et ils craquent.
Sans parler des traumatismes abominables qu’on découvre quand on les fait parler de leur enfance.
Voilà comment nous vivons tous. Quelque chose cogne à la porte durant des années, mais nous ignorons ce qui cogne.
Cette angoisse que je porte en moi, je la vois partout en ville. Sur ces bâches publicitaires où une jeune fille béate lape un yaourt vanille, dans ces dojos où s’étirent les femmes en âge de cancer, dans ces salles de sport où se réfugient les cadres.
Jusque dans cette manière de saisir notre téléphone pour pallier l’absence la plus brève… N’est-ce pas la preuve de l’angoisse dans laquelle nous vivons tous ? Je ne suis pas plus malin qu’un autre. Personne en avançant en âge ne peut en être exempt – et comment, sans drogues, pourrais-je m’en prémunir ?
Ce jour-là je m’étais réveillé peu après 4 heures du matin. Depuis qu’Isabelle était partie, je dormais mal. J’avais pris le premier métro et fait l’ouverture du parc de la Tête d’Or.
De la brume s’échappait de la surface du petit lac ; l’eau était restée plus chaude que l’air. Les arbres avaient perdu leurs feuilles. Ils attendaient dans leur immobilité le soleil prévu dans la journée ; ils attendaient la neige qui viendrait peut-être cet hiver. La vue de la neige est une des rares choses qui me rendent heureux. Mais nous n’étions que début décembre et j’avais peu d’espoir.
Quand j’avais 20 ans, je croyais que toute souffrance était guérissable. Depuis que je me suis fait plaquer, j’ai toujours des anxiolytiques sur moi et des bières dans mon frigo. Cela dit, les levers de soleil au parc restent le meilleur rempart contre ce qu’on appelle pudiquement les « pensées noires ».
Autour des berges du lac, des petits plis apparaissaient sur l’eau, telles des rides qu’on pourrait enlever d’un simple revers de la main. Un joggeur avec des oreillettes Bluetooth courait sur l’allée goudronnée. Un retraité promenait un chien jaune.
De la buée s’échappait de ma bouche.
C’est toujours le matin que mes pensées noires sont les plus accablantes. Le matin, rien ne vaut la peine, je suis l’homme le plus nul du monde, la vie m’apparaît comme un long dimanche pluvieux. Mais nous n’étions pas dimanche. Nous étions jeudi, une journée de travail m’attendait. J’étais content de la commencer avec la fille aux mésanges. Je la regardais sans bouger – je ne suis pas du style à aborder les femmes dans un espace public.
Les mésanges voletèrent encore quelques minutes autour d’elle.
Puis, comme chaque fois, elle se frotta les mains l’une contre l’autre, replaça son bonnet et partit pour son jogging.
J’avançai et me plaçai à mon tour sous le cèdre. Mais les oiseaux avaient disparu. Ils m’ignoraient comme Isabelle m’ignorait à présent. Les idées noires revinrent s’agripper à moi. Il était presque 8 heures. Les promeneurs de chien se faisaient plus nombreux. Deux cyclistes s’embrassaient devant la sculpture de faune avant de partir chacun de son côté. Un père remettait des gants sur les mains de son enfant. Il reste de l’amour dans nos villes, mais il n’est pas pour moi.
Je repris le chemin du métro. Je bus un café dans un bistrot, mangeai un croissant, feuilletai les journaux. La ville bruissait de moteurs ; les voitures et les vélos se disputaient la place sur le bitume. Les parents amenaient leurs enfants à l’école,
les mères tirant sur leurs bras en disant Dépêche-toi. Et les enfants passeraient de la tyrannie de leurs parents à celle de la classe. Qu’on laisse les enfants tranquilles. Ma misanthropie me reprenait tel un liquide corrosif. Je suis content de ne pas avoir d’enfants. J’aurais été un père mauvais.
Je m’appelle Bastien Fontaine, j’ai 41 ans et je suis inspecteur du travail. Mon métier consiste à faire respecter le Code du travail dans les entreprises. Nos bureaux sont situés à Villeurbanne dans un immeuble dont la moquette ne s’est jamais remise du passage à l’euro. J’ai trois collègues, Guilaine, Éric et Ludivine, à qui je n’avais guère l’habitude de parler avant de me faire plaquer, mais depuis je fais des efforts pour ne pas rompre tout lien avec le grand brocoli de l’espèce humaine.
Cette journée aurait dû être une journée ordinaire. Une journée de décembre plutôt ensoleillée, et même agréable, avec une promenade au parc le matin, la routine des contrôles, deux à trois bières le soir. Il en fut autrement.
Il était 17 heures. J’étais en train de faire le point avec Guilaine quand le commissariat central m’appela. Un accident du travail mortel venait d’avoir lieu dans une entreprise de Vénissieux – sur mon secteur. Un ouvrier s’était fait broyer dans une compacteuse hydraulique. Je quittai mes collègues dans la minute ; rien qu’à leur réaction lorsque je leur répétai ce que m’avait dit la police je sus que j’allais passer une soirée abominable.
Inspecteur du travail, c’est un métier solitaire, quelque chose entre shérif et assistante sociale – au vu de la flotte de véhicules qu’on met à notre disposition, je pencherais plutôt pour la seconde proposition.
La Renault démarra sans problème ce soir-là. Au premier embouteillage, je jetai un œil rapide sur le dossier de l’entreprise. La boîte s’appelait Plastirec et faisait du recyclage industriel. À partir de bouteilles plastiques vides qu’elle compactait, Plastirec créait des balles de deux mètres cubes qu’elle revendait à d’autres industriels. Je ne l’avais jamais contrôlée malgré la dangerosité de ces compacteuses. Comme toujours dans ces cas-là, quand survient l’accident, je me sentais coupable.
Pourtant je ne peux pas aller partout. Dans le département du Rhône, il y a un inspecteur pour dix mille salariés. J’ai beau en faire le plus possible, mes contrôles restent aléatoires.
Le contrôle, c’est la base de mon travail. On débarque dans une entreprise à l’improviste. On examine les postes, les ateliers, on relève les noms des salariés présents. On vérifie que les équipements sont réglementaires, que les salariés ont bien été embauchés dans les règles et ont été formés. Les inspecteurs du travail (ou plutôt les inspectrices, car les femmes sont devenues majoritaires dans le métier) passent au hasard – ou si on nous a signalé des abus majeurs.
Sans prévenir, de jour comme de nuit, sans autorisation, j’entre partout, je vois tout. Peu importe que je sois en costard cravate ou en jean-baskets. J’entre. Évidemment, il ne faut pas s’attendre à être bien accueilli. J’ai appris avec le temps à adopter le bon comportement. Rester calme et éviter le contact visuel. Ne pas mettre d’affect. Et, surtout, les laisser dire.
J’ai déjà été traité de collabo et de salopard… Les filles sont traitées de salopes et de mal-baisées. On entend aussi beaucoup d’histoires de couilles: Vous nous cassez les couilles, Je m’en bats les couilles, Vous n’avez pas de couilles… Les patrons déversent sur nous une colère longtemps accumulée. Contre l’instituteur qui les a humiliés, contre le flic qui leur a mis une amende sur la route, contre le facteur qui n’a pas déposé leur colis, contre le maire et que sais-je encore. En tant que fonctionnaire, je prends pour l’ensemble. Mais je reste impassible.
Quand je contrôle, l’État c’est moi. C’est gratifiant.
Je crois être un bon inspecteur. Dans le genre froideur légaliste plus que vengeur marxiste. Je n’ai pas de pitié, ni de connivence, ni d’acharnement spécifique. Mais si je veux contrôler dix fois l’hypermarché où un manager martyrise ses caissières, c’est mon droit. Je fais partie des fonctionnaires les plus libres de France. Je suis pratiquement immutable. Personne ne peut faire obstacle à mon travail, personne n’a le droit de m’interdire quoi que ce soit, même pas mon supérieur. En l’occurrence ma supérieure à l’époque, c’était Guilaine. On s’entendait bien, et, malgré les grilles d’évaluation infantilisantes mises en place par le ministère, la confiance régnait entre nous. On avait passé un deal, on s’entraidait et, surtout, on se fichait la paix.
Après un contrôle il faut rédiger des courriers qui seront adressés en recommandé aux employeurs. C’est moi qui les signe. Pas Guilaine, pas le ministre du Travail, moi. Souvent ce sont des « lettres d’observations » qui listent les problèmes constatés, parfois un arrêté de travaux quand les zingueurs se baladent sur le toit sans garde-fous. Dans les cas les plus graves, comme les accidents ou les harcèlements, il faut rédiger des procès-verbaux. Il s’agit alors de décrire en termes juridiques les planches pourries, les remarques racistes ou la suite de négligences qui a conduit à l’accident. L’essentiel de mon métier tient dans ces écrits. Je constate. Que les douches sont inaccessibles. Que les salles de pause sont inexistantes. Que le délégué syndical a été privé de l’autorisation de distribuer ses tracts. Sans notre regard et sans ces lois, la majorité des employeurs exploiteraient leurs salariés jusqu’à épuisement ainsi qu’on le faisait au XIXe siècle. Certes, les enfants ne travaillent plus dix heures par jour dans des filatures. N’empêche qu’aucune de mes visites, aucune, ne finit sur un « Bravo, rien à dire ». Il y a toujours quelque chose à signaler, et parfois en montant le ton.
Quand ça dégénère, nous pouvons menacer l’employeur de poursuites pénales. Il m’arrive de le faire. Mais le plus souvent, c’est du bluff. Car la plupart des PV sont classés par les tribunaux. Les procureurs se fichent de la délinquance patronale, ils sont obsédés par d’autres formes de violences. J’ai beau avoir un arsenal juridique à ma disposition, je reste un bas fonctionnaire. Quand, par miracle, mon PV permet d’intenter un procès contre un patron, sa condamnation sera symbolique.
Mais je ne me décourage pas. J’applique le Code du travail.
Je suis payé pour ça.
L’ironie est que mes parents étaient de vrais chiens de garde de la bourgeoisie. Quand ils m’ont inscrit en droit à Lyon 3, ils espéraient que je devienne avocat d’affaires. À cette époque, j’avais 18 ans. Je cherchais une issue. Les amphithéâtres de la fac étaient peuplés de crétins en chaussures bateau, pull sur les épaules, des blondinets qui avaient planifié leur carrière, leur nombre d’enfants et leur voyage aux States. Je ne me fis aucun ami. Mais contre toute attente, dans le noir désordonné de ma tête, où la notion de bonheur n’a jamais été crédible, où l’idée
de loisir m’inspire du mépris mais où la vérité garde son importance, entrer dans la logique juridique m’apporta un immense plaisir. Il n’était plus question de rhétorique ou de violence pour imposer son pouvoir. Je découvrais la force de la loi.
Le cours sur le droit du travail n’était pourtant pas très prisé ; il se tenait dans un sous-sol. Le professeur était captivant. Il nous révéla une mémoire insoupçonnée, ces couches de lois votées pour protéger les faibles, notre Constitution, nos règles de sécurité. Ces lois sont un filet invisible tendu sous nos existences, car nous passons le plus gros de notre temps à travailler.
J’ai voulu prendre ma place dans cette histoire, une place à l’opposé de celle de mes parents. Aujourd’hui mon métier consiste à rendre visible ce filet de protection, à défendre ces travailleurs.
Je suis un bas fonctionnaire mais j’incarne. Chaque jour je le rappelle aux patrons: Non, votre salarié n’a pas à vous demander une pause, ce n’est pas comme ça que ça se passe.
La loi oblige. Ça n’a rien à voir avec être sympa ou avec l’épaisseur de votre carnet de commandes : un patron doit accorder des pauses à ses ouvriers et leurs durées sont strictement précisées par le Code du travail.
Car nos tonnes d’angoisse n’ont pas toujours été sublimées par de l’alcool, du yoga ou des anxiolytiques. Des députés plus nombreux dans des temps plus anciens ont réussi à imposer des règles protectrices. Et tant que ces lois ne seront pas abolies, l’État doit les faire respecter. J’étais jeune quand je pénétrai à l’intérieur de cette forêt de textes, d’amphithéâtres, à travers ces articles buissonnants et les épines des premiers chagrins – car j’ai toujours été attiré par les femmes qui me font souffrir – mais j’avais trouvé ma voie, et malgré le scandale qu’il provoqua dans ma famille, je ne m’en suis pas détourné. Certes, je sais qu’il y a une part de leurre. Que l’exploitation capitaliste a besoin d’un paravent juridique pour que perdure l’inégalité entre la classe laborieuse et la classe possédante. Je sais que nos PV seront classés. Beaucoup de mes collègues se découragent et quittent le métier. Les mecs deviennent charpentier en écoconstruction ou avocat aux prud’hommes, les femmes maraîchère bio ou institutrice ; quand elles reviennent prendre un café dans les bureaux, elles disent Je ne sais pas comment vous faites pour tenir.
Moi je tiens.
Même si mes mains se crispaient sur le volant en allant à Vénissieux. Un homme était mort dans une compacteuse. J’avais l’impression que les phares des voitures étaient comme des bougies funèbres traçant des lignes dans l’obscurité. Mort broyé. J’aurais dû inspecter cette entreprise. C’est la base de ma mission, de porter attention aux métiers dangereux. Sauf que c’est le tonneau des Danaïdes. Il y a trop de demandes, trop d’infractions. Je klaxonnai hargneusement une voiture qui n’avançait pas assez vite. Pour un peu, j’aurais voulu me battre.
Isabelle me reprochait de détester tout le monde. Mais tout le monde se déteste. Ce n’est pas ma faute. Dans les entreprises,
on ne voit que ça, de la haine entre salariés et patrons, entre collègues et entre services. À croire que c’est une production naturelle. Je la vois partout. La haine se secrète à la machine à café comme une huile jaune. Il y en a tant qu’on pourrait en faire une énergie de combustion. Les jeunes insultent les vieux.
Les voisins de bureau se haïssent. On se hait à l’université, on s’humilie à l’armée. Les profs veulent tous la mort du suractif pénible et toute coiffeuse a désiré très fort enfoncer ses ciseaux dans votre gorge.
Isabelle ne comprenait pas qu’avec une telle misanthropie je sois catholique. Que je croie en la résurrection du Christ et tout le tralala. Mais si je n’allais pas à la messe le dimanche, la haine me submergerait. Il faut bien que je m’arme, que je mette quelque chose en face de cette violence. Il n’y a qu’à la messe que je peux entendre mon curé dire Ne répondez pas à la haine par la haine, sinon jusqu’où la haine ira-t-elle ? Seul, je n’ai pas les moyens moraux de contrer ces flots jaunes. Isabelle
me disait d’un air condescendant Tu as encore besoin de ça.
Elle voyait mon besoin de religion comme un handicap – alors que moi je le considère comme une dimension supplémentaire de mon âme. Une des rares choses que j’aime en moi. Quelque chose de bon. J’ai besoin de Dieu, un besoin noble, qui m’aide à me prémunir de la haine. Isabelle ne pouvait pas se passer de son tapis de yoga. Je ne vois pas en quoi c’est supérieur.
Jésus-Christ nous met au défi d’aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent: c’est tout de même un objectif plus élevé que de savoir faire le poirier.
Pour le reste, il n’y a que les athées qui s’imaginent que les chrétiens croient à tout en bloc. Que nous sommes vraiment consolés. Je ne suis consolé de rien. Je ne me confesse pas, mon catéchisme est approximatif et l’Immaculée Conception
une vaste blague. Mais je vais à l’église le dimanche, et en entrant dans l’édifice séculaire je m’inscris dans une histoire d’angoisse plus belle que la vôtre. Quelque chose alors est possible, malgré les ouvriers tués au travail, malgré les guerres et les chagrins d’amour. Peut-être qu’un jour je comprendrai ce que signifie être aimé de Dieu mais pour l’instant je ne suis aimé de personne. Pour l’instant, du matin au soir, je souffre et je demeure – comme Isabelle me l’a assez répété – un lâche, un misanthrope et un égoïste. Mais dans ce monde privé de beauté, dans ce monde privé d’espérance, le Christ est ressuscité et je vous emmerde.
Extraits
« Dans les institutions de type CERN, CNES ou CNRS, deux sortes de personnels se côtoient: les scientifiques et les ingénieurs. Deux professions qui doivent travailler ensemble alors que tout les oppose. D’un côté il y a les scientifiques. Ils ont beau avoir des titres universitaires, ils sont comparables à des poètes ou des enfants. On attend d’eux des intuitions géniales, mais leur comportement est incohérent. Les scientifiques arrivent en retard, portent des pulls troués et des lunettes fêlées. Ils téléphonent avec des Nokia et ne savent pas étendre le linge. De l’autre côté il y a les ingénieurs, en grande majorité des hommes. Ils fabriquent et règlent les machines, dessinent des plans, huilent des mécanismes. Ils savent résoudre avec un calme olympien des problèmes concrets comme l’introduction d’une fouine dans les tunnels du LHC. Les ingénieurs ont des voitures propres. Ils savent nouer leurs lacets. Ils sont rasés. Ils ont acheté le dernier iPhone et arrivent à l’heure. Le scientifique a besoin de l’ingénieur pour donner corps à ses idées ; l’ingénieur a besoin du scientifique pour savoir quelle machine construire. » p. 52
« Ce cahier était le début de sa reconquête. Elle avait l’impression de reprendre un peu de pouvoir. Chaque ligne écrite lui permettrait de circonvenir sa disparitionnite, de lui donner des règles. C’était comme si une autre dimension s’ouvrait à elle. Peut-être que tout s’expliquerait. » p. 88
À propos de l’autrice
 Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot
Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot
Sophie Divry est née à Montpellier en 1979 et vit actuellement à Lyon. Elle a reçu la mention spéciale du prix Wepler pour La Condition pavillonnaire et le prix de la Page 111 pour Trois fois la fin du monde. Fantastique Histoire d’amour est son septième roman. Avec sensibilité, elle allie l’art du récit et une exploration de nos sociétés contemporaines. (Source: Éditions du Seuil)
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte X (ex-Twitter) de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#fantastiquehistoiredamour #SophieDivry #editionsduseuil #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #NetGalleyFrance #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie