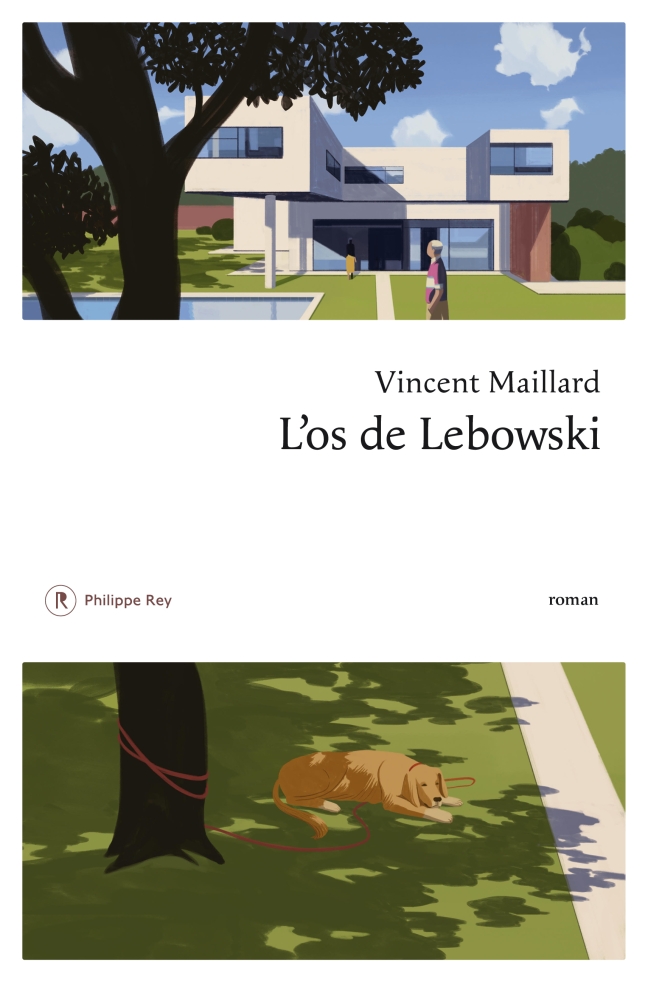Sélectionné pour le Prix Stanislas 2021
En deux mots
Tugdual Laugier est embauché comme consultant chez Michard & Associés, une société qui a édicté le secret comme règle primordiale et au sein de laquelle il passe son temps à attendre. Après trois ans, on va lui commande une étude sur les perspectives de développement d’un client chinois. Ce rapport de plus de mille pages va lui valoir des félicitations et… causer sa perte.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Le voyage en Absurdie de Tugdual Laugier
Pierre Darkanian réussit une entrée remarquée en littérature. Si l’on rit – jaune – dans Le rapport chinois, c’est que les tribulations d’un jeune cadre dressent un portrait féroce du capitalisme sauvage.
C’est après une batterie de tests assez bizarres que Tugdual Laugier a été recruté par un tout aussi bizarre cabinet conseil. Même s’il trouve les règles de fonctionnement de Michard & Associés aussi strictes qu’incompréhensibles, il accepte de s’y plier, car la rémunération est aussi attractive que la perspective de missions intéressantes. La suite ressemble plus à un chemin de croix qu’à une ascension fulgurante.
Pendant trois ans, il ne se verra confier aucune mission, passant de l’attente patiente au découragement. Il joue avec sa cravate et avec ses crayons de papier et peut mettre se permettre de tester ses flatulences. Après tout, ce métier ce n’est que du vent! Mais pourquoi chercherait-il un nouvel emploi? Il gagne bien sa vie, peut offrir une vie agréable à Mathilde, sa compagne et se voit même affublé d’une évaluation élogieuse!
Arrive alors le jour de la mise à l’épreuve. On lui demande de rédiger un rapport sur les perspectives de développement d’un client chinois sur le marché français. S’il ne sait pas trop par quel bout prendre cette mission, il va tout de même finir par rédiger un rapport de plus de mille pages, aidé par Mathilde qui va lui susurrer l’idée qui enthousiasmera ses clients. La mini-viennoiserie à la française peut partir à l’assaut du monde! Pour le reste, Wikipédia et internet, des listes de menus de restaurants chinois ou encore l’assortiment d’une boulangerie feront l’affaire.
Ce que Tugdual ignore, c’est que les activités du cabinet sont sous surveillance, la section financière soupçonnant des transactions illicites et un trafic de drogue à grande échelle. C’est pourquoi la commissaire Fratelli va élaborer un plan basé sur la collaboration du rédacteur du rapport chinois.
On l’aura compris, c’est le capitalisme sauvage dans toute sa splendeur que cette satire habilement construite dénonce au fil des pages. On y retrouve d’ailleurs des allusions à la crise des subprimes et à l’Affaire Madoff, aux sociétés offshore bien cloisonnées, aux travaux fictifs et aux rémunérations délirantes. Mais comment démanteler un monde qui ne repose sur rien?
Si ce voyage en Absurdie n’était pas aussi drôle, il en deviendrait presque inquiétant. Gageons que vous n’oublierez pas de sitôt Tugdual Laugier, mégalo autant que malhonnête. Il vient prendre place aux côtés de Ignatius J. Reilly, l’odieux personnage principal de La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, dans la galerie des paranos inoubliables, des imbéciles qui se prennent pour des génies et qui – comme le laisse suggérer la couverture du livre – finissent toujours par chuter.
Le rapport chinois
Pierre Darkanian
Éditions Anne Carrière
Premier roman
304 p.,19 €
EAN 9782380821543
Paru le 20/08/2021
Où?
Le roman est situé en France, principalement à Paris.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Une rumeur circule dans les cercles de pouvoir. Elle concerne un épais dossier intitulé Le Rapport Chinois. On dit que sa lecture rend fou. Pour certains, ce rapport à quelque chose à voir avec les cartels de la drogue. Pour d’autres il s’agit du manifeste d’un complot mondial. Quelques-uns en parlent comme d’un texte visionnaire.
On s’accorde en tout cas sur l’identité de son rédacteur: Tugdual Laugier. Mais là-aussi le mystère reste entier… Est-ce le nom d’un imposteur surdoué, d’un prophète ou d’un parfait imbécile ?
Quand la société des Hommes devient une farce, la vérité a besoin d’un bouffon. Le premier roman de Pierre Darkanian est une corde tendue par-dessus l’absurdité du monde moderne. On y danse, trébuche et se redresse derrière Tugdual, aussi inoubliable que Falstaff ou Ignatius Reilly, d’un abime à l’autre, d’un rire féroce vers une troublante mélancolie.
Avec Le Rapport chinois, Pierre Darkanian offre à la littéraire française sa Conjuration des imbéciles. C’est son premier roman.
Les critiques
Babelio
Goodbook.fr
Lecteurs.com
Actualitté
Transfuge (Éric Naulleau)
Marie France (Valérie Rodrigue)
Les premières pages du livre
« Pour intégrer le cabinet Michard & Associés, Tugdual Laugier avait dû passer deux tests de recrutement que le chasseur de têtes avait respectivement intitulés « test productif » et « test d’aptitudes ». Le premier consistait à rédiger en une semaine un mémoire d’une trentaine de pages, sur le thème du « rouleau ». Il s’agissait d’un exercice classique conçu par les recruteurs afin de jauger le comportement du candidat dans une situation de stress. Sans aucune information complémentaire, mais sans se laisser déconcerter, Tugdual avait planché sur le rouleau à pâtisserie, le rouleau de scotch, le rouleau compresseur, les rouleaux du Pacifique, les rouleaux de printemps, le rouleau de peinture, le rouleau à gazon, et il parvint même à trouver une problématique commune à tous ces rouleaux, à savoir la question du déroulé, et surtout à se passionner pour son travail. Fier de son ouvrage, Tugdual remit, dans les délais impartis, un mémoire de cent cinquante feuillets entre les mains du chasseur de têtes qui l’adressa à son tour aux recruteurs de Michard & Associés, non sans avoir pris soin de le féliciter pour son « très beau boulot » bien qu’il ne l’eût pas lu. Tugdual n’en entendit plus jamais parler.
Pour le test d’aptitudes, Tugdual fut convoqué dans un centre d’affaires du 16e arrondissement de Paris où, lui avait dit le chasseur de têtes, son futur employeur avait réservé une salle afin de lui « faire passer toute une batterie de tests ». À 8 heures, Tugdual fut installé par une hôtesse d’accueil dans une pièce qui ne disposait que d’une chaise et d’un bureau sur lequel l’attendaient une machine à café, un plateau-repas, un crayon et une liste de huit questions auxquelles il convenait de répondre par oui ou par non :
1. Êtes-vous mauvais perdant aux jeux de société ?
2. La vie est-elle pour vous une balade en barque ?
3. Êtes-vous prêt à tout pour arriver à vos fins ?
4. Êtes-vous perfectionniste ?
5. Souhaitez-vous toujours être premier dans tout ce que vous faites ?
6. La vie appartient-elle à ceux qui se lèvent tôt ?
7. L’argent contribue-t-il au bonheur ?
8. Pouvez-vous vous contenter du correct ?
Tugdual avait répondu oui-non-oui-oui-oui-oui-oui-non. À 8 h 15, il avait posé son stylo, craignant d’être espionné et mésestimé s’il y accordait davantage de temps, et il patienta jusqu’à ce qu’on voulût bien lui apporter d’autres formulaires. On ne lui apporta rien. Seul dans la petite pièce qu’il ne quitta que pour se soulager, il resta toute la journée à se demander ce que l’on attendait de lui. À 12 h 15, il attaqua le plateau-repas préparé à son intention et jugea la nourriture délicieuse. Il lui sembla d’abord préférable de ne pas ouvrir la petite bouteille de vin avant de supposer que, puisqu’elle lui était offerte, il était sans doute plus convenable de la boire, d’autant que la tranche de camembert et la mini-baguette étaient si tendres qu’il eût été dommage de se priver de vin. Assis au bureau, et faute d’alternative, Tugdual consacra l’après-midi à la digestion de son plateau-repas – auquel il repensa plusieurs fois par la suite dans un sourire radieux – et agrémenta son oisiveté de quelques tasses de café. À 20 heures, l’hôtesse ouvrit la porte pour lui indiquer qu’il pouvait y aller, sans que Tugdual sût si sa sortie correspondait à la fin du test ou à la fermeture du centre d’affaires.
Trois jours plus tard, le chasseur de têtes le rappela, et bien que Tugdual eût juré qu’il ne mettrait jamais les pieds dans un cabinet géré par de pareils illuminés, le bilan des tests et les conditions de recrutement lui firent reconsidérer la chose : ses résultats avaient suscité l’admiration des associés du cabinet Michard, qui offraient de le recruter à un salaire mensuel de sept mille euros. Les illuminés se révélaient être de sacrées pointures.
Tugdual Laugier commença sa carrière chez Michard & Associés par un séminaire dans un centre d’affaires des Champs-Élysées, cette fois, où il fut reçu par un homme et une femme d’une trentaine d’années. Il était encore si peu habitué à leur jargon professionnel qu’il ne comprit pas si ses interlocuteurs faisaient ou non partie du cabinet et il n’osa pas leur poser la question. Le duo se relaya pendant deux jours pour expliquer au seul Tugdual Laugier que le cabinet Michard & Associés était le plus prestigieux au monde. Tugdual n’avait pas été recruté par hasard, et s’il avait été choisi parmi des centaines d’autres candidats, c’est que le cabinet Michard avait vu en lui un talent en puissance, un peu comme un diamant brut qui ne demandait qu’à être poli. Tugdual se félicita d’être un diamant brut qui ne demandait qu’à être poli et il songea qu’il avait beaucoup de mérite d’avoir été choisi parmi des centaines d’autres candidats. Les intervenants présentèrent succinctement le cabinet Michard, une belle boutique, reconnue dans le milieu des affaires, notamment auprès d’une clientèle d’investisseurs asiatiques qui appréciaient son modèle de conseil fondé sur le design thinking et l’impertinence constructive – en totale rupture avec les stratégies de conseil classiques –, ainsi que sa capacité à apporter des réponses innovantes aux problématiques rencontrées par ses clients dans un contexte économique en perpétuelle mutation. Tugdual nota sur son bloc design thinking et impertinence constructive. Les trois valeurs phares du cabinet Michard étaient excellence, implication et confidentialité, et Tugdual nota sur son bloc excellence, implication et confidentialité, et les souligna. Les intervenants insistèrent surtout sur la confidentialité, que Tugdual souligna d’un trait supplémentaire, parce que le prestige du cabinet tenait en premier lieu à sa politique d’absolue confidentialité qui, parmi les trois valeurs phares du cabinet, était celle qu’il fallait placer au sommet de la hiérarchie car la moindre entorse à celle-ci eût privé le cabinet de toute crédibilité aux yeux de ses clients et du milieu des affaires. Et Tugdual finit par encadrer le mot confidentialité tout en fronçant les sourcils et en hochant la tête en direction de ses interlocuteurs pour leur signifier que le message était bien passé.
« Personne ne doit savoir pour qui travaille le cabinet, disait la jeune femme.
— Personne », répétait systématiquement l’homme à sa suite.
En pratique, la politique de confidentialité du cabinet contraignait les consultants à respecter le protocole : n’ayant pas accès au réseau informatique du cabinet, ils devaient demander à l’associé en charge du dossier l’autorisation d’accéder à la partie du réseau susceptible de les intéresser et ne devaient jamais mentionner le nom de leurs clients ni à l’extérieur du cabinet, ni dans leurs rapports, ni même devant leurs collègues. Ce point étonna particulièrement Tugdual : il était formellement interdit aux consultants, sous peine de licenciement immédiat et de poursuites disciplinaires, de parler entre eux de leurs rapports, et on les dissuadait même, pour ne pas tenter le diable, de nouer entre eux des contacts autres que professionnels. S’il voulait se faire des amis, il n’avait qu’à s’inscrire au club de rugby de son quartier, et tout le monde rit d’un air entendu – huhuhu – comme on le faisait au boulot quand un supérieur ou un ancien lançait une boutade. La femme ne rit pas mais arbora un sourire très professionnel et Tugdual se fit la remarque qu’elle était drôlement jolie et se demanda si elle était en couple avec l’intervenant parce que, si tel était le cas, il avait bien de la chance de se payer un morceau pareil. Lui, à la maison, même si Mathilde était jolie aussi dans son genre – visage d’enfant sage, discrète fossette, charmantes pommettes –, ce n’était pas un morceau à proprement parler et il fallait bien reconnaître qu’il aurait été fier de se promener au bras d’un morceau comme celui-là, avec sa taille de guêpe, son regard d’acier et sa chevelure soyeuse, et il aurait pris un immense plaisir à voir les jaloux baver d’envie sur son passage. L’homme poursuivit avec une anecdote à propos des dîners en ville au cours desquels il restait toujours vague sur ses activités professionnelles malgré les questions appuyées de ses amis. Et la femme ajouta que c’était tant mieux parce que les conversations professionnelles n’intéressaient personne. Et de nouveau, tout le monde rit – huhuhu –, sauf la femme qui se contenta de sourire, et Tugdual regretta d’avoir fait huhuhu plutôt que de s’être contenté de sourire lui aussi. C’était la raison pour laquelle chacun des consultants nouvellement recrutés suivait seul le programme d’intégration.
« Les amis sont des amis et les collègues sont des collègues, dit la femme.
— Si vous êtes aussi grassement rémunéré, c’est parce que vous avez des contraintes », précisa utilement l’homme.
Et il était indéniable que Tugdual Laugier était particulièrement bien payé, largement mieux que chez la concurrence. Sept mille euros par mois pour un premier job, c’était inespéré.
L’élaboration des rapports devait, elle aussi, respecter des règles de confidentialité très strictes. Les deux intervenants firent défiler de nombreuses slides sur un grand écran blanc où il était question de noms de code, de références cryptées, d’excellence et de formatage interne. Puis on aborda la facturation : il s’agissait là du nerf de la guerre puisque c’était le moyen pour le cabinet de gagner de l’argent – l’inter¬venant disait « gagner sa croûte » – et de s’assurer que tous les consultants fussent occupés équitablement, ni trop ni trop peu. À la fin de la semaine, les consultants accédaient au logiciel de facturation et indiquaient sur quels dossiers ils avaient planché afin que le cabinet pût émettre les factures à l’adresse des clients. Les consultants devaient préciser les références du dossier ainsi que le nom de l’associé en charge, chaque dossier étant rattaché à un associé particulier. Si, comme ça pouvait arriver au début, ils n’avaient rien eu à faire de la semaine, les consultants remplissaient la mention travail personnel, permettant ainsi aux associés d’identifier les consultants disponibles et de leur affecter de nouveaux dossiers.
« Mais, rassurez-vous, ajouta l’homme, vous ne resterez pas longtemps les bras croisés », et tout le monde rit – huhuhu – même si Tugdual se contenta d’abord de sourire avant de s’apercevoir que, cette fois, la femme riait aussi.
L’attention de Tugdual Laugier avait rapidement été mise à mal par la complexité des informations à retenir, si bien qu’elle s’était progressivement recentrée sur la corbeille et le choix de la mini-viennoiserie qui accompagnerait sa tasse de café. Les yeux fixés sur les slides et le cœur submergé d’une délicieuse ivresse, il s’interrogeait sur le modèle réduit de chausson aux pommes, bien meilleur que son homologue de taille adulte. En tout cas, si le prestige d’un cabinet de conseil se mesurait à la qualité des petits déjeuners qu’il offrait à ses nouvelles recrues, Michard & Associés était un sacré cabinet ! Une grande tasse de café, un verre de jus d’orange et des tout petits croissants et pains au chocolat. Quelle chance d’avoir été recruté ici ! Avec le salaire qu’il percevrait, il devrait travailler dur, mais on travaillait mieux avec beaucoup d’argent sur son compte en banque et des croissants dans l’estomac. Et quel ne fut pas son émerveillement lorsqu’il découvrit, à son retour de déjeuner, que la corbeille en osier avait été réapprovisionnée ! Et en chouquettes s’il vous plaît ! Derechef, et bien qu’il eût déjà fait bonne chère à la Maison de l’Alsace des Champs-Élysées, il tendit la main vers la corbeille, et réitéra le mouvement toute l’après-midi durant. Au loin, et derrière le voile invisible qui avait recouvert ses pupilles inertes, Tugdual entendait la voix monocorde de l’intervenante, fort jolie décidément, qui disait que le cabinet Michard & Associés était salué par ses clients pour son aptitude unique à dénouer des problématiques complexes, grâce à son savoir-faire, à l’expérience du terrain, à la rigueur de ses équipes et à l’inspiration créative de ses associés, capables d’opérer à la frontière d’espaces critiques, et exigeant néanmoins des réponses simples, qui ne pouvaient se résoudre qu’à la lumière d’une analyse exhaustive et sans cesse renouvelée par des professionnels dont les recommandations, toujours soumises à une validation empirique, découlaient d’un raisonnement logique et d’un fort ancrage dans la réalité des faits, et aboutissaient à des solutions aux antipodes du panel des alternatives habituellement proposées aux clients, dont la diversité (fonds d’investissement, institutionnels, organisations privées, publiques, parapubliques, fondations ou structures associatives) requérait un talent d’adaptation et de perpétuelle remise en cause, propre aux équipes du cabinet dont le cœur de métier consistait à répondre aux besoins des clients et à améliorer leurs performances selon leurs aspirations et les défis stratégiques imposés par leur environnement contextuel, que seule une vision protéiforme et adaptative permettait de relever (innovation organisationnelle ou technologique, démarche précursive dans l’implémentation des ERP, structuring performatif des ratios de gestion, optimisation des process internes, re-thinking des outils CRM, accompagnement en phase critique), le tout sans faire courir aux clients le moindre risque opérationnel et en respectant leur identité sociétale, et Tugdual se demandait s’il aurait droit à des mini-croissants et des chouquettes tous les jours de la semaine ou s’il s’agissait d’un privilège réservé aux consultants en formation, ce qui eût été bien dommage parce qu’ils étaient bons. Drôlement bons, même.
À l’issue de la formation, au cours de laquelle l’homme répéta parfois certains mots prononcés par sa collègue, que Tugdual se sentit obligé de prendre en note (confidentialité… collègues = collègues… facturation = gagner croûte… erp ??? crm ????), l’intervenante se tut. Avec son sourire très professionnel, elle attendit que Tugdual terminât d’avaler sa chouquette pour lui demander s’il avait des questions. Tugdual en avait bien quelques-unes mais elles concernaient principalement les mini-viennoiseries (y en aurait-il tous les matins à son bureau ?), les tickets-restaurant (seraient-ils à huit euros ou neuf soixante ?), le bloc-notes et le crayon à papier estampillés au nom du cabinet qu’il avait trouvés sur la table (pouvait-il les garder à l’issue du séminaire de formation ?), les vacances (pourrait-il poser trois semaines en août ?) et l’intervenante elle-même (était-elle célibataire ?). Dans les limites auto-perçues de son intelligence, deux signaux coutumiers se déclenchèrent en même temps qu’une légère angoisse : le premier lui confirmait qu’il n’avait rien compris, le second lui enjoignait de ne surtout pas poser de question.
« Tout est limpide, répondit Tugdual, qui aurait donné la même réponse à l’issue d’une conférence sur la combustion des alcanes.
— Alors dans ce cas…, enchaîna l’intervenant en ouvrant les bras comme pour lui donner l’accolade mais sans en concrétiser l’esquisse.
— … bienvenue chez Michard & Associés ! compléta la femme dans un nouveau sourire qui fit songer à Tugdual qu’il aurait payé cher pour la voir toute nue.
— Bienvenue dans notre grande famille », ajouta enfin l’homme en lui tendant une poignée de main ferme, et tout le monde rit – huhuhu – sauf la femme.
Tugdual les remercia et leur proposa d’échanger leurs numéros, ce qui était la façon la plus discrète d’obtenir celui de la jeune femme. Après tout, ils venaient de passer deux jours ensemble, ce qui créait des liens.
« Pourquoi pas ? » répondit la femme, que l’imagination de Tugdual n’arrivait plus à rhabiller.
Mais personne ne prit le numéro de qui que ce fût. Et Tugdual pensa que c’était tout de même une drôle de grande famille qu’il rejoignait s’il ne devait parler à personne. En tout cas, il les avait trouvés épatants. Vraiment très professionnels. Un peu gauchement, il les salua de nouveau avant de prendre congé.
Il ne les avait jamais revus.
Le lendemain, Tugdual Laugier franchit enfin les portes du cabinet Michard & Associés, qui occupait deux niveaux d’un immeuble du 8e arrondissement, dont la façade principale faisait face à la Seine. L’agent d’accueil lui remit un badge magnétique permettant d’accéder en ascenseur au septième étage et à son bureau, le numéro 703. Le dernier étage, où étaient regroupés l’ensemble des associés du bureau de Paris, était strictement interdit aux simples consultants, sauf autorisation exceptionnelle. Les deux intervenants avaient longuement insisté sur ce point lors du séminaire.
Muni de son badge, Tugdual se rendit seul au septième et regretta qu’une secrétaire ne lui fît pas au moins faire la visite des lieux. Certes, il ne devait nouer de relations extraprofessionnelles avec personne, mais la plus élémentaire politesse ne commandait-elle pas de le présenter à ses collègues ? N’allaient-ils pas au moins se saluer le matin dans les couloirs, et échanger quelques mots de temps à autre à la machine à café ? Il se fit alors la réflexion qu’en dehors des deux intervenants en charge du séminaire de formation, et dont il n’était d’ailleurs pas certain qu’ils en fissent partie, Tugdual n’avait encore croisé aucun représentant du cabinet. Michard en faisait tout de même un peu trop sur le chapitre de la confidentialité. En dehors du logo qui s’affichait ici et là, le couloir était sombre et desservait huit bureaux d’une quinzaine de mètres carrés que des cloisons en pvc opaques séparaient les uns des autres dans une atmosphère infiniment déprimante. Pour l’instant, il ne dirait rien, mais il fallait compter sur lui pour faire remonter le cahier des doléances dès qu’il aurait trouvé ses marques au sein du cabinet.
Tugdual prit place au sein du bureau 703 où une table, un ordinateur, trois crayons à l’effigie du cabinet, un bloc, une corbeille, une horloge et une vue sur la cour tenaient lieu d’accessoires et de décor. Toute la journée, il resta à sa table, sans trop oser s’aventurer dans le couloir, l’esprit papillonnant de la cour à la page d’accueil de son écran d’ordinateur et les globes oculaires tournant bientôt au rythme des aiguilles qui lui faisaient face. Dans le couloir, le silence était religieux et, de ses quelques allers-retours à la machine à café, il conclut que la plupart des bureaux voisins étaient inoccupés, et que les rares consultants qu’il croisait étaient de fieffés malotrus, à répondre inlassablement à ses salutations chaleureuses par un drôle de rictus. Comme lors de son test d’aptitudes, Tugdual attendit sagement qu’on voulût bien lui donner du travail.
Il attendit trois ans.
L’état d’esprit de Tugdual Laugier avait beaucoup évolué au cours de ces trois années. D’abord inquiet de ne pas être à la hauteur des missions qui lui seraient confiées, il avait cherché à se renseigner sur la nature de celles-ci tout en redoutant qu’on lui en confiât. S’il obtenait de ses collègues quelques secondes d’attention, ils lui répondaient en termes vagues et sibyllins, évoquant du bout des lèvres des dossiers dont le niveau de confidentialité était tel qu’ils ne pouvaient lui en révéler davantage, avant de délaisser Tugdual à l’orée d’une conversation dont on lui refusait le plaisir. D’ailleurs, hormis un drôle d’échalas à lunettes qu’il croisait au fond du couloir depuis son arrivée, la plupart des collègues entrevus durant ces trois années étaient restés quelques mois et avaient tous disparu un beau matin sans crier gare. Il n’y avait ni pot d’accueil ni pot de départ, et Tugdual éprouvait un inavouable sentiment d’envie lorsqu’il voyait sa fiancée préparer une galette pour tirer les rois avec ses propres collègues.
Il avait pensé se former tout seul en étudiant les rapports qu’il glanerait dans les tiroirs de son bureau, oubliés par ses prédécesseurs, ou dans ceux de ses voisins. Les tiroirs de son bureau, cependant, étaient vides et la pièce ne comportait pas d’autre ornement que l’horloge, ni armoire ni étagère d’aucune sorte, et les bureaux de ses collègues ne comportaient pas plus de rangements que le sien, ce qui n’avait rien d’illogique puisqu’il n’y avait rien à classer.
« Rien ne traîne dans les bureaux, lui avait dit son collègue du fond du couloir. Les projets de rapports ne sortent pas du réseau interne ultraconfidentiel, et les rapports définitifs sont conservés aux Archives. »
À la machine à café, les collègues paraissaient toujours pressés, méfiants, et se contentaient la plupart du temps de le saluer de leur rictus revêche. Parfois, sans pour autant se risquer à une conversation, l’échalas à visage émacié et aux yeux de taupe brisait la torpeur par un « Ça bosse, aujourd’hui ! ». Apparemment, ça bossait. Tugdual observait alors son collègue sans oser crier lui aussi que ça bossait alors que ça ne bossait pas mais espérant, par son sourire entendu, que son collègue comprît que ça bossait aussi chez Laugier. Et puis, à force d’entendre son collègue s’écrier « Ça bosse ! », Tugdual avait craint que sa réserve fût interprétée pour ce qu’elle signifiait (qu’il ne bossait pas) et que les bruits de couloir colportassent bientôt la vérité. À son tour, il s’était donc mis à lancer des « Ça bosse ! » à tout bout de champ, dès le matin dans le couloir qui menait à la machine à café, en attendant son café, en retournant à son bureau, en refermant la porte, en allant aux toilettes, en quittant son bureau… « Ça bosse chez Laugier ! »
De temps en temps, un associé du cabinet débarquait dans le couloir en sifflotant (« didididi-dadadada ») et chantonnant à propos d’un certain « Relot » qui avait bien mérité son café (« C’est pour qui le bon café ? C’est pour ce bon vieux Relot, toujours premier au boulot ! »). Tugdual ne l’avait encore jamais croisé, mais il reconnaissait la voix. « Voilà le drôle d’oiseau », se disait-il dès que le sifflement retentissait dans le couloir. Tugdual l’entendait s’étonner que les bureaux fussent vides, alors qu’il ne passait jamais la tête dans le sien, puis sermonner les collègues qu’il trouvait à la machine à café, leur reprochant d’être toujours en pause, à papoter, alors que ce bon vieux Relot turbinait jour et nuit à s’en esquinter la santé. Il citait Jean Jaurès et Jules Ferry, vantait les vertus de l’école républicaine, qui lui avait permis de gravir les échelons, leur parlait de la Chine où il faisait très froid l’hiver, très chaud l’été, où il avait habité quatre ans à bouffer du clébard avec des baguettes, avertissait que les Chinois étaient partout, sa femme, sa secrétaire, ses clients – tout le monde était chinois ! Avant de remonter au huitième étage, il les pressait de retourner bosser s’ils voulaient un jour devenir associé comme lui, et ne manquait jamais de leur rappeler que le secret de la réussite tenait en trois mots : boulot, boulot, boulot. Puis il repartait comme il était venu, en sifflotant (« didididi-dadadada »), et chaque fois Tugdual refrénait l’ardent désir de le croiser de peur de se voir reprocher, comme ses collègues, de traîner dans le couloir plutôt que d’être à son bureau. La voix pouvait retentir trois fois dans la matinée puis elle se taisait pendant des mois. Vraiment, quel drôle d’oiseau !
Puisqu’il fallait bien s’occuper, Tugdual avait dû trouver des activités qu’il pût exercer dans le huis clos de son bureau feutré, et avait développé pour l’ordre une approche obsessionnelle qui le conduisait plusieurs fois par jour à « ranger tout ce fatras », là où tout autre que lui aurait vu une pièce inoccupée. Dès que l’un des trois crayons à papier venait à manquer dans son pot, il prenait l’air renfrogné, repérait le fuyard de son œil de faucon, s’en saisissait d’un mouvement sec et lui adressait solennellement les avertissements d’usage : « Si je te reprends encore une fois à faire l’école buissonnière, je te brise les os, vilain garnement ! » Et lorsque le crayon – pourtant averti ! – tentait une nouvelle fois de se faire la belle, Tugdual Laugier, dans un cérémonial parfaitement établi, interpellait le récidiviste au milieu de sa cavale, s’emparait de l’une de ses extrémités, le levait au ciel pour l’exposer à la foule, en saisissait l’autre extrémité et brisait le mutin en deux, avant d’en présenter les morceaux démembrés aux crayons survivants pour leur faire passer l’envie d’imiter leur petit camarade. S’étant rapidement retrouvé avec des dizaines de morceaux de crayon sans mine, dépourvu de taille-crayon et ne sachant comment réclamer de nouvelles fournitures aux services généraux, Tugdual avait dû se résoudre à acheter lui-même de nouveaux crayons, de peur de se voir privé de l’un de ses principaux passe-temps. Il avait ainsi fait l’acquisition – sur ses deniers personnels – d’un sachet de cent crayons à papier sur lesquels il avait régné en despote une année durant avant de se résoudre à l’acquisition de cent nouveaux petits opprimés que, dans un souci de justice, il avait cette fois numérotés afin de ne pas faire subir aux primo¬délinquants le même sort qu’aux récidivistes. L’institution judiciaire était bientôt devenue une mécanique implacable où les crayons fidèles étaient récompensés par un usage quotidien et des entortillements capillaires, les récalcitrants placés en quarantaine, tandis que les délinquants notoires étaient mis hors d’état de nuire. « L’État français ferait bien de s’en inspirer ! songeait-il. Ça nous éviterait la chienlit ! »
Le déjeuner était devenu l’épicentre de sa journée de travail. À 11 heures, la grande agitation débutait. Il appelait les brasseries des alentours pour s’enquérir du menu du jour, questionnait les serveurs sur les accompagnements proposés, se renseignait sur les tables disponibles, jouait aux indécis, raccrochait, contrarié, rappelait aussitôt ayant changé d’avis, réservait pour 11 h 45, prétextait une urgence pour annuler, et réservait de nouveau pour midi. Il se mettait l’eau à la bouche en visionnant des émissions de cuisine dont raffole Internet, s’imaginait les plats, se réjouissait à l’idée de l’avocat-¬crevettes, espérait se laisser suffisamment de place pour les profiteroles au chocolat, et à 11 h 30, n’y tenant plus, il enfilait son imperméable – jamais sa veste, qu’il laissait consciencieusement sur le dossier de son fauteuil pour faire croire qu’il était encore là – et s’évadait au grand jour. Dans l’ascenseur, il considérait son reflet dans le miroir, rentrait le ventre, creusait les joues et se désolait de constater que sa silhouette replète, son visage poupin et ses cheveux courts et drus ne correspondaient pas du tout à l’image qu’il se faisait de lui-même, beaucoup plus proche de celle des acteurs américains, regard profond, mèches rebelles et voix rauque. Dès qu’il posait le pied dans le hall, l’image fantasmée reprenait ses droits sur celle du miroir et, d’un pas assuré, débordant d’importance, il saluait les agents d’accueil avant de rejoindre la rue dans un trottinement folâtre qui trahissait la béatitude de l’âme. Il passait au kiosque à journaux, échangeait sur la politique avec le marchand – qui n’y comprenait rien, le bougre ! – et, gai comme un pinson, poussait très en avance les portes de la brasserie sur laquelle il avait jeté son dévolu. Enfin attablé, unique client d’une salle encore vide, immensément satisfait de se voir le seul oisif au milieu du ballet des serveurs dressant les tables autour de la sienne, Tugdual examinait le menu qu’il connaissait par cœur, hésitait, opinait du chef, et finissait par choisir le plat du jour. Commençait alors le suprême plaisir de l’attente, réconfortante de certitudes. Là-bas, dans la cuisine, un chef et deux commis œuvraient, dans un commun effort, à la confection de son entrée. Quand elle arrivait, le guilleret Tugdual se nouait une serviette épaisse à carreaux rouge et blanc autour du cou, se frottait le ventre, remerciait la vie de l’avoir doté d’un si joyeux appétit et, en trois généreuses bouchées, engloutissait son mets dans un absolu contentement. Il marquait une pause entre le hors d’œuvre et le plat pour laisser la clientèle d’affaires s’installer aux tables environnantes et saluer ses voisins d’un hochement de tête qu’on ne lui rendait pas. D’un claquement de doigts d’habitué, le pionnier Tugdual poursuivait son aventure en solitaire, s’évitant les désagréments d’une cuisine bondée, d’un chef débordé ou d’une carte incomplète, dégustant ses rognons pendant que ses commensaux espéraient encore leur salade. Il se faisait ensuite volontairement rattraper pour mieux profiter du dessert. Comblé, il laissait traîner l’oreille là où la conversation lui seyait, lançant des commentaires comme on lance des hameçons. « Bonne chance pour sortir de l’euro ! » glissait-il, tout en connivence, à deux voisins en pleine querelle économique ; « Vivement la retraite ! », hilare, à trois jeunes hommes de son âge dénigrant leur travail ; « Ce que femme veut… », complice, à un mari malmené par son épouse… Parfois, l’interlocuteur acquiesçait, saluait le trait d’esprit d’un haussement de sourcils bienveillant qu’il regrettait aussitôt, Tugdual l’ayant interprété comme une invitation à participer à la discussion. Le trublion Laugier multipliait alors les boutades, approuvait les opinions des uns, nuançait celles des autres, recadrait le débat, se désintéressait totalement de son assiette, retournait même sa chaise pour se rapprocher de la table voisine, s’y installait parfois, et monopolisait bientôt la parole au grand dam des clients trop polis pour faire taire l’importun. Mais le plus souvent, son bon mot, son invective, sa fulgurance mourait dans une indifférence gênée ou dans l’hypocrisie d’un plissement de lèvres bien élevé. Peu lui importait, il avait le ventre plein. Ô qu’il était bon le temps du déjeuner. Qu’elles étaient revigorantes et saines ces heures pleines durant lesquelles Tugdual Laugier ne s’en voulait pas de n’avoir rien à faire.
À son retour, il profitait de la solitude de son bureau pour digérer dans un calme méphitique le menu trop copieux, comblant la vacuité de ses après-midi par de distrayantes flatulences. Avachi dans son fauteuil, le fumet des rognons encore en bouche, baigné dans la familière puanteur de ses entrailles, il s’étonnait qu’une telle odeur pût paraître si agréable à ses narines alors qu’elle eût été insoutenable à celles de tout autre. Dieu qu’il s’en donnait à cœur joie ! Quel curieux plaisir, vraiment, que la pétarade !
Cette singulière activité en annonçait inévitablement une autre, tout aussi réjouissante. Largement mis à contribution, son intestin sonnait l’alerte d’un délestage imminent, pareil au sémaphore signalant un récif. Tugdual se précipitait dans le couloir et rejoignait en courant les toilettes, muni d’un peu de lecture. La peau du derrière rafraîchie par le thermo¬plastique de l’abattant, il savourait cette parenthèse enchantée où l’être humain en revient à sa condition de tuyau de chair, muni du Monde, du Figaro ou de tout autre journal qu’il avait pu récupérer sur la table basse du hall de l’immeuble. Longtemps après les dernières éclaboussures, il refermait son journal, se relevait avec la mine fataliste qu’il affichait au réveil et, avant de s’essuyer le derrière, jetait un œil attentif à sa production du jour. Était-elle ferme comme l’entrecôte qu’il avait dévorée au déjeuner ou mollassonne comme son tiramisu ? Était-ce une pièce unique et massive ou un chapelet de petites crottes ? Son œuvre, qu’elle fût imposante ou figurative, le rendait si fier qu’il rechignait à tirer la chasse. N’était-ce pas une part de lui-même, après tout, qui flottait là, au pied du trône ? N’était-ce pas la seule matière qu’un homme pût véritablement engendrer ? Quel dommage en tout cas qu’il fût l’unique expert à profiter de la vue d’un si bel étron ! Enfin, dans un bruit de cataracte, survenait l’anéantissement de sa production ultime que Tugdual veillait à faire disparaître dans la tuyauterie de l’immeuble, usant du balai s’il en était besoin, afin qu’il n’en demeurât aucune trace pour la postérité.
Parfois, sa défécation paisible était perturbée par une cacophonie de talons venant du plafond, comme si, à l’étage supérieur, un hurluberlu s’essayait aux claquettes – clap, clap, clap ! Puis le tintamarre s’interrompait brusquement, et ne lui parvenait plus alors qu’un chuintement étouffé qui lui rappelait quelque chose mais qui mourait avant de lui révéler ses mystères – « didididi-dadadada »…
Lorsque le silence de son bureau devenait pesant et que son intestin ne lui permettait plus de le rompre à sa guise, Tugdual s’assurait discrètement que les alentours fussent vides pour se lancer dans un concerto. Après des exercices de vocalises (« A-E-I-O-U »), il annonçait avec le ton compassé des animateurs de France Musique l’intermède qui suivrait.
« Concerto en la mineur de Vivaldi, par l’orchestre philharmonique de Vienne, dans une interprétation toute personnelle du maestro Tugdual Laugier… »
De cette performance musicale, seul Tugdual percevait l’absolue majesté : trompette gutturale, cymbale sur joues, flûte à pincement de nez, guitare sur dents, percussion sur côtes, tambour de fesses ! Le petit concert achevé, ému aux larmes, il adressait à une foule imaginaire une gracieuse révérence. Si un collègue s’était trompé de porte à ce moment précis, il serait tombé nez à nez avec ce grand dadais de Tugdual, un mètre quatre-vingt-huit, pas encore gros mais en passe de le devenir, envoyant des baisers, la main sur le cœur, à son public de crayons à papier, chef d’orchestre sans orchestre, violoncelliste sans archet, génie sans idée.
Il avait également trouvé en sa cravate un fidèle compagnon de jeu, la roulant, la déroulant autant qu’il le pouvait, la dénouant parfois pour en faire un garrot, pour en faire un lasso, qui Rambo, qui Zorro. II se l’enfonçait aussi dans la bouche, comme un rouleau de printemps qu’il gobait en ouvrant grand la mâchoire (« Rô-rô-rô ! »), et la retirait en toute hâte pour s’éviter la douloureuse épitaphe « Ci-gît Tugdual Laugier, mort à 25 ans, étouffé par sa cravate ». Le jeu de la cravate lui inspira d’autres défis comme celui de se fourrer dans la bouche le plus grand nombre de bûchettes de sucre, défi auquel il se prépara toute une semaine, chapardant consciencieusement chaque matin cinq ou six sachets à la machine à café, redoutant de se faire pincer s’il en subtilisait davantage. En fin de semaine, il établit un record que l’on ne battrait pas de sitôt : trente-cinq bûchettes dans la bouche, oui monsieur !
Au dîner, Mathilde lui demandait comment s’était passée sa journée. Tugdual prenait l’air affecté de ceux qui taisent courageusement des secrets trop lourds à porter pour le commun des mortels. Il eût été soulagé de pouvoir partager avec elle ses inquiétudes et son spleen, mais il craignait que l’adoration de Mathilde, qu’il s’imaginait briller d’un éclat pur et limpide, ne se teintât d’opaline. Alors, Tugdual s’emportait à décrire un labeur interminable, jonglant entre les appels téléphoniques et les sollicitations internes, donnant les impulsions décisives, rayant à grands traits les notes des subalternes, corrigeant avec tact celles des supérieurs, se nourrissant à peine d’un sandwich en triangle au milieu du raffut ! Compte tenu de son salaire, naturellement, il n’avait pas à se plaindre, mais le diktat de la rentabilité allait finir par lui esquinter la santé.
« Et je gagnerais plus chez Rothschild, crois-moi ! »
Et Mathilde le croyait.
« Chéri, tu gagnerais plus chez Rochild », acquiesçait-elle d’ailleurs lorsque les responsabilités de son fiancé lui paraissaient trop lourdes.
Et Dieu qu’elles étaient lourdes ! Pestant, maugréant, tapant du poing sur la table, Tugdual fustigeait les travers du capitalisme aveugle et dissipait dans un redoublement d’indignations les réminiscences honteuses de ses après-midi : bûchettes de sucre, avalements de cravate, concerts gutturaux – pouet, pouet, pouet, la trompette… Impensable d’avouer à Mathilde qu’il n’avait encore vu ni rapport ni associé et que ses seuls subalternes étaient une centaine de crayons à papier ! Mathilde devait continuer de croire qu’il bossait comme un cheval, ce dont Tugdual n’était pas loin d’être lui-même convaincu. Il est en effet une vérité éternelle que l’être humain, naturellement réfractaire à l’effort, le devient d’autant plus qu’il n’y est plus confronté. Ainsi, dès que Tugdual se voyait contraint de rédiger un courrier au syndic, l’affaire prenait désormais des proportions internationales. Mathilde devait se montrer aux petits soins, le soulager entièrement des tâches ménagères – Tugdual ne pouvant être partout à la fois – et écouter attentivement les projets de courrier dont il lui faisait lecture. Il n’était plus question de parler d’autre chose aux dîners que de la désignation de son interlocuteur (« Chère Madame, Cher Monsieur… Madame, Monsieur… Madame ou Monsieur le Président… Madame la Présidente, Monsieur le Président… »), de la phrase d’accroche (« En ma qualité de propriétaire, je me permets de vous contacter… Je me permets de vous contacter en ma qualité de propriétaire… C’est en ma qualité de propriétaire que je me permets de vous contacter… »), du ton du courrier (respectueux ? directif ? poli ? insolent ? résolu ?) et, plus fondamental encore, de la formule de politesse qui classait les rédacteurs en castes : les gens du monde (« Je vous prie de croire en l’assurance de toute ma considération respectueuse »), les intellectuels (« Je vous prie de croire en l’absolue sincérité de mes hommages spirituels »), les obséquieux (« Je vous prie d’agréer l’hommage de mon indicible et respectueux dévouement »), les hypocrites (« Je vous prie de croire, Monsieur le Président du syndic, que je vous compte parmi mes amis les plus fidèles »), les sans-manières (« Bien cordialement »)… Chez Michard, Tugdual arpentait le couloir en soufflant, plein de componction, d’un pas pressé et lourd, de son bureau à l’imprimante, de l’imprimante à son bureau.
« Ça bosse, chez Laugier ! »
Ah oui, ça bossait ! Le courrier au syndic comptait bientôt dix pages où Tugdual multipliait les réclamations, dénonçait des exactions intolérables, critiquait la mairie d’arrondissement, accusait la Ville de Paris, en appelait à l’État, à la cedh ! Ce n’était plus un courrier, c’était un mémoire, un opuscule, un brûlot !
« Ça bosse, chez Laugier ! »
Lorsque le courrier – qu’il avait intitulé mémoire ampliatif – était enfin achevé, chaque mot était si bien pesé qu’on n’y comprenait plus rien. Mathilde était chargée d’aller le porter en toute hâte au bureau de poste afin qu’il fût relevé dès le samedi matin, son fiancé n’ayant pas eu une minute pour le faire poster par une assistante. Et si Mathilde s’étonnait d’avoir à se précipiter pour un courrier qui n’avait rien d’urgent, Tugdual lui rappelait que sa mission n’était rien comparée à la sienne, qui l’avait retardé dangereusement dans son travail.
Il avait rencontré Mathilde lors d’une soirée étudiante. Bien que n’ayant jamais connu un grand succès dans ce type d’événements, ni n’importe où ailleurs, Tugdual ne doutait pas de son charme et avait, ce soir-là, opté pour une nouvelle stratégie de séduction, les précédentes n’ayant pas toujours porté leurs fruits. Plutôt qu’essayer d’attirer la danseuse la plus convoitée de la piste par des mouvements de bassin et d’irrésistibles œillades, Tugdual s’était dirigé vers Mathilde qui se tenait dans un coin, à l’écart d’un groupe de jeunes filles dont le cercle de discussion s’était refermé devant elle comme les portes d’une forteresse. Tugdual, lion superbe et généreux, l’avait abordée avec des mots qu’il ne cesserait de lui rappeler les années suivantes :
« Comment se fait-il que la plus jolie fille de la soirée n’ait pas de cavalier ? »
Bien qu’un peu inquiète à l’idée que ce grand dadais pût se moquer d’elle, Mathilde avait levé vers lui ses pommettes roses et un sourire d’encouragement. Il l’avait rassurée, l’avait fait danser, elle qu’on invitait si peu, lui avait raconté sa vie – travail acharné et aventures d’un soir –, dépeint ses ambitieux projets et s’était même laissé aller à lui confesser qu’il aspirait désormais à vivre une belle histoire plutôt qu’à collectionner les conquêtes. Mathilde l’avait laissé la raccompagner jusqu’à la porte de sa chambre et avait apprécié qu’il n’insistât pas pour passer la nuit avec elle. « Tu es différente de toutes celles que j’ai eues », lui avait-il chuchoté avec ce même regard de don Juan touché au cœur. Le lendemain, il lui avait envoyé un sms. « La belle Mathilde m’accorderait-elle une heure de son temps ? » Elle la lui avait accordée. Rapidement, Tugdual avait élaboré pour eux une feuille de route avec des projets à réaliser, des étapes à franchir, des objectifs à atteindre. Dans sa chambre d’étudiant, il avait relié entre elles trois pages blanches avec du scotch. Il avait tiré un trait sur toute la largeur, entrecoupé de petites barres verticales. Le grand trait horizontal représentait le reste de leur vie et les barres verticales chacune des cinquante prochaines années. C’est ainsi que Mathilde, les yeux ronds d’étonnement au-dessus de ses pommettes roses, avait découvert que Tugdual gagnerait deux mille euros net dans deux ans, qu’ils achèteraient un appartement dans trois, que Tugdual gagnerait quatre mille euros dans quatre, qu’ils se marieraient cette même année, qu’elle aurait son premier enfant dans cinq, son second dans sept – mais qu’une marge de sécurité lui laissait encore le loisir de le reporter l’année suivante. Venaient ensuite l’acquisition du second appartement, définitif celui-ci, l’inscription des enfants à Henri-IV, l’investissement locatif dans un petit studio qui leur servirait de pied-à-terre pour leurs vieux jours, la résidence secondaire…
« Dans la vie, disait-il, il faut une feuille de route, sinon on ne sait pas où l’on va. Je suis le capitaine, qui donne le cap, et tu es mon fidèle matelot. »
Et si Mathilde ne répondait pas, Tugdual insistait :
« Pas vrai, chérie ?
— Vrai. »
D’ailleurs, il ne prenait jamais une décision sans consulter Mathilde, qui l’approuvait toujours : « J’ai bien fait d’acheter du pain ce matin. Pas vrai, chérie ? – Vrai, chéri » ; « C’est une sacrée affaire que j’ai faite là, vrai ou faux ? – Vrai, chéri » ; « Ce n’est pas avec des empotés pareils qu’on va redresser la France ! J’ai tort ou j’ai raison ? – Tu as raison, chéri. » Bien que se sentant parfois trimballée comme une valise, Mathilde éprouvait un amour reconnaissant envers Tugdual : pour la première fois quelqu’un l’incluait dans ses plans. De son côté, l’amour de Tugdual pour Mathilde était sincère mais maladroit. Il n’osait lui avouer que les petits plaisirs de la vie n’étaient pour lui des plaisirs qu’en ce qu’il avait hâte de les raconter le soir même à Mathilde (il ferait beau ce week-end, il avait une faim de loup, il avait acheté vingt-quatre rouleaux de papier-toilette au prix de douze) et se persuadait que celle-ci ne se contenterait pas de si peu. Non, Mathilde attendait de lui ce que toutes les femmes devaient attendre d’un mari : protection, assurance et prestance. Sans quoi, à la moindre déconvenue, les bonnes femmes filaient à l’anglaise pour trouver mieux ailleurs sans qu’il y eût rien d’inconvenant à ça : n’importe qui changerait d’employeur contre un meilleur salaire. Tugdual vivait ainsi chez lui dans une quête d’admiration qui se déclinait sous toutes les formes du quotidien, de sa façon de boire le café le matin (à gorgées franches et bruyantes) jusqu’à sa manière de pousser le caddie au supermarché (sifflotant, bras écartés, sans embardée). Il devait se surpasser en tout pour éblouir Mathilde.
Tugdual avait décrété qu’ils iraient déjeuner tous les dimanches chez la mère de Mathilde et avait fait passer son diktat pour une exigence de sa fiancée, qui n’y tenait pourtant pas.
« N’insiste pas, Mathilde, je la connais, ta mère ! Les habitudes sont les habitudes ! »
Et si Mathilde contestait, Tugdual couvrait sa voix jusqu’à ce qu’elle l’approuvât.
« Vrai, chéri.
— À la bonne heure. Alors, allons-y, sinon ma belle-doche va encore nous faire une crise. Et pareil pour mon beauf. J’ai tort ou j’ai raison ?
— Tu as raison, chéri. »
En l’absence du père, décédé lorsque Mathilde était enfant, Tugdual s’était érigé en chef de famille, dont les membres avaient vu l’arrivée comme une bénédiction pour Mathilde qui manquait terriblement de confiance en elle, mais ils commençaient à se lasser de le voir régenter leur propre vie. Il avait fait du bout de table, autrefois assigné au père, sa place habituelle, sa fiancée se tenant à sa droite, sa mère et son beau-frère à sa gauche. Gaspard, de deux ans le cadet de Mathilde, plutôt introverti et fervent catholique, se faisait accueillir à son retour de la messe par quelque boutade que Tugdual se gardait de renouveler : « Allons donc, voilà la grenouille de bénitier ! Dis donc, j’espère que tu ne pries pas pour les chômeurs parce que là-haut, Il n’a pas l’air de t’écouter » ; « Alors, saint Gaspard, je sais que les voies du Seigneur sont impénétrables mais Il ne se fait pas beaucoup entendre du côté de la Terre promise où on se bat en Son nom depuis deux mille ans ! » Sur ce, Tugdual tournait sa bouille satisfaite et goguenarde vers Mathilde ou vers sa belle-mère : on ne faisait pas gober à Tugdual Laugier ces sornettes de cureton ! Parfois, Mathilde lui chuchotait de ne pas vexer son frère et Tugdual répondait tout haut pour que son « beauf » l’entendît :
« Il ne va pas se vexer, l’enfant de chœur : Dieu est plein de miséricorde. Pas vrai ? »
Et comme Gaspard ne répondait toujours pas, Tugdual, en pater familias bienveillant, venait lui adresser une accolade virile.
Gaspard s’irritait de la fulgurante familiarité avec laquelle le traitait le nouveau venu. Si Mathilde était heureuse avec cet individu plutôt qu’un autre, il en était ravi pour elle, mais pourquoi diable ce Tugdual Laugier s’évertuait-il à multiplier les marques d’intimité à son égard ? Chiquenaudes, boutades et conseils… Au déjeuner, Tugdual avait décrété qu’il convenait de parler affaires – autrement dit, des siennes – et puisque les femmes n’y connaissaient rien, il ne s’adressait qu’à Gaspard, qui s’y intéressait encore moins.
«Tu verras, le monde des affaires est un monde de requins», l’avait prévenu Tugdual après trois mois chez Michard qu’il avait occupés à s’enfoncer des bûchettes dans la bouche et à péter comme un goret ulcéreux.
La famille de Mathilde, bien élevée et trop peu habituée aux rapports sociaux pour s’en priver totalement, l’écoutait religieusement évoquer ses lourdes responsabilités, ainsi que son salaire qui dépassait – et de loin ! – ses ambitions les plus folles. D’ailleurs, il avait apporté pour l’occasion la feuille de route qui trônait habituellement dans l’entrée. C’était inscrit là, noir sur blanc, au-dessus du trait représentant son vingt-sixième anniversaire : «2 000 € net/mois». Gaspard n’avait qu’à vérifier par lui-même s’il ne le croyait pas. Il n’était pas question de fanfaronner en révélant combien il gagnait aujourd’hui – ça n’était pas son genre – mais il n’avait pas à se plaindre. »
À propos de l’auteur
 Pierre Darkanian © Photo Céline Nieszawer
Pierre Darkanian © Photo Céline Nieszawer
Avec Le Rapport chinois, Pierre Darkanian offre à la littéraire française sa Conjuration des imbéciles. C’est son premier roman. (Source: Éditions Anne Carrière)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
Tags
#lerapportchinois #PierreDarkanian #editionsannecarriere #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2021 #PrixStanislas2021 #selection #prixlitteraire #rl2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #roman #RentréeLittéraireaout2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict