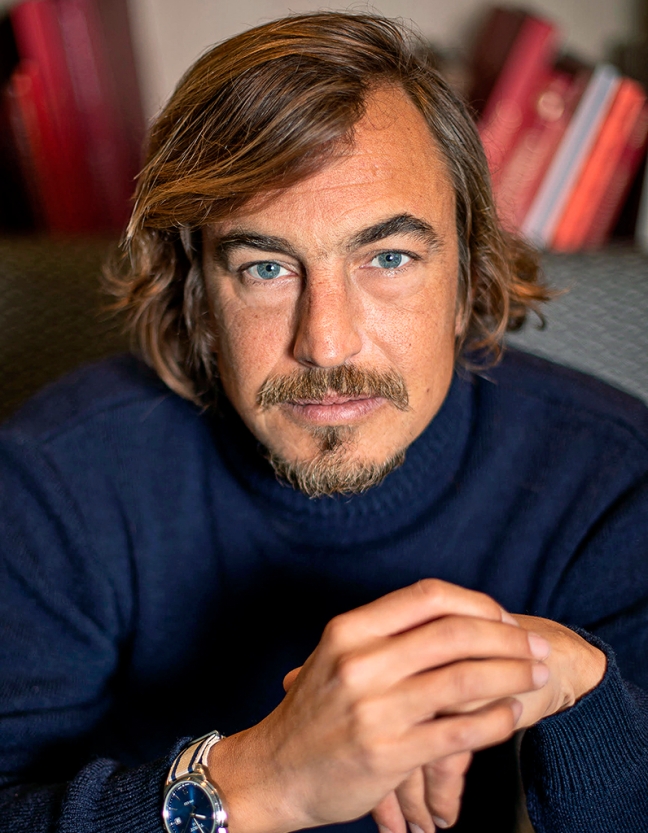En deux mots
Le constat est sans appel pour le narrateur qui perd ses cheveux par touffes: il est victime d’une alopécie. Une atteinte physique difficilement supportable. Après avoir pris la fuite puis essayé tous les traitements, du plus sérieux au plus farfelu, il a bien fallu s’accommoder de cette maladie.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Quand les cheveux tombent par touffes
Noam Morgensztern entre en littérature avec ce roman de l’alopécie. Une chute des cheveux qui le fait d’abord fuir, puis explorer son passé et sa famille et goûter à toutes sortes de traitements. Mais cette atteinte physique est aussi une réflexion sur le rapport qu’on entretient avec son corps.
«Ses poils, ces milliers d’antennes qui s’étiraient vers le frisson, font de ses bras et de ses jambes des blocs anesthésiés au monde. La présence, la caresse, le vent d’une approche et celui d’un départ, tout cela est réduit à la sensation de l’absence.» L’alopécie dont a été victime Adam ne lui a guère laissé de répit. D’un trou sur le crâne qu’il pouvait encore cacher, l’affection s’est développée régulièrement et inexorablement, jusqu’à ce résultat aussi lisse que traumatisant.
Au début, il a eu le réflexe de fuir pour cacher ses touffes de cheveux manquantes aux yeux de ses proches. Sans doute un mélange de honte et un besoin de prendre de la distance avec son drame. Mais dans les rues de Tanger, il n’aura trouvé ni le répit, ni la paix. Car, comme il le confesse, «il m’a été laborieux de planter ma fiction-soignante dans un décor crédible. Avec mon corps déserté, j’étais comme apatride, et le lieu où me retrouver pour y déployer ma fiction était une quête harassante.»
À la maladie s’ajoute désormais les regards et les observations des autres, qu’ils soient bienveillants ou méprisants.
Alors, pour tenter de remédier à ce mal qui le ronge chaque jour davantage, Adam va tout essayer.
Il va consulter encore et encore. Les sorciers et autres rebouteux, malgré leurs promesses, ne parviendront pas à enrayer la chute des cheveux.
Ces faux médecins ne venant qu’ajouter leur incompétence aux vrais spécialistes, également démunis.
Alors Adam va se replier sur lui-même, convoquer l’histoire familiale pour souligner que son destin est tragique, mais qu’il est loin d’être aussi terrible que les déportations, que l’exil vécu aussi bien côté paternel que maternel. Ce qui va entraîner une nouvelle phase de culpabilisation. Même s’il ne peut s’empêcher de vouloir faire de son expérience une manière d’intégrer les misères subies par le clan, d’intégrer une ligne dans une généalogie du malheur.
En passant en revue tous les chocs, toutes les occasions de stresser, Noam Morgensztern se rend compte combien les hypothèses sont fragiles pour expliquer la genèse de sa maladie. Qu’il n’a plus désormais d’autre choix que celui d’accepter de porter son fardeau, lui qui aurait pu sombrer. Il aura finalement, grâce à l’écriture, trouver une voie vers le salut. À un poil près.
Après la peau
Noam Morgensztern
Éditions Riveneuve
Premier roman
224 p., 20 €
EAN 9782360137039
Paru le 11/01/2024
Où?
Le roman est situé à Paris et à Tanger. On y évoque aussi Radzymin, au nord de Varsovie, Tykocin et Bialystok, Gdansk et la mer Baltique, ainsi que Kiev, la Sibérie, Olchany en Biélorussie, Munich, Auschwitz, Marseille et Deauville. Plus tard, on ira aux États-Unis, de l’Arizona à la Californie. Côté maternel, on passe d’Alger à Metz, puis Lille.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Adam est un jeune homme en colère. Un matin, il s’aperçoit que son enveloppe capillaire le quitte, tous ses poils et ses cheveux tombent en masse. Il se retrouve nu et défiguré. Adam se cache, désemparé, il apprend que son corps est en proie à une maladie auto-immune : une alopécie. Son obsession alors, être soigné vite et bien.
Adam plaque tout pour remonter à la genèse de son symptôme, un long périple qui pourrait bien le conduire jusqu’à Tanger s’il ne découvrait en chemin de quoi tout reconsidérer.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Les premières pages du livre
« Par un trou, comme ça, de la taille d’une gommette d’enfant, soudain niché dans sa barbe de trois jours. Ça met la peau à nu d’Adam. Une trace indélébile, mais en creux. Le trou s’épanche, jusqu’aux maxillaires, en même temps qu’il semble se déplacer sur sa joue, son cou, il revient vers le menton, lui glisse au-dessus des lèvres, il a son rythme; le passage du trou désherbe la peau d’Adam. Il croit que le trou s’élargit à mesure qu’il le redoute. Le trou monte, progresse dangereusement vers les tempes; alors soudain quelque chose s’enflamme de conscience et de peur. Adam n’avait pas remarqué que le trou était passé aussi à l’arrière de son crâne, là, ses occiputs seront nus comme deux yeux clos. C’est le vent du matin frais qui lui indiqua la perte; un lambeau de vent sur sa nuque, une caresse du diable. Adam vient de l’apprendre: le diable est une bête à sang froid. L’horizon des pertes monte comme un fleuve engagé, tandis qu’apparaissent de nouveaux trous qui se fondent dans sa calvitie déjà présente. Adam préfère croire à une vieillesse prématurée, il examine les photos de famille, les cheveux de son père, de sa mère, les grands-parents, les sœurs, le frère, il demande à chacun sa nature capillaire, si par chance ils connaissent le diable. Eux répondent qu’ils ne savent pas trop; leurs poils, leurs cheveux, ils laissent faire : Dans la famille on a les cheveux épais, ton père les a fins, mais ta mère les a crépus, ton grand-père c’était une tignasse, ta grand-mère de l’ondulé, ton frère est frisé et tes sœurs la couleur change tout le temps. Le diable est une affaire personnelle. Adam cherche ce que l’hérédité annonçait et qu’il aurait loupé. C’est si soudain. Ça ne peut pas être ça la vieillesse, comme ça, d’un coup, il est jeune encore. Il cherche, sans savoir où aller. C’est autre chose qui le quitte. C’est ce qu’il se dit. Quand il passe la main dans ses cheveux, tous les cheveux restent dans sa main. Le mouton après la tonte. Un scalp de Pow-wow. Les camps aussi. Oui, saisir une poignée de cheveux libres est une image rare, et désarmante.
Il y a le cheveu qui se détache. Il dévoile son bulbe blanc déraciné. Il y a celui qui casse dans sa période la plus délaissée. Il y a celui qui tient et voit tous les autres tomber. Ceux qui n’ont pas cédé – comme se brisent les brindilles d’un nid déserté – perdent rapidement en densité, ils tiennent filasses sur le cuir chevelu défectueux, forment de petits villages traversés par un clair chemin de campagne, avec son clocher isolé qui persiste en épi ridicule. Ses cheveux lâchent sans prévenir, des journées de toile d’araignée qu’il balaie de son visage. Sur l’oreiller, ils s’enroulent en fagots pris dans les bouloches du coton usé. Là encore, balayer, balayer. Au restaurant, il croit le service négligent: il y en a sur la nappe ou dans l’œuf mollet — non, tout vient d’Adam. Quelque temps après, son crâne dévoile des zones finalement nues; alors apparaissent les bosses de l’enfance, des souvenirs de cicatrices, sa varicelle mal soignée — la lune en fait. Adam croit que c’est terminé. Tu crois? Écoute bien sa dissymétrie.
Son sourcil droit s’affaisse en son milieu, en une bruine invisible qui lui luge sur l’œil. Quelque chose qui casse net. Le monde tait sa rumeur pour mieux faire entendre le poil qui se détache de sa peau — tu entends dans le silence de l’automne le bruitage de la feuille qui quitte sa tige? Voilà, c’est ça. Son autre sourcil tient bon, lui ne sait rien de son frère qui est tombé. L’accord du visage d’Adam est rompu. Un double discours, Oui, ses expressions cahotent. L’interlocuteur d’en face cherche la clarté d’un propos qui lui est maintenant brouillé. Ça le rend perplexe, l’autre, le visage d’Adam cahin-caha, il a le sentiment qu’Adam lui ment un peu, qu’il n’écoute pas bien, qu’il se fout de sa gueule, ou la mine impassible, et sa propre concentration s’altère, il est perdu, l’autre, et ça l’énerve. Un simple dialogue devient un carnet de rendez-vous manqués. Puis l’autre sourcil tombe. Il n’a rien vu, Adam, rien entendu, le silence de la terre qui tourne. Le voilà avec deux arcs-en-ciel monochromes. Avant, ses sourcils formaient un petit auvent que le soleil rabaissait et faisait plus remarquer, ils encadraient son paysage. Maintenant, son champ visuel s’est élargi en même temps qu’il s’est fragilisé. L’action de voir se dilue dans un monde trop grand, trop plein — à quoi se tenir s’il n’y a plus les bords du bassin ? Durant des années, ses sourcils avaient travaillé la précision de quelques intentions, celles du masque de la vie: la Joie, la Peur, la Colère, la Tristesse, et l’Amour qui les contient tous. Ses sourcils surtitraient la pudeur de ses émotions. Mais à présent, qui aimerait un être sans projet? C’est une catastrophe, crois-moi, de voir son visage invariable et réduit à l’étonnement de tout.
Les cils maintenant. Ils tombent et tous ses vœux sont foutus. Soudain ses yeux se mettent à pleurer abondamment parce que le vent, parce que la poussière et l’air douteux des grandes villes. Plus rien ne retient son liquide lacrymal qui, comme la salive, doit se renouveler. Plus vulnérables qu’avant, ses yeux sont à la merci de n’importe quelle brise, souffle, courant d’air ou effluve. Son œil droit lâche en permanence une larme de saletés. Ses yeux s’arrondissent aussi. Ses cils d’avant étiraient le regard en format seize neuvièmes, mais maintenant son regard est comme hébété de ne plus avoir d’étendue. Son œil est plus rond, plus petit, plus naïf. Adam retourne vers quelque chose du poisson. Au revoir le regard espiègle, l’œil sournois, la plissure du charme, l’art de toiser quelqu’un, bye-bye le blink de la drague — comme si on pouvait sceller des intentions. Ses paupières déshabillées sont deux moules, molles et fripées, surlignées de rouge et à la lisière sans accroc. Le battement de ses paupières, jadis ralenti par l’éventail des cils, est désormais net et invisible. Son regard en couperet fade. On dirait aussi que ses yeux veulent rentrer au plus profond de leur cavité, tellement ils ont honte d’être nus.
De profil, son visage se résume au front bombé, l’arête du nez, tremplin de la bouche et jusqu’à la protubérance du menton. Rien qui accroche le regard. Ou plutôt si : tout retient les regards alentour. Les autres, son visage les happe. Ils ne voient pas tout de suite ce qui les attire, mais pressentent que quelque chose manque à son dessin. Ils ne savent pas quoi. Lui non plus, Adam ne comprend plus rien.
Ça continue. Dans le mouchoir se trouvent ses courts poils du nez, devenus inutiles. Plus rien ne le chatouille, ni ne filtre. Désormais ses narines sont deux conduits dégagés qui se rejoignent jusqu’à sa gorge en un tuyau totalement vulnérable. Alors sa langue et ses amygdales: des buvards s’encrassent à chaque inspiration; ses poumons: la poubelle. Le froid d’hiver le brûle, ça grimpe plus haut la giclée de menthe. N’importe quel parfum qui passe l’agresse, l’aveugle, en même temps que les odeurs se lissent. Toutes les filles sont de la vanille chimique et les garçons du poivre tiède: et une vieille orange pour les camions poubelles, C’est ça, son nouveau monde intérieur. L’oxygène pénètre dans son nez par blocs et plus du tout par bouffées. L’air l’irrite et fait gonfler ses sinus au point d’y former un étau permanent qui réduit aussi sa cavité nasale, il siffle et s’effile dans le passage devenu étroit. On disait renifler, mais tout coule chez lui maintenant. Aucune branche pour la rosée. Alors déglutir, déglutir. Déglutir comme on essore du linge incontinent. Chez les vieillards, Adam remarque que des poils gris leur sortent des narines comme une touffe d’herbe déracinée, les poils des vieux tortillent vers le sol et la lumière. Mais lui, il n’a plus d’âge, maintenant, Adam. Ou alors c’est un vieux bébé.
Tout va disparaitre. Jamais plus il n’aura la barbe du soi-disant sage, celle du soi-disant grand traducteur des lois divines, celle du bûcheron bonhomme, celle de l’homme moderne huilée au chanvre, celle du package hipster-coworking-café. Plus jamais la barbe négligée de l’artiste peintre, ou celle du poète
qui laisse le vent y enfanter; plus jamais la barbe qui frotte, la barbe qui gratte, adieu la barbe de trois jours, de cinq jours — d’aucun jour. Son relief à tailler du visage est banni. Il n’a qu’une seule vie, mais comment admettre que toutes les autres apparences lui sont désormais exclues, lui qui ne sait me plus à quoi il ressemble. Adam commettrait crime que son portrait-robot prendrait une seconde – à main levée: Nous recherchons un œuf! Exit le crime. Certains lui disent : Quelle aubaine de ne plus avoir à se raser le matin! Tu vas garder un visage éternellement jeune et lisse. Il ne les écoute pas, les gens froids. Ils ne comprennent pas la perte du geste de s’occuper de soi. Un visage éternellement une et lisse, des insensés. La mort à la peau douce. Tous les picots de la repousse de ses poils drus, jadis coupés à la triple lame de la publicité, comme les sillons d’un vinyle sur lesquels sa main ripait pour faire entendre la musique de ses pensées en mouvements. Tout est encore plus dématérialisé.
Les bruits qu’il était seul à entendre – le battement des cils, les sourcils qui en s’étonnant frottaient la monture de ses lunettes, ou le son électrique de ses cheveux qui ployaient sur l’oreiller, le soir dans le lit, ou encore sa main qui grattait sa barbe naissante en un feu qui crépite, et tous les autres poils dans un son de tabac à rouler – ont disparu.
Son visage qui se lisse se tait aussi. Ce qu’il avait d’homogène et d’accueillant est maintenant une porte fermée. Son visage est une masse. Son visage est une fesse.
Adam repense à cette fille qui parlait la langue des signes. Pour se dire leurs prénoms, il fallait se trouver un signe distinctif. Elle avait un grain de beauté sur la pommette droite, alors Adam levait son doigt, pointait sur lui son grain de beauté à elle et c’est elle qu’il nommait. Elle lui répondait en croisant les bras sur sa poitrine, et ses mains placées au-dessus de ses épaules jetaient ses doigts, un jet sec, une seule fois, pour signifier les nombreux poils désordonnés qui s’affolaient à la surface des épaules d’Adam. Elle l’avait déjà vu tout nu. C’était ça, le nom d’Adam, pour elle. Un doigt sur la pommette, un jet sec des épaules. Maintenant les épaules d’Adam sont deux quilles lisses et froides. Un doigt sur la pommette, une caresse qui lui tombe des épaulettes.
Lentement aussi, le creux de ses aisselles dévoile le tracé clair d’un quartier détruit en pointillé. Un monde déraciné. La bille de son déodorant est une tête chercheuse chauve et débile qui rentre bredouille.
Ses poils se défont après la douche, quand la serviette l’efface. Adam ramasse dans le siphon son amalgame de poils qui lui viennent des quatre coins du corps. Ses poils les plus tenaces finissent par se perdre dans les manches des pulls, les plis du jean. Vient quelque chose du stéréotype féminin : ses bras sont de lisses présentoirs à bijoux, ses jambes prêtes à un défilé de mannequins en plastoc. Faillite des salons de beauté. Son mollet à nu est appétissant comme un sanglier de BD. Ses poils, ces milliers d’antennes qui s’étiraient vers le frisson, font de ses bras et de ses jambes des blocs anesthésiés au monde. La présence, la caresse, le vent d’une approche et celui d’un départ, tout cela est réduit à la sensation de l’absence, si un toucher brusque ne la contredit pas.
Même les fleurs ont des poils. Les insectes ont des poils. Tout ce qui veut sentir la vie autour a des poils. Lui n’a plus rien. Un galet blanc. Une salamandre. Salamandridae vulnerabili, dira un savant, heureux de son latin, lunettes rondes et barbichette. »
Extraits
« Si j’ai pris ce long temps pour te reparler de ces lieux — le salon de chez Boris, la ville de Tanger, le cimetière —, ce n’est pas pour justifier que j’ai beaucoup travaillé, et jusqu’à l’aboutissement d’un échec, mais d’abord pour te dire combien il m’a été laborieux de planter ma fiction-soignante dans un décor crédible. Avec mon corps déserté, j’étais comme apatride, et le lieu où me retrouver pour y déployer ma fiction était une quête harassante. » p. 41
« Mais l’alopécie n’est pas la mort, pas exactement. Elle est plutôt le stigmate de son découragement. Oui, l’alopécie — la pelade — nous déshabille de notre vivant; la mort prépare son visage jaune, enchaîne sur l’apparence d’un corps terminé, partie pour l’effeuillage total et indolore, et puis un moment elle s’arrête — le train au milieu du paysage —, la mort s’arrête, perdue: la chose — le corps — est laissée à l’état de friche, la mort «ne sait plus». Il y a une forme de suicide raté dans l’alopécie, quelque chose qui ne marche plus, un mauvais rouage. Le défunt n’est pas mort!, dit Toinette dans le Malade imaginaire. La personne allongée, dans son terrible coma végétatif, dont la vie dépend de tuyaux, de liquides, de pompes, et de lois qui empêchent d’y mettre un terme pour la soulager, soulager la famille, soulager l’hôpital — avec l’alopécie, ce n’est pas possible : il n’y rien à débrancher, rien à soulager, rien à décider pour son propre corps, ni pour l’alopécie des autres. Attendre. Ne rien attendre. On est abasourdi de se retrouver dans cet état lourd et silencieux d’un entre-deux monde laissé. Le Purgatoire en mode urbex. » p. 85
À propos de l’auteur
 Noam Morgensztern © Photo DR
Noam Morgensztern © Photo DR
Noam Morgensztern est comédien, musicien et technicien du son. Enfant, il suit des cours de piano et de comédie à Toulouse. En 2000, alors élève au Cours Simon, il découvre le doublage et prête sa voix pour des films comme La Pianiste de Mickael Haneke et La Chambre du fils de Nanni Moretti. En parallèle du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, qu’il rejoint en 2003, Noam Morgensztern se forme aux métiers du son à l’Institut national de l’audiovisuel et aux principes de la musique classique et du piano à la Jerusalem Academy of Music and Dance. Au Conservatoire, il joue dans Richard II de Shakespeare mis en scène par Andrzej Seweryn, Les Cancans et La Femme fantasque de Goldoni par Muriel Mayette-Holtz et Le Songe de Strindberg par Lukas Hemleb. Avec Dominique Valadié, il aborde des scènes issues de 4.48 Psychose de Sarah Kane et travaille avec Michel Fau des extraits de Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Sous la direction de Daniel Mesguich, il interprète le rôle-titre dans un extrait de Platonov de Tchekhov. Au théâtre, il joue notamment avec la compagnie Les Sans Cou dans des mises en scène d’Igor Mendjisky, Le Plus Heureux des Trois et Masques & Nez. Il interprète également plusieurs spectacles sous la direction de Victor Quezada dont Petit boulot pour vieux clown de Matei Visniec, Pablo Neruda, il y a cent ans naissait un poète (une lecture de textes et de poèmes écrits par Pablo Neruda) et Victor Jara, une création musicale en hommage à l’auteur-compositeur-interprète populaire chilien. En 2007, Noam Morgensztern met en scène Car cela devient une histoire, autour de l’œuvre de Charlotte Delbo, sur des musiques de Franz Léhar.
Il entre à la Comédie-Française en 2013 pour reprendre le rôle d’Arlequin sur la tournée du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Galin Stoev. Il poursuit son exploration du répertoire classique en jouant Molière dans les mises en scène de Claude Stratz du Malade imaginaire et d’Hervé Pierre de George Dandin, Shakespeare dans celles de Robert Carsen pour La Tempête, Léonie Simaga pour Othello, de Muriel Mayette-Holtz pour Le Songe d’une nuit d’été et, plus récemment de Thomas Ostermeier pour La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez. Il joue sous la direction de Jean-Pierre Vincent dans La Dame aux jambes d’azur de Labiche, Christophe Lidon dans La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt, Anne Kessler dans La Ronde d’après Schnitzler et Julie Deliquet dans Vania d’après Tchekhov, metteuse en scène qu’il retrouve la saison dernière dans Fanny et Alexandre d’après Bergman. En 2017, Christian Hecq et Valérie Lesort le mettent en scène dans 20 000 lieues sous les mers d’après Jules Verne. En 2019, Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux l’engagent dans l’aventure musicale des Serge (Gainsbourg point barre) et il joue également dans Jules César de Shakespeare par Joseph Dana. Dans le cadre du Festival Singulis, il propose Au pays des mensonges, un seul-en-scène composé de nouvelles de l’auteur israélien Etgar Keret.
Au cinéma, il tourne entre autres pour Marc-Henri Dufresne dans Le Voyage à Paris et pour Valérie Donzelli dans Que d’amour, une adaptation du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux. À la télévision, il est dirigé par Caroline Huppert dans J’ai deux amours, par Amos Gitaï dans Plus tard tu comprendras et par Dominique Ladoge dans La Loi de mon pays, un rôle qui lui vaut le prix du Meilleur espoir masculin au Festival de La Rochelle en 2011. Le réalisateur Benjamin Abitan lui demande d’incarner Tintin dans les adaptations radiophoniques des albums d’Hergé par les Comédiens-Français dans la série Tintin diffusée sur France Culture.
Noam Morgensztern participe à la création de la Web TV La Comédie continue! mise en place lors du premier confinement de mars 2020 et à la programmation en ligne qui a suivi. Il prête sa voix aux livres tels que La Bible des écrivains (Bayard, sous la direction de Frédéric Boyer) et à ceux de Christian Bobin, Paul Claudel, Jack Kerouac, Timothée de Fombelle. Après la peau est son premier roman.
(Source: Comédie Française / Éditions Riveneuve)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Tags
#apreslapeau #NoamMorgensztern #editionsriveneuve #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #premierroman #alopecie #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie









 Manon Hentry-Pacaud © Photo DR
Manon Hentry-Pacaud © Photo DR