Lauréate du Palmarès Livres Hebdo des libraires 2023
En deux mots
Quand sa mère meurt tragiquement Joan a 6 ans. Sa grand-mère la recueille et la rebaptise Amelia. Mariée et mère d’un petit garçon, elle vit un nouveau drame et se retrouve seule, décidée à en finir. Finalement, elle quitte la Californie dans un bus brinquebalant jusqu’en Amérique centrale. Là, elle trouve son paradis, même s’il est entouré de serpents.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
La réfugiée de la Llorona
Joyce Maynard nous offre une nouvelle preuve de son talent avec ce riche roman, aux multiples rebondissements. Il raconte le destin tragique d’une femme qui, après avoir perdu sa mère, puis son mari et son fils, trouve refuge en Amérique centrale où elle va tenter de se reconstruire, en essayant d’oublier les fantômes du passé. Brillant!
«J’avais vingt-sept ans quand j’ai décidé de sauter du Golden Gate Bridge. L’après-midi j’avais une vie merveilleuse et, une demi-heure plus tard, je ne voulais plus que mourir.» Quel incipit! Avouez que vous avez d’emblée envie de savoir ce qui peut motiver une jeune femme à vouloir en finir avec la vie.
C’est ce que Joyce Maynard va nous raconter en revenant sur le parcours de son héroïne, mais aussi et surtout en nous dévoilant ce qui s’est passé après être monté sur le célèbre pont de San Francisco.
Joan a connu une enfance plutôt heureuse, même si la carrière de sa mère Diana – une chanteuse que l’on comparait à Joan Baez – la contrainte à se retrouver souvent seule. Mais elle a trouvé le moyen de s’évader grâce à ses crayons de couleur. Mais un premier drame va venir la frapper, alors qu’elle n’a pas sept ans. Sa mère meurt à New York dans des circonstances troubles. Un groupuscule terroriste, le Weather Underground, provoque un accident mortel en tentant de fabriquer une bombe et Diana figurait dans la liste des victimes. «Dans l’un des bulletins d’informations qui passa à l’antenne dans les jours suivant l’explosion, une photo de ma mère tirée de son annuaire du lycée apparut à l’écran. Elle était beaucoup plus jolie en vrai que sur la photo qu’ils montrèrent. Un reporter colla un micro devant une femme qui se révéla être l’épouse du policier décédé. «J’espère qu’elle brûle en enfer comme les autres», dit-elle. C’est à ce moment-là que nous avons changé de nom et sommes devenues Renata et Amelia.»
Joan ne comprend pas vraiment pourquoi elle s’appelle désormais Amelia, ni pourquoi sa grand-mère devient Renata, mais elle obéit et suit son aïeule. Elle n’aura plus l’occasion de voir son père non plus, ce dernier ayant promis de rester loin d’eux.
Les années vont passer, sa passion pour le dessin s’affirmer sans pour autant que ses blessures ne se referment. C’est quand elle va croiser Lenny qu’elle va croire le bonheur possible. Celui qui va devenir son mari est attentionné et aimant. Ensemble, ils rêvent de construire une famille. Quand naît leur fils Arlo, ils sont aux anges.
Mais un nouveau drame vient frapper leur paisible existence. En courant derrière un ballon, Arlo et son père, qui tentait de le rattraper, sont fauchés par une voiture et meurent sur le coup. Dès lors, on comprend l’envie d’Amelia d’en finir. Sauf qu’au moment de faire le grand saut, elle s’est souvenue de cette phrase de Lenny: «quand on a atteint le fond, on ne peut que remonter.»
Alors plutôt que de mourir, elle va rassembler quelques affaires et prendre le premier bus, sans vraiment connaître sa destination. Sur la route, au gré des rencontres et du hasard, elle va laisser le destin la guider. Et arriver en Amérique centrale dans un village au bord d’un lac et d’un volcan, dans un hôtel baptisé La Llorona, une sorte de petit paradis sur terre: «L’hôtel ressemblait à la maison d’un conte de fées. Partout où je posais le regard, je découvrais un détail extraordinaire, sans doute une création de Leila ou des gens du village: pas seulement les pierres transformées en singes, jaguars ou œufs, mais les plantes grimpantes qui formaient des tonnelles ruisselaient de fleurs épanouies évoquant les visions les plus folles d’un trip au LSD, les cours d’eau artificiels serpentaient dans les jardins, butaient sur des pierres lisses et rondes – quelques-unes vertes, sous une certaine lumière en tout cas, d’autres presque bleues. Un banc de pierre était creusé à flanc de colline. Il y avait aussi une méridienne qui semblait faite d’un seul tronc d’arbre. Un vieux bateau de pêche en bois, sur lequel s’empilaient des coussins, était suspendu à un arbre. De son tronc jaillissaient une demi-douzaine de variétés d’orchidées et une chouette taillée elle-même dans une loupe de bois.»
Commence alors, au fil des rencontres et des destins des habitants mais aussi des clients de l’hôtel, le roman d’une reconstruction. Mais comme tout paradis, il est entouré de serpents et ce chemin de résilience sera semé d’obstacles. La propriétaire de l’hôtel qui l’a accueillie va mourir et lui laisser gérer l’endroit. Une tâche délicate car tous ne voient pas d’un très bon œil cette étrangère leur dicter leur conduite. Mais Amelia a appris à affronter les problèmes lorsqu’ils surviennent, qu’ils soient petits ou gigantesques. Et à tenter de trouver dans l’adversité un nouveau chemin sur lequel elle pourra avancer. Jusque vers l’autre rive.
Joyce Maynard fait preuve d’une rare maîtrise de la narration pour tisser une histoire avec l’autre, pour s’imprégner de la magie d’un lieu, pour nous en décrire toute la sensualité. Elle enrichit aussi son roman de légendes, plus ensorcelantes et mystérieuses les unes que les autres, sans pour autant perdre le fil d’un récit qui court sur quatre décennies. Car l’écriture est toujours très fluide, les descriptions – en particulier la flore et la faune – précises, le rythme d’une grande musicalité. Et le tout accompagné d’un final éblouissant.
Comme le dit Gabriel García Márquez dans L’Amour aux temps du choléra, cité en exergue du livre: «Considérer l’amour comme un état de grâce qui n’était pas un moyen mais […] une fin en soi.»
Playlist
La Llorona, le nom de l’hôtel, fait référence à une chanson traditionnelle mexicaine sur une mère qui arpente la terre en pleurant la mort de ses enfants.
Dos besos llevo en el alma, Llorona,
que no se apartan de mí.
Dos besos llevo en el alma, Llorona,
que no se apartan de mí.
El último de mi madre, Llorona,
y el primero que te di.
El último de mi madre, Llorona,
y el primero que te di.
Je porte deux baisers dans mon cœur, Llorona,
qui jamais ne me quitteront.
Je porte deux baisers dans mon cœur, Llorona,
qui jamais ne me quitteront.
Le dernier que m’a donné ma mère, Llorona,
et le premier que je t’ai donné.
Le dernier que m’a donné ma mère, Llorona,
et le premier que je t’ai donné.
«La Llorona»
Angela Aguilar interprète La Llorona © Production Angela Aguilar Oficial
L’hôtel des Oiseaux
Joyce Maynard
Éditions Philippe Rey
Roman
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Florence Lévy-Paoloni
528 p., 25 €
EAN 9782384820313
Paru le 24/08/2023
Où?
Le roman est situé principalement en Amérique centrale, au Guatemala – même si le pays n’est pas précisé – et aux États-Unis, de New York à San Francisco, en passant par Poughkeepsie dans l’État de New York, puis en Caroline du Nord, en Floride et en Californie. On y évoque aussi une île de la Colombie-Britannique.
Quand?
L’action se déroule des années 1970 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
1970. Une explosion a lieu dans un sous-sol, à New York, causée par une bombe artisanale. Parmi les apprentis terroristes décédés : la mère de Joan, six ans. Dans l’espoir fou de mener une vie ordinaire, la grand-mère de la fillette précipite leur départ, loin du drame, et lui fait changer de prénom : Joan s’appellera désormais Amelia.
À l’âge adulte, devenue épouse, mère et artiste talentueuse, Amelia vit une seconde tragédie qui la pousse à fuir de nouveau. Elle trouve refuge à des centaines de kilomètres dans un pays d’Amérique centrale, entre les murs d’un hôtel délabré, accueillie par la chaleureuse propriétaire, Leila. Tout, ici, lui promet un lendemain meilleur : une nature luxuriante, un vaste lac au pied d’un volcan. Tandis qu’Amelia s’investit dans la rénovation de l’hôtel, elle croise la route d’hommes et de femmes marqués par la vie, venus comme elle se reconstruire dans ce lieu chargé de mystère. Mais la quiétude dépaysante et la chaleur amicale des habitants du village suffiront-elles à faire oublier à Amelia les gouffres du passé ? A-t-elle vraiment droit à une troisième chance ?
Dans ce roman foisonnant, Joyce Maynard, avec la virtuosité qu’on lui connaît, emporte les lecteurs sur quatre décennies. Riche en passions et en surprises, L’hôtel des Oiseaux explore le destin d’une femme attachante, dont la soif d’aimer n’a d’égale que celle, vibrante, de survivre.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France TV Culture (Laurence Houot)
Les Échos (Isabelle Lesniak)
Le Devoir (Christian Desmeules)
Madame Figaro (Minh Tran Huy)
Femina.fr (Anne Michelet)
Blog Aude bouquine
Le livre du jour (Frederic Koster)
Les premières pages du livre
Le pays où se déroule cette histoire, s’il évoque par certains aspects différents lieux d’Amérique centrale, est une invention de l’autrice. C’est également le cas du lac, du volcan, de l’hôtel, des habitants du village, de l’herbe magique, des lucioles qui n’apparaissent qu’une fois par an, une nuit seulement. De nombreuses espèces d’oiseaux décrites dans ces pages n’existent pas réellement. Cette histoire peut être qualifiée de chimère ou simplement de rêve. La partie sur le pouvoir de l’amour – et la capacité de ceux qui en vivent les effets à accomplir l’impossible – est réelle et authentique.
« Une chose sur les temps difficiles
J’avais vingt-sept ans quand j’ai décidé de sauter du Golden Gate Bridge. L’après-midi j’avais une vie merveilleuse et, une demi-heure plus tard, je ne voulais plus que mourir.
J’ai pris un taxi. Je suis arrivée près du pont juste après le coucher du soleil. Il se dressait dans le brouillard avec cette magnifique teinte rouge que j’adorais, quand je m’intéressais encore à la couleur des choses et des ponts, lorsque je les traversais. À l’époque où je m’intéressais à tant de choses qui me semblaient à présent dénuées de sens.
Avant de quitter pour la dernière fois mon appartement, j’avais fourré un billet de cent dollars dans ma poche. Je l’ai donné au chauffeur. Attendre la monnaie était inutile.
Il y avait des touristes, bien sûr. Des voitures circulant dans les deux sens. Des parents avec leurs enfants dans des poussettes. J’avais été comme eux.
Un bateau passait sous le pont. De là où je me trouvais, me préparant à sauter, je l’ai regardé s’engager entre les piles. Des hommes lavaient le pont du bateau. Plus rien n’avait de sens.
J’avais vaguement conscience qu’un homme âgé m’observait. Peut-être chercherait-il à m’arrêter. J’ai attendu qu’il s’en aille, ce qui s’est produit quelques minutes plus tard.
Sauf que j’étais incapable de faire le dernier pas, de monter sur le garde-fou, de passer par-dessus.
Lenny avait dit, un jour que le chèque de notre loyer avait été rejeté, la semaine où Arlo avait été renvoyé du jardin d’enfants parce qu’il avait des poux, que j’avais attrapé une mononucléose et qu’une canalisation avait éclaté dans l’appartement, détruisant une pile de dessins sur lesquels je travaillais depuis six mois : « Une chose sur les temps difficiles : quand on a atteint le fond, on ne peut que remonter. »
Debout sur le pont, tandis que je contemplais l’eau sombre et ses remous, je crois que j’ai compris autre chose. Même si ce que je vivais était affreux, une petite partie de moi ne pouvait pas abandonner le monde. Pleurer un deuil immense, comme je le faisais, devait servir d’une certaine façon à me rappeler que la vie était précieuse. Même la mienne. Même alors.
Je me suis éloignée du garde-fou.
Je ne pouvais pas le faire. Mais je ne pouvais pas non plus rentrer chez moi. Je n’avais plus de chez-moi.
C’est ainsi que je me suis retrouvée à l’hôtel des Oiseaux.
1
1970
À partir d’aujourd’hui, tu t’appelles Amelia
Nous avons entendu l’information à la télévision, deux semaines avant mon septième anniversaire. Ma mère était morte. Le lendemain matin, ma grand-mère m’annonça qu’il nous fallait changer mon nom.
J’étais assise à la table de la cuisine – Formica jaune parsemé d’éclats en forme de diamants, éternel paquet de Marlboro Light de ma grand-mère, mes crayons de couleur disposés dans leur boîte en fer. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner, mais ma grand-mère ne décrochait pas.
« Ils peuvent tous aller au diable », maugréait-elle. Elle avait l’air en colère, mais pas contre moi.
Bizarre, les souvenirs. Je m’accrochais à mon crayon. Tout juste taillé. Bleu. Le téléphone sonnait sans arrêt. J’ai fait le geste de décrocher, mais Grammy m’a dit non.
« Les gens vont nous poursuivre. Ils auront tout un tas d’opinions. Il vaut mieux qu’ils ne fassent pas le rapport », m’expliqua ma grand-mère en prenant une cigarette.
Opinions sur quoi ? Rapport ? Quels gens ?
« On ne peut laisser personne découvrir qui nous sommes. Tu ne peux plus t’appeler Joan », décréta Grammy.
À vrai dire, j’avais toujours voulu un autre prénom que celui que ma mère m’avait donné, celui de sa chanteuse préférée. (Baez, pas Joni Mitchell. Même si elle les adorait toutes les deux.) Je lui demandais souvent de m’appeler autrement. (Liesl, comme l’une des enfants de La Mélodie du bonheur. Skipper, comme la petite sœur de Barbie. Tabitha, comme dans Ma sorcière bien-aimée.)
« Je peux m’appeler Pamela ? » demandai-je.
C’était le prénom d’une fille de l’école qui avait des cheveux magnifiques. J’adorais sa queue-de-cheval.
Grammy répondit que ça ne marchait pas comme ça. Elle avait déjà choisi mon nouveau prénom. Amelia.
Alice, une amie de Grammy au club de bridge, avait une petite-fille de mon âge. Je ne l’avais vue qu’une seule fois. Amelia. Elle était morte quelque temps auparavant. (D’un cancer, j’imagine, mais on ne prononçait pas ce mot à l’époque.) Après quoi, Alice avait cessé de venir au club de bridge.
Ma grand-mère raconta quelque chose que je ne compris pas au sujet d’un papier nécessaire avec mon nom dessus pour aller à l’école et prouver que j’existais.
« J’existe.
– C’est trop compliqué à expliquer », dit-elle. Il fallait qu’on déménage tout de suite. J’irais dans une autre école. On ne me laisserait pas entrer au cours préparatoire sans les papiers. Elle savait comment s’y prendre. Elle l’avait vu dans un épisode de Columbo.
L’après-midi même, nous sommes allées en bus jusqu’à un immeuble où ma grand-mère a rempli plein de papiers. J’étais assise par terre et je dessinais. Quand nous sommes parties, nous avions mon nouveau certificat de naissance. « C’est officiel. Maintenant, tu es Amelia », m’apprit-elle.
J’avais aussi un nouvel anniversaire, le même que celui d’Amelia qui était morte. Il me manquait maintenant deux mois avant mes sept ans. Ce n’était que l’un des nombreux événements qui se produisirent les jours suivants et qui me perturbèrent. « Ne pose pas autant de questions », répétait Grammy.
Ma grand-mère changea aussi de nom. Esther devint Renata. Pour moi elle était toujours Grammy, alors c’était facile. Il me fallut un certain temps pour me rappeler que j’étais Amelia et pas Joan. J’étais en train d’apprendre les majuscules. Je maîtrisais bien le « J », mais je devais tout recommencer avec le « A ».
Un carton arriva avec, à l’intérieur, des vinyles. Je les reconnus tout de suite : ceux de ma mère. L’écriture sur le carton était la sienne.
Quelques jours plus tard, les déménageurs vinrent. Ma grand-mère avait emballé toutes nos possessions, peu nombreuses en fait. Quand ils eurent emporté le dernier carton – ma poupée Tiny Tears, quelques livres, ma collection d’animaux en porcelaine, le ukulélé que ma mère m’avait offert pour mes six ans et dont je ne savais pas jouer, mes crayons de couleur –, je regardai par la fenêtre les hommes charger le camion. Personne n’avait dit où nous allions. On partait, voilà tout.
« Tu vois cet homme avec l’appareil photo ? demanda ma grand-mère en le montrant du doigt. Voilà pourquoi nous devons partir. On ne nous laissera plus jamais tranquilles. »
Qui ?
Les paparazzi. « Ceux-là mêmes qui ont rendu la vie impossible à Jackie Kennedy, au point qu’elle a été obligée d’épouser ce vieux bonhomme affreux avec son yacht. »
Je ne comprenais rien du tout. Le week-end suivant, nous défaisions les cartons dans notre nouvelle maison, un appartement avec une seule chambre à Poughkeepsie, dans l’État de New York, où vivait mon oncle Mack, le frère de Grammy. Il l’appelait toujours Esther, mais comme il ne m’avait vue que deux fois, ça ne lui a pas été difficile de m’appeler Amelia. Le premier soir, il nous commanda des plats à emporter chinois. Je lui tendis le petit papier plié dans mon biscuit.
« Une tasse est utile quand elle est vide », lut-il.
Il y avait une ombrelle en papier sur la table. Ouverte fermée, ouverte fermée.
Grammy trouva du travail dans un magasin de tissu. Comme ma mère ne s’était jamais occupée de me faire entrer à l’école maternelle, l’année précédente, elle m’inscrivit au cours préparatoire à l’école élémentaire Clara Barton. Par la suite, je n’ai posé qu’une seule fois des questions sur ma mère. J’avais l’impression que je n’étais pas censée parler d’elle et je ne le faisais pas.
Il n’y avait pas eu d’obsèques. Personne ne vint nous dire combien ils étaient navrés de ce qui était arrivé. Si Grammy possédait des photos de ma mère, elle les gardait dans un endroit qui m’était inconnu. En l’absence d’une image d’elle, j’en dessinai une que je glissai sous mon oreiller. Joues roses, yeux bleus, bouche en bouton de rose. Longs cheveux bouclés comme une princesse.
Quand, à l’école, les enfants me demandaient pourquoi je vivais avec ma grand-mère et pourquoi ma mère n’était jamais là, je répondais qu’elle était une chanteuse célèbre, mais que je n’avais pas le droit de dire laquelle. Elle était en tournée avec son groupe et répétait pour un spectacle au Hootenanny.
« Ça ne passe plus à la télé, dit un certain Richie qui fichait toujours la pagaille.
– Je voulais dire The Johnny Cash Show. Je les confonds toujours. »
Au bout d’un moment, il y eut moins de questions, mais de temps en temps un enfant demandait encore quand elle allait rentrer, si j’allais partir à Hollywood et si je pouvais leur donner un autographe.
Je répondais qu’elle s’était cassé la main. La main gauche, mais elle était gauchère. Je trouvais que cela rendait le mensonge plus convaincant.
« Je parie que ta mère n’est pas vraiment célèbre. Je parie qu’elle est bête, comme la grand-mère dans Beverly Hillbillies, dit Richie.
– Ma mère est très belle », assurai-je. Ça au moins, c’était vrai.
Les cheveux noirs et brillants de ma mère lui arrivaient à la taille et j’adorais les brosser. Elle avait de longs doigts élégants (mais des ongles sales) et elle était si mince que quand nous étions allongées toutes les deux sur un matelas pneumatique, dans l’un des campings où nous vivions toujours à l’époque, je pouvais suivre ses côtes du doigt. Je me souvenais surtout de sa voix, un pur soprano sans faiblesse. Elle avait une si bonne oreille (son talent pour la musique était bien meilleur que son talent pour choisir les hommes) qu’elle pouvait chanter une mélodie complexe en mode mineur sans le soutien d’une guitare, même si elle n’éprouvait apparemment aucune difficulté à trouver un beau guitariste folk barbu pour l’accompagner.
On la comparait à Joan Baez, mais son petit ami, Daniel – celui avec qui elle était le plus souvent (par intermittence) durant mes six premières années jusqu’au mois précédant l’accident –, prétendait que non, elle ressemblait davantage à la sœur cadette de Joan, Mimi Fariña. La plus jolie, avec la voix plus douce.
Elle chantait tout le temps pour moi, dans la voiture tard le soir ou quand nous nous apprêtions à dormir sous notre tente dans le sac de couchage que nous partagions. Elle connaissait toutes les vieilles ballades anglaises – des chansons sur des hommes jaloux qui jettent la femme qu’ils aiment dans la rivière parce qu’elle ne veut pas les épouser, sur des femmes au cœur pur promises à un noble, qui lui préfèrent un humble roturier et s’aperçoivent qu’il est le plus riche du pays.
Elle chantait pour m’endormir tous les soirs. Les chansons faisaient office d’histoires.
Twas in the merry month of May, when green buds all were swellin’… Sweet William on his death bed lay. For love of Barbara Allen 1.
« Est-ce qu’on peut vraiment mourir parce qu’on aime trop quelqu’un ? lui demandais-je.
– Seulement si on est un vrai romantique, répondait-elle.
– Est-ce que tu es une vraie romantique ?
– Oui. »
Certaines chansons de ma mère risquaient plus de me tenir éveillée que de m’endormir.
I’m going away to leave you, love. I’m going away for a while. But I’ll return to you some time. If I go ten thousand miles 2.
Quand elle chantait « Je vais partir », j’étais inquiète. C’était mieux quand elle chantait « Je reviendrai », peu importait comment. « Ce n’est qu’une chanson », m’expliquait-elle.
Mais l’une de ces vieilles ballades me faisait une peur bleue, « Long Black Veil ». J’étais couchée et je serrais dans mes bras la girafe que Daniel avait gagnée pour moi un jour dans une fête foraine en faisant exploser cinq ballons de suite avec des fléchettes. Même si j’avais entendu ma mère chanter cent fois cette chanson, j’en redoutais la fin.
Late at night when the north wind blows… In a long black veil she cries o’er my bones 3.
Drôle de choix pour une chanson censée m’endormir, mais ma mère était ainsi.
« Arrête ! » criais-je de mon lit – ou du matelas, quel qu’il soit, sur lequel elle m’avait couchée – chaque fois qu’elle chantait « Long Black Veil » et qu’elle en arrivait là. Elle se taisait et je la suppliais de continuer. J’aimais tellement sa voix. Même quand les paroles me donnaient des cauchemars.
Ma mère voulait que je l’appelle Diana. Elle disait que m’entendre l’appeler Maman lui donnait l’impression d’être vieille, comme un personnage d’une série télé qui portait un tablier. Ou comme ma grand-mère, ce qui était pire.
Elle avait fait ses études à Berkeley. Elle avait rencontré mon père lors d’un sit-in contre la guerre au Vietnam à People’s Park. Elle ne le savait pas encore, bien sûr, mais quand ils retraversèrent le pont, elle était enceinte.
Mon père reçut son ordre d’incorporation à l’automne. Il devait se présenter à peu près au moment de ma naissance. Il partit pour le Canada. Il écrivait à Diana tous les jours, parfois deux fois par jour, pour la supplier de le rejoindre, mais elle s’était alors mise avec un joueur de banjo qui s’appelait Phil et qui lui rappelait Pete Seeger, en plus sexy. Je pense que Diana était plus amoureuse des chagrins d’amour, dans la vie ou dans les chansons, qu’elle ne l’avait jamais été de mon père. Puis Phil et elle rompirent, et elle chanta beaucoup de chansons tristes. Enfin, c’était toujours le cas.
Elle rencontra Daniel le jour de son accouchement. C’était tout elle. Il lui fallait un homme à ses côtés et elle n’avait jamais de mal à en trouver un.
Daniel était sa sage-femme en salle d’accouchement, chose rare à l’époque pour un homme, mais Daniel adorait les bébés et, comme il me le dit un jour, il aimait aider les femmes à mettre un enfant au monde. Il avait assisté Diana durant trente-deux heures de contractions, suivies de six heures à pousser. L’histoire raconte que, quand je suis née, tous deux étaient tombés amoureux.
Mes souvenirs de ce que je qualifie comme les « Années Daniel », avec l’apparition fréquente de divers « invités », se concentrent surtout sur la musique que nous écoutions, un disque de Burl Ives que Daniel m’avait acheté. Burl Ives ressemblait tout à fait au grand-père qu’on aurait aimé avoir, si on avait un grand-père. Il m’avait aussi acheté un album de chansons pour enfants de Woody Guthrie. Contrairement à Burl Ives, Woody Guthrie paraissait un peu dingue, mais ses chansons étaient bien plus drôles. Je demandais à Diana et à Daniel de passer le disque de Woody Guthrie une douzaine de fois par jour. La chanson que je préférais évoquait une promenade en voiture et s’accompagnait de drôles de bruits qu’il fallait faire avec la bouche. La façon qu’avait Daniel de se tapoter les lèvres pour imiter le bruit du pot d’échappement des très vieux véhicules, qui correspondait parfaitement au pot d’échappement de notre très vieux véhicule, constitue l’un des souvenirs les plus vivaces que je garde de lui. Je croyais que toutes les voitures faisaient ce genre de bruit.
Nous passions beaucoup de temps en voiture – une voiture après l’autre. En général ces vieilles guimbardes problématiques rendaient l’âme sur une route nationale alors que nous allions à une manifestation pour la paix, à un concert, ou que nous rentrions à la maison quand nous en avions une, au motel, au camping ou, à défaut, à l’appartement d’un guitariste ami de ma mère. Diana et moi passions des heures sur le bord de la route pendant que Daniel ou un autre copain bricolait la voiture. La plupart d’entre eux se mélangent dans mon esprit – cheveux longs, drôle d’odeur, jeans traînant dans la poussière –, mais l’un d’eux, Indigo, se détache des autres. Il m’appelait Gamine et s’amusait à me chatouiller même après que je lui avais dit que je détestais les chatouilles. Un jour que nous avions une chambre dans un motel avec piscine, il m’a jetée à l’eau.
« Joanie ne sait pas nager », cria Diana. Indigo se contenta de rire. Je sentais que je coulais au fond de la piscine. J’ouvris la bouche. Pas d’air. J’agitais les bras, mais je n’avais rien à quoi m’accrocher.
Enfin, Diana fut là. Elle avait sauté dans la piscine vêtue de sa jupe en jean. Elle me tirait vers la surface. Je me suis mise à tousser et à chercher mon souffle, en me vidant de toute l’eau avalée. Ce fut la dernière fois que je m’aventurai dans une piscine.
Ma mère et ses copains m’emmenèrent à de nombreux concerts. Mes principaux souvenirs de l’époque concernent l’odeur des toilettes portables Porta Potti où j’avais toujours peur de tomber, celle de marijuana et de musc, ainsi que le bien-être que je ressentais quand ma mère entrait dans la tente avec moi et son petit ami du moment, tard le soir. Ensuite, je les entendais chuchoter et rire doucement d’une manière que j’interprète maintenant comme faisant partie de leurs jeux amoureux, quand ils me croyaient endormie. À l’époque, c’était simplement la bande son de ma vie, pas différente des vieilles ballades et de « Kumbaya ».
Les discours continuaient souvent dehors, transmis par une sono qui grésillait. Mes nuits préférées étaient celles où Diana chantait pour moi tandis que les papillons de nuit tournaient autour de nos têtes à la lumière de notre lampe Coleman. Lorsqu’elle et Daniel vivaient ensemble, il s’asseyait devant la tente avec sa lampe de poche et lisait le manuel préparant à l’examen qu’il allait passer pour obtenir un niveau supérieur dans son métier de sage-femme, fumait un joint ou taillait le bout de bois que je le voyais travailler aussi loin que remontaient mes souvenirs. Il ne ressemblait à rien de reconnaissable, ce bout de bois, mais il était si doux que j’aimais le tenir contre ma joue. J’imaginais que la main de ma mère me caressait de cette façon, mais elle était souvent occupée ailleurs.
Nous avons un moment vécu tous les trois à San Francisco. Nous habitions même dans un appartement, avec un canapé et un vrai lit pour moi. La sœur de Daniel lui avait envoyé une souche de levain. Durant quelque temps, une odeur de pain plana dans notre appartement et je crus vraiment que, pour une fois, nous allions y rester. Mais, à l’été 1969, j’avais alors six ans, ma mère et Daniel décidèrent de traverser le pays pour assister au festival de musique de Woodstock. Son idée à elle, sans doute, mais Daniel était d’accord.
Ils chargèrent la voiture, une Renault couleur argent cet été-là, avec tout ce que nous possédions, c’est-à-dire pas grand-chose : quelques chemises teintes au nœud, quelques jeans, et comme toujours ma boîte de crayons de couleur, ma girafe, un édredon en patchwork que nous avait fait ma grand-mère, les bottes de ma mère avec des roses gravées sur les côtés, auxquelles elle tenait beaucoup, et les manuels de l’école de sage-femme de Daniel. Une caisse contenant la précieuse collection de vinyles de Diana était rangée dans le coffre. Quand nous nous trouvions dans une région chaude comme l’Arizona, elle avait peur qu’ils ne fondent. Un jour, elle acheta une glacière et y mit de la glace pour qu’ils soient en sécurité. À l’époque, il ne m’est pas venu à l’idée qu’elle prenait davantage soin de ses disques que de moi.
Nous campions la plupart du temps, mais pas dans les parcs nationaux parce qu’ils étaient trop chers. Une semaine avant le début du festival, notre voiture commença à émettre des bruits comme dans la chanson de Woody Guthrie et nous ne sommes jamais arrivés à Woodstock. Nous avons échoué à un festival dans une petite ville près de la frontière canadienne. Diana dansa avec un homme qui faisait un trip d’acide et qui lui donna les clés de sa Coccinelle orange. Nous avons quitté le concert et pris la route avant qu’il soit suffisamment redescendu de son trip pour changer d’avis.
Trois jours plus tard, peut-être parce que Diana avait dansé avec le type de Hare Krishna, ma mère et Daniel se sont disputés, comme souvent, sur une aire de repos dans le New Jersey. Ce fut la dernière fois. Je n’ai qu’un vague souvenir de ce qui se passa ensuite. Diana et moi étions assises à l’avant de la voiture pendant que Daniel fourrait ses affaires dans son sac, ainsi que quelques albums dont ma mère ne voulait plus parce qu’ils lui rappelaient Daniel (Burl Ives en faisait partie et aussi Woody Guthrie) et la souche de levain qu’il avait mise dans un bocal. Le bout de bois sur lequel il travaillait fut la dernière chose qu’il plaça dans le sac.
« Tu es une super petite fille », me dit-il, juste avant de sortir du parking de l’aire de repos. Nous l’avons dépassé quelques minutes plus tard, debout sur le côté de la route, le pouce levé. Il avait l’air de pleurer, mais ma mère prétendit que ce n’était sans doute qu’une allergie. Moi aussi, j’avais envie de pleurer. De tous les gens que j’avais connus au cours de ces années, Daniel semblait le seul fiable.
En remplissant le réservoir de la voiture, sans faire le plein, Diana engagea la conversation avec un certain Charlie qui appartenait à un groupe appelé The Weather Underground 4. Je retins ce nom parce que l’idée me semblait déroutante : quel temps pouvait-il faire sous terre ? Pour moi, il devait toujours être à peu près le même.
Charlie nous invita à venir avec lui et un groupe d’amis, dans une maison de l’Upper East Side sur la 84e Rue Est qui appartenait aux parents de l’une d’eux. Peu après, nous traversions un pont et arrivions à New York.
C’était une maison de brique avec un pot de géranium sur le perron que personne n’avait apparemment arrosé depuis un bon moment. Charlie et ses amis passaient de nombreux disques dont j’étudiais les pochettes, car je n’avais pas de livres : Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Cream. Ma mère avait toujours la plupart de nos albums dans la caisse, bien sûr, mais personne n’avait envie de les écouter. Des chansons comme « Silver Dagger » et « Wildwood Flower » semblaient déplacées dans la maison des parents de l’amie de Charlie.
Je savais, même à l’époque, que Joan Baez et ma grand-mère n’auraient pas aimé cet endroit, elles auraient désapprouvé ce qui s’y passait. La musique que Charlie et ses amis écoutaient était différente – bruyante, pleine de cris, et les guitares avaient l’air de pleurer. Nous mangions beaucoup de beurre de cacahuète, de Cocoa Puffs et parfois des glaces pour le dîner, ce qui aurait pu paraître super mais ne l’était pas. La belle-fille de l’amie de Charlie vint un jour. Elle avait deux ans de plus que moi et elle rangeait sa poupée Barbie dans une boîte spéciale. Je connaissais suffisamment les opinions de ma mère pour ne pas réclamer une Barbie, mais la fille me laissa lui enfiler tous ses vêtements et j’étais ravie.
Lors de ce dernier voyage à travers le pays, Daniel m’avait lu tous les soirs un chapitre de La Toile de Charlotte dans la chambre d’un motel, sous la tente ou là où nous nous étions arrêtés. Il avait dû emporter le livre en partant alors qu’il nous restait trois chapitres avant la fin. Je ne savais pas ce qui arrivait à Fern, Wilbur le cochon et Charlotte, et je me faisais du souci pour eux. Je ne comprenais pas pourquoi tous les amis de ma mère détestaient les cochons 5. Si Wilbur était un exemple typique, les cochons paraissaient vraiment super.
Je ne comprenais pas grand-chose aux conversations de Charlie et de ses amis, sinon que la guerre au Vietnam prenait une place importante. Je ne savais pas, bien sûr, ce qu’était cette guerre ni où elle se déroulait. J’avais compris qu’ils construisaient au sous-sol un truc qui nécessitait beaucoup de clous. Un jour, je suis descendue voir et tout le monde s’est mis en colère, surtout Charlie, qui m’a traitée de sale gosse.
Après quoi, ma mère décida qu’il valait mieux que je ne reste pas dans la maison de l’Upper East Side et elle m’emmena chez ma grand-mère dans le Queens. « Charlie n’est pas mon genre. Je ne vais pas rester là-bas », dit-elle. Elle irait prendre ses disques et reviendrait me chercher quelques jours plus tard. Nous nous installerions dans une jolie petite maison quelque part à la campagne et nous aurions un jardin. Elle trouverait quelqu’un qui m’apprendrait à jouer du ukulélé (il y avait à parier que ce serait un homme). Elle voulait enregistrer un album. Un type qui avait un jour rencontré Buffy Sainte-Marie lui avait donné sa carte.
1. « C’était le joyeux mois de mai, quand tous les bourgeons gonflaient… Le tendre William était couché sur son lit de mort. À cause de son amour pour Barbara Allen. » (Toutes les notes sont de la Traductrice.)
2. « Je vais partir et te laisser, mon amour. Je vais partir un long moment. Mais je reviendrai un jour. Si je parcours dix mille miles. »
3. « Tard dans la nuit quand souffle le vent du nord… Vêtue d’un long voile noir elle pleure sur mon cadavre. »
4. Le Temps sous terre.
5. Pigs : « cochons », mais aussi « flics ».
2
Apparemment, aucun survivant
Ma grand-mère préparait des sandwichs au fromage fondu, les informations en fond sonore, quand nous avons appris l’explosion. Le présentateur ne cessait de parler d’un endroit qu’il appelait la maison du Weather Underground sur la 84e Rue Est. « Complètement détruite », disait-il. Deux personnes dans la rue à l’extérieur du bâtiment avaient été tuées lors de l’explosion, dont un policier qui n’était pas en service, père de trois filles et d’un garçon de dix ans.
Il ne restait rien de la maison, mais on montra une photo de ce qu’elle avait été et je reconnus les marches et la porte d’entrée rouge. « Apparemment, aucun survivant », ajouta le présentateur.
Dans la rue, au milieu des décombres, un reporter interviewait une passante. « Une bande de meurtriers. Bon débarras », dit-elle.
Après avoir coupé les informations, ma grand-mère me mit au lit, mais je l’entendais à travers le mur qui séparait le salon où je dormais et sa chambre. Ce fut la seule fois que j’entendis Grammy pleurer.
On ne révéla que le lendemain les noms de ceux qui avaient été tués en fabriquant la bombe, mais nous avions compris. Si ma grand-mère ne m’en dit rien, j’entendis le reportage à la radio et une seule image s’imposa à mon esprit : des Cocoa Puffs fusant dans toutes les directions. J’avais en tête la pochette de l’album des Beatles qui tenaient sur leurs genoux des poupées ensanglantées, ainsi que la pochette de King Crimson qui me donnait des cauchemars, même avant l’explosion : le visage d’un homme vu de si près qu’on distinguait l’intérieur de ses narines et ses yeux écarquillés comme s’il était en train de hurler. J’imaginais des bouts de vinyles éparpillés dans la rue devant la maison et les bottes de Diana avec les roses gravées sur les côtés qu’elle emportait chaque fois que nous déménagions, même quand nous ne prenions presque rien d’autre. (Ma collection d’animaux en verre, par exemple. Je les avais tous laissés dans la maison qui avait explosé. Je me représentais mes animaux, un par un, qui volaient à travers la pièce et se retrouvaient projetés dans la rue. Cheval. Singe. Souris. Licorne. J’avais pris si grand soin d’eux jusqu’alors.)
À dire vrai, il ne restait rien de reconnaissable, même si un reporter de la télé indiqua que la police avait trouvé un bout de doigt. En l’entendant, Grammy éteignit le poste.
« Comment est-ce que le doigt est parti de la main de la personne ? Ils en ont fait quoi quand ils l’ont trouvé ? » ai-je demandé à ma grand-mère.
Dans l’un des bulletins d’informations qui passa à l’antenne dans les jours suivant l’explosion, une photo de ma mère tirée de son annuaire du lycée apparut à l’écran. Elle était beaucoup plus jolie en vrai que sur la photo qu’ils montrèrent. Un reporter colla un micro devant une femme qui se révéla être l’épouse du policier décédé.
« J’espère qu’elle brûle en enfer comme les autres », dit-elle.
C’est à ce moment-là que nous avons changé de nom et sommes devenues Renata et Amelia.
Ensuite, j’ai vécu avec ma grand-mère, d’abord à Poughkeepsie, puis en Caroline du Nord, en Floride et de nouveau à Poughkeepsie et encore en Floride. Je n’ai jamais rencontré mon père, Ray, mais environ un an après notre premier déménagement ou peut-être notre deuxième, ma grand-mère l’a recherché. Au cas où il n’aurait pas entendu ce qui était arrivé à ma mère, elle pensait qu’il devait l’apprendre. Elle lui fit promettre de ne jamais révéler à qui que ce soit nos nouveaux noms ni où nous vivions.
Ray habitait sur une île de la Colombie-Britannique avec sa femme, qui avait récemment donné naissance à des jumeaux. Il dit à ma grand-mère que j’étais la bienvenue si jamais nous passions dans le coin.
« Je me rappellerai toujours que nous étions assis dans le parc cet été-là et que nous chantions toutes ces vieilles chansons idiotes. On peut dire ce qu’on veut sur Diana, mais elle avait une très belle voix », écrivit-il.
Je devais être en CE2 quand Daniel sonna à notre appartement en Floride. Il avait sans doute réussi l’examen pour monter en grade, car il roulait dans une voiture normale. Il travaillait dans un hôpital de Sarasota. Ray avait à l’évidence rompu sa promesse de garder notre secret.
« Ta mère était l’amour de ma vie », me dit Daniel. Il se mit à pleurer. Je croyais qu’il venait pour me réconforter, mais finalement, ce fut moi qui le consolai. « Je pense qu’elle n’a jamais voulu faire de mal à personne. Elle n’a sans doute pas compris ce que préparaient les autres. Tout ce qui lui importait, c’était de chanter », me dit-il.
Et moi ? avais-je envie de lui demander.
« Diana n’aurait sans doute pas été d’accord, mais je t’ai apporté une poupée. » C’était une Barbie et il avait bien sûr raison. Ma mère ne m’aurait jamais permis d’avoir une Barbie, pas même celle qui était noire.
Ma grand-mère et moi avons raccompagné Daniel dans la rue pour lui dire au revoir. Il a ouvert le coffre. J’ai compris à la manière dont il a soulevé le carton que ce qu’il contenait lui était très précieux et qu’il lui était difficile de s’en séparer. C’était une pile d’albums, ceux que ma mère l’avait laissé emporter le jour où nous l’avions abandonné sur l’aire de repos : Woody Guthrie, Burl Ives, le premier disque de Joan Baez, très rayé. Je connaissais encore les paroles de toutes les chansons : « Mary Hamilton », « House of the Rising Sun », « Wildwood Flower ». Toutes les vieilles chansons que nous chantions ensemble dans la voiture.
« Je suis le premier à t’avoir vue. J’ai coupé le cordon », dit Daniel en s’asseyant sur le siège du conducteur. Il me fallut une minute pour comprendre de quoi il parlait. Dans la salle d’accouchement, ce jour-là, il était de service.
« J’aurais adoré être ton père.
– Ça aurait sans doute été bien », répondis-je.
Hormis Daniel – et Ray, mon père, à qui ma grand-mère avait fait jurer de garder le secret, comme à moi –, aucun de ceux que nous connaissions ne nous retrouva après l’explosion. Malgré tout Grammy vivait dans la peur d’être découverte. Les années passèrent et je ne compris jamais pourquoi cela lui semblait si important, mais pas une semaine ne s’écoulait sans qu’elle me rappelle ma promesse de ne jamais raconter à personne ce qui était arrivé et qui nous étions auparavant.
« C’est notre secret. Nous l’emporterons dans la tombe », disait-elle. Cela me faisait penser à la mort et me rappelait la chanson du long voile noir, « Long Black Veil », qui me donnait toujours des frissons.
L’emporter dans la tombe. Quel sens avaient ces mots pour une fillette de dix ans ? C’était le mantra de mon enfance. Jamais personne ne doit savoir qui tu es. Tu dois me le promettre. Tu l’emporteras dans la tombe.
Je faisais des cauchemars sur ce qui arriverait si quelqu’un découvrait qui nous étions.
Ma grand-mère passa d’un emploi à l’autre durant ces années. Ne pas avoir de carte de sécurité sociale posait un problème. Il lui fallait connaître quelqu’un personnellement pour être embauchée, ou faire du babysitting pour lequel on ne lui demandait rien.
J’avais dix-huit ans, je venais de terminer le lycée, quand ma grand-mère reçut le diagnostic. Cancer du poumon stade quatre. Les Marlboro avaient eu raison d’elle.
Je me suis occupée d’elle tout l’été. La dernière semaine, alors qu’elle était en soins palliatifs, elle m’a fait promettre, encore une fois, de garder le secret sur ma mère.
« Je n’en ai jamais parlé à personne, Grammy. Mais même si je le faisais, ça n’aurait plus d’importance. » Je comprenais beaucoup mieux à présent ce qui s’était produit et ce que faisaient Charlie et les autres dans le sous-sol de la maison de l’Upper East Side ce jour-là. À seize ans, j’étais devenue curieuse et j’avais passé une journée entière à la bibliothèque à faire des recherches sur le Weather Underground. Je n’avais sans doute jamais voulu savoir auparavant comment ma mère était morte, mais en lisant les articles je ne réussis pas à m’ôter les images de l’esprit. Du verre brisé dans toute la rue. Un bout de doigt. Celui d’une femme.
« Promets-moi. N’en parle jamais. Ça risque d’entraîner des ennuis que tu ne peux pas comprendre », répéta Grammy.
Elle suivait un traitement lourd et, à part ces mots, ce qu’elle disait n’avait guère de sens, mais elle se mit à marmonner quelque chose à propos du FBI et de nouveaux examens devenus possibles pour retrouver des gens, réalisés à partir d’une simple trace de salive sur une tasse de café ou quelques cheveux sur une brosse.
« Si jamais quelqu’un te pose des questions sur Diana Landers, tu n’as jamais entendu parler d’elle », chuchota-t-elle.
3
Un homme côté soleil
Il ne fallut pas longtemps pour débarrasser l’appartement de ma grand-mère, qui possédait si peu de choses. Elle avait voulu être incinérée et que ses cendres soient dispersées au pied de l’Unisphere de la Foire internationale de 1964 où elle m’avait emmenée quand j’étais bébé. Ses économies, quand j’eus payé sa dernière facture, s’élevaient à un peu plus de mille huit cents dollars. Mon héritage. Je m’en servis pour prendre un studio et acheter un tourne-disque afin d’écouter mes albums.
Il faut vivre d’une manière très différente quand vous gardez un secret, surtout un secret gros comme la façon dont votre mère est morte et que le nom qu’on vous donne n’est pas celui de votre naissance.
Si on détient un secret, il est plus facile de n’être proche de personne et, longtemps, c’est ce que je fis. Durant toutes mes années de lycée et d’école d’art, je n’eus jamais de petit ami ni d’amie proche. À l’exception de mes cours et de mon travail de serveuse dans un modeste restaurant de Mission, j’étais isolée.
Je dessinais tout le temps. Je punaisai une photo de Tim Buckley au mur, en partie parce que je le trouvais beau, mais aussi parce qu’il était mort jeune et de façon tragique, comme ma mère. Je passais si souvent « Once I Was » que je dus racheter l’album. Chaque fois que j’avais envie de me retrouver d’une humeur particulièrement sombre, il me suffisait de mettre cette chanson.
Et puis j’ai rencontré Lenny, un homme étranger à toute forme de tragédie. Si je voulais décrire Lenny en une phrase, ce serait celle-ci : Il marchait côté soleil. Je veux dire que c’était la dernière personne de qui je me serais imaginé tomber amoureuse, la dernière personne susceptible de tomber amoureuse de moi. Sauf que ce fut ce qui nous arriva.
Peu après mon diplôme de l’école d’art, j’avais été sélectionnée pour participer à une exposition à San Francisco, dans une petite galerie coopérative de Mission. Les artistes s’y relayaient et proposaient des assiettes de crackers saupoudrés de fromage en boîte quand quelqu’un entrait jeter un coup d’œil, ce qui n’arrivait pas très souvent.
La plupart des œuvres de l’exposition étaient abstraites ou conceptuelles. L’une d’elles consistait en un morceau de viande posé au milieu de la pièce. Le deuxième jour, les mouches tournaient autour, et le quatrième jour on sentait l’odeur de la viande pourrie dans toute la galerie. « Je crois que tu devrais l’enlever », dis-je à son auteur quand il arriva pour distribuer à son tour les crackers. « Pas de problème », répondit-il. Il avait apporté un autre bout de viande. Un morceau moins cher.
Mon travail était accroché dans un coin. À la différence de presque tous les artistes exposant leurs œuvres dans la galerie, mes dessins au crayon étaient très réalistes, inspirés par la nature. Dessiner m’intéressait depuis que j’étais toute petite, avant même de venir habiter avec ma grand-mère, mais cela devint une obsession probablement après la disparition de ma mère. Quand je sortais mes crayons, plus rien d’autre n’existait.
Au cours des années, il m’était arrivé de passer mes journées dans les bois ou, quand c’était impossible, au parc, à dessiner toute sorte de champignons ou à soulever des branches pourries pour observer le fourmillement des insectes qu’elles cachaient et à les reproduire. Au printemps suivant le décès de ma grand-mère, j’étais partie dans la Sierra Nevada une quinzaine de jours. J’avais marché, dormi dans ma vieille tente et rempli mon carnet de croquis de dessins des fleurs sauvages que je trouvais. Ce carnet de croquis m’avait valu une bourse à l’école d’art.
À l’époque de l’exposition à la galerie, mes dessins représentaient surtout des oiseaux. Les croquis affichés au mur montraient une espèce de perroquets connue sous le nom de conures, qui avaient élu domicile en ville.
On disait que, vers le milieu des années quatre-vingt, deux ou trois conures rares et magnifiques s’étaient échappées d’un magasin d’oiseaux exotiques au sud de la Californie pour remonter vers le nord et arriver finalement à San Francisco, où elles s’étaient accouplées avec un étonnant succès. Bientôt, une volée d’oiseaux de couleurs vives était perchée dans les arbres de Telegraph Hill.
Dans une ville où la population d’oiseaux était majoritairement constituée de pigeons, de moineaux et de geais, on ne pouvait que remarquer le plumage rouge, bleu et jaune des perroquets de Telegraph Hill. Par la fenêtre de mon petit studio de Vallejo Street, debout avec ma tasse de café, je les regardais descendre en piqué au-dessus des marches de Filbert en direction de Coit Tower. Mes photos de ces oiseaux exotiques, si inattendus dans la brume de la Bay Area, punaisées sur le mur au-dessus de ma table à dessin, devinrent le point de départ de la série de dessins que j’exposais à la galerie le jour où Lenny y entra.
Cet homme de taille et de carrure moyennes devait avoir à peu près mon âge. Son apparence n’avait rien de particulièrement remarquable, sinon son regard très doux et l’allure de quelqu’un bien dans sa peau. J’en fus sans doute frappée parce que je n’aurais pas pu en dire autant de moi. Il portait une veste des San Francisco Giants si usée que la plupart des gens l’auraient trouvée bonne à jeter. J’en conclus qu’il était soit totalement fauché, soit extrêmement attaché à son équipe. Les deux étaient vrais, mais Lenny aimait les Giants presque autant qu’il m’aima, au bout du compte.
Il passa sans s’arrêter devant les autres œuvres exposées – un œil géant sculpté avec les mots « BIG BROTHER » en travers de la pupille, un tableau représentant un jeune homme tenant un revolver contre sa tempe qui, je le savais (contrairement à d’autres), ressemblait beaucoup à l’artiste. Il était dans mon cours de dessin d’observation et souffrait de dépression. Quand le moment vint pour l’auteur du tableau au revolver d’accueillir les visiteurs à la galerie et de proposer les crackers, il déclara qu’il ne pouvait pas. Il n’arrivait pas à sortir de son lit.
On comprenait, au premier coup d’œil, que Lenny avait une attitude extrêmement positive dans la vie. Il ne prêta aucune attention au flanchet de bœuf qui pourrissait par terre. Il se dirigea droit vers mes conures de Telegraph Hill.
« Elles sont magnifiques », dit-il devant le dessin d’une paire de conures perchées sur une branche. Il avait un cracker dans la bouche, deux autres dans les mains et il souriait. J’appris plus tard qu’il était entré dans la galerie avec l’espoir de trouver à manger gratuitement. Ce qui finit par arriver fut un bonus inattendu.
« C’est moi qui les ai dessinées, dis-je.
– Quand j’étais petit, nous avions un perroquet dans la famille. Jake. Je lui avais appris à dire “Téléportation, Scotty 1” et “Vas-y, fais-moi plaisir 2”. »
C’était Lenny tout craché. Ses attachements à une chanson, un tableau ou un lieu étaient fondés sur de plaisantes associations avec une vie jusqu’alors singulièrement heureuse. Outre le perroquet, il avait deux sœurs qui l’adoraient (une aînée, une cadette) et un chien, ainsi que des oncles, des tantes, des cousins, des amis de colonies de vacances qu’il voyait encore régulièrement, des parents toujours mariés et toujours amoureux. À sa bar mitzvah, sa famille l’avait porté sur une chaise à travers la pièce en chantant. Il faisait partie d’une équipe de bowling, possédait ses propres chaussures de bowling et une chemise avec son nom brodé sur la poche. C’était sa première année d’enseignement dans un quartier difficile et il entraînait une équipe de T-ball le week-end. Pour quelqu’un comme moi, c’était un vrai Martien.
« J’admire vraiment les artistes. Je suis incapable de tracer une ligne droite.
– Tu as sans doute plein d’autres talents. Des trucs pour lesquels je suis complètement nulle. » Une remarque pas très maligne, mais pour moi, ces quelques mots adressés à un homme – pas un canon de beauté, mais attirant, à peu près de mon âge – étaient tout à fait inhabituels. Après les avoir prononcés, j’eus peur qu’ils apparaissent comme pleins de sous-entendus sexuels, ce qu’il me confirma plus tard.
« Tu sais lancer une balle de base-ball ?
– Devine.
– Je vais t’emmener à un match, déclara-t-il, comme ça.
– Où ?
– Ne me dis pas que tu n’as jamais été à Candlestick Park ?
– Alors, je ne te le dirai pas. »
Ensuite, nous ne nous sommes plus quittés. Pendant le match – mon premier événement sportif professionnel –, il prit le temps de m’expliquer le tableau des scores, le point produit et l’erreur forcée. Vers la fin, lors d’un tour de batte, l’un des Giants exécuta un coup sûr qui vola au-dessus de la tête du lanceur. Je me tournai vers lui et dit quelque chose du genre : « Super ! »
« On appelle ça une chandelle. Ce n’est pas une bonne chose », m’expliqua-t-il gentiment. Puis il m’embrassa sur la bouche. Un baiser fabuleux. Ce soir-là, de retour dans mon appartement (le mien, parce que Lenny était en colocation), nous avons fait l’amour pour la première fois. Pour moi, la toute première fois.
J’avais vingt-deux ans, j’avais terminé l’école d’art depuis six mois. J’étais illustratrice médicale à temps partiel, ce qui expliquait les crayons alignés par couleur sur la table de la cuisine de mon appartement de Vallejo Street, ainsi que les photos des principaux organes et les dessins des appareils reproducteurs, circulatoires, lymphatiques, digestifs et squelettiques affichés au mur. Quelques années auparavant, pendant mes études, j’avais punaisé, à côté de mes schémas d’anatomie, une carte postale d’un tableau de Chagall que j’adorais – un homme et une femme, dans un petit appartement quelque part en Russie, avec sur la table un gâteau et un bol rempli d’une sorte de baies, une rangée de maisons proprettes et identiques, visibles par la fenêtre, une chaise avec un coussin brodé, un unique tabouret.
Le tableau représente les amoureux qui occupent la pièce. La femme porte une modeste robe noire à col ruché, des chaussures noires à hauts talons à ses pieds incroyablement petits et elle tient un bouquet. L’homme et la femme s’embrassent et leurs pieds sont comme en apesanteur. Seules leurs lèvres sont en contact, en fait, même si cela exige une gymnastique étonnante de la part de l’homme. Pour réaliser ce baiser, il tourne la tête à 180 degrés, ce que la tête d’aucun être humain ne peut accomplir, comme me le rappelaient mes graphiques d’anatomie. Sans parler du fait que les personnages ne touchent pas terre. Seul l’amour permet à deux êtres de prendre ainsi leur envol.
Quelque chose d’incroyablement tendre et innocent, mais en même temps érotique, émane des deux amoureux du tableau. Ils n’ont besoin que du contact de leurs lèvres pour s’élever.
Le lendemain du match de base-ball, Lenny m’apporta une carte postale identique à celle accrochée au mur. Il la glissa sous la porte avec un mot : Je crois que je suis amoureux.
Quand il vint me chercher pour dîner le même soir, avec un bouquet de roses, il ressemblait à un type qui avait gagné le gros lot au jeu télévisé préféré de ma grand-mère, Jeopardy ! Si des mortels avaient pu prendre leur envol ce jour-là, ç’aurait été nous deux. Je n’aurais sans doute pas encore dit que j’aimais cet homme, mais je savais que je le ferais très vite. Lenny et moi ressemblions aux personnages du tableau. Comme si nous avions inventé l’amour.
Il enseignait en CE1 à l’école élémentaire Cesar-Chavez. Il adorait ses élèves. Tous les soirs, au dîner, il me racontait ce qui s’était passé en classe, quel élève avait eu une journée difficile, quel autre avait fini par comprendre la soustraction. J’en vins à connaître leur nom à tous.
Il fut tout de suite romantique. Durant la brève période précédant son emménagement chez moi, et par la suite, il n’arrivait jamais sans un bouquet de fleurs, une barre de chocolat ou un cadeau idiot, par exemple un yo-yo. Il copiait des poèmes dans des livres et me les lisait tout haut. Il aimait des chansons comme « I Think I Love You », « Feelings », « You Light Up My Life », parce qu’elles exprimaient parfaitement ce qu’il ressentait pour moi. Si une chanson qu’il aimait passait à la radio quand nous étions en voiture, il montait le son et chantait en même temps. Un jour, il apporta un album des Kinks. Il voulait me faire écouter une chanson qui lui évoquait notre relation : « Waterloo Sunset ».
Pour moi, les meilleurs moments avec Lenny, ceux auxquels je penserais après, n’étaient pas ceux-là. J’étais davantage touchée par des choses très ordinaires que Lenny considérait comme évidentes : alors que j’avais attrapé un rhume, il courut m’acheter des médicaments contre la toux, une autre fois il rentra chez nous avec une paire de lacets (pas des roses, des lacets) parce qu’il avait remarqué que les miens étaient si effilochés que j’avais du mal à les passer dans les œillets de mes baskets. Il ne faisait jamais très froid à San Francisco, mais quand il pleuvait, il chauffait la voiture pour moi et un jour, sachant que j’empruntais sa Subaru pour traverser le pont et me rendre à un rendez-vous chez le dentiste, il vérifia la pression des pneus la veille. Une autre fois, lors d’une escapade d’un week-end à Calistoga, il resta assis deux heures à côté de moi sur le bord de la piscine de l’hôtel en essayant de m’aider à surmonter ma peur de l’eau. « Je ne te quitterai jamais », disait-il. Sans doute sa seule déclaration qui se révéla fausse.
Alors que nous essayions de faire un bébé (décision prise environ une semaine après notre rencontre), il prépara un tableau qu’il posa sur le réfrigérateur pour noter ma température tous les matins et savoir quand j’ovulais, à côté d’une boîte où il vérifiait chaque jour que j’avais pris mon comprimé d’acide folique.
Nous n’étions à peu près jamais en désaccord, même si ça ne s’était pas très bien passé quand, pour plaisanter, j’avais déclaré que, étant née dans le Queens, j’aurais probablement dû être supportrice des Yankees. « On va y remédier », répondit-il.
Pratiquement, notre seul sujet de tension concernait mon peu d’envie de voir sa famille. Pour lui, étant juif, Noël n’était pas un problème, mais il y avait toutes les autres fêtes : Thanksgiving, l’anniversaire de Lenny, celui de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante, de son oncle Miltie. Il n’était pas religieux, mais il jeûnait à Yom Kippour en l’honneur de son grand-père, mort quelques années avant notre rencontre. Lenny aimait beaucoup son grand-père, comme à peu près tous les membres de sa nombreuse famille, et gardait de merveilleux souvenirs d’être allé au stade de base-ball avec lui quand il était enfant.
D’une part, j’aimais bien entendre les anecdotes de Lenny sur son enfance heureuse, sa vie heureuse. Mais d’autre part, parfois, les histoires de sa vie côté soleil – le côté de Lenny – semblaient me séparer de l’homme que j’aimais, comme si nous ne parlions pas la même langue. En dehors du fait que nous étions dingues l’un de l’autre, il m’apparaissait toujours comme une sorte de voyageur étranger me rendant visite depuis son pays d’origine, et il devait ressentir la même chose à mon égard. Malgré tout ce que nous partagions, ce fossé existait entre nous. Son expérience du monde lui donnait un sentiment d’espoir et de sécurité, alors que je repérais facilement les problèmes et anticipais les malheurs avant même qu’ils ne se produisent.
Les parents de Lenny vivaient à El Cerrito, de l’autre côté du pont. La première année de notre vie commune, il pensait que je viendrais avec lui au seder de Pessah dans sa famille. Je trouvai une excuse, une obligation en rapport avec mon cours de peinture, mais il ne fut pas dupe.
« C’est difficile pour moi de me trouver dans une famille », lui expliquai-je.
Il avait posé des questions sur la mienne, naturellement. Je ne lui avais parlé que de l’essentiel : je ne connaissais pas mon père et ma mère était morte quand j’étais toute petite, ma grand-mère m’avait élevée et, après sa mort quatre ans plus tôt, il n’y avait plus personne.
Lenny étant Lenny, il voulait en savoir plus : comment ma mère était morte, comment j’avais vécu sa disparition. « Nous devrions aller sur sa tombe », dit-il. Il voulait connaître la date de son décès pour allumer une veilleuse le jour anniversaire.
Je ne pouvais pas lui dire qu’il n’y avait pas de tombe. Comment enterrer un bout de doigt ?
« Je ne veux pas en parler. C’est mieux comme ça. » Il était ma famille à présent, tout ce dont j’avais besoin.
Puis arriva quelqu’un d’autre. Notre fils.
Arlo naquit juste un an après notre rencontre. C’était le soir de la Série mondiale, une rencontre entre les Mets et les Red Sox qui ne laissait d’autre choix à Lenny que d’encourager Boston. Mais ce soir-là, il ne pensait qu’à notre bébé et à moi. Ni la casquette portée à l’envers par les Mets à partir d’un déficit de deux points dans la dixième manche pour gagner le match ni, finalement, le championnat ne réussirent à détourner Lenny une seule minute de sa place à mes côtés durant les vingt-trois heures qu’il fallut à Arlo pour venir au monde. « C’est incroyable, non ? Nous avons fait un bébé », s’émerveilla-t-il quand la sage-femme plaça notre fils dans mes bras.
Je suis papa. Il ne cessait de répéter ces mots.
Je disais souvent qu’il n’y avait pas de meilleur papa ni de meilleur mari. Il m’apportait le café au lit, rentrait à la maison avec des cadeaux bizarres et drôles : un stylo plume, une paire de chaussettes aux couleurs des Giants, un diadème en faux diamants. Il emmenait Arlo aux bébés nageurs tous les samedis. Il était le seul père dans un bassin rempli de mères, leurs bébés dans les bras, tandis que j’étais assise au bord, car j’avais gardé une phobie de l’eau depuis le jour où Indigo, le copain de ma mère, m’avait jetée dans la piscine du motel. Quand Arlo pleurait la nuit, Lenny était toujours le premier à sauter du lit pour me l’amener. Il le baignait et le changeait chaque fois qu’il le pouvait. Jusqu’alors, il adorait son métier d’enseignant, mais maintenant il détestait partir travailler. « Je ne veux rien rater », disait-il.
La famille de Lenny, ses parents en particulier, restait un sujet délicat. J’avais accepté de rendre visite de temps en temps à Rose et Ed, mais pas aussi souvent qu’ils l’auraient souhaité avec leur premier petit-fils, ni comme Lenny l’aurait voulu pour eux.
Rose et Ed étaient des gens merveilleux, ce qui n’était en rien surprenant compte tenu de l’attitude de Lenny dans la vie. De tout temps, j’avais rêvé de faire partie d’une grande famille aimante, mais maintenant que j’y étais accueillie je me sentais inadaptée. Quand nous nous trouvions dans la famille de Lenny, tout le monde parlait sans arrêt et fort. On s’interrompait, on donnait son opinion, on exprimait librement ses sentiments. On riait toujours beaucoup.
Je participais peu à ces échanges, mais c’était sans importance car la discussion allait bon train. J’étais assise sur le canapé, je nourrissais Arlo et acceptais les offrandes comestibles qui se succédaient. J’emportais parfois un carnet à dessin et faisais des croquis de tout le monde. Ma belle-mère m’appelait « le Michel-Ange de notre famille ». (Notre famille, disait-elle. Pour Rose, sinon pour moi, je faisais partie de leur cercle bienheureux.) Elle et mon beau-père avaient encadré tous les dessins que j’avais réalisés chez eux. Ils étaient accrochés à côté des photos de tous les membres de la famille, moi y compris. Ma photo n’avait jusqu’alors jamais figuré sur le mur de personne.
« Alors, quand allez-vous faire le deuxième ? » me demanda Rose, le jour du premier anniversaire d’Arlo. Je n’avais pas l’habitude de ce genre de question. J’avais appris très jeune à ne pas dévoiler mes intentions.
Dans la voiture ce jour-là, en quittant El Cerrito pour rentrer chez nous, Lenny était plus silencieux qu’à l’ordinaire.
« Ne fais pas attention à ma mère. Elle est comme ça. Elle t’adore, dit-il.
– Je ne savais pas quoi répondre.
– Je sais que c’est difficile pour toi. Peut-être qu’un jour tu pourras essayer de m’expliquer pourquoi. »
C’était impossible. J’avais fait une promesse à ma grand-mère.
Nous nous sommes mariés quelques semaines après le premier anniversaire d’Arlo, au sommet du mont Tamalpais, dans un gîte de randonnée extraordinaire et sans électricité, la West Point Inn. Rachel, la sœur de Lenny, joua du piano sur le vieil instrument de la pièce principale – des airs de comédies musicales, de l’American Songbook, des Beatles –, accompagnée par quelques membres de la famille aux bongos, au tambourin, et à l’accordéon par l’oncle Miltie. La mère de Lenny et ses sœurs avaient passé les jours précédents à faire des gâteaux. On avait tout hissé, y compris la chaise haute d’Arlo, par le sentier forestier. Arlo venait de faire ses premiers pas. Il courait en rond, rayonnant.
Dans les dernières semaines, Lenny n’avait cessé de revenir sur la question des invités de mon côté. Pour lui, il était inconcevable que personne n’ait envie d’être là quand quelqu’un qu’il considérait comme adorable prononcerait ses vœux.
À l’école d’art, j’avais entretenu des relations occasionnelles avec les autres étudiants, mais rien de sérieux. Même si je ne pouvais pas l’expliquer à mon futur époux, le vieux fléau du secret – l’impossibilité de dire qui j’étais vraiment – m’empêchait d’être proche de qui que ce soit, à part de Lenny.
« Et des oncles, des tantes, des cousins ? Il doit bien y avoir quelqu’un. »
Dans un moment de faiblesse, j’avais révélé que la dernière fois que j’avais entendu parler de mon père biologique, c’est-à-dire presque vingt ans auparavant, il vivait sur une toute petite île de la Colombie-Britannique. Cela suffit à Lenny.
« Je ne l’ai jamais vu, avais-je rappelé à Lenny. Je sais juste qu’il s’appelle Ray et qu’il est le père de jumeaux. »
Mon futur époux rechercha Ray. J’étais dans la pièce quand il lui téléphona.
« Vous ne me connaissez pas, mais je suis amoureux de votre fille, dit Lenny. Nous allons nous marier le mois prochain dans le comté de Marin, en Californie. Cela nous ferait un immense plaisir si vous assistiez au mariage. »
Des années auparavant, le gouvernement des États-Unis avait annoncé une politique d’amnistie pour les réfractaires à la guerre du Vietnam qui avaient fui au Canada. Ray ne courait aucun danger d’être appréhendé à la frontière s’il venait à la cérémonie. Mais d’après la moitié de la conversation que j’entendais, celle de Lenny, il était évident qu’assister à mon mariage intéressait à peu près autant mon père biologique que participer à un contrôle fiscal.
En parlant à l’homme qui allait devenir son beau-père, la voix de mon futur époux demeura amicale, sans trace d’accusation ni de tentative de culpabilisation.
« Je sais que c’est un long voyage, dit Lenny, une main tenant le combiné, l’autre sur mon épaule. Je serais ravi de vous offrir le billet d’avion. Mes parents peuvent vous loger. Amelia serait vraiment touchée. »
Bien des années plus tôt, ma grand-mère avait informé Ray de mon changement de nom. De toute façon, il ne m’avait jamais appelée par mon prénom d’origine.
« Je vois », dit Lenny d’une voix très calme à présent. Je savais qu’il essayait de toutes ses forces de ne pas se mettre en colère. « Je comprends. Vous y réfléchirez peut-être. »
Ses derniers mots avant la fin de la conversation furent : « Vous avez une fille magnifique, Ray. Si vous la rencontrez un jour, vous l’adorerez. »
Je devinai à l’expression de Lenny que Ray avait alors raccroché.
1. Référence à la série Star Trek.
2. Référence à Dirty Harry de Clint Eastwood.
4
Une façon de trouver sa famille
J’étais heureuse, sans doute pour la première fois de ma vie. Mais le secret était toujours là – la peur que ma grand-mère m’avait léguée, en plus de ses figurines Hummel et son livre de cuisine de Betty Crocker, qu’un jour quelqu’un trouverait de qui j’étais la fille et s’en prendrait à moi.
Cet automne-là, j’étais pelotonnée sur le canapé et je regardais la télévision avec Lenny après avoir couché Arlo quand, dans un magazine d’information, survint un sujet sur les nouvelles technologies qui aidaient à résoudre les crimes. Le cas exposé était celui de deux adolescentes violées et tuées en Angleterre. Un garçon du village avait été accusé du crime, mais innocenté grâce à un test ADN. Le même test avait finalement permis d’identifier le véritable coupable après que la police locale eut mis en place des points de collecte d’échantillons de sang ouverts à tous les hommes volontaires de la région. Un seul avait refusé, mais un autre qui répugnait à se faire tester avait persuadé son ami de le faire sous son nom. Quand la police finit par obtenir l’échantillon, l’ADN de cet homme correspondait à celui du violeur. L’émission que nous regardions racontait sa mise en accusation et sa condamnation à la prison à vie.
Lenny aimait la science autant que les énigmes policières. La nuit, dans notre lit, il continua à parler de cette histoire. Lui pour qui la famille comptait tellement était tout excité à l’idée que je pourrais peut-être, grâce à un test ADN, trouver des parents dont j’ignorais l’existence – autres que Ray, mon père biologique, qui n’avait montré aucune envie de faire ma connaissance.
« Même s’ils sont parfois un peu agaçants, c’est si important pour moi d’avoir mes parents, mes sœurs, mon oncle Miltie et tous les autres. Je voudrais que tu connaisses ce genre de liens.
– Je vous ai, toi et Arlo. »
Mon mari n’était pas prêt à abandonner.
« Cette histoire d’ADN est formidable. Je n’arrive pas à croire que quelques mèches de cheveux ou tout autre indice enfermé pendant trente ans dans un labo permette de résoudre une affaire. »
Comme un bout de doigt, pensai-je, mais je n’en dis rien. À mon avis, cela ne m’apprendrait rien de plus sur ce qui était arrivé à ma mère presque vingt ans plus tôt. Cette histoire était close. Je ne voulais plus y penser.
Puis quelque chose se produisit qui m’y replongea. Marcy, ma professeure de dessin de l’école d’art, me téléphona : « Ça paraît dingue, mais j’ai reçu un appel d’une sorte de détective qui posait des questions à votre sujet. Il parlait d’activités terroristes à New York et d’un policier tué. Son discours n’avait aucun sens. À la date où a eu lieu l’événement, quel qu’il soit, vous étiez une petite fille. Je lui ai dit qu’il devait faire erreur.
« Il se trompait même sur votre nom. Il vous appelait Joan », poursuivit Marcy.
Je sentais la transpiration sur la paume qui tenait le combiné. Depuis l’explosion, dix-neuf ans plus tôt, j’avais tenu la promesse faite à ma grand-mère de garder pour moi ce qui était arrivé et la manière dont j’y étais liée. Seules deux personnes avaient appris où nous nous trouvions : mon père biologique, Ray, et Daniel.
Daniel n’aurait jamais parlé. Ray, c’était une autre histoire.
« Le détective vous a-t-il dit où il avait trouvé cette prétendue information à mon sujet ? » demandai-je à ma professeure. C’était certainement le FBI. Il me recherchait.
« Tout ça, c’était dingue. Il a évoqué un voyage qu’il avait fait en Colombie-Britannique. Un réfractaire à la conscription pendant la guerre du Vietnam.
– Ils ont dû me confondre avec quelqu’un d’autre », affirmai-je à mon amie.
Durant quelques jours, je m’attendis à voir un agent fédéral sonner à notre porte, mais personne ne se montra. Je savais pourtant qu’il était temps de raconter la vérité à Lenny.
Je m’y préparais. Mais on était en octobre et les Giants étaient parvenus en Série mondiale, contre les Oakland Athletics. Lenny était sur un petit nuage. Je me suis dit que rien ne devait venir contrarier son enchantement. Je lui avouerais ce que j’avais toujours caché quand les matchs seraient terminés.
5
Un ballon orange et noir
Les Giants contre les Athletics. Le rêve de mon mari. En l’honneur du troisième anniversaire d’Arlo, les sœurs de Lenny s’étaient cotisées et nous avaient offert des billets pour le troisième match. L’idée était qu’Ed et Rose gardent Arlo pendant que Lenny et moi allions au stade.
La veille, tandis qu’Oakland menait la série, Lenny prit une décision.
« Mon père est supporter des Giants depuis encore plus longtemps que moi. Voir le match à Candlestick lui ferait un immense plaisir. Donnons nos billets à mes parents. De toute façon, je n’ai pas vraiment envie d’y aller sans Arlo. »
Nous sommes donc restés chez nous, ce qui me convenait parfaitement. Nous allions regarder le match à la télé. Je n’avais pas besoin d’être avec cinquante mille personnes. Deux me suffisaient, du moment que c’étaient ces deux-là.
Une demi-heure avant le début du match, Lenny décida qu’il nous fallait des cacahuètes, comme au stade. Nous avons couru tous les trois au bout de la rue pour en acheter, ainsi qu’un pack de bière. « Allez, les Giants », dit Marie, la caissière, à Lenny en lui rendant la monnaie. Tout le voisinage connaissait mon mari et savait qu’il soutenait l’équipe.
Arlo avait repéré dans le magasin un ballon gonflé à l’hélium. Aux couleurs des Giants, orange et noir. Marie le lui donna.
Je me suis repassé un millier de fois les huit minutes qui suivirent, comme la séquence de l’explosion du Hindenburg, le nuage atomique sur Hiroshima, l’assassinat de Kennedy.
Arlo voulait tenir le ballon, mais Lenny dit que ce n’était pas une bonne idée. « Tu risques de le perdre, mon chéri. On va enrouler la ficelle à ton poignet pour l’empêcher de s’échapper. »
Extraits
« Comment décrire La Llorona telle qu’elle m’apparut ce jour-là? Une vision du paradis à la période la plus noire de ma vie,
L’hôtel ressemblait à la maison d’un conte de fées, Partout où je posais le regard, je découvrais un détail extraordinaire, sans doute une création de Leila ou des gens du village: pas seulement les pierres transformées en singes, jaguars ou œufs, mais les plantes grimpantes qui formaient des tonnelles ruisselaient de fleurs épanouies évoquant les visions les plus folles d’un trip au LSD, les cours d’eau artificiels serpentaient dans les jardins, butaient sur des pierres lisses et rondes – quelques-unes vertes, sous une certaine lumière en tout cas, d’autres presque bleues. Un banc de pierre était creusé à flanc de colline. Il y avait aussi une méridienne qui semblait faite d’un seul tronc d’arbre. Un vieux bateau de pêche en bois, sur lequel s’empilaient des coussins, était suspendu à un arbre. De son tronc jaillissaient une demi-douzaine de variétés d’orchidées et une chouette taillée elle-même dans une loupe de bois. » p. 81
« Maria et Luis avaient commencé à travailler pour Leila peu après qu’elle avait acheté le terrain. Ils étaient tous jeunes à l’époque. À présent, ils étaient vieux.
Luis faisait encore de longues journées physiquement éprouvantes: il réparait les murs, transportait du bois, préparait du ciment, montait sur une vieille échelle pour tailler les branches du jocote, s’occupait du jardin. Mais ses gestes trahissaient des douleurs au dos. Maria se chargeait des repas et, si ses plats étaient toujours délicieux, elle se déplaçait lentement, restait de longues minutes à éplucher une mangue ou à hacher une tête d’ail.
Elmer, le fils du couple, donnait un coup de main partout où il le fallait, mais il était encore adolescent et facilement distrait, surtout par Mirabel, la jeune femme qui aidait Maria. Elle faisait ls chambres, la lessive et chaque jour, au coucher du soleil, elle me préparait au mixeur une boisson composée de fruits frais, de lait de coco et d’un mystérieux assortiment d’épices (cardamome, peut-être, et gingembre?) devenue sa spécialité à La Llorona. Au fil des années, de nombreux clients l’avaient suppliée de leur donner la recette, proposant de la payer, mais Mirabel se contentait de sourire et de secouer la tête. » p. 117-118
« Il m’arrivait une chose étrange à l’hôtel de Leila. Je ne m’étais pas débarrassée de ma profonde tristesse, mais je revenais modestement à La vie. Mon corps engourdi retrouvait des sensations. Le soleil sur ma peau, les bons plats, tout simplement l’odeur du jus d’orange pressée que Mirabel posait devant moi chaque matin et l’élixir au coucher du soleil que j’attendais à présent avec impatience en fin d’après-midi, tout en regardant le soleil plonger derrière le volcan, suivi tous les soirs par un merveilleux repas.
Durant nos dîners dans le patio, Leila me racontait les histoires de ses clients sur plusieurs dizaines d’années. Pour des raisons que je ne comprenais pas, elle semblait souhaiter que je sache ce dont elle avait été témoin. Plus encore, ce qu’elle avait appris.
« Un jour… » commençait-elle devant notre plat de tamales, de pepian de poulet ou une soupière de ragoût de poisson, assaisonné avec des aromates que je ne connaissais pas. Et elle se lançait dans une nouvelle histoire. » p. 119
« Beaucoup d’histoires se sont déroulées à cet endroit. Certaines heureuses, d’autres à vous briser le cœur. Tous ceux que j’ai rencontrés venaient ici poussés par une quête ou une autre. Ils n’ont pas toujours trouvé ce qu’ils cherchaient, mais ils ont en général trouvé ce dont ils avaient besoin. » p. 123
« Le nom qu’elle avait choisi, La Llorona, était un hommage à une vieille légende d’Amérique centrale. Une femme, qui avait vu son mari dans les bras d’une autre, avait fui, aveuglée par la colère, et avait noyé ses enfants dans la rivière. Regrettant immédiatement son geste, elle s’était elle aussi jetée dans la rivière, mais n’avait pas réussi à les sauver. Depuis, elle vivait au purgatoire, parcourait le monde à la recherche de ses enfants et pleurait toutes les nuits. On l’appelait La Llorona – la femme qui pleure. » p. 123
« Une chose qui concernait Leila. Même si elle était morte depuis sept ans, elle hantait encore ce terrain et ses bâtiments. Durant le court laps de temps pendant lequel je l’avais connue, j’avais non seulement compris sa passion, mais j’en étais venue à la partager. J’éprouvais l’obligation d’entretenir ce qu’elle avait créé. Un jardin est une chose vivante. Il faut s’en occuper tous les jours.
« Rien n’est immuable. Ni les jardins ni les histoires d’amour. Ni la joie ni le chagrin. Les animaux meurent. Les enfants grandissent. Il faut apprendre à accepter les changements quand ils se produisent. S’en réjouir si c’est possible. Voir ce qu’ils apportent de nouveau à la vie », m’avait dit Leila un jour que nous nous promenions dans les allées de la propriété et que nous nous arrêtions le temps d’examiner certaines de ses plantes préférées. » p. 368
À propos de l’autrice
 Joyce Maynard © Photo Audrey Bethel
Joyce Maynard © Photo Audrey Bethel
Collaboratrice de multiples journaux, magazines et radios, Joyce Maynard est aussi l’auteur de plusieurs romans – Long week-end, Les Filles de l’ouragan, L’homme de la montagne, Les règles d’usage, Où vivaient les gens heureux – et d’une remarquable autobiographie, Et devant moi, le monde (tous publiés chez Philippe Rey). Mère de trois enfants, elle partage son temps entre la Californie et le Guatemala. (Source: Éditions Philipe Rey)
Site internet de l’autrice
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte Twitter de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice
Tags
#lhoteldesoiseaux #JoyceMaynard #editionsphilipperey #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteratureetrangere #litteratureamericaine #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

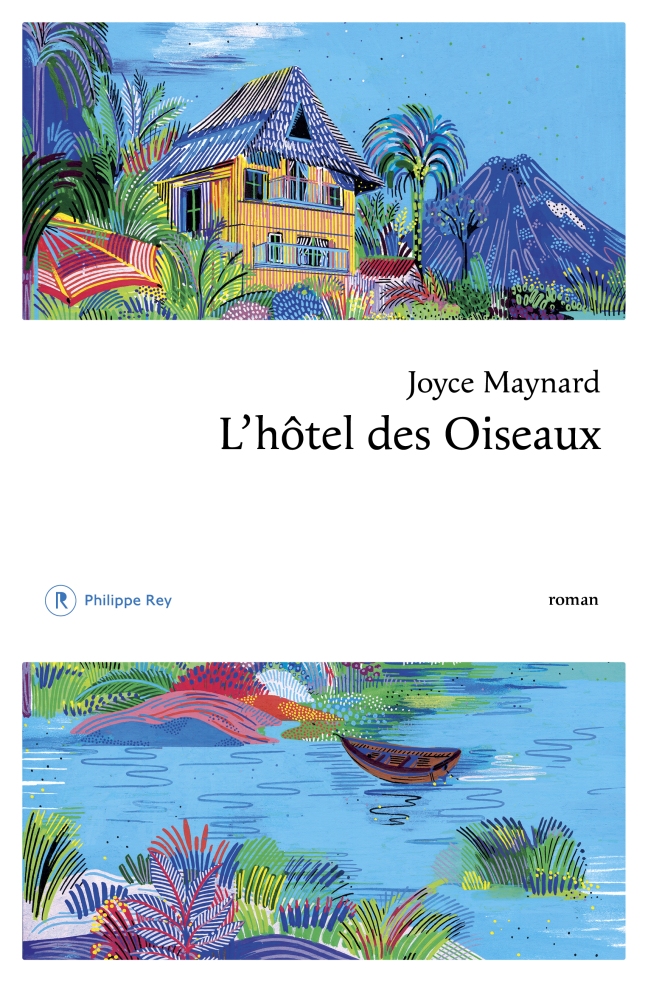







 Mario Vargas Llosa © Photo Power Axle
Mario Vargas Llosa © Photo Power Axle



 Eduardo Halfon © Photo Ulf Andersen
Eduardo Halfon © Photo Ulf Andersen


