En deux mots
Sonia est née en République Dominicaine où sont parents, venus d’Haïti, étaient venus chercher de quoi faire vivre leur famille. Dès son plus jeune âge la fille, très douée, va prendre fait et cause pour cette diaspora et s’engager pour améliorer la condition de tous ces gens discriminés. Un combat d’une vie marqué de nombreux échecs et d’une brillante reconnaissance.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Sonia Pierre, une vie de combats
Dans son nouveau roman, Catherine Bardon met en scène une femme au destin exceptionnel. Sonia Pierre aura lutté toute sa vie pour les Haïtiens qui ont émigré en République Dominicaine et qui étaient réduits à l’esclavage, ou presque. Un combat qui est aussi un magnifique portrait de femme libre.
Une fois de plus Catherine Bardon réussit à nous entraîner vers cette République Dominicaine, où elle séjourne une partie de l’année, avec un formidable roman. C’est à Lechería, au cœur d’un bidonville où logent les travailleurs immigrés haïtiens que nait son héroïne. Ses parents ont traversé l’île en 1950 dans l’espoir de pouvoir échapper à la misère régnant dans leur pays natal, mais ils ont très vite dû déchanter. Même en travaillant sans relâche, Maria Carmen et André ne pourront économiser de quoi rentrer chez eux, où les attend pourtant un fils, confié à sa grand-mère.
Le temps va passer, et malgré leur vie de galériens, la famille va s’agrandir. Maria Carmen va mettre au monde un, puis deux, puis trois garçons. Des enfants qui pourront à leur tour vendre leur force de travail quand ils seront plus grands. Le 4 juin 1963 naît une fille, Sonia.
Très vite, elle va faire preuve de caractère et montrer des dispositions qui impressionnent le père Anselme, un prêtre canadien qui entend offrir les meilleures chances à cette élève aussi appliquée que douée. Il va réussir à convaincre ses parents à la laisser étudier et à l’envoyer dans une vraie école. «Elle avait onze ans et n’avait pas imaginé que son existence pouvait se fracturer comme ça. L’école et le batey. Une vie coupée en deux. Deux vies. Deux univers qui coexistaient à quelques kilomètres l’un de l’autre, sans se rencontrer. Deux populations, deux langues, deux mondes, celui des nantis et celui de ceux qui ne comptent pas. Et elle, un funambule en équilibre sur la frontière qui les séparait.»
Avant qu’il ne soit emporté par la dengue, son mentor lui fait promettre de suivre ses rêves et de ne jamais renoncer. Mes ses aspirations auraient pu être étouffées dans l’œuf puisqu’elle choisit d’aider les travailleurs dans leurs revendications, en menant la contestation et en traduisant les revendications en espagnol. Cette manifestation la conduira en prison. Cependant, grâce à son jeune âge, elle sera relâchée, forte d’une nouvelle conviction. Désormais elle défendra les opprimés. Au bénéfice d’une bourse, elle pourra étudier le droit à La Havane.
C’est sous le ciel cubain qu’elle va imaginer l’association qui va lui permettre de concrétiser son combat. À son retour en Dominique, elle déposera les statuts de la MUDHA, «Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas», le mouvement des femmes dominico-haïtiennes.
Ce sont tous les combats menés par cette femme tenace que raconte Catherine Bardon avec la plume qui avait déjà ravi les milliers de lecteurs de la saga des Déracinés. Faisant suite à La Fille de l’ogre, la romancière s’attache désormais à raconter les destins exceptionnels de femmes de cette République Dominicaine qu’elle aime tant. Ici aussi, elle s’appuie sur une solide documentation, sur un réseau d’informateurs constitué au fil des ans et sur la visite des lieux où s’est déroulée l’histoire, lui permettant d’ajouter les couleurs et les odeurs à son récit.
À la touche féministe, il faut ici ajouter le combat pour le droit à la dignité des immigrés. Au moment où elle promulguée la «loi immigration», Catherine Bardon nous rappelle qu’un homme en vaut un autre, qu’il a droit à la considération et au même traitement que ceux qui abattent le même travail que lui. Un plaidoyer pour davantage d’humanité qui réchauffe le cœur.
 Sonia Pierre recevant le Prix international de la femme de courage des mains de Micelle Obama et Hillary Clinton. DR
Sonia Pierre recevant le Prix international de la femme de courage des mains de Micelle Obama et Hillary Clinton. DR
Une femme debout
Catherine Bardon
Éditions Les Escales
Roman
288 p., 21 €
EAN 9782365698313
Paru le 4/01/2024
Où?
Le roman est situé principalement en Haïti puis en République Dominicaine et à Cuba. On y évoque aussi San Salvador, Saint-Domingue, les Etats-Unis avec New York, Washington, Miami, Houston et la Virginie ainsi qu’un voyage à Genève.
Quand?
L’action se déroule de 1951 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Le destin hors du commun de Sonia Pierre, fille de coupeurs de canne, qui fit de sa vie un combat pour les droits humains.
République dominicaine, 1963. Sonia Pierre voit le jour à Lechería, dans un batey, un campement de coupeurs de canne à sucre. Consciente du traitement inhumain réservé à ces travailleurs, elle organise, à treize ans seulement, une grève pour faire valoir leurs droits. Une des rares habitantes du batey à suivre des études, elle devient avocate et consacrera sa vie tout entière à combattre l’injustice jusqu’à sa mort tragique.
Catherine Bardon révèle l’existence de cette femme exceptionnelle et met en lumière la condition terrible des travailleurs migrants en République dominicaine, un sujet toujours d’actualité. Bouleversant plaidoyer pour la solidarité et la fraternité, Une femme debout est un roman puissant et terriblement humain.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Blog T Livres T Arts
Blog Les chroniques de Koryfée (Karine Fléjo)
Blog Le Monde de Marie
Les premières pages du livre
Dimanche 4 décembre 2011 – Villa Altagracia – 5 h 45
Maudit coq.
Sonia ouvre un œil. Ce volatile va finir dans une casserole. Elle frissonne et remonte la couverture jusqu’à son cou. Depuis son retour de Genève, quatre jours auparavant, elle dort mal. Son sommeil fragmenté, le décalage horaire et la fatigue intense qui l’a envahie lors de ces interminables réunions de travail pèsent sur ses journées. Une grande lassitude ralentit ses pensées et le moindre de ses gestes.
La nuit a été difficile. Elle a eu un mal fou à s’endormir et elle s’est réveillée en sueur à plusieurs reprises malgré la fraîcheur de la nuit. Le dîner d’hier est mal passé. Elle n’a fait aucun excès, pourtant elle s’est sentie ballonnée, une désagréable sensation de brûlure dans l’estomac. L’inconfort l’a empêchée de se rendormir. La sérénade des grenouilles, qui d’ordinaire la berce, ne lui a été d’aucun secours. Pour se donner de l’allant, elle pense à la journée de fête qui l’attend.
Décembre 1950 – Marigot –
Haïti – Message d’information
La rumeur enflait. Elle venait du bout du chemin, du côté de la mer. Les avant-bras plongés jusqu’aux coudes dans l’eau mousseuse, Maria Carmen dressa l’oreille. Interrompant sa lessive, la jeune femme se redressa. Elle leva les yeux vers le ciel. Le soleil n’avait pas encore atteint le milieu de sa course et la chaleur était déjà accablante. Elle essuya une main sur sa robe et du revers balaya la sueur qui perlait à son front. Elle jeta un coup d’œil sur son fils. La porte de la case était ouverte, une vaine tentative de créer un courant d’air. Assommé par la chaleur, le bébé s’était assoupi sur la paillasse. Une mouche butinait la commissure de ses lèvres d’où s’échappait un filet de bave. Maria Carmen entra dans la case, se pencha sur l’enfant et chassa l’insecte d’un moulinet furtif.
Dehors, le bruit s’amplifiait. Elle ressortit de la masure de bois et traversa la mince bande de terre piquetée de maigres touffes d’herbes roussies qui tenait lieu de jardin, pour atteindre le chemin. Les voisins se tenaient sur le seuil de leur case, perplexes. Qui pouvait bien venir troubler la torpeur du village ?
C’était une matinée ordinaire. Les pêcheurs étaient presque tous rentrés après leur nuit en mer. De loin, Maria Carmen salua le grand Samuel et son frère Jaquelin, deux bons à rien qui pêchaient de temps à autre avec leur père. Ils étaient à peine vêtus, juste un caleçon, comme s’ils venaient de se réveiller. Quand il la vit, Jaquelin contracta ses lèvres en un sourire graveleux qu’il accompagna d’un clin d’œil. Elle détourna le regard. Plus loin le vieil Adolphe, jambes arquées, carcasse tremblotante, se cramponnait à sa canne en bambou aux côtés d’Augustine. En face, Céleste était elle aussi sortie de sa case, son dernier-né dans les bras. Tous avaient le visage tourné en direction de la mer.
La main en visière sur le front, Maria Carmen vit une voiture passer au bout du chemin. Elle soulevait un épais nuage de poussière. Quelqu’un criait. Des paroles indistinctes dans un haut-parleur. Mus par un élan collectif, comme aimantés par le véhicule qui venait de disparaître de leur champ de vision, les villageois se mirent en marche d’un pas lent. Maria Carmen jeta un coup d’œil sur son bébé endormi avant de les suivre. D’autres groupes convergeaient en direction du front de mer où une petite troupe cernait déjà la camionnette arrêtée face à l’immensité étincelante. Les derniers pêcheurs s’étaient joints à eux. Une voiture étrangère à Marigot, c’était un évènement assez rare pour créer un attroupement de curieux dans le village. À plus forte raison quand s’en échappait le ronflement ininterrompu d’un flot de paroles. En s’approchant, Maria Carmen vit qu’il y avait deux hommes dans la camionnette. Celui qui était assis à côté du conducteur s’extirpa du véhicule. Écartant les badauds, il se jucha sur le plateau arrière. Il tenait un porte-voix à la main. Une fois debout, il porta l’engin à son visage et réentonna la litanie qu’il n’avait cessé de marteler :
« Ceci est un message d’information de la présidence de la République. Les plantations de la Dominicanie recrutent des hommes et des femmes pour la saison de la canne à sucre. Si vous êtes jeunes et vigoureux, si vous voulez un vrai travail, un bel avenir… »
Les villageois se sentaient gonflés d’importance: on venait tout exprès de Port-au-Prince pour les informer des grandes opportunités offertes par le pays voisin. Bientôt ce serait la zafra. Les plantations de canne dominicaines avaient besoin de leurs bras. Ils seraient transportés, logés et nourris, bien payés, et rentreraient chez eux après la récolte, les poches pleines. Les hommes, déjà séduits, approuvaient d’un hochement de tête. Ils ignoraient qu’en vertu d’accords bilatéraux, la République dominicaine dédommagerait Haïti pour chacune de leur tête. Les femmes, plus sceptiques, faisaient la moue, mais, pragmatiques, elles imaginaient déjà comment dépenser cet argent providentiel. À la fin d’un discours bien rodé, l’aboyeur regagna son siège sous des applaudissements nourris. Déjà la voiture s’éloignait pour aller porter la bonne parole dans le village voisin.
En écoutant le crieur, Maria Carmen avait senti son cœur se serrer. Elle se dandinait d’un pied sur l’autre. Ce n’était pas nouveau. Elle avait entendu des messages semblables, diffusés par la radio et aussi dans les discours du président Magloire. Dans toutes les zones rurales, des véhicules circulaient pour recruter des travailleurs avec le concours du gouvernement haïtien. Des hommes étaient déjà partis là-bas, de l’autre côté de la frontière, en quête d’un meilleur avenir.
Comme Gédéon, le fils d’un voisin, qui travaillait pour une grande compagnie américaine, à l’ingenio Central Romana dans le sud du pays et faisait parvenir de temps à autre un colis à sa famille. Il avait été sélectionné par un recruteur du nom de Rigobert. Il se murmurait que ce Rigobert, originaire de Coterelle, occupait un poste important, il était majordome (contremaître) dans une canneraie où il avait fait fortune. La bonne preuve : il revenait une fois l’an, les poches pleines, pour sélectionner et escorter de nouveaux volontaires vers la plantation dominicaine. Il vantait les immenses champs de canne si abondante de ce côté-là de la frontière, les salaires réguliers, les jolies cases, la fortune de ceux qui avaient déjà franchi le pas… Tout le monde au village s’était mis à croire dur comme fer à cet Eldorado tout proche. Il suffisait de se décider à quitter Marigot, les enfants, les frères, les sœurs, les parents, les amis, la mer, la plage… Il suffisait de grimper dans la kamionet, qui les emmènerait de l’autre côté de la frontière, en Dominicanie, ce pays qui offrait de merveilleuses perspectives.
Après le départ de l’aboyeur, les hommes s’étaient regroupés en petites coteries sur la plage. Ils pesaient et soupesaient ce qu’ils venaient d’entendre. À l’écart, assises dans le sable, abritées sous la toile de leurs parapluies, quelques femmes supputaient : lesquels de leurs fils, époux ou compagnons allaient s’en aller ? Qui allaient rester seule ? Pourraient-elles partir, elles aussi ? Mais dans ce cas, que deviendraient leurs petits ? C’était ainsi, les hommes partaient, les femmes restaient. À s’épuiser pour nourrir et faire grandir les enfants qu’ils leur avaient abandonnés. Elles mourraient au bout d’une éternité passée à attendre en vain.
Pensive, Maria Carmen reprit le chemin de la case de sa mère. Ils étaient neuf frères et sœurs à se partager les deux pièces de la masure, sans compter les bébés. Son pas traînant soulevait des volutes de poussière derrière elle. Les pleurs de Petit Louis lui firent presser le pas.
Janvier 1951 – Marigot – Se konsa lavi
— pa janm di non a la chans !
Assise face à la mer, Maria Carmen eut un hochement énergique de la tête. Les genoux repliés sur sa poitrine, elle laissait filer des poignées de sable blanc entre ses doigts. Les cocotiers étiraient leurs ombres sur la plage désertée, leurs palmes frissonnaient dans la brise du soir. André était à ses côtés, un grand jeune homme efflanqué aux membres déliés, presque un gosse. Le père de Petit Louis. Faute d’argent, chacun vivait avec sa famille. Comme beaucoup d’autres, André pêchait dans une embarcation qui n’était pas la sienne, pour un patron qui le payait mal, car il n’y avait jamais de pêche miraculeuse. Il prêtait aussi main-forte pour des constructions, mais il n’y avait pas grand-chose à bâtir. Ou à la ferronnerie. C’étaient des boulots de rien, pas de quoi s’offrir une maison, pas de quoi entretenir une femme, encore moins un enfant.
Le passage de la kamionet au crieur avait agi comme un électrochoc. Son discours n’était pas nouveau et pourtant, ce fut ce jour-là, qu’après avoir maronné toute l’après-midi, Maria Carmen prit sa décision. Elle en avait assez de cette misère qui lui collait à la peau comme une malédiction. Il fallait juste convaincre André de partir. Là-bas il y avait un travail bien payé pour lui, une maison à tenir pour elle, un avenir…
— Et Petit Louis ? demanda André qui n’était pas du genre aventureux.
Maria Carmen balaya l’argument d’un geste de la main :
— Ma mère s’en occupera. Je reviendrai le chercher une fois qu’on sera installés.
Elle avait tout réfléchi. Il n’y avait pas à hésiter. Pour achever de convaincre André, elle se lova contre lui et picora son cou de petits baisers, comme il aimait. Il la renversa sur le sable encore tiède.
*
Tard le même soir, longtemps après que le soleil eût disparu, des hommes rassemblés par petits groupes devant les cases discutaient encore, pesant le pour et le contre d’une décision qui modifierait à tout jamais le cours de leur vie. Jeunes ou anciens, célibataires ou mariés, pour la plupart sans travail, pas un qui ne caressât l’espoir de la belle vie qu’on leur faisait miroiter. Une vie qu’ils gagneraient avec dignité. Pour cela, ils devraient louer leurs bras pour cette grande zafra qui, chaque année, en Dominicanie, mobilisait une main-d’œuvre d’Haïtiens trop heureux d’échapper à la misère. Quitter leurs familles, c’était le prix à payer. Certains jeunes étaient enthousiastes à l’idée de laisser derrière eux Marigot, ce village ensommeillé où il ne se passait jamais rien. Ils savaient le travail rude dans les champs de canne, mais cela ne leur faisait pas peur, ils étaient vigoureux. Et puis, ils seraient tous ensemble. Les plus vieux restaient réservés, hésitant à abandonner le cours tranquille de leurs vies. Mais tous envisageaient désormais la possibilité de partir. Les femmes vaquaient à leurs occupations, ruminant en silence, laissant les hommes à leurs élucubrations.
*
Maria Carmen et André, eux avaient tranché. Ils se mettraient en route dès le lendemain pour rejoindre la Dominicanie, l’Eldorado.
Maria Carmen se releva titubante. André lui tapota le derrière pour chasser le sable de sa robe. Elle se haussa sur la pointe des pieds et effleura ses lèvres d’un baiser léger. À demain.
De retour à la case, elle mit sa mère devant le fait accompli. Je m’en vais avec André. Petit Louis reste ici. Elle se cramponnait à sa décision, refusant d’y penser davantage, de peur de faillir à sa résolution. Elle jeta quelques hardes dans un bout de toile qu’elle noua aux quatre coins. Elle dormit mal, harassée par la chaleur moite, angoissée à l’idée de ce grand voyage qu’ils allaient entreprendre, eux qui n’avaient jamais quitté Marigot. Au petit matin, elle s’habilla en hâte et cacha quelques gourdes* dans sa ceinture. Elle embrassa sa mère, se pencha sur la paillasse où l’enfant sommeillait. Elle voulait le serrer une dernière fois dans ses bras. Elle fit un geste pour le prendre mais se ravisa. S’il se réveillait, s’il la regardait de ses grands yeux noirs, si elle respirait l’odeur chaude de sa peau de bébé, elle n’aurait plus le cœur à partir. Elle abandonna son fils, le cœur gros. André l’attendait devant le potager.
Ils remontèrent la grand-rue du village d’un pas décidé, refusant de regarder en arrière, et se postèrent à l’angle de la route pour guetter le taptap. Ils attendirent longtemps. À mesure que le soleil montait et avec lui une chaleur accablante, Maria Carmen sentait fondre sa détermination. Un bus finit par apparaître juste au moment où ils s’apprêtaient à rebrousser chemin. Le véhicule bringuebalant, déjà plein à craquer, arborait, peint en bleu vif sur la carcasse de bois, un nom prophétique « Se konsa lavi ».
Par les fenêtres sans vitres s’échappaient des flots de rires et de conversations. Deux femmes se serrèrent pour libérer un bout de banc où Maria Carmen put poser ses fesses. André lui resta debout, puis finit par s’asseoir sur le marchepied. Les palmes s’agitaient dans un murmure pour leur dire adieu. Écrasés les uns contre les autres, les voyageurs étaient résignés à l’inconfort du voyage. Se konsa lavi ! Le taptap s’arrêtait dans le moindre village et de nouveaux passagers montaient sans qu’aucun ne descende. Plus on approchait de Port au Prince, plus ils étaient nombreux à s’entasser dans la carcasse de ferraille et de bois. À chaque virage, chaque cahot, ce n’était que hoquets, cris et protestations, pour la plupart joyeux et bon enfant.
Ils arrivèrent fourbus, essorés de fatigue.
Leur voyage avait duré huit heures. Pour quelque 150 kilomètres.
Dimanche 4 décembre – Villa Altagracia – 5 h 50
C’était ainsi que commençait l’histoire.
Son histoire.
Un aboyeur et un taptap nommé Se kon sa la vi.
C’est du moins ainsi qu’elle se la racontait quand, enfant, allongée sur sa paillasse dans l’obscurité moite de la case, elle peinait à trouver le sommeil. Dans le silence tonitruant de la nuit, les bruits des autres qui se retournaient sur leur matelas crissant de feuilles de maïs en grognant leurs rêves, la tenaient éveillée longtemps après l’extinction des feux. Alors elle voyageait dans sa tête, elle se racontait l’histoire de Maria Carmen et d’André, caressée par l’haleine chaude de la nuit tropicale.
Oui, c’était là son prologue. Son imagination s’envolait là-bas, de l’autre côté de la frontière, au-delà du rio Massacre.
En Haïti, dans un pays qui n’était pas le sien. Un pays de montagnes et de mer, un pays de nègres marrons et de dieux vaudous, un pays de misère.
Et elle commençait le voyage…
1951 – Port-au-Prince – Malpasse – Le pied gauche
Cette foule, ces grandes artères, ces maisons géantes aux balcons de bois, cette circulation, cette agitation incessante, ces gens partout, ce bruit, ces odeurs suffocantes, essence et pourriture mêlées… C’était donc ça, Port au Prince ?
Cramponnée à la main d’André, Maria Carmen ne savait où donner du regard, les yeux arrondis d’une surprise mêlée d’effroi. Tout ici était démesuré. Les voitures pétaradaient le long de grandes rues bien droites, les gens cheminaient avec détermination. Et eux, ils étaient perdus, étrangers à tout ce remue-ménage. On était bien loin de la langueur de Marigot dont la jeune femme regrettait soudain le calme. Étourdis par le trafic, titubants de fatigue, Maria Carmen et André décidèrent de ne pas s’éloigner de la gare routière où ils monteraient dans le premier autobus pour la frontière. Renseignements pris, ils comprirent qu’ils arrivaient trop tard. Pas de transport avant le lendemain matin. Ils n’avaient pas les moyens de s’offrir une chambre dans une auberge, et n’avaient d’autre choix que de rester là. À un stand de rue, ils achetèrent une portion d’effilochée de porc accompagnée de plantains frits qu’ils se partagèrent avant de regagner la station des transports où ils devraient patienter jusqu’au matin. Recroquevillée dans un recoin de la gare routière, Maria Carmen passa la nuit dans les bras d’André. Ces bras seraient-ils assez robustes pour assurer leur avenir ?
Ils ne fermèrent pas l’œil, blottis l’un contre l’autre dans l’attente du premier tap-tap en partance pour la frontière. Au matin, ce fut la foire d’empoigne pour trouver une place, mais à force de trémoussements et de jeux de coudes, ils se faufilèrent jusqu’à la porte du bus. Direction plein est. Après les montagnes, ils longèrent un bon moment l’Étang saumâtre avant d’arriver à Malpasse, la dernière ville du pays. En face, c’était la Dominicanie rêvée.
Malpasse était un lieu étrange, un chaudron du diable chauffé à blanc par un soleil implacable. Il y régnait une effervescence désordonnée qui mettait les nerfs à vif. Un ballet incessant d’hommes qui tiraient des brouettes débordant de fruits, de légumes et de volailles, de femmes avec d’énormes paniers sur la tête, d’enfants dépenaillés qui braillaient. C’était le lieu de tous les trafics, de tous les petits commerces. Tout s’y échangeait, tout s’y négociait, tout changeait de main en un clin d’œil, produits agricoles, produits manufacturés, gourdes et pesos, et bien sûr main-d’œuvre. Car c’était le haut lieu du recrutement pour les plantations de canne dominicaines. Au bout de la route, fermée par la grille imposante qui séparait les deux pays, le plus grand désordre régnait. Des camions bâchés et des tap-tap stationnaient, attendant de passer de l’autre côté pour décharger leur marchandise. Une foule compacte s’agglutinait sous l’œil goguenard des douaniers qui se remplissaient les poches sans vergogne.
Ils avaient cru pouvoir franchir la frontière à pied. En observant le manège des habitués et des douaniers qui contrôlaient les papiers et exigeaient un bakchich pour entrouvrir la grille où l’on passait au compte-gouttes, ils comprirent que ce serait impossible. Le seul moyen, c’était de trouver un recruteur. Ils errèrent dans la bourgade, glanant des informations ici et là, dans l’espoir de tomber sur l’un d’eux. Ils étaient nombreux, comme eux, à guetter. Maria Carmen buta sur une pierre et se rattrapa tout sourire au bras d’André. C’était de bon augure. Elle allait faire une rencontre. C’était le pied gauche, ce serait un homme. Le recruteur, évidemment.
La chance leur sourit. Un attroupement s’était formé. Un rabatteur passait en revue les candidats à l’exil. Il évaluait d’un coup d’œil leur capacité de travail et laissait tomber son verdict. Celui-là oui, celui-là non. Ça avait tout d’un marché aux esclaves, mais eux, pourtant si fiers d’appartenir à la nation qui avait aboli l’esclavage avant toute autre en se libérant du joug des colonisateurs, n’en avaient pas conscience. Ils se prêtèrent à l’examen sans ciller. Elle était jolie, lui un peu maigre, ils étaient jeunes et en bonne santé. Ils furent enrôlés. Le départ aurait lieu le jour même pour la raffinerie de Catarey, dans le centre du pays, au nord de Saint-Domingue. On leur promit un logement à eux, un contrat de travail pour les six mois à venir, soit le temps de la récolte, et un retour au pays d’ici l’été. Ils s’entassèrent sur la plateforme d’une camionnette prête à rendre l’âme à chaque cahot et franchirent la porte de fer.
De l’autre côté, Jimani. La Dominicanie.
Ballottés comme dans une barque emportée par une folle tempête, ils avaient longé un lac, traversé un désert, des montagnes, des vallées, des hameaux, un fleuve, d’autres montagnes, des bourgs, des villes, pour déboucher sur la grande plaine en cuvette par une route tendue entre deux murs de canne à sucre vert tendre.
Duvergé, Neiba, Vicente Noble, Azua, Bani, San Cristobal, Villa Altagracia, Lecheria. Fin du voyage. De la Dominicanie, ils n’avaient rien vu.
1951-1963 – Lechería –
Le parfum de la misère
C’était un hameau en pleins champs, greffé aux parcelles de canne dont les plants étaient déjà hauts. Au bout d’une étroite piste de terre qui se perdait sur la gauche, à moins d’un kilomètre de la route montant de la capitale vers le nord, de l’autre côté du rio Haïna. Au loin, à l’ouest, l’horizon butait sur des collines ondulantes piquetées de cocotiers qui dessinaient les premiers contreforts de la cordillère centrale. Un vert plus sombre contrastait avec celui, tendre, des prairies et des plantations. Par là-bas, derrière, c’était Haïti, le pays qu’ils venaient de quitter et qui déjà leur manquait.
Le camion à bout de souffle s’arrêta dans un dernier cahot qui projeta leurs corps ruisselants de sueur les uns contre les autres. Sa plateforme arrière s’ouvrit et il déchargea son contingent de bras à l’ombre d’un immense manguier, face à une double rangée de baraquements de bois de palme aux toits de zinc. Ils étaient arrivés. Ils s’extirpèrent du véhicule, hébétés, dans un état proche de la catatonie. L’endroit avait la chaleur d’un four. Sous la lumière blanche du soleil de midi qui gommait toutes les couleurs, le paysage déconfit avait fondu en petites touffes de poussière, sans parvenir à masquer la laideur du décor. Non loin, une haute cheminée crachait un panache d’épaisse fumée noire qui assombrissait le ciel azur. La raffinerie.
María Carmen balaya du regard le panorama, sans un mot. Une pierre comprima son cœur et dévala dans son estomac. Elle ne s’attendait pas à ça. Ça, c’était cette enfilade de baraques délabrées. Elle apprendrait plus tard que c’étaient les anciennes étables d’un élevage de Trujillo. En guise de comité d’accueil, un attroupement de femmes mal attifées, armées d’un balai ou chargées d’une bassine, un essaim d’enfants à moitié nus, maigres à faire peur, au ventre gonflé, deux vieillards statufiés sur de vilaines chaises. Des chiens faméliques se morfondaient, couchés sur le flanc, le museau assiégé de mouches. Un coq étique fouaillait du bec la terre, sa crête pendait sur le côté, deux plumes hérissaient son croupion. Un chaudron noirci chauffait sur un lit de braise devant un porche. Des pièces de linge défraîchies séchaient, pendillant à des piquets.
Un vague relent de pourriture et d’excréments flottait dans l’air mêlé à une entêtante odeur de sucre brûlé. Mais ce que María Carmen renifla, c’était le parfum de la misère. Son regard s’agrippa à un arbuste orné de rubans chamarrés au tronc souillé de coulures de cire. L’arbre marabout dressé telle une potence. Les grigris des croyances vaudous la réconfortèrent, un petit peu.
Ils étaient là désormais, et tout irait bien.
On le leur avait promis.
*
Une grosse camionnette apparut. Un contremaître, un Haïtien, peut-être un ancien coupeur qui avait pris du galon, en descendit. Il fit décharger une petite table et une chaise de bois qu’il installa au centre de l’esplanade. Il posa un épais registre, s’assit, et, d’une écriture maladroite, enregistra les nouveaux ouvriers. Nom, âge, liens entre eux. Puis il tria le troupeau silencieux qui avait resserré ses rangs dans un réflexe animal. D’un mouvement net de sa trique de goyave. Les hommes seuls à droite. Les couples à gauche. Les femmes seules, elles étaient trois, à l’écart. « yo ale tou dwat nan bordel la » (celles-là, elles vont tout droit au bordel) bougonna d’un air désolé une ancêtre toute fripée, agrippée à un bâton qui lui tenait lieu de béquille. María Carmen eut un hoquet, elle venait de comprendre ce qui lui avait échappé jusque-là : ces filles jeunes et sans attache n’avaient pas été recrutées pour les travaux des champs.
À María Carmen et André, le contremaître attribua une cellule dans une bicoque toute en longueur, un taudis de planches et de torchis craquelé, au sol en terre battue. Trois murs aveugles, une porte de tôle ondulée mal ajustée qui laissait passer le jour en haut et en bas, surmontée d’une plaque de bois portant le numéro neuf, – María Carmen lâcha un petit soupir de soulagement, c’était son numéro porte-bonheur, à l’intérieur une paillasse malodorante sur un châlit de bois, une table branlante et un tabouret, un seul. Sordide et insalubre. Pour la cuisine c’était dehors. Pour les besoins aussi. « Tou sa pou sa ». Cet accablant constat s’imposa à María Carmen tandis qu’elle déposait son balluchon sur le lit. Son estomac, vide depuis la veille, se rappela à elle dans un spasme. Accablée, la jeune femme se mordit les lèvres et dut se reprendre pour retenir ses larmes.
Ils étaient là désormais, et tout irait bien.
On le leur avait promis.
*
Dans le regard méprisant des anciens, ils étaient des « kongos ». Des ignorants sans la moindre idée des us et coutumes du batey. Parqués dans une zone réservée aux nouveaux, désorientés par ce monde qu’ils découvraient. Ils devraient trouver leurs marques et le plus tôt serait le mieux. Les anciens, eux, se serraient les coudes, jouissant de l’aura de qui a de l’expérience. Ils étaient installés dans les meilleures zones et les familles bénéficiaient de cases individuelles. Les contremaîtres avaient trouvé ce moyen, créer des clans pour entretenir des rivalités artificielles.
Le quotidien se mit en place. Au fil des jours, chacun semblable au précédent, les nouveaux venus apprirent la loi du batey : c’était la loi de l’exclusion, de la faim, du profil bas, du désespoir. Celle des deux tonnes quotidiennes de canne par tête, sous la menace muette des coups de fouet, dont avaient été roués, pour l’exemple, deux ouvriers qui avaient tenté de s’enfuir.
C’était un endroit à l’écart du monde. Un hameau autarcique où les règles et l’ordre, le logement, les chemins, le transport, le magasin, l’infirmerie étaient assurés par la compagnie. Un monde lent et pesant comme le pas des bœufs qui ahanaient en tirant les chariots rouillés aux essieux grinçants. Destinés au transport des fagots de canne, ils ramassaient les hommes armés de leur machette avant les premières lueurs du jour, pour les ramener à la nuit tombée, la tête basse, l’estomac vide, le corps anéanti, les bras endoloris, les mains couvertes d’estafilades, le dos cassé de s’être penché au plus près du sol pour couper les tiges à ras, les épaules moulues d’avoir coupé, coupé, coupé, mis en bottes, mis en bottes, chargé la canne. Un labeur de bête sous un soleil d’enfer.
Après leur départ, le batey devenait le territoire des femmes qui s’apostrophaient d’un compartiment à l’autre. Elles avaient construit autour de leur infortune un mur de solidarité, elles se serraient les coudes, la misère n’avait pas réussi à anéantir leur bonhomie, pas encore gâté leurs âmes. Elles égrainaient leurs souvenirs, parlaient de là d’où elles venaient, Côtes-de-fer, Terre noire, Grande saline, Belle fontaine, Gros l’Abîme… Elles avaient improvisé des métiers, coiffeuse, sage-femme, couturière, infirmière, cordonnière… Elles s’approvisionnaient au colmado de la centrale, une banane plantain, une racine de manioc, une tasse de riz, où le bodeguero décomptait les achats de la paye de leur homme au prix fort. De toute façon, il n’y avait pas de peso, la seule monnaie d’échange était des jetons qui ne valaient que sur la plantation. L’argent circulait en circuit fermé sans que nul n’en voie jamais la couleur, une économie en vase clos. Elles cuisinaient, lavaient le linge, grattaient la terre d’un minuscule conuco, potager, grignoté sur les terres de la plantation, jetaient des épluchures aux poules, tressaient des chapeaux en palme. Elles arbitraient les chamailleries des enfants, certains pas plus haut que trois pommes, qui poussaient comme des herbes folles, livrés à eux-mêmes et dont les jeux brouillons se terminaient en genoux égratignés et en pleurnicheries. »
Extrait
« Difficile de réconcilier tout ça dans sa tête d’enfant.
Sonia n’était déjà plus d’ici et pas encore de là-bas. Elle le pressentait, ce serait difficile. Chaque jour de sa vie.
Elle avait onze ans et n’avait pas imaginé que son existence pouvait se fracturer comme ça. L’école et le batey. Une vie coupée en deux. Deux vies. Deux univers qui coexistaient à quelques kilomètres l’un de l’autre, sans se rencontrer.
Deux populations, deux langues, deux mondes, celui des nantis et celui de ceux qui ne comptent pas. Et elle, un funambule en équilibre sur la frontière qui les séparait. » p. 74
À propos de l’autrice
 Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas
Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas
Après une carrière dans la communication, Catherine Bardon se consacre désormais à l’écriture et partage son temps entre la France et la République dominicaine. Elle est l’autrice de la saga Les Déracinés qui s’est vendue à plus de 500 000 exemplaires et qui a été distinguée à de nombreuses reprises, notamment par le Prix Wizo et par le Festival du premier roman de Chambéry en 2019. En quelques romans, Catherine Bardon s’est imposée comme une voix puissante du paysage romanesque français. Ses romans ont été traduits dans plusieurs langues. (Source: Éditions Les Escales)
Page Facebook de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice
Tags
#unefemmedebout #CatherineBardon #editionslesescales #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #republiquedominicaine #SoniaPierre #coupdecoeur #lundiLecture #LundiBlogs #NetGalleyFrance #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie










 Mattia Filice © Photo DR
Mattia Filice © Photo DR


 Judith Perrignon © Photo Patrick Swirc
Judith Perrignon © Photo Patrick Swirc
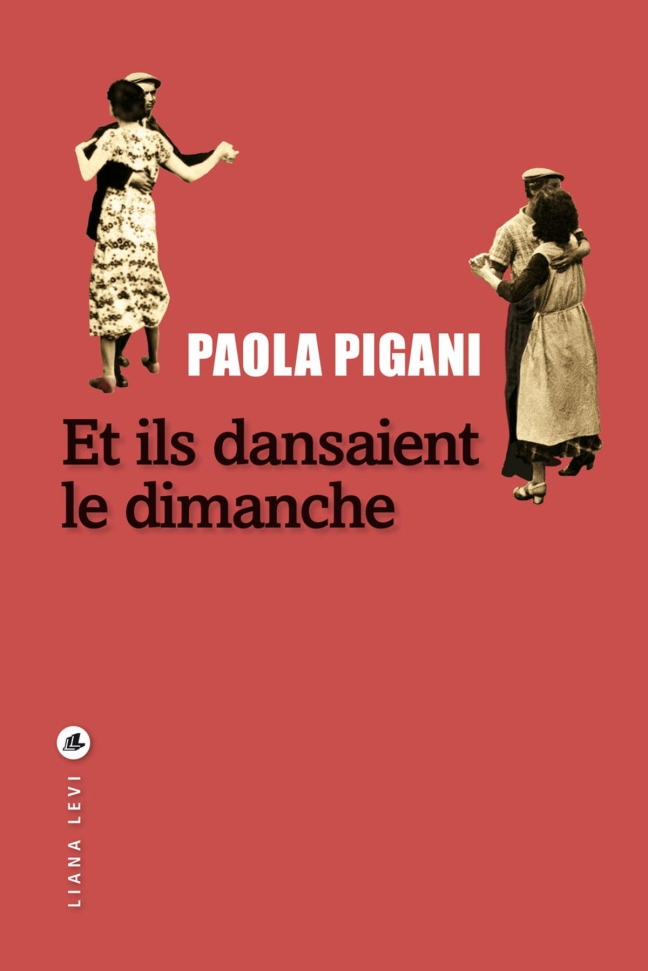

 Paola Pigani © Photo Melania Avantazo
Paola Pigani © Photo Melania Avantazo

