En deux mots
Jeanne est une archéologue de sauvetage, appelée sur des sites qui vont être prochainement détruits, comme c’est le cas en Béringie, du côté de la Sibérie occidentale après le réchauffement de la planète. Une région qu’avait déjà exploré le géologue Hushkins à l’époque de la Guerre froide et où vivait Sélhézé, il y a des milliers d’années. Leurs histoires respectives forment la trame de cet ambitieux premier roman.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Les trois visages de la Béringie
Dans cet ambitieux premier roman, Jeremie Brugidou nous fait découvrir la Béringie à travers les récits croisés d’une archéologue, d’un géologue et d’un autochtone à trois époques différentes. Sur fond de dérèglement climatique et d’ambitions géopolitiques.
On le sait, le permafrost est menacé de disparaître avec le réchauffement climatique et de libérer ainsi des tonnes de gaz à effet de serre émises par les plantes et animaux anciens gelés. Et c’est en Sibérie occidentale, du côté du détroit de Béring que la menace est la plus grande. C’est là que l’on envoie Jeanne, une archéologue, afin qu’elle puisse faire des prélèvements et retracer en particulier l’histoire de la faune prise jusque-là dans les glaces. Ses traces préhistoriques vont disparaître pour laisser place au «Beringia Park» que des investisseurs souhaitent ériger là pour le repeupler de mammouths et aurochs clonés et proposer des safaris aux chasseurs.
Revenir au temps des chasseurs, c’est aussi ce que fait l’auteur en nous racontant la vie de l’un d’entre eux, Sélhézé. Le jeune homme, il y a plusieurs milliers d’années, va être confronté à la montée des eaux et à la création sur ses terres d’un détroit qui reliera Russie et Amérique. On l’aura compris, c’est encore une fois le moyen de rassembler les temporalités, de confronter ce bouleversement climatique avec celui qui nous menace. Mais ce télescopage des époques s’accompagne aussi d’un mélange des genres dans le style. On y retrouve un journal de bord, des rapports scientifiques, des mythes, un rapport de fouilles, un herbier, de la poésie et une quête obsédante.
Ces allers et retours entre raison et imagination caractérisent surtout Hushkins, le géologue qui n’a de cesse de fouiller ce territoire, d’en explorer tous les recoins. Car ici la rigueur scientifique s’imprègnent des croyances qui ont aussi construit cet endroit du globe, l’œuvre littéraire en étant en quelque sorte le dépositaire.
Premier roman ambitieux, Ici la Béringie nous parle certes d’écologie, mais il va bien au-delà. Dans notre rapport au monde et aux animaux, dans la primauté de l’économie et de l’exploitation des ressources et dans le besoin de sans cesse nourrir nos imaginaires, il nous propose une sorte de bréviaire pour les temps futurs qui s’annoncent bien sombres. Ce faisant, il s’inscrit logiquement à la suite de Doggerland, le roman dans lequel Elisabeth Filhol explorait elle aussi une terre engloutie, celle qui reliait la Grande-Bretagne au reste de l’Europe.
Ici, la Béringie
Jeremie Brugidou
Éditions de l’Ogre
Premier roman
200 p., 19 €
EAN 9782377561049
Paru le 19/08/2021
Où?
Le roman est situé entre la Sibérie orientale et l’Alaska, sur ce qui consiste aujourd’hui le Détroit de Béring.
Quand?
L’action est construite autour de trois époques, il y a quelque quatre mille ans, dans les années de Guerre froide et dans un futur assez proche.
Ce qu’en dit l’éditeur
Il y a quelques milliers d’années, Sélhézé, une jeune Qui-Collecte, voit la mer envahir progressivement son environnement.
À l’aube de la guerre froide, Hushkins, un géologue américain, découvre les traces de la Béringie au milieu du chaos provoqué par les incursions américaines et soviétiques.
Dans un futur proche, Jeanne, une archéologue, cherche son frère disparu en même temps qu’elle dirige le chantier de fouilles du permafrost au sein du Beringia Park, sorte de Jurassic Park consacré à la faune du Pléistocène.
Des milliers d’années les séparent et pourtant, les destins de ces trois personnages sont intimement liés et portent en eux le secret de la Béringie.
Ici la Béringie est l’histoire de ce territoire disparu, mystérieux et sauvage, qui sommeille aujourd’hui dans les profondeurs du détroit de Béring.
Dans son premier roman, Jeremie Brugidou reprend les codes du récit d’exploration, du carnet de terrain et du roman d’aventures pour interroger les relations que nous entretenons avec le vivant à l’heure où les bouleversements climatiques nous rapprochent plus que jamais des Tchouktches, derniers habitants de cette terre fantôme qu’est la Béringie.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Goodbook.fr
Diacritik (Jean-Philippe Cazier)
Le Carnet et les instants (Thierry Detienne)
Actualitté (Victor de Sepausy)
La Kube
L’echo.be ( Timour Sanli)
Blog La page qui marque
Blog La viduité
Blog de Claire Garand
Charybde 27: le blog
Les premières pages du livre
« Malgré le ressac, le ferry manœuvre élégamment au plus proche de la grève d’Ouelen. Le sable froid reçoit mes pieds et le vent de la toundra sibérienne m’accueille. Sur la jetée, William me tend immédiatement le carnet. La couverture épaisse et gondolée est auréolée de traces de sel. Sensation mêlée de douceur et de rugosité, je passe ma paume tout autour. Impression de caresser une vieille bête aux poils cristallisés par la mer. Je ne l’ouvre pas tout de suite. William m’a contactée il y a quelques mois pour rejoindre cette mission de sauvetage archéologique et diriger les fouilles de l’« arche aux baleines ». C’était l’occasion de retrouver Naomi et d’explorer une piste plus personnelle. Le carnet avait été remis à William dans une enveloppe à mon nom par l’un des locaux engagés sur le terrain de fouilles. C’est ce qui a précipité mon départ. J’ai tout de suite su que c’était un message de mon frère, même si William m’expliquait au téléphone qu’il s’agissait visiblement d’un carnet authentique, jusque-là perdu, d’une expédition scientifique qui s’était déroulée ici il y a environ un siècle.
Demain, je dois rencontrer les rangers de l’immense parc de conservation qui jouxte la zone de fouilles pour évoquer les « fuites » d’ivoire de mammouth. L’augmentation brutale de la fonte du permafrost avait pris tout le monde de court. D’anciens vestiges biologiques très bien conservés avaient émergé dans le Grand Nord et provoqué une ruée vers les ossements. On retrouvait mammouths, dents de sabre, saïgas, tous les classiques. Parfois, on découvrait aussi des structures préhistoriques comme l’arche aux baleines et alors, dans l’urgence, on faisait appel à moi. Naomi m’avait parlé du trafic important de parties animales décongelées qui transitait par les bateaux de pêche du détroit. Ça provoque parfois certains accrochages avec les orques qui migrent et qu’elle observe en ce moment. Après des mois de séparation, je la rejoins enfin.
La traversée du détroit de Béring a été moins pénible que je ne le pensais. Belle conversation avec un architecte tchouktche sur le ferry. Le détroit se dit aussi « Irvytguyr ». J’ai noté ce que j’ai pu malgré la houle. Son sourire était vertigineux. Il m’a dit qu’en tchouktche il y avait beaucoup de termes pour désigner le permafrost selon la densité du gel dans les sols. À une époque où les changements étaient plus lents, on inventait des noms pour chaque état des choses. Il a attiré mon attention sur quelques larges ombres très vives qui sillonnaient sous la coque. J’ai repéré un aileron poivre et sel, recouvert de crustacés ou de coraux avec une large cicatrice sur la pointe qui se recourbe en spirale. Mon camarade de mer est un Louoravétlan, un « homme véritable », m’a-t-il traduit avec un rictus. Il connaît les baleines, c’est un chasseur et, comme beaucoup, il travaille en ce moment sur les grands travaux. Au-dessus de nous, on ne voyait que ça : le chantier du pont monumental s’imposant face au ciel. Un pylône s’enfonçait brutalement au milieu du petit morceau encore émergé de l’île de la Grande Diomède, qu’on appelle ici Imèklin. J’ai mieux compris les tirades révoltées de Naomi. Quand l’énergie magnétique avait scellé l’union des États-Unis et de la Russie, il avait fallu bâtir une infrastructure au goût du jour. Du côté de l’Alaska, tout le monde ne parle que du grand pont qui reliera les continents et survolera l’enfer qu’est devenu le détroit depuis l’augmentation du trafic maritime avec l’ouverture du passage du Nord-Ouest. La construction atteint presque la Sibérie. Encore quelques mois de travaux et ce fameux pont géant sera terminé. La Gozok Sustainable Industries ne me laissera pas un jour de plus avant de tout faire exploser pour installer ses turbines sous-marines et renforcer les sols là où ça fond. Le chauffeur qui m’a emmenée à l’embarcadère du ferry côté Alaska s’est vanté d’assurer les transports avec l’un des derniers véhicules à pétrole de la planète. Je regardais alors le chantier du pont qui se prolongeait vers l’horizon. « Du côté sibérien, les travaux prennent du retard », m’a-t-il dit. Je sais, c’est pour ça qu’on m’a appelée.
Entre le signe inattendu de mon frère, l’ordre de mission archéologique, les dossiers de subventions et les négociations avec Gozok, tout s’était accéléré jusqu’à mon départ. C’est la première fois que je dirige un chantier de fouilles pour la paléoanthropologie. Je me familiarise tout juste avec les termes et les concepts. Le référent paléo m’a gentiment fait comprendre que je n’avais rien à faire ici et que, s’il leur fallait un vulgaire braconnier des sous-sols, ils avaient déjà de quoi faire sur place. Il m’a reprise sur la « palynologie ». J’ai encaissé. Quel rapport entre la mission ici et l’étude des pollens ? J’ai tenu bon, je suis quand même la meilleure dans les sauvetages de fouilles archéologiques improvisées, celles qu’on lance en urgence avant que les projets de grands travaux ne rasent tout. Je n’y connais rien en préhistoire, mais William me fait confiance.
Première nuit en Tchoukotka. J’aurais pu dormir si je n’avais pas ouvert ce foutu carnet. Installée dans ma tente sur le camp de fouilles, sur la première page, année 1946, je lis le nom de Hushkins. L’écriture change en cours de route. Je suis persuadée que c’est mon frère qui a écrit la suite. Un jeu de piste un peu pervers pour que je le retrouve. J’ouvre prudemment le vieux carnet qui s’effriterait presque. Sous la pulpe de mes doigts, ça crépite au coin des feuilles. Les premières pages sont remplies de listes assez précises d’espèces que j’imagine végétales au vu de l’herbier qui compose les pages suivantes : des tiges, des fleurs, des graines, toutes sèches et cramées par le sel. Puis des traces de sang oxydé et d’écailles recouvrent quelques pages, après quoi les listes s’estompent et des récits se chevauchent, parfois illisibles. William a utilisé le terme « fiévreux » en parlant de ce carnet abîmé, dont les pages étaient auréolées et cartonnées par l’humidité et le sel. Entre deux fleurs aplaties, ça se brouille. Un petit bruant des neiges perce la première aube dans le ciel noir. Je manipule difficilement le carnet, dont chaque page semble près de s’effriter sous mes yeux. Les tiges se mêlent aux fibres du papier, ça entre dessous, dedans, à travers. Ici le bleu évaporé des spores vibre encore sur la plaine. Des fleurs, Arnica frigida, Astragalus arcticus, Cerastium beeringianum, recomposent un paysage en deux dimensions, pressées sur l’aplat du papier. Ce carnet a plus d’un siècle, pourtant quelque chose s’agite encore entre les pages. Je cherche les signes de mon frère dans les remous chronologiques. Mon rythme cardiaque change et me pince la poitrine. C’est là que le sommeil me quitte définitivement. Au-dessous de Lupinus arcticus, une fleur qui déverse sa vivacité argentée sur toute la double page, une écriture plus récente, moins effacée : Il y a ici la Béringie. William m’a répété cette phrase énigmatique prononcée par l’homme qui lui avait apporté le carnet. Je fouillerai les autres carnets pour comprendre ce qu’il a voulu dire, mais je suis sûre que c’est la marque de mon frère. Derrière ces mots, des pages semblent scellées, je ne parviens pas à les séparer sans déchirer complètement la page avec son écriture. Des miettes végétales tombent à chaque tentative. Ça sent l’humide. Sur les pages suivantes, je devine, esquissée au charbon délavé, une vaste vallée fluviale. Un ours invente la prairie par un chant profond et chaud. Je repense aux kèlièts, les esprits invisibles, et aux tèryky, des créatures errantes de la toundra, contre lesquelles le Tchouktche du ferry m’a mise en garde. Des êtres déplacés et déliés ; et des ivrognes, a-t-il ajouté après un silence, en rigolant. Ne pas oublier aussi de trouver des « racines d’or » que l’on peut faire en tisane pour soigner les yeux. Je ne me lasse pas de caresser du bout des doigts Lupinus arcticus qui halète dans un souffle bleuté. Plus loin, c’est une loutre qui crée la Terre, et au verso je lis : « Ranunculus hyperboreus a été figée dans sa danse tourbeuse, pourtant tu peux la faire revivre depuis les profondeurs de la mer. »
J’étais au fond de l’océan et tout était translucide. Jusqu’à la surface s’érigeaient de grandes montagnes dont les pointes dépassaient à l’air libre. J’étais peut-être à une centaine de mètres de profondeur et je respirais parfaitement. C’était une technique que j’avais apprise des poissons et qu’il ne fallait surtout pas que j’oublie. Je me répétais sans cesse la procédure respiratoire à suivre. C’était complexe, je crois, mais presque naturel, apaisé en tout cas. Je voyais des corps colossaux passer au-dessus, des baleines et d’autres créatures. Il y avait des tanks qui descendaient également en file indienne depuis la berge lointaine. Ce qui me frappait, c’était la clarté de l’eau, en noir et blanc, tout était limpide et flottant sur des distances infinies. La guerre se préparait dans une placidité indescriptible. Au fond, un bouillonnement m’appelait intensément. Je descendais lentement le long de la pente douce, de plus en plus profondément. Soudain, j’ai croisé un corbeau. Je ne sais pas s’il nageait ou volait. Il s’est posé devant moi et avait l’air de me toiser. J’ai commencé à douter de ma propre légitimité sous-marine. Je n’arrivais plus à respirer, je me suis réveillé.
Pas besoin d’être palynologue pour comprendre. Il pose le carnet et fait tourner entre ses doigts la fleur vive au-dessus de son front. Les pollens parlent la langue commune. Être à l’écoute, laisser passer les premières incompréhensions, attendre que les particules se déposent, par strates. Parfois ça parle, et on ne s’y attend pas. C’est quand ils ont trouvé ici la même fleur qu’il avait cueillie de l’autre côté que l’évidence lui a claqué la poitrine. Les mêmes signatures-pollen de part et d’autre du détroit. Il place l’anémone dans son herbier sibérien et ils compareront la fleur avec celle conservée dans l’herbier alaskien, l’herbier maudit. Avec soin, il la fixe au papier par la tige, note la date, l’arborescence phylogénétique avec le nom de ses ancêtres connus et une nouvelle suggestion de dénomination taxonomique qu’il avait pris l’habitude d’inventer avec elle : Dianae beringianum. Il relève le nez et sent le souffle glacé de la toundra sur sa nuque. Il fixe à nouveau la page fraîche de l’herbier qu’il laisse un peu battre au vent sec. Il le sait, ces fleurs appelées aussi « filles du vent » ne sont pourtant pas arrivées ici par le vent d’est. Elles ne sont pas plus récentes que celles de l’autre côté, en Alaska, ni plus vieilles que celles des îles Aléoutiennes. Elles ont toutes colonisé par radiation depuis un centre commun qui se trouve aujourd’hui sur le plateau océanique à des centaines de mètres sous la mer. Il en mettrait sa main à couper.
Hushkins se relève de son lit de tussack, s’ébroue et envoie une secousse dans ses bras engourdis et ballants. Des paquets de tiges sèches roulent sous le vent. Debout un temps, il reste immobile devant l’étendue de la péninsule des Tchouktches, aux limites des terres sibériennes. Les poils de la steppe se dressent en un frisson qui fait chanceler le vieux chercheur. Son corps partage une autre intimité avec ces lieux. Le vent froid agresse les vertèbres. Il se penche en avant et observe, le dos rond, les morceaux de prairie secs qui partent au vent et tournoient un temps autour de son corps empêché. Il a arpenté des terres semblables toute sa vie, de l’autre côté du détroit, juste en face. Maintenant, ces années lui remontent dans la colonne. Hushkins se laisse toiser docilement par le vent, le corps penché en avant, la tête relâchée. Diane lui avait appris à détendre ainsi le dos quand il se fige. Il fait quelques pas, la tête et les bras pendants, perdant un peu l’équilibre, se laissant aller aux aspérités du terrain, fermant parfois les yeux, détendu jusqu’à retomber sur les touffes moelleuses de tussack. Les autres sont de l’autre côté de la colline, près du campement. Il frôle les limites que forment la prairie avec les dunes et son humanité avec le reste. Des limites en saccades, comme des plateaux empilés, des morceaux de terrain qui se glissent dessus dessous en une cristallisation anachronique. Avec son ancienne réglette de géologue, il mesure des empilements de quelques décimètres d’épaisseur, soit plusieurs centaines de milliers d’années.
Enfoncer le doigt dans le sable. Humer les tiges de jonc humides. Réveiller les paumes au lichen. Relier les deux mondes. Au pied des volcans, les plages pareilles aux jours se chevauchent et dessinent une carte du temps. Un battement par siècle. Il lui semble que son cœur s’est accordé au temps des transformations géologiques depuis qu’il se laisse guider par l’idée, trop vaste pour son esprit, que Diane lui a soufflée. L’idée de la terre engloutie. L’archéologie des crêtes de plage révèle une esquisse vivante du mouvement des bancs de sable. Elles dessinent les mouvements de la mer comme de la terre et forment une archive à ciel ouvert de leurs interactions au cours des différentes périodes de glaciation et de déglaciation. Chaque bande de sable lui fournit un indicateur sur une ligne du temps dont il ne connaît pas encore tout à fait l’échelle. Il pourrait compter en millions d’années s’il trouvait les bons empilements. Entre ses doigts, il caresse la petite pierre polie qu’il garde toujours dans la poche de sa chemise. Elle lui rappelle les lèvres de Diane et l’abrasion du torrent où il l’avait rencontrée pour la première fois ; encore une autre chronologie. Son regard pointé vers l’est, il croit distinguer l’autre rive, de l’autre côté du détroit de Béring, et le temps en extension accélérée qui l’en sépare. L’expédition délivre toutes ses promesses, il faut juste tenir, encore un peu, et continuer à jouer au chef de meute. Devant lui, la mer et ses nuances de bleu. Il voit clair sur des kilomètres et des millénaires à la fois.
Avant de rejoindre les deux autres, il s’assoit dans le sable pour observer un moment l’activité des insectes. Il oublie un peu les plantes et leurs rêves enracinés dans une mémoire qu’il voudrait tant troquer contre celle de ces coléoptères littoraux qui vaquent à d’immenses projets. Dans un autre récit, leur prothorax ressemblerait au masque d’un esprit dit « soleil noir » et dont les élytres formeraient le corps iridescent et polymorphe. S’ils ouvraient la bouche, on y verrait l’univers. Hushkins a déjà épinglé le spécimen, et les boîtes entomologiques sont pleines. En suivant les errances de ces nouveaux personnages à la trace, Hushkins trouve des fossiles de coquilles de mollusques disparus. Celles de l’escargot marin géant Neptunea complètent les relevés des crêtes de plage et indiquent un ressac de l’océan s’étalant sur des dizaines de millions d’années. Il y a environ treize mille ans, se répète-t-il, la terre s’étalait à sec jusqu’à l’Amérique pour la dernière fois. Maintenant, il a la certitude que Diane avait raison, mais elle ne verra jamais comment leurs deux univers se rejoignent. Depuis, la mer recouvre les terres et monte encore, et les migrations de mollusques bivalves ont repris entre la mer de Béring et la mer des Tchouktches, autour de la péninsule extrême-orientale de la Sibérie qui touche presque l’autre doigt lithique, américain.
Les moustiques fêtent le crépuscule. Leurs corps montent et descendent selon une carte qu’ils sont seuls à connaître. Ils sont affairés au grand événement de la fin des jours. Ils disent adieu à ces milliers de petits soleils qui se couchent à quelques centaines de mètres d’eux. C’est ce monde-là qu’ils perçoivent, lui aurait dit Diane. Verront-ils le lever du jour ? Pendant ce temps, Hushkins rejoint ses deux compagnons, Sigafoos et Myza, et à eux trois ils forment un triangle qui avance sur la plaine, consciencieusement. Ils ont le nez pointé vers le sol, un carnet à la main. Ils composent un tableau. Trois hommes dans les hautes herbes, deux accroupis, un debout, masques et carnets. Hushkins peut écrire debout immobile pendant des heures. Parfois, autour d’un dessin de semence de pissenlit, ses notes de terrain trahissent une bifurcation inattendue : « Nous en étions là à tracasser le sol… depuis combien de temps déjà ? » Les graminées s’accumulent dans les poches des yeux. Hushkins a abandonné le masque anti-moustiques. Le grillage que portent Sigafoos et Myza semble animé d’une pellicule vivante qui vibre, cherchant désespérément un accès au sang. Cette expédition repose d’abord sur une intimité inscrite dans le partage involontaire des sangs, orchestrée par un empire de moustiques nouvellement éclos.
Sigafoos insère son stylet dans le sol, mesure l’hygrométrie, note, prélève le tubercule, note, effrite les graines, note. Il réserve une case dans chaque ligne de son tableau pour y apposer le bout de son doigt recouvert de pollen : il y presse son doigt, et une trace jaunâtre imbibe le papier. Il a remarqué que la couleur du pollen et la forme de l’auréole ne sont jamais tout à fait identiques d’une fleur à une autre et il crée en parallèle un autre classement, qu’il garde pour lui. La palynologie trouve là sans doute son plus haut point d’expression. C’est peut-être une sorte de nuancier phylogénétique, une gamme de couleurs de l’évolution du vivant depuis l’apparition des plantes à fleurs et des pollinisateurs. Le soleil se couche, comme chaque soir, loin derrière ces montagnes qu’on distingue parfaitement à plusieurs centaines de kilomètres dans une clarté de ciel. Et le trio prend un moment pour sentir la transition des couleurs, des températures et des sons.
Le triangle a fait bon chemin. La plaine a été quadrillée, l’inventaire de ce côté de l’océan doit être pathologiquement exhaustif. Hushkins était déjà allé au bout de son obsession de l’autre côté, seul, avant la guerre. Ou plutôt il avait terminé seul, puisque Diane l’avait accompagné pendant plusieurs années. Puis elle était morte au loin, d’un cancer, pendant qu’il finissait le recensement. Il n’en parle jamais. Quand il a rencontré Myza à Petropavlovsk, chez un mécanicien, il partait pour un exil sans retour. Mais auprès de Myza, il s’est mis à raconter, encouragé par sa générosité avec les histoires, et a déversé un flot de paroles pendant plusieurs nuits. Les histoires de plantes et de Diane se mélangeaient et Myza croyait reconnaître une histoire familière. Il a encouragé Hushkins à poursuivre la quête, il l’accompagnerait et lui servirait de guide. Alors Hushkins a retrouvé le fil de son « rêve palymnésique », comme il l’appelait, un rêve hanté de souvenirs d’humains et d’angiospermes. Il n’a plus quitté Myza. Et il n’a plus jamais parlé de sa vie de l’autre côté du détroit, avec Diane.
Parfois Myza raconte à son tour. Il parle d’un amour d’avant le temps. Il invente un peu. Il recompose. Sigafoos ne pose jamais de questions. Il est botaniste dans chaque cellule de son être. Ses mains sont de la couleur des chatons de saule qu’il frotte constamment entre ses paumes. Il est accroupi dans les hautes herbes et malaxe une pâte de pigment jaune rosacé, de la couleur des couchants.
Le ravitaillement se fait attendre depuis une semaine. Myza garde ce sourire inimitable qui est pour Hushkins la matérialisation de la confiance. Hushkins propose aux deux camarades un nouveau camp de base pour la suite des recherches, quand le ravitaillement sera arrivé, de l’autre côté du lac à l’intérieur des terres, sur un plateau plus exposé au vent. Il faut bien éliminer l’hypothèse d’une propagation éolienne. Ce sera sans doute moins confortable. Myza sourit. Les précautions des Blancs lui ont toujours inspiré un sourire ironique. Il se souvient des têtes indigènes fichées sur leurs propres harpons tout le long de la péninsule devenue base militaire soviétique. La décision était tombée sous la forme d’un colis jeté depuis un avion. Ils avaient une semaine pour se déplacer. Où ? Personne n’y avait songé. Les chasseurs de la côte n’y avaient pas accordé d’importance et, de plus, la saison battait son plein. Une semaine plus tard, une frégate militaire ramenait de sa chasse un filet de têtes indigènes et les soldats avaient pris le soin de les empaler sur des harpons plantés tous les neuf mètres le long de la frontière de la nouvelle base. Leurs cheveux battaient au vent.
Myza, ça lui est égal, il aime ces terres, avec ou sans vent, et cette expédition est la seule possibilité pour lui d’y revenir. Il a quelque chose à y retrouver. Depuis la grande confiscation par les étrangers russes et américains, seules les expéditions scientifiques ont accès au lieu. Étudier puis civiliser l’extrémité du territoire, achever le travail inabouti des missionnaires orthodoxes, favoriser les échanges. Le commerce des peaux et de l’ivoire a englouti les autres habitants de la péninsule, comme les isatis, ces renards bleus des banquises ; fourrures de phoque, d’ours blanc ou de renne, peaux de zibeline et de glouton, défenses de morse sculptées ou non, sans parler de l’huile et des fanons de baleine. Appétit vorace des visiteurs étrangers et flots de mauvaises eaux-de-vie. Le XIXe siècle avait vu la grande baleine boréale et les camarades morses chassés jusqu’à quasi-extinction. Il n’y a pas si longtemps, on rencontrait sur les côtes du Kamtchatka, rapportés par les courants, à peine plus de carcasses de morses décapités que d’humains boréaux massacrés. Le bruit de la dékoulakisation se répand maintenant sur les steppes et pourrait bien à nouveau tout faire basculer. Il lui semble entendre encore les porte-voix : « Le pouvoir aux pauvres vers l’avenir radieux et unique du communisme soviétique. » Il faut profiter de la moindre fenêtre de vent avant le rétrécissement définitif du monde. Et puis, un autre projet est en cours, qui fait sourire Myza.
Sigafoos, ancien braconnier à l’ouest, trappeur et homme des bois, diplômé de l’université de Seneca, suit Hushkins depuis qu’il a fini son doctorat sous sa direction. Il lui doit toutes ses découvertes botaniques. Sur les recommandations de Hushkins, il a effectué le tout premier prélèvement de colonne de glace dans un lac des terres confisquées d’Alaska et y a découvert une véritable frise chronologique à unité pollen. Mais pour la première fois, il émet un doute. S’ils cherchent des traces de pollens, pourquoi aller fouiller les plaines balayées ? Il entrevoit déjà sur les plaines plus exposées des pollens disséminés au vent frappant les tiges sèches. Il voit se profiler les énormes lacunes dans le registre phylochromatique de son carnet. Il voit la fébrilité du chef. Pour le convaincre, Hushkins lui parle des mousses, lichens et couverts de roche qu’il a recensés en Alaska sur les falaises les plus exposées. Des structures et des motifs végétaux officiellement endémiques, mais qu’il espère retrouver également ici, sur cet autre côté de la mer de Béring. On perd l’itinéraire précis des pollens, mais on trouvera le réseau des mousses. Sigafoos sent bien que Hushkins les emmène sur une voie dont il dissimule le cap, il voit bien le regard embrumé du vieux maître et, pour la première fois, sent l’issue incertaine de cette expédition. Mais Myza trace déjà l’itinéraire jusqu’aux lichens.
Le soir, les trois camarades parlent surtout de Joy. À la dernière livraison, elle leur a apporté les nouvelles de la guerre qui recommence. Ça affecte ses affaires, mais elle continue de faire le lien entre les communautés autochtones de la côte alaskienne et celles d’ici. Hushkins est inquiet car elle cristallise les soupçons. Cependant il continue de lui confier les carnets qu’il remplit chaque semaine et qu’il faut mettre en sûreté, à l’abri de l’humidité et des fouilles arbitraires qui ne manqueront pas lors du retour aux entrepôts de Beringovski. Il ne saurait d’ailleurs pas où stocker la quantité de textes et d’extraits d’herbiers qu’ils sont en train d’accumuler. C’est Joy qui les fait passer à l’ouest, ou plutôt, vu d’ici, en direction de l’est. Hushkins est persuadé qu’au retour il réalisera la paix par la force de son idée : la réunification des deux grands blocs par un Éden commun et oublié.
Au loin, on entend des tambours. Myza note rigoureusement les rythmes. Hushkins n’en sait rien, mais Myza a d’autres projets que celui de constituer des herbiers pour réconcilier deux grandes nations qui se sont bâties sur les cendres de son peuple. Cette expédition est l’occasion de revenir sur des terres confisquées. Ils sont près des pâturages d’estive pour les rennes. Des campements de nomades sont installés dans les vallées voisines et résonnent dans la clarté glacée de l’air. Les peaux d’estomac tendues sur des cerclages de bois fumé font sonner un rythme inhabituel parmi les nomades. Les tambours ont de très anciennes fonctions et ont toujours servi d’intermédiaires. Maintenant, il semble qu’un nouveau canal se soit créé pour communiquer entre familles à chants rythmiques différents au sujet des transformations du territoire qu’elles partagent. Myza note la différence des rythmes entre les peaux sacrées et les peaux profanes tout en consultant les cartes de la zone. Les nouveaux rythmes indiquent des directions, des distances, des vitesses. Il est bien placé pour entendre les frappes des campements éloignés.
Autour du feu, Hushkins lit le journal de Steller, compagnon naturaliste du commandant Béring au cours de l’expédition maritime qui donna son nom au détroit et apporta la mort au commandant en 1741. Ce soir, Steller dessine les vaches de mer, ou ce qui deviendra brièvement la rhytine de Steller avant de disparaître. Avec ces dessins, seules traces qui nous restent des sirènes, chassées jusqu’à l’extinction par les marins qui les avaient découvertes, on complète certaines lacunes dans le registre fossile, comme les expressions de leur regard. Sigafoos complète ses carnets. Hushkins feuillette le journal et lit des extraits à haute voix. « Ce foutu Béring refuse absolument de me prêter attention, alors que je collecte depuis des jours au fil de l’eau des traces irréfutables de terre ferme. Je vois passer des algues aux bulbes éclos qui trahissent une mise à sec prolongée et donc des roches émergées à proximité. Pourtant aucun de ces médiocres navigateurs ne veut croire aux courants marins. Je lui dis haut et fort ce que je pense de lui et on me met aux fers. On prend le chemin le plus long et déjà le scorbut frappe dans les basses cales. Nous n’atteindrons jamais l’Amérique. » Hushkins s’absorbe dans le feu au rythme du battement des flammes. Avec ses herbiers, il récolte des traces de passage et voit dans la terre des courants là où le reste du monde ne voit que de l’immuable. « Atteindrons-nous l’Amérique avant que je ne sombre ? » écrit-il dans la marge du journal de Steller.
Hushkins se remémore chaque soir les chapitres qui constitueront l’ouvrage décisif de sa vie. Les calculs sont contradictoires, mais selon son hypothèse, le détroit a connu de nombreuses ouvertures et fermetures au cours des derniers soixante millions d’années, entraînant un effet de refuge puis de recolonisation par les plantes, de contraction puis d’expansion du biotope terrestre. Ce mouvement de compression et de décompression a formé des cercles concentriques dont il estime que le centre se trouve aujourd’hui sous la surface de la mer de Béring, autour des îles Diomède. Selon Hushkins, lors de la dernière période émergée de la Béringie, la flore était suffisamment diversifiée, et le climat suffisamment tempéré au sud du plateau pour que celle-ci ait été peuplée pendant des dizaines de milliers d’années par des populations d’hominidés.
Au moins dix mille ans.
Le temps pour l’établissement d’une véritable culture béringienne, engloutie il y a à peine douze mille ans.
Il lève la tête un temps et regarde la fumée qui sort de sa bouche comme aspirée par le sombre. Il visualise les cercles les uns dans les autres qui augmentent puis diminuent, propageant puis anéantissant les colonisations florales. C’est comme une respiration très lente. Il faudrait pouvoir sauter de cercle en cercle, se dit-il, jouer sur différentes bagues du temps. Il retarde le moment de dormir car ses nuits l’emmènent trop loin.
Dans un demi-sommeil, il creuse sous la mer au son des tambours qui l’empêchent de dormir.
Le scientifique a du mal à faire le pont entre ses deux rives existentielles.
L’autre côté du détroit le hante aussi.
Myza reconnaît dans le rythme inhabituel des tambours l’outrage et l’appel qui s’y tapit.
En Hushkins a lieu une autre guerre, glacée, un permafrost des viscères, depuis que Diane est morte. Il lui semble que les battements s’adressent à lui et font sursauter le temps.
Ce matin, je suis réveillée par un battement qui se fait de plus en plus fort au campement des ouvriers. Ça commence par des saccades, puis des sortes de glissements rythmiques pour évoluer vers une véritable secousse tellurique propagée à partir de vieux bidons de kérosène vides. Dans un demi-sommeil, je me dis que les travaux de construction des néohydroturbines ont déjà commencé et qu’on creuse sous la mer. Je me lève en sursaut, croyant entendre le broyage de ma structure préhistorique sous les chenilles géantes des mégasondes Gozok. Il faudra que je tire ça au clair.
Depuis quelques jours maintenant, je travaille avec l’équipe d’excavation au cœur du sanctuaire archéologique sous une pluie atmosphérique. Le détrempage des boues, récemment libérées du permafrost, facilite l’extraction des ossements. Avec le réchauffement, les terres autrefois prisonnières de la glace dégèlent et révèlent leurs mystères. Au début, je me suis inquiétée de voir des pigments rouges et noirs s’écouler dans les failles sous l’effet des jets. On a beau affiner la cible des lances à eau, ça frappe fort et indistinctement. Parfois, derrière un mur de glaise, une paroi disparaît aussi vite qu’elle est apparue. Nous gagnons du temps, nous perdons des images, nous n’avons plus trop le choix. Il faut arriver au bout de ce lieu avant qu’ils ne rasent tout. Le financement arrive à son terme et il y a peu de chances que Gozok Sustainable Industries renouvelle l’enveloppe et retarde encore le bâti. Au vu des résultats, disons, peu applicables. À l’époque où William m’a contactée pour ce chantier de fouilles qui s’annonçait compliqué – ma spécialité –, il m’a prévenue qu’il faudrait ménager tout le monde et gagner du temps vu ce que les fouilles mettaient au jour. J’ai alors mis en place mon plan B et réussi à faire espérer à GSI un nouveau minerai hyperductile pour leurs nouvelles générations de voitures Grav-zero, « zéro gravité », avant qu’ils n’explosent tout pour installer les turbines et finaliser le pont. Je savais que, depuis le passage au rayonnement magnétique dans les transports et les télécommunications, ils auraient besoin de ce type de minerai, surtout avec l’organisation des JO 2054 au pôle Nord. Nous leur avons laissé entendre qu’une telle découverte était « hautement probable ». Nous avons un peu faussé les relevés géomorphologiques, un petit montage improbable avec les fonds marins de l’Atlantique exploités pour leurs ressources. Il m’arrive encore de confondre les cartes et de m’appuyer sur les cartes faussées, sortes de rhapsodies géologiques que je trouve très belles, mais qui s’avèrent piégeuses si je ne suis pas attentive. Pendant les mois de préparation des dossiers de financement, j’y ai mélangé les propriétés de toutes sortes de terrains miniers tout en effaçant sans scrupule leurs contours géopolitiques. Maintenant, je sens tous ces mois tendus de levées de fonds qui remontent et s’écoulent, impitoyables, le long d’un filet d’eau glacé à la tombée des reins. Je sens que ma relation à ces terres est en train de changer. Je ne dis plus « Tchoukotka », mais « péninsule des Tchouktches » et je sais que le détroit de Béring se dit ici « Irvytguyr ».
Le campement a été installé sur la plage voisine, sur un des escarpements créés par les nombreux reflux de la mer de Béring au cours des derniers soixante millions d’années. Depuis la fameuse expédition Hushkins, cet endroit éveille les fantasmes scientifiques. Dès que les relations internationales l’ont permis, le terrain a très vite été enseveli sous les activités et les discours scientifico-entrepreneuriaux. Ces derniers temps, leur accumulation accélérée laisse entrevoir une sale tournure. Le désastre à venir sera sans doute aussi fracassant que l’a été la découverte de ces lieux. J’imagine une fin tragique à l’image de celle de l’expédition Hushkins, qui a involontairement ouvert la voie à toute cette machinerie d’extraction.
La pointe de la Sibérie orientale recule à mesure que le reflux diminue et que remonte la mer. Encore quelques centimètres et tout sera salé. Tout ce que cette toundra contient de trésors enfouis sera dévoré par l’indifférence marine. En attendant, on profite des quelques degrés supplémentaires pour percer la glace. L’industrie de dragage des dégels bat son plein et j’ai fait jouer la concurrence pour acquérir ce merveilleux système hydraulique. Les pompes envoient une eau à très haute pression pour briser les masses de permafrost décompactées et la succion fait le reste. La boue est rejetée et forme une petite péninsule qui prolonge la falaise. On peut extraire jusqu’à quatre-vingts tonnes par heure dans ce sol de glace, de roche et de galettes argileuses. Aux abords de la zone de fouilles, on abaisse la pression et progressivement la lance à eau fait place aux brosses et aux souffles de nos bouches. Agenouillée avec les autres sur une terre surprise de sa mise au jour soudaine, je marche indélicatement sur des rêves.
Ici, nous avons commencé à dégager une structure gigantesque d’ossements qui date probablement du Pléistocène. La structure s’impose au paysage, aussi bornée et indifférente qu’un somnambule aux rêves farouches. Puissante et haute, elle est à la fois une évidence, une énigme, un charnier et un poème. En général, je me contente de diriger les fouilles et d’organiser la récupération des artefacts dans les meilleures conditions possibles, mais ici quelque chose me retient et m’absorbe. J’ai l’habitude des recherches archéologiques appartenant à notre temporalité historique, avec des écrits, des témoignages. Ici, l’énigme est abyssale. Grâce à William, je participe autant que je peux aux discussions des paléoanthropologues. Nous sommes parvenus à reconstituer un quasi-récit. Nous savons qu’au cœur de ce récit il y a ces côtes de baleines franches boréales mêlées à des défenses de mammouths, disposées en allée, formant comme une arche profonde de plusieurs dizaines de mètres de long. Une côte, une défense, une côte, une défense, etc., érigées tel le squelette d’une immense chimère endormie. Le tracé de l’arche est très précis. Une sorte de couloir ou de tunnel. Se dirigeant vers la mer. L’hypothèse m’est d’abord apparue évidente et brusque : un intermédiaire terre-mer. Mais apparemment, à l’époque de la mise en place de cette structure, la mer se trouvait beaucoup plus loin, et il était alors difficilement imaginable qu’elle puisse un jour arriver jusqu’ici, à l’entrée ou à la sortie de ce tunnel d’ossements, de ce qui est aujourd’hui littéralement un passage. On me dit qu’il faudrait parvenir à la dégager jusqu’au sol originel où elle a été érigée, sans la fragiliser. C’est pas gagné. Avec la marée, les galets emportés par les vagues jouent déjà une musique régulière sur les os.
Avec le réchauffement, l’archéologie de sauvetage foule de nouvelles terres. Mais si la mer monte encore, tout sera recouvert. Déjà les vagues taquinent les mammouths et les domaines se mélangent. Des dragages robotisés sous le plancher océanique ont dégagé récemment tout un corps de fauve, tellement bien conservé dans la glace sous les sédiments qu’il a comme bondi hors de la fosse d’extraction. L’opération a été filmée par les caméras des robots. Le scaphandrier qui se trouvait alors au fond pour entretenir le système de pompe a vu fondre sur lui un fauve gigantesque à dents de sabre, d’au moins cinq mètres de long. Avec le tourbillon créé par les rejets de pompage, la bête a flotté en spirale pendant plusieurs minutes, belle comme un pétale dans le vent, curieuse comme une panthère jouant avec un homard dans les fonds de la mer, avant d’être emportée plus loin par les tombants et les courants de convection d’eaux profondes. On voyait le scaphandrier se débattre, sans visibilité, entre les câbles, les tuyaux et le sable soulevé en brouillard. La bête n’a pas pu être récupérée, mais les images hantent encore les réseaux sociaux. Je revois ce fauve qui tourbillonne en pleine eau, les yeux fermés, comme saisi par un rêve apnéique, léger dans sa prédation féroce. Peut-être reste-il dans son estomac des morceaux humains. Tout au fond de la mer, je vois son cadavre dans les plaines abyssales fournir un festin d’un autre temps à une assemblée de requins aveugles, de congres benthiques, de poulpes translucides et de crabes recouverts de filaments bactériens comme des lianes de poussière.
Peut-être en sera-t-il de même avec cette arche. Je vois un corps arrêté trop tôt en plein milieu d’un processus ; de quoi, je ne sais pas. Comment le dater, comment imaginer son environnement ? Les procédés de datation atomique donnent des fourchettes temporelles trop larges. La grande interrogation des spécialistes, c’est de savoir si l’arche date de la fin des « terres béringiennes », juste avant le basculement hors du Pléistocène. Dans les intestins de mammouths récupérés dans les tourbes voisines, on retrouve des pollens qui indiquent une terre riche en herbes et en joncs. Une sorte de paysage de steppe, mais clairsemé de bouquets denses témoignant d’une vitalité arboricole et de fourrés d’arbrisseaux. Ces ossements et ces défenses ont-ils connu les mêmes contrées ? Quelles subjectivités les contemplaient alors ? J’ai lu que les études génétiques sur les ADN des populations en Asie et aux Amériques avaient révélé non seulement la proximité entre ces deux groupes humains, mais surtout une étape intermédiaire de peuplement entre les deux continents. L’image du « passage de Béring », je l’ai bien : la migration des hominidés entre les deux grands continents. Mais l’image d’un « monde de Béring » m’est inconnue.
Les études parlent d’une « mutation importante des haplotypes », ce qui semble signaler un groupe génétique isolé pendant plusieurs milliers d’années, peut-être une dizaine, suffisamment en tout cas pour créer une « maturation » inscrite dans les gènes, avant d’entrer définitivement en Amérique. Si la Béringie a été si longuement habitée par les humains, il doit y avoir des récits liés à ces terres submergées. Plus de dix mille ans de peuplement dans un climat idéal. On doit pouvoir retrouver aussi des récits qui évoquent la disparition des terres. Il doit y avoir des traces, peut-être même une civilisation béringienne. Du côté américain, tout est verrouillé, effacé dans le besoin d’instaurer le mythe du Nouveau Monde. Étrangement, ici, il reste des zones grises. Cette arche est la trace d’un récit, d’une histoire de fin du monde. Si seulement on parvient à la dater, je pourrai remonter les écheveaux du temps pour pister une source narrative, un écho du monde de celles et ceux qui ont vécu ici.
Sous la tente, je me replonge dans les cartes et les carnets. Il faut que je sois claire devant William sur le programme de fouilles. Mon rituel : punaiser les pensées parasites. Je suis venue pensant chercher quelqu’un et maintenant j’ai l’impression que c’est moi qu’on cherche, que quelque chose me cherche. Sensation tenace de ne pas être à ma place. Pour quoi, pour qui est-ce qu’on s’embourbe ainsi dans la vase et le temps, là, à « tracasser le sol », comme dirait Hushkins ? Plongée dans mes cartes-hologrammes de la stratigraphie locale, j’ai quelques remords, des arrière-pensées. Ces cartes montrent des terres pleines à ras bord de données, de stocks, de potentiels, pour les scientifiques comme pour les exploitants. Mais les terres ont été progressivement vidées de leurs habitants. Moi aussi, je l’ai voulue, mon expédition héroïque, et j’ai tout figé dans le temps : le détroit de Béring et ses habitants avec. Je déplace des montagnes de tourbe gelée avec l’aide de chasseurs locaux. Où vivent-ils ? Les bases militaires, les compagnies d’extraction minière, puis énergétique, les réserves scientifiques, les parcs de préservation et maintenant les parcs de réincarnation impliquent tous un déplacement des populations autochtones. Ça me révolte, et pourtant j’y participe en faisant le travail du croque-mort : rendre le cadavre présentable. Le prétexte aujourd’hui est la conservation d’un territoire en voie de disparition, avec tout son biotope et son patrimoine culturel. Les mêmes qui conservent aujourd’hui massacraient avec zèle quelques dizaines d’années à peine en arrière. Faire plier l’indigène, détruire ses relations à l’environnement, éliminer les proies principales. Pour introduire l’idée d’une nature séparée de l’humain, qu’il faudrait protéger de l’ignorant, de l’indigène. On détruit, on répare et on renomme, puisque, au fond, grâce à nous, on recrée.
Le dernier déplacement massif, celui des Évènes, ou Kaaramkyns, comme on les appelle ici, pour la création du Beringia Park, a eu lieu il y a quelques années. Il a provoqué des soulèvements importants chez les communautés autochtones. Plusieurs passages reliant les zones sèches ont été bloqués et tenus pendant des semaines. Le parc, c’est des milliards de dollars qui passent sous leur nez et sur leurs terres. Ça a commencé par la réintroduction de bœufs musqués, de bisons des plaines, de chevaux de Yakoutie et autres grands brouteurs, ramenés par avion et bateau, puis ça a été le clonage de quelques mammouths et grands prédateurs, le tout pour recréer un écosystème pléistocène. On a fait venir des néomammouths de Corée du Sud où leurs cellules avaient été mises en culture à partir de morceaux de chair presque fraîche récupérée dans une croûte glacée près d’ici. Le mammouth naît d’un éléphant indien, le tigre à dents de sabre naît de la dernière mère porteuse des tigres de l’Amour gardée en captivité. J’ai des ouvriers qui sont spécialisés dans la récupération discrète de morceaux de mammouths pour les musées et les labos à travers le monde. Le grand-père de l’un d’entre eux a découvert le premier mammouth entier, à la fin du XXe siècle. L’animal avait quatre mois quand il était mort, et aujourd’hui il a à peu près quarante mille ans. La viande aurait pu encore être mangée. Il avait fallu retenir les chiens. C’est le nouvel or local. Depuis la « submersion planétaire » déclarée officiellement par l’ONU en 2046 et devenue maintenant quotidienne, l’humanité semble chercher à épuiser ses propriétés démiurgiques dans une sorte d’ultime potlatch des connaissances : face à la fin, on balance toute notre capacité technique pour le plaisir de la voir brûler. Que savait-on au juste du monde des panthères nébuleuses avant qu’elles n’aient complètement disparu l’année dernière ? Quels secrets, quels chants, quels rêves avaient-elles à nous transmettre ? On s’est contentés de stocker des peaux et des chromosomes. Les tigres ressuscités par clonage auront-ils les mêmes rêves que les tigres d’avant ?
Le soir, je traîne un peu au campement des ouvriers. Je vois un cercle de bidons renversés aménagé sur un morceau de terre fraîchement aplani. Mon chef de chantier, Mitkine, tente de m’attirer vers le feu pour boire un verre de vodka. À propos des tambours bricolés, il évoque un désir de renouer avec le folklore musical de leurs ancêtres. Je n’en crois pas un mot, mais je sens qu’il vaut mieux ne pas trop creuser, les hommes me paraissent très à vif. Ces tambours improvisés sont une alerte dont je dois tenir compte. Mais à qui ces signaux sont-ils vraiment adressés ? Aux communautés d’Alaska ? On me raconte des récits de libération des eaux ayant inondé le lien terrestre avec l’Amérique. Dans ces temps anciens, pas de différence profonde entre les êtres, seulement un riche répertoire de corps et de figures, et tout le monde était « humain » sous des formes variées. Il fallait juste être attentif à la singularité et à l’importance de toutes ces perspectives afin de naviguer entre les formes pour maintenir un équilibre. Depuis, il y a trop de tèryky. Il faut alors les abattre pour soulager le mal dont elles sont le symptôme, une sorte de glissement des réseaux de communication entre les êtres, une confusion et une incompréhension généralisées. Aujourd’hui, on a besoin de distinctions pour s’y retrouver, me dit-il, c’est comme ça. Je me demande si mon frère ne se serait pas fondu dans un groupe comme celui-ci. C’est plausible. Ou peut-être est-il devenu tèryky. S’il est encore en vie quelque part, en tout cas, c’est ici que je le trouverai, j’en mets ma main à couper. Demain, je dois rencontrer Caïmœn. »
À propos de l’auteur
 Jeremie Brugidou © Photo Jean-Philippe Cazier
Jeremie Brugidou © Photo Jean-Philippe Cazier
Jeremie Brugidou est né en 1988 et vit à Bruxelles. Il est artiste-chercheur, cinéaste et écrivain. Il a réalisé plusieurs films (Bx46 en 2014, Le Chant de la nuit en 2017, avec Fabien Clouette, et Poacher’s Moon avec David Jaclin en 2021). Docteur en études cinématographiques, ses recherches portent sur la manière dont la fiction et les images permettent d’imaginer de nouvelles perspectives anthropologiques. Il pratique le thuy phap, un art martial vietnamien. (Source: Éditions de l’Ogre)
Page Facebook de l’auteur
Compte instagram de l’auteur
Compte Linkedin de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
Tags
#icilaberingie #JeremieBrugidou #editionsdelogre #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2021 #litteraturebelge #litteraturecontemporaine #RentréeLittéraireaout2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #roman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict

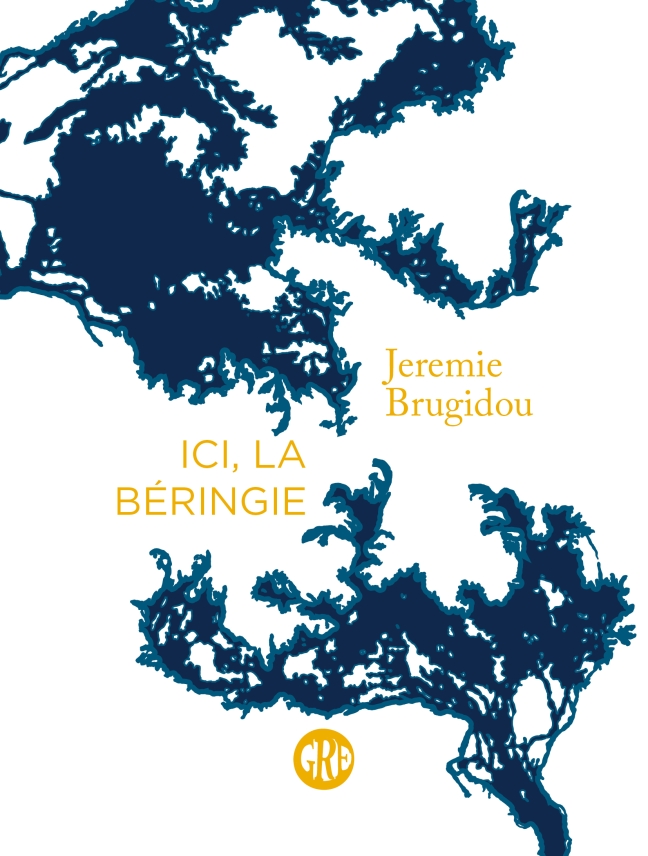














 Carte du Doggerland réalisée par William E. McNulty et Jerome N. Cookson © National Geographic Magazine
Carte du Doggerland réalisée par William E. McNulty et Jerome N. Cookson © National Geographic Magazine