En deux mots
Mila à l’humeur vagabonde. Entre un père fondeur de cloches installé dans le Jura suisse et une mère taxi en Haute-Provence, elle voyage et trouve l’inspiration pour ses dessins. Des dessins qui réjouissent son demi-frère Théo qui se cache après un trafic d’armes qui a mal tourné.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Milva, ses parents et son frère
Le nouveau roman de Célia Houdart a tout de la chronique familiale et naturaliste. Milva, 16 ans, partage sa vie entre son père et sa mère, entre la Suisse et la France. Elle dessine la nature et veut se consacrer aux beaux-arts. Mais soudain, on bascule dans le thriller…
Milva aime la nature, Milva aime dessiner. Aussi le traumatisme de la séparation passé, elle s’accommode fort bien de ses deux points de chute. À Saignelégier dans le Jura suisse où son père a une fonderie qui réalise notamment des cloches pour les vaches qui partent en alpage. Entre l’école d’art de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Noirmont, elle aime se promener avec son carnet à dessins et croquer les fleurs sauvages du titre.
La fille de 16 ans suit un scénario identique lorsqu’elle part rejoindre sa mère qui s’est installée à Mane dans les Alpes-de-Haute-Provence, non loin de Forcalquier. C’est là aussi que vivent son demi-frère Théo et son amie Kyoko. C’est cette dernière qui va découvrir le commerce peu recommandable du jeune homme. Lui qui prétend vendre du fromage suisse à Dubaï achète en fait des armes et les revend aux Lybiens. Une activité qui va le forcer à fuir et à se cacher après un passage à tabac. Il se réfugie dans une galerie souterraine avec trois caisses d’armes. Les dessins que sa sœur réussit à lui apporter venant le réconforter.
C’est en courts chapitres que Célia Houdart entremêle la chronique familiale, le roman initiatique, le thriller qui fait planer un réel danger sur la famille et les touches poétiques autour d’une nature que le lecteur est invité à arpenter et à aimer. Et c’est précisément ce qui fait le charme de ce roman, cette confrontation du beau et du sordide, de la poésie et de la géopolitique. Le rhododendron voisine avec le missile antichar et la bruyère avec le fusil d’assaut.
Deux mondes antagonistes qui vont pourtant se rejoindre dans ce récit initiatique ou le bien et le mal s’offrent une sarabande endiablée que la plume sensible de Célia Houdart rend avec toutes ses nuances.
Les fleurs sauvages
Célia Houdart
Éditions P.O.L
Roman
208 p., 19 €
EAN 9782818057865
Paru le 4/01/2024
Où?
L’action se déroule d’une part en Suisse, à La Chaux-de-Fonds et au Noirmont ainsi qu’à Saignelégier, sans oublier La Sage en Valais et Montreux et d’autre part en France, à Forcalquier et à Mane dans les Alpes-de-Haute-Provence, ainsi qu’à Baulieu-sur-Mer.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Tout à la fois roman d’apprentissage, thriller, roman d’amour et poème en prose, Les Fleurs sauvages nous conduit sur le chemin dangereux de la tendresse entre une sœur artiste et un frère qui gagne sa vie par le commerce des armes. La jeune Milva âgée de 16 ans vit avec son père, ouvrier fondeur, à Saignelégier, dans le Jura suisse. Pour les vacances, elle rejoint sa mère, chauffeuse de taxi à Mane dans les Alpes-de-Haute-Provence. Milva dessine beaucoup et tout le temps. Théo, son demi-frère de 8 ans son aîné, est un petit délinquant tombé progressivement dans le grand banditisme. Kyoko la petite amie japonaise de Théo, en fouillant l’ordinateur de son compagnon, découvre que celui-ci se livre au commerce d’armes provenant des Balkans qu’il revend à des milices libyennes. À cause d’une livraison de marchandise en échange de laquelle il ne perçoit pas la somme qui lui a été promise, et après un passage à tabac à Beaulieu-sur-Mer, Théo décide de garder trois caisses d’armes et de se cacher avec elles à Mane, dans un ancien tunnel ferroviaire. Milva voudra se porter au secours de son frère et lui rend visite clandestinement dans sa cachette, pour lui offrir ce qu’elle a de plus précieux et intime : son carnet de dessins.
Tout au long du roman, on croise la présence des fleurs : une belladone tatouée sur un bras, un vallon tapissé de bruyères et de rhododendrons, des motifs Art nouveau. Et des armes : un canif, des missiles antichars, un fusil d’assaut A47 dont Célia Houdart s’attache à décrire, entre les mains d’un Touareg, en plein désert libyen, le montage et le démontage patients. Tout un réseau mystérieux de correspondances se tisse, presque magiquement, entre le pire du monde contemporain et la délicatesse d’un univers intime et familial. L’univers poétique, mystérieux et floral de la jeune adolescente se confronte aux plus violentes réalités géopolitiques. Sans manichéisme ni pathos, Célia Houdart décrit deux visions de notre monde aujourd’hui, sombre et solaire, au plus près des corps et des sensations.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
RTS (Drôle d’époque)
En Attendant Nadeau (Valentin Hiégel)
Diacritik (Maryline Heck)
Actualitté (Valentine Costantini)
Célia Houdart présente «Les fleurs sauvages» © Production Jean-Paul Hirsch
Les premières pages du livre
« 1.
Milva marchait dans la forêt. Son attirail, moins lourd qu’encombrant, cliquetait au bout de ses bras. Elle sentait le relief du sol sous la semelle de ses bottes. Les épicéas absorbaient la lumière et les sons. Pour rejoindre l’étang, elle obliqua vers la droite. De jeunes ronces rendaient le passage moins praticable. Elle entendit un bruit suivi d’un frémissement d’herbes. Elle s’arrêta, aux aguets. Son sang battait dans ses oreilles. À quelques centimètres de ses pieds, elle vit trotter une musaraigne qui, aussitôt, disparut dans un trou. Les fougères étaient encore humides de rosée. Milva reprit sa progression. Elle calculait la longueur de ses enjambées pour éviter les orties et des branches cassées. Ses bottes brillaient. Mélange de fraîcheur et de moiteur. Plus exactement, une moiteur dans laquelle par instants, par bouffées, une fraîcheur montait. Le ciel gris-blanc intensifiait la lumière. Une percée soudain, c’était l’étang. Milva choisit un coin qu’elle aimait, un peu à l’écart, et se délesta de son barda. Des libellules posaient leur corps irisé et sans poids sur les cannes. L’herbe avait déjà été foulée, deux bouts de bois en forme de Y étaient fichés dans le sol. Un autre pêcheur avait précédé Milva. Elle contempla l’eau calme qui reflétait la forêt et la roselière. Dans une zone sans ajoncs s’élevait une sorte de brume, une fumerole, qui semblait relier le paysage à un autre monde.
Milva jeta des poignées d’amorce qu’elle avait préparée la veille, consistant en biscottes, biscuits, vieilles pommes de terre, parfumées d’une larme d’absinthe et malaxées en rêvant grosse capture. C’était comme un rituel, une offrande pour quelque divinité lacustre. Elle rinça soigneusement ses mains collantes en utilisant l’eau de sa gourde, se gardant bien de les tremper dans l’étang pour ne pas effrayer les poissons. Ensuite elle tendit ses lignes.
Plus un souffle de vent. De grands insectes patinaient sur l’eau tranquille. Odeur de roseaux et d’iris fanés. L’étang pouvait dégager certains jours quelque chose de lourd et douloureux, presque malsain, qui contrastait avec la légèreté et la fraîcheur de l’air. Milva guettait le moindre frémissement des bouchons fluorescents. Elle admira le vol lent d’un héron, le passage d’un ragondin serrant entre ses dents une branche de saule et qui, arrivé à sa hauteur, tourna la tête pour la regarder. Soudain, tictictictictic, son moulinet se dévidant à toute vitesse, Milva se précipita sur sa canne à lancer. Elle l’agrippa. Elle sentit tout de suite qu’une chose inhabituelle se passait. Elle dut laisser du mou. Il fallait à tout prix éviter que le fil ou l’extrémité incroyablement courbée de la canne ne se casse. Elle chercha un peu de souplesse dans son poignet pour accompagner la prise, tout en veillant à ne pas glisser elle-même dans l’eau, pour être ensuite entraînée au milieu des roseaux que lui désignait le fil de pêche – plus une direction à vrai dire qu’un point précis –, car, au soleil, le nylon devenait pratiquement invisible. Balader le poisson, le fatiguer, sans lui déchirer non plus la bouche avec l’hameçon, le sortir avec douceur de l’étang, c’était tout un art que Théo avait transmis à Milva.
Elle tenait à deux mains sa canne, biceps contractés. Des veines gonflaient sur le dessus de ses mains. Son front perlait de sueur qui, ensuite, coulait sur sa figure. Clicclicclicclic. Chaque centimètre de fil rembobiné était une petite victoire. Milva se voyait, après une longue lutte, prisonnière de la vase grise, un bras levé, s’enfonçant puis disparaissant complètement, des bulles s’échappant de ses narines, dans une atmosphère d’âcre vapeur. À mesure que le fil se dévidait, en elle s’élevait un tourbillon d’images plus inquiétantes les unes que les autres, comme un délire parallèle. Ce sont les sauts du poisson, ses enroulements d’anaconda constricteur, qui ramenèrent brusquement Milva à la réalité. Le poisson se débattait avec force sans vraiment sortir de l’eau. La surface de l’étang était comme une grande toile cirée brutalement tirée et froissée par une main invisible. Et puis plus rien. Toute la tension au bout du fil s’était relâchée.
Milva ramena très doucement le fil sans bouchon ni hameçon. Le poisson, sans doute un brochet, il ne pouvait guère s’agir d’autre chose, avait sectionné le fil au ras de l’émerillon et avalé la ligne.
2.
Vexée d’être rentrée bredouille, Milva jeta tout son matériel en vrac dans la remise à outils, sans nettoyer le manche des cannes ni rincer sa boîte à amorce dont le maigre résidu de pommes de terre allait suffire, en quelques jours, à empuantir l’air et à attirer les mouches. Dans un rond d’herbe au milieu des graviers de la cour, le vent faisait tourner les pales d’une girouette en bambou dont le mouvement animait deux personnages en métal qui dansaient sur trois notes en boucle. Dans la petite pièce qui servait d’entrée à la maison, Milva retira ses bottes de la pointe du gros orteil. Elle les abandonna au milieu du passage, chacune fourrée d’une chaussette en boule. Elle traversa le salon, laissant sur le carrelage des empreintes qui s’évaporèrent aussitôt, puis elle s’affala dans le canapé. Elle fixa le plafond. Au bout de quelques minutes, d’un bond, elle se releva, se précipita dans sa chambre, prit son ordinateur et, assise cette fois tout au bord du canapé, consulta des sites de pêche qu’elle avait déjà réunis en onglets dans sa barre d’outils. Elle se mit en quête de bons tuyaux pour éviter à l’avenir pareille déconvenue. De lien en lien, elle se retrouva sur un forum où des pêcheurs amateurs postaient des photos de mouches artificielles qu’ils avaient confectionnées eux-mêmes, dont certaines, ornées de plumes et de poils, imitaient parfaitement des insectes en pleine mue ou blessés. Milva observa un moment cette collection de bijoux inquiétants. Là, elle perçut un faible bruit, un tapotis cristallin, venant de la fenêtre. C’était Fantômas.
– Tiens, te revoilà. Où étais-tu allé te fourrer ?
Milva glissa les mains sous les pattes avant du chat, puis le cala sur son épaule. Elle pouvait sentir, à travers son tee-shirt, la pointe des griffes qui se déployaient et se rétractaient tour à tour, marquant sa peau de piqûres très légères et inoffensives, car la recherche de stabilité n’empêchait pas l’animal d’être précautionneux.
Devant la maison, une vaste dépression creusait le paysage qui, le matin et le soir, presque toute l’année, s’emplissait de brouillard, sauf les mois de juin et de juillet, où les prairies se tapissaient de plantains et de gentianes jaunes.
Milva devait retrouver Sam. Si elle ne voulait pas manquer le train, c’était l’heure de partir. Elle déposa délicatement Fantômas sur un fauteuil. Elle enfila son blouson, des baskets et fit claquer la porte.
Elle vit à travers la toile de son sac la lueur de son smartphone. Elle plongea la main. C’était un message de sa mère, celle-ci l’informait que Théo, son demi-frère, et Kyoko, son amie, viendraient déjeuner le lendemain chez elle. Elle lui demandait d’arriver plus tôt. Pour une fois qu’elle les avait tous les trois. Elle appelait de sa voiture avec un kit mains libres. Milva soupira. Elle réfléchit quelques secondes et décida de ne rien changer à ses plans, jusqu’à ce que Kyoko lui écrive un SMS : « Je suis heureuse de te voir demain en Haute-Provence. » Touchée, l’adolescente s’arrêta devant la gare, relut le SMS et changea son billet en pianotant très vite sur son téléphone.
Théo et Milva n’avaient pas passé leur enfance ensemble. Tout au plus des week-ends à La Chaux-de-Fonds où, à l’époque, habitaient Irène, leur mère, et Jacques, le père de Milva. Et quinze jours mémorables en Norvège où ils étaient partis tous les quatre dans une vieille Twingo. Milva et son demi-frère, âgés respectivement de huit et seize ans, s’étaient accordés pour trouver le chalet inconfortable et laid, détestables le salami et les œufs de saumon en tube. Affichant tout au long des vacances – à l’exception des jours où ils avaient eu la bonne idée d’aller à la pêche – une humeur massacrante, se liguant contre leur mère, l’accablant sans cesse de reproches. Au point qu’un matin, après des courses, poussée à bout et en larmes sur le parking du supermarché, Irène avait refusé de continuer comme cela, menaçant de rentrer, de prendre le premier avion, et de les laisser tous là, avec leur caddie, la vieille Twingo, de les quitter pour toujours. Ébranlés, Théo et Milva avaient demandé pardon à leur mère. Ces uniques vacances passées ensemble et cet épisode où ils avaient fait l’expérience d’une certaine cruauté les avaient étrangement liés. Mais ils ne le comprirent qu’après coup.
Le paysage défilait. À l’approche du Noirmont, il consistait en une alternance de pâturages et de petits bâtiments en béton et tôle d’acier pliée, ateliers de mécanique et d’usinage de pièces destinées à l’industrie horlogère. Au sud, des éoliennes couronnaient le front des collines.
3.
Sam attendait sous le nouvel auvent de la gare, un grand toit plat soutenu par de hauts piliers minces, qui faisait aussi office d’abribus. Quand il aperçut Milva, Sam marcha à sa rencontre. Il portait un sweat blanc avec un hippocampe imprimé en bleu turquoise. Milva se fit la réflexion que l’animal semblait inspirer à Sam sa manière de se tenir et de se déplacer. Un air digne et placide. Quelque chose de souple dans la colonne. Avec son nez fin en trompette, la similitude était troublante.
Les deux amis se saluèrent poing contre poing et se mirent en route. Milva resta d’abord silencieuse. Elle avait trop d’orgueil pour raconter à Sam son fiasco du matin à l’étang. Se taire était pour eux la meilleure façon de reprendre contact, un prélude complice, avant de se mettre à parler sans s’arrêter, ce qui arrivait toujours au bout d’un moment, comme une sorte de vague.
– Je dois partir plus tôt.
– Chez ta mère ?
– Théo et Kyoko débarquent.
– Tu vas pouvoir faire des balades à moto.
– Ce n’est même pas la peine d’y penser. On va déjeuner dans le jardin. Melon au beaumes-de-venise, rôti, haricots verts. Ma mère harcèlera de questions mon frère qui restera évasif ou inventera je ne sais quoi. Kyoko me demandera si je dessine toujours. Ou alors ce sera lui, l’air faussement attentif. Une tarte aux fraises et ciao.
– Tu es sûre ?
– On parie ? dit Milva en haussant les épaules. Puis elle s’arrêta pour refaire soigneusement les lacets de sa nouvelle paire de Vans, un modèle à damier que Sam, à qui rien n’échappait, avait tout de suite remarqué.
En ville, Sam et Milva avaient un itinéraire de prédilection. Ils se rendaient rituellement, rue du Progrès, à la hauteur du numéro 77, où, au sol, se trouvait une plaque d’égout ornée de deux inscriptions en arabe. Posée là on ne savait pourquoi, elle fut remarquée de manière tout aussi surprenante grâce à un médecin à la retraite, guide du patrimoine et flâneur invétéré, qui arpentait la ville en observant à peu près tout, y compris donc les plaques d’égout. Milva, informée de cette bizarrerie par l’émission « Calmos » sur Couleur 3, radio qu’elle écoutait pour l’originalité de sa programmation musicale et dont les brèves relayaient toutes sortes d’informations locales, s’était rendue dès le lendemain à l’adresse indiquée par l’animateur, pour voir de ses propres yeux le disque en fonte. Instantanément fascinée, Milva s’était mis en tête de déchiffrer elle-même les inscriptions à l’aide d’une application qu’elle s’était empressée d’installer sur son smartphone. Elle avait ainsi découvert que l’une des inscriptions, رطملا, signifiait « la pluie », et que l’autre, ةتاربص, désignait « Sabratha », une ville côtière de Libye à laquelle la plaque avait sans doute été primitivement destinée. Ancien poste de traite phénicien, annexé par les Romains qui y édifièrent tout un ensemble de bâtiments (un amphithéâtre, des thermes et des temples) dont Milva admira les ruines sur Internet, aujourd’hui encore carrefour du commerce transsaharien et, depuis une dizaine d’années, capitale des passeurs de migrants. D’un naturel curieux, et puisque l’application dont elle disposait lui permettait de connaître d’autres mots dans la langue choisie, Milva en avait profité pour apprendre comment s’écrivait en arabe son propre nom, celui de Sam et celui de son chat.
Milva et Sam redoutaient toujours que la régie municipale, pour réparer ce qu’il faut bien appeler une erreur, retire la plaque. Chaque fois, c’était pour eux un soulagement de constater que celle-ci était encore là. Des feuilles, de minuscules débris, des poussières s’y étaient incrustés, c’est tout.
Après, ils allaient rendre visite à un grand marronnier. Quelques années plus tôt, Sam avait retiré un clou fiché dans son écorce et s’était soudain trouvé enveloppé, c’est du moins ce qu’il avait affirmé, d’un nuage rose qu’il avait interprété comme un signe de gratitude émis par l’arbre à son endroit. Même si Milva n’avait jamais tout à fait cru Sam, dont l’imagination galopait encore plus vite que la sienne, elle l’avait secrètement envié d’avoir été témoin d’un tel phénomène sans avoir consommé la moindre substance psychédélique. Aussi allaient-ils l’un et l’autre régulièrement caresser l’arbre, avec le secret espoir qu’un nuage rose, ou d’une autre couleur, se forme pour eux. Mais à part le cycle saisonnier de la pousse et de la chute des feuilles, il ne se passait jamais rien. Ce n’était pas grave. Cette petite plate-forme en surplomb de la ville offrait, sur le plan géométrique des rues, la tour Espacité, les bois et les fermes au loin, les jours bien sûr où elle n’était bouchée ni par le brouillard, ni par une tempête de neige, une très belle vue.
Milva et Sam redescendirent rue Numa-Droz chez Doucette-Follette, un magasin de location de costumes tenu par Monique, dite Doucette-Follette, une couturière qui appelait toutes ses machines « ma chérie », et son canari « Georgy », en hommage à George Michael. Même fermée, la boutique, grâce à sa grande vitrine, proposait toujours un spectacle divertissant. En découvrant un mannequin vêtu d’une chemise à jabot, avec boutons de manchette, fuseau de ski glissé dans des Dr. Martens à paillettes, Milva s’exclama :
– Je sais quoi porter cet hiver au Bikini Test.
Non loin de la boutique se trouvait l’ABC, un centre culturel à la façade ocre rouge, qui accueillait des projections de films, des spectacles et des concerts. Au rez-de-chaussée, le café-restaurant était l’un des endroits les plus chaleureux de la ville. La cuisine y était bon marché, éclectique et savoureuse. À midi, les employés des services sociaux ou de la poste, Jacques et son apprenti, l’équipe de l’ABC, tout le monde s’y retrouvait. En été, des parasols et des tables étaient disposés sur la terrasse. L’hiver, un épais rideau protégeait du froid la porte d’entrée, et on pouvait se réchauffer à l’intérieur en buvant un vin chaud à la cannelle ou une absinthe. Au fond était aménagé un coin bibliothèque avec de grands fauteuils, des magazines et des journaux tenus entre deux tiges en bois.
Sam et Milva s’installèrent là plutôt que sur la terrasse qui, à cette heure de la journée, était bondée. Milva reconnut les premières mesures d’Is It Any Wonder ? de Durand Jones & The Indications, et la voix aérienne du chanteur. Elle demanda à Sam :
– Tu pars quand dans le Valais ?
– Après-demain.
– À Évolène ?
– Tout près, à La Sage. Avec ma mère et Jocelyne. Un berger nous sous-loue un petit appartement tout en bois. Il faut que tu viennes l’été prochain.
Le visage de Milva s’illumina.
La chanson continuait :
If you ever leave me alone
I’ll be cryin’ wishin’ you’d come home
Uh ooh, uh ooh, uh ooh…
Milva et Sam buvaient un thé glacé au citron en décortiquant des pistaches. Ils étaient heureux. Ils n’avaient pas du tout envie de prendre le train et encore moins de se quitter.
Extrait
« Les premiers jours, lorsque Milva était chez sa mère, il lui fallait toujours quelques secondes le matin pour se souvenir qu’elle était là. Elle s’apprêtait à aller prendre ses cannes à pêche dans la remise. Elle avait l’impression, qui n’était pas toujours désagréable, d’être ailleurs. Ni tout à fait en Suisse, ni tout à fait en France. Dans un royaume intermédiaire.
À la séparation de ses parents, Milva avait onze ans. Irène était partie du jour au lendemain à Aix-en-Provence pour commencer sa formation de taxi. Elle tirait le diable par la queue. En accord avec Jacques, elle avait choisi de partir seule. Milva en avait voulu à sa mère. Elle prétendait qu’elle aurait très bien pu la suivre. Aller à Mane où elle avait de bons souvenirs avec ses grands-parents. » p. 70
À propos de l’autrice

Après des études de lettres et de philosophie et dix années dédiées à la mise en scène de théâtre, Célia Houdart se consacre à l’écriture. Depuis 2008, elle compose en duo avec Sébastien Roux des pièces diffusées sous la forme d’installations ou de parcours sonores. Elle a été lauréate de la Villa Médicis hors-les-murs, du Prix Henri de Régnier de l’Académie Française (2008) pour son premier roman Les merveilles du monde, du Prix Françoise Sagan (2012) pour Carrare et du prix de la Ville de Deauville Livres et musiques (2015) pour Gil. (Source: Éditions P.O.L)
Site internet de l’autrice
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte X (ex-Twitter) de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Compte LinkedIn de l’autrice
Tags
#lesfleurssauvages #CeliaHoudart #editionspol #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

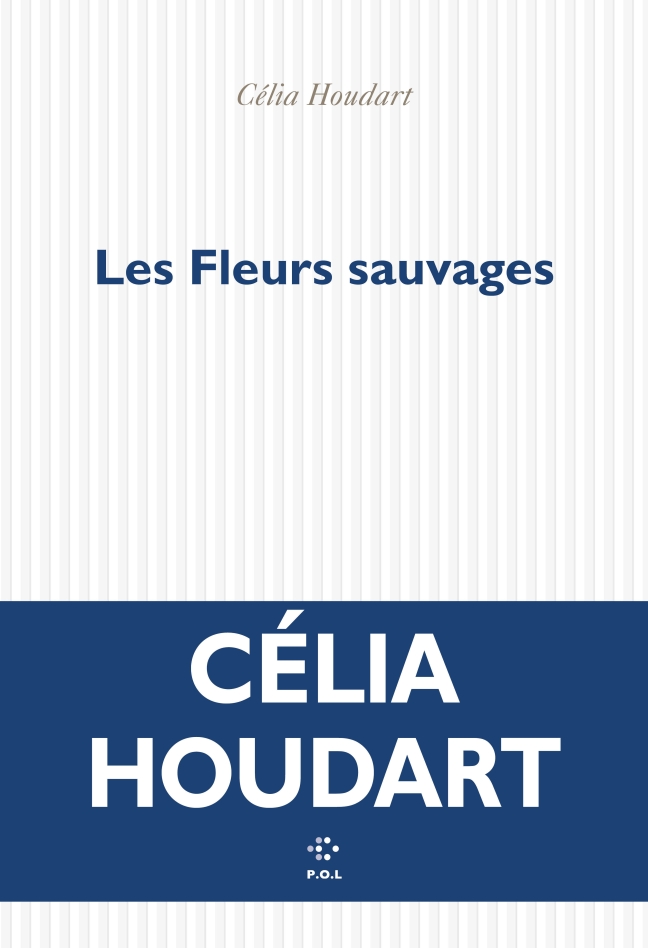









 Éric Fottorino © Photo Joël Saget
Éric Fottorino © Photo Joël Saget




 L’Arrivée des moissonneurs dans les marais Pontins (1830)
L’Arrivée des moissonneurs dans les marais Pontins (1830) Départ des Pêcheurs de l’Adriatique (1835)
Départ des Pêcheurs de l’Adriatique (1835)



 Rose-Marie Pagnard © Photo Yvonne Böhler
Rose-Marie Pagnard © Photo Yvonne Böhler


