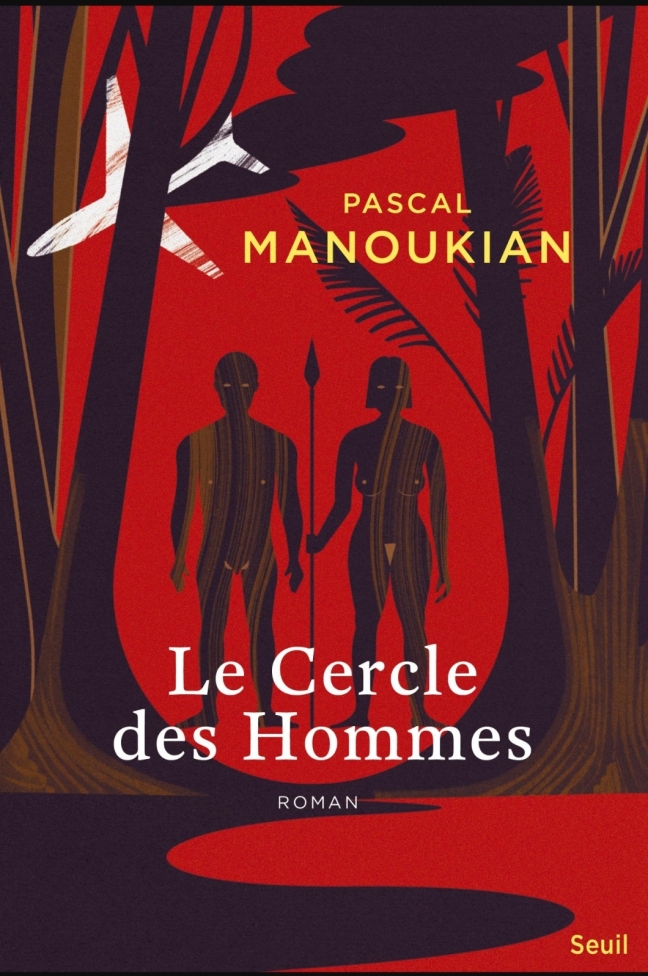En deux mots
Le narrateur arrive à Zapotal, village perdu du Mexique, avec un stock d’opium et d’héroïne (sa Lady), dans l’attente du shoot final qui le fera passer de vie à trépas. Entre rêve et éveil, souvenirs et rencontres improbables, il va vivre des expériences très particulières.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
En route vers le dernier voyage
Le premier roman de Mateo Garcia Elizondo raconte les errances d’un junkie arrivant dans un village perdu du Mexique pour se shooter à mort. Un récit halluciné, initiatique, qui efface la frontière entre le rêve et la réalité, la vie et la mort.
Quand il arrive à Zapotal, le narrateur a un plan bien précis en tête. Il va dépenser ses derniers pesos pour s’acheter ses dernières doses d’héroïne, la Lady, et s’offrir une fin en apothéose, une surdose qui le fera passer de l’autre côté. Il a déjà vendu ses derniers biens et s’est éloigné des siens pour gagner ce coin perdu du Mexique, à la lisière de la jungle.
Sa dégaine et son physique – il est cadavérique – ne plaident pas pour lui. Dans le village, on veut qu’une chose, son départ. Mais il va tout de même trouver un homme qui va accepter de lui louer une chambre miteuse. Un yaourt devrait suffire à la faire tenir encore quelques heures, avant de partir pour son ultime trip. Car la drogue, c’est devenu toute sa vie, depuis ce jour où il est devenu addict. «La première fois que tu prends de l’héroïne, tu as l’impression de découvrir quelque chose d’extraordinaire, quelque chose qui vaille enfin la peine d’être vécu. Nous, à l’époque, on n’avait jamais rien ressenti de pareil. Notre vie s’annonçait plus que banale et solitaire jusqu’à ce que l’on croise la lady sur notre route. À partir de ce jour-là, on a eu l’impression d’être en couple avec la femme la plus sensuelle de la planète.» En parlant de femme, on découvrira au fil du récit qu’il a perdu la sienne, devenue accro à son tour. «On passait des jours entiers blottis l’un contre l’autre comme des fœtus, elle maigrissait à vue d’œil ; mais les cernes et le look moribond lui allaient plutôt bien, on aurait dit une princesse de la nuit.»
C’est aussi un peu pour la retrouver qu’il a continué à se shooter, elle qui peuple désormais ses rêves. Quand la frontière entre conscient et inconscient se fait floue, quand il lui devient impossible de comprendre si ce qu’il perçoit est la réalité ou non. «Je vois des chiens et des enfants courir entre les arbres, des amis morts, qui auraient vieilli, en train de faire cuire de la viande sur un gril. Scènes impossibles. Je crois que je n’aurais rien pu espérer d’autre dans la vie. Ça fait bien longtemps que j’ai oublié ce qu’étaient le désir et le plaisir, c’est l’effet de la lady.»
Avec cette bizarre sensation de se réveiller, de revenir de l’au-delà. Et devoir reporter le grand voyage qu’il appelle de ses vœux. Il est pris à partie, manque de s’effondrer en creusant la terre à la recherche d’un coffre, et erre à la recherche du Rincón de Juan, le rendez-vous de tous les paumés du coin.
L’auteur, fils de la photographe Pía Elizondo et du graphiste Gonzalo García Barcha est aussi le petit-fils de Gabriel García Márquez et de l’écrivain et poète mexicain Salvador Elizondo. Bon sang ne saurait mourir. On sent ce premier roman nourri de ses ancêtres et de tous les morts qui l’entourent et dont la compagnie ne le dérange nullement, bien au contraire. Dans sa vallée de larmes, il chemine à leurs côtés, va chercher dans les vestiges de sa mémoire de quoi nourrir ses rêves.
Dans la tradition mexicaine, qui veut que les morts accompagnent les vivants, l’auteur joue constamment avec cet au-delà, en abolissant la frontière. Est-ce la confession d’un junkie halluciné ou le message laissé par un esprit qui a déjà gagné les limbes? On retrouve la fantasmagorie d’Au-dessous du volcan, dans ce roman initiatique déjà riche de – belles – promesses.
Dernier rendez-vous avec la Lady
Mateo Garcia Elizondo
Éditions Maurice Nadeau
Roman
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Julia Chardavoine
184 p., 21 €
EAN 9782862315089
Paru le 22/08/2023
Où?
Le roman est situé au Mexique, dans un village imaginaire nommé Zapotal.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Un jeune homme s’installe à Zapotal, un village perdu au fin fond du Mexique en lisière de la jungle. Il emporte avec lui d’impressionnantes réserves d’opium et d’héroïne pour en finir avec la vie et un cahier dans lequel il entreprend de raconter les derniers instants de son existence. Hanté par des visions et des souvenirs, il oscille entre la vie et la mort dans les limbes magiques du demi-sommeil et de la drogue, se promène au hasard et découvre le Rincón de Juan, un bar où convergent les âmes perdues et où ivrognes et prostituées lui apprennent à fumer des scorpions pour se sevrer. Mais les trous de mémoire se multiplient, les réserves de drogue s’étiolent, le manque se fait plus fort et la mort s’approche inéluctablement. À moins qu’il ne soit déjà passé de l’autre côté et que cela ne ressemble en rien à ce qu’il avait pu imaginer…
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
La cause littéraire (Patryck Froissart)
RFI (Olivier Rogez) https://rfi.my/9t3c
Lettres capitales (Dan Burcea)
Mateo Garcia Elizondo présente son roman «Dernier rendez-vous avec la Lady»
Les premières pages du livre
« Chapitre 1
Je suis venu à Zapotal mourir une bonne fois pour toutes. Dès que j’ai mis un pied dans le village, je me suis débarrassé de tout ce que j’avais dans les poches, des clés de la maison que j’ai laissée derrière moi à la ville, des cartes en plastique et de tout ce qui avait mon nom ou ma photo. Il ne me reste plus que trois mille pesos, une boulette de résine d’opium et sept grammes d’héroïne. Ça devrait suffire à me tuer, sinon je n’aurai plus de quoi me payer une chambre ou m’acheter un peu de lady, pas même assez pour un pauvre paquet de clopes. Et je finirai par mourir de froid et de faim, au lieu de faire l’amour avec ma belle faucheuse, lentement, tout en douceur, comme prévu. Ça devrait être plus que suffisant, mais je m’y suis déjà essayé à plusieurs reprises et je finis toujours par me réveiller. Je dois avoir quelque chose à régler avant.
Ce voyage, je veux le faire depuis longtemps. C’est mon dernier souhait dans cette existence dépouillée de tout désir. Tout ce qui me rattachait à la vie, je m’en suis déjà défait. Ma femme est morte, mon chien aussi. J’ai coupé les ponts avec ma famille et mes amis, j’ai vendu la télé, la vaisselle, les meubles. Un peu comme dans une course avec moi-même pour amasser assez de came et de blé et réussir à me tirer avant d’être complètement paralysé. Je voulais tout perdre, c’était comme ça. Là où je vais, je n’ai plus besoin de rien, pas même de mon corps, mais ce sac d’os m’a collé aux basques pendant tout le trajet et je n’ai pas eu d’autre choix que de me le trimballer.
J’ai seulement pris mon kit avec moi. C’est dans cette boîte que je garde ma pipe, ma cuillère, mes seringues, tout le matos. C’est là que je range mon cash aussi. J’ai acheté ce carnet à la station de bus, parce que je n’aurai pas grand-chose pour me divertir quand je serai en train de crever et je ne veux pas devenir fou. Et puis, il faut que je mette les choses au clair. Pas pour les autres, juste pour moi-même, pour comprendre ce qu’il m’arrive. J’ai besoin d’écrire ce que ça fait de mourir, parce que personne n’est jamais là pour le raconter. Et moi si. Je suis encore là, même si je suis déjà loin. Je sais ce que c’est de vivre dans les limbes et de glisser progressivement de l’autre côté. Je suis une sorte de mort-vivant et, depuis un moment déjà, les gens me regardent comme ça. Je préfère ne pas en parler avec eux, car ce que j’ai à dire, ce n’est plus pour les vivants. J’espère que personne ne me lira d’ailleurs afin d’éviter tout malentendu, que personne ne trouvera ce carnet, qu’on le brûlera, qu’on le jettera à la poubelle ou dans une fosse avec ce qui restera de moi.
Je suis venu jusqu’ici parce que je ne veux pas qu’on me réveille quand je serai en train de mourir. Je ne veux pas qu’on me retrouve, qu’on me lève du lit, qu’on m’habille ou qu’on me maquille. Je ne veux rien de tout le tralala : les rites, les pleurs, les beaux discours. Je veux seulement qu’on dise que j’ai renoncé à tout comme un saint, que je me suis défait des liens terrestres et des préoccupations de la chair, que je suis allé seul dans la montagne affronter la mort. Je veux qu’on pense et dise de moi : « Quel courage ! » et « C’était pas n’importe qui. » Les gens croient qu’on fait ce genre de choses par lâcheté, mais non. On le fait quand on comprend qu’on est venu au monde pour ça. C’est la seule chose qui garde du sens. Enfin, je crois. C’est justement ce que j’essaye de tirer au clair.
Je n’avais jamais entendu parler de Zapotal et je ne sais pas vraiment pourquoi j’ai atterri ici. Je voulais simplement me rendre au bout de la ligne, aux confins de cette terre, mais je n’avais pas imaginé que ce serait cet endroit-là. Ici s’achève le monde des hommes, ensuite il n’y a plus que jungle et montagne. On raconte qu’au-delà du village les gens se perdent dans les fourrés et deviennent fous, qu’ils voient des monstres apparaître et qu’ils attrapent une fièvre qui les fait saigner de tous leurs pores. La journée, on entend le bruit des cigales se mêler au rugissement des scies électriques dont les hommes du village se servent pour abattre les arbres dans un bras de fer avec la nature, une lutte pour envahir son territoire. Chaque arbre est une victoire qui laisse dans son sillage des sols arides et enveloppés d’un brouillard chaud et puant, des friches désolées qui ne servent plus à rien et qui n’ont plus la moindre trace de vie. Les mauvaises herbes, en revanche, poussent plus vite qu’on ne peut les arracher, elles envahissent le village, dévorent les rues et les maisons sur leur passage. De jour, les hommes se débattent avec ce fléau dans la chaleur suffocante et, de nuit, pour se distraire et oublier, ils s’enivrent et se bastonnent jusqu’à tomber raides.
J’ai cru comprendre que le village avait été fondé comme une exploitation forestière, parce qu’il n’y avait rien d’autre ici, rien qui ait pu intéresser qui que ce soit. Pour encourager la colonisation, le gouvernement a fait venir des prostituées de toute la région, et ce hameau de putes et de bûcherons est devenu le Zapotal. En dehors des maisons pour la plupart modestes, on trouve quelques fermes, des scieries, une chapelle, deux haciendas abandonnées, une épicerie et un bar. La route en terre qui mène jusqu’ici sert uniquement au passage des camions chargés d’arbres récemment abattus et des rares bus comme celui avec lequel je suis arrivé. Ce sont les seuls moyens de transport qui pénètrent ces terres désolées et apportent suffisamment de bière, de cigarettes et de Coca-Cola pour donner au village un air illusoire de civilisation.
Près de l’arrêt de bus, j’ai trouvé une maison d’hôtes ou du moins ce qui s’y apparente le plus dans le village. Le patron me loge dans une chambre au deuxième étage d’une construction inachevée en béton et au toit de tôle. Elle donne d’un côté sur la rue et, de l’autre, sur une cour intérieure et une citerne. Le patron me fait la nuit à cent pesos, même si c’est une porcherie. Il y a un lit simple, une table, une commode et des toilettes au fond avec un lavabo et une cuvette sans siège. Les murs de ciment sont déjà fissurés et, l’après-midi, une lumière rougeâtre filtre à travers les rideaux fleuris. La piaule parfaite pour mourir.
Le patron m’a demandé ce que je venais faire au village, et comme je savais qu’il ne comprendrait pas, je lui ai répondu que j’étais en vacances. Il m’a dit de ne pas fumer dans la chambre, parce que les gens qui viennent en vacances comme moi, ils brûlent toujours leur matelas et il y a déjà eu plusieurs incendies. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et je lui ai donné six cents pesos pour avoir la paix pendant quelques jours. Puis je me suis étalé sur le lit pour fumer de l’opium. J’étais enfin arrivé et je n’avais plus besoin de me presser.
Je me souviens que j’ai commencé à avoir sommeil et que j’ai senti dans ma bouche une boule de coton prendre la forme de mes dents. Peu à peu, j’ai cessé de sentir mes narines, puis les orbites de mes yeux et les lobes de mes oreilles. Je baignais dans le plaisir qui me parcourait tout entier, de la pointe de mes orteils à celle de mes cheveux.
Ça commence toujours comme ça.
Chapitre 2
Quand on fume l’opium, le brouillard dans le cerveau se dissipe ; les pensées deviennent aussi réelles et tangibles que des objets physiques, on pourrait presque les toucher. On dit que l’opium donne envie de dormir ; mais moi, je ne me sens jamais aussi éveillé que dans ces moments-là. Sous une douce cape de fumée, les visions cachées dans les sous-sols de l’esprit, impossibles à saisir en état de veille, se déploient en bifurcations harmoniques, surgissent pour se fondre dans la clarté d’un panorama lumineux. On se sent bien, on se sent intelligent et raffiné, fort physiquement, et si quelqu’un venait toquer à la porte, on serait prêt à le recevoir avec du thé et des biscuits. Moi, quand je fume l’opium, j’ai l’impression d’être allongé dans une pièce débordant d’œuvres d’art, de tables en marbre et de fauteuils en velours, d’être installé dans un château ou dans la demeure de quelque milliardaire. Il me semble même que ce milliardaire, c’est moi, que ce royaume exubérant et voluptueux m’appartient, qu’il est entièrement mien.
On s’endort doucement et les rêves se transforment en basse, une musique de fond qu’on n’entend plus au bout d’un certain temps, même si elle est encore là. La première chose que je vois quand la roupillante me gagne, ce sont des nuées d’oiseaux qui volent dans le ciel, à l’unisson, sans se toucher les uns les autres, comme une cape qui ondule et palpite au vent. Je sais que c’est un souvenir lointain, quelque chose que j’ai vu en voiture quand j’étais petit, mon père conduisait et la route traversait une plaine infinie d’herbes dorées et monotones. Je n’arrive pas à me rappeler du contexte ; je ne sais pas où on allait ni d’où l’on venait, mais depuis la fenêtre du siège arrière, j’observais cette présence gigantesque et abominable avec un mélange d’horreur et de fascination.
Il me semble toujours apercevoir dans cette entité unique et vivante, qui se contracte et se dilate tour à tour dans le ciel, une présence tantôt humaine, tantôt animale, comme si un visage se penchait derrière ce voile pour m’observer et me protéger. Me saluer un instant avant de disparaître. C’est une présence connue, mais qu’il m’est difficile de reconnaître et quand il me semble que la clarté est telle que je vais enfin y parvenir, alors la nuée d’oiseaux se contracte à nouveau. Le visage se cache une fois encore, et si je l’attends, il ne revient plus. Il ne ressurgit que lorsque je l’oublie et que je me laisse surprendre une fois de plus.
Cette vision me berce, m’apaise. Je dois lutter contre le sommeil écrasant qui m’envahit dès que cette image survient dans mon esprit. Je me maintiens éveillé uniquement pour pouvoir continuer à l’observer, et si je n’y arrive pas, alors je l’imagine, et je ne tarde jamais à m’écrouler comme un corps mort. Dans ce va-et-vient, je découvre des paysages qui gagnent en netteté avant de se volatiliser et j’essaye de trouver un fil qui me conduirait au travers de ses passages, de ses petites portes, de ses ruelles obscures, sous ses voûtes, le long de ses escaliers et jusqu’à ses remparts. J’avance entre ses sommets et ses crêtes, le long des sous-sols et des vides derrière les murs, je me perds dans la texture de chaque vision jusqu’à ce que, comme dans tous les rêves, j’oublie que je suis en train de rêver, je me laisse alors porter par ces trames improbables qui m’entraînent vers l’endroit le mieux caché au monde qui m’est à la fois étrange et familier.
J’étais en train de me promener dans un jardin luxuriant, orné de statues en marbre comme celles de dieux grecs, mais osseuses, pleines de plaies et d’ecchymoses, je me suis approché pour les regarder de plus près et je me suis rendu compte que je les connaissais. C’était ma bande du squat. Je n’avais pas vu certains de mes potes depuis très longtemps. Mike par exemple, était mort depuis belle lurette, mais peut-être qu’il n’était pas tout à fait mort. Il était immobile, sauf que j’ai remarqué que ses lèvres bougeaient : « T’es déjà là, brindille ? Tu ferais mieux de te tirer, c’est pas un endroit pour toi, ici… »
J’ai eu l’impression qu’il voulait me dire qu’ils s’étaient tous retrouvés ici, que le Zapotal était une immense salle de shoot, et qu’au lieu de m’échapper, j’étais simplement revenu au point de départ. Il me conseillait de rentrer à la ville parce qu’ici, c’était un club très select ; je trouvais ça bizarre parce que Mike n’avait jamais été un type comme ça, c’était plutôt le genre à te recevoir à bras ouverts, à partager s’il avait de quoi, alors je lui ai juste répondu : « Bordel, Miguel, qu’est-ce qui te prend ? Depuis quand tu te la racontes comme ça, hein ? T’es en manque ou quoi ? »
Entre deux rêves, j’ai senti qu’un chien me léchait la main, comme pour essayer de me réveiller, j’ai ouvert les yeux et j’ai regardé autour de moi. Une très vieille dame squelettique allait et venait dans la chambre. Elle se comportait comme ma mère, mais c’était impossible puisque ma mère était morte en me mettant au monde. … »
Extraits
« La première fois que tu prends de l’héroïne, tu as l’impression de découvrir quelque chose d’extraordinaire, quelque chose qui vaille enfin la peine d’être vécu. Nous, à l’époque, on n’avait jamais rien ressenti de pareil. Notre vie s’annonçait plus que banale et solitaire jusqu’à ce que l’on croise la lady sur notre route. À partir de ce jour-là, on a eu l’impression d’être en couple avec la femme la plus sensuelle de la planète. » p. 52-53
« Je ne sais pas pourquoi elle est tombée amoureuse, mais elle a réussi à trouver une faille dans ma carapace pour se faufiler jusqu’à moi: personne d’autre qu’elle n’a jamais réussi à m’atteindre. Je crois qu’avec Valérie, la vie a essayé de me sauver, oui, c’est bien ça, je crois. Je ne peux pas imaginer que la vie ait plutôt voulu l’envoyer droit dans un incinérateur, et c’est pourtant ce qui s’est passé.
Elle disait que la lady était un peu comme ma maîtresse et je lui promettais que je n’aimais personne d’autre qu’elle. Petit à petit, nos rendez-vous ont commencé à tourner de plus en plus autour de la lady, et de moins en moins autour de nous, jusqu’à ce qu’elle devienne accro elle aussi. On passait des jours entiers blottis l’un contre l’autre comme des fœtus, elle maigrissait à vue d’œil ; mais les cernes et le look moribond lui allaient plutôt bien, on aurait dit une princesse de la nuit. » p. 88
« Je ne sais pas si mes yeux sont ouverts ou fermés, mais j’ai l’impression d’être dans une boîte très étroite, de descendre dans les tréfonds les plus sombres et reculés d’un sous-sol. Cette sensation de plonger n’est pas nouvelle ; je l’ai fait toute ma vie. Je sais qu’on ne touche jamais le fond. Allongé, immobile, je coule et, tout au fond, je retrouve mes souvenirs, comme des animaux monstrueux qui nagent dans les profondeurs de l’océan.
Et là, je vois Valérie. Je sens son corps chaud autour du mien et sa respiration lente contre mon cou. Des frissons hérissent ma peau quand elle me caresse le dos. Avec elle, je me sentais pleinement en sécurité et en paix. Quand je m’endormais dans ses bras, des idées et des rêves me venaient à l’esprit, exactement comme quand je fume de l’opium. Il me semble que dans ma vie, rien n’a été aussi semblable à un shoot de lady qu’un moment dans les bras de ma Valérie.
Entre les eaux, j’aperçois son corps étendu sur le lit. Son parfum de fleurs fanées me parvient et je découvre à flanc de montagne, au-dessus des nuages, un chalet dont la cheminée en pierre laisse échapper de la fumée. Je vois des chiens et des enfants courir entre les arbres, des amis morts, qui auraient vieilli, en train de faire cuire de la viande sur un gril. Scènes impossibles. Je crois que je n’aurais rien pu espérer d’autre dans la vie. Ça fait bien longtemps que j’ai oublié ce qu’étaient le désir et le plaisir, c’est l’effet de la lady. »
« Ce sont des souvenirs récents, des souvenirs de mon errance dans Zapotal. Mon temps perdu. Je vois des foules de gens qui chuchotent et me dévisagent depuis les champs de maïs ou les maisons abandonnées. Je vois au loin des silhouettes indistinctes qui se penchent au-dessus des murailles des haciendas: elles ont conscience de ma présence, elles savent que je m’approche et que tôt ou tard je finirais par les rejoindre. Je vois un corps allongé et immobile sur un lit, aussi gris que la fumée dans laquelle je l’observe se former ; autour de lui, des présences chuchotent avec des voix préoccupées. C’est moi, mais je vois tout de l’extérieur, comme dans un rêve ou comme un fantôme. Je sens les parois d’une boîte très étroite qui descend au-delà de la croûte terrestre. Elle a la forme d’un corps humain et se dissout immédiatement en fumée. Il n’en reste plus que des résidus, des particules informes qui flottent dans l’air et jaillissent de l’encens comme un courant d’air.
Ce sont des souvenirs de l’autre côté, des choses dont on ne peut pas se rappeler de son vivant. On dirait que mes yeux, incapables jusqu’alors de faire la mise au point, peuvent soudain voir que dans le bol qu’on m’a offert, il n’y a rien qu’un peu de lait. Je récupère la sensation du toucher et je sens que les haillons effilochés que je porte depuis des jours sont immatériels. » p. 149
À propos de l’auteur
 Mateo García Elizondo © Photo Jaime Navarro
Mateo García Elizondo © Photo Jaime Navarro
Mateo García Elizondo est né en 1987 à Mexico. Il est titulaire d’un diplôme de journalisme et est également scénariste (il a écrit le film Desierto et de nombreux scénarios de romans graphiques). Son premier roman, Dernier rendez-vous avec la Lady, a remporté le prix littéraire Ciutat de Barcelona et lui a valu d’être inclus dans la deuxième liste des 25 meilleurs jeunes auteurs de langue espagnole du magazine Granta. Malgré le poids d’une filiation littéraire des plus honorifique, puisque son grand-père paternel est Gabriel García Márquez et son grand-père maternel est l’écrivain mexicain Salvador Elizondo, Mateo fait preuve pour son premier roman d’une très grande originalité et d’une puissance d’écriture remarquable. (Source: Éditions Maurice Nadeau)
Tags
#dernierrendezvousaveclalady #MateoGarciaElizondo #editionsmauricenadeau #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2023 #litteraturemexicaine #litteratureetrangere #litteraturecontemporaine #litteraturehispanique #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #roman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie






 Selva Almada © Photo DR Agustina Fernandez
Selva Almada © Photo DR Agustina Fernandez