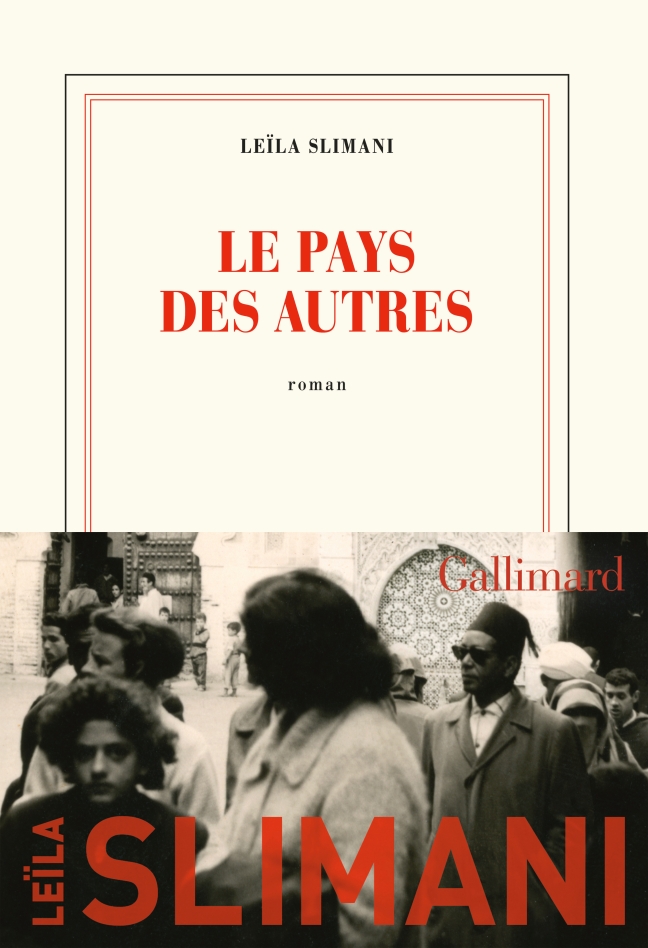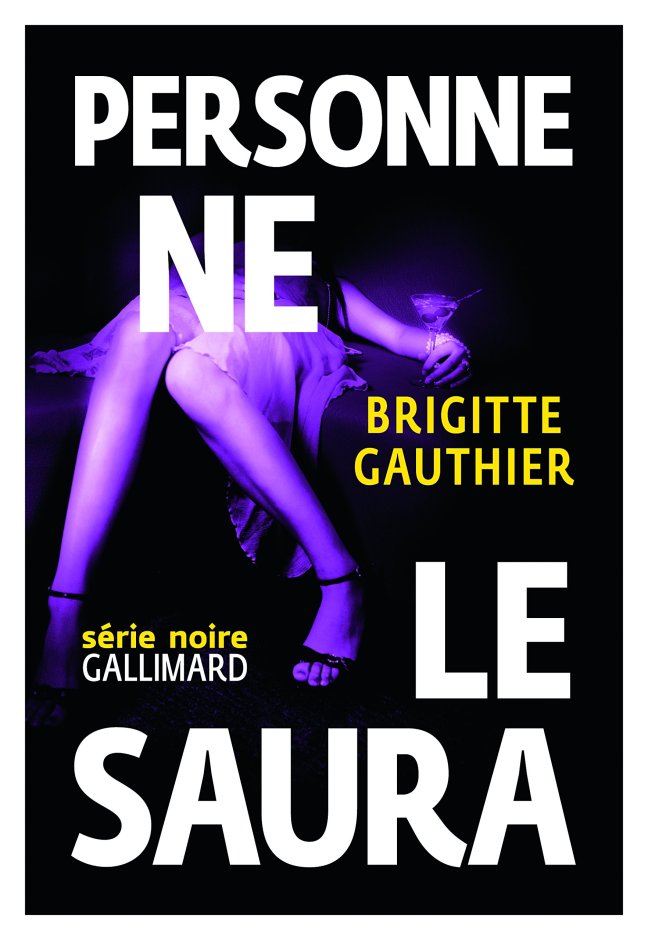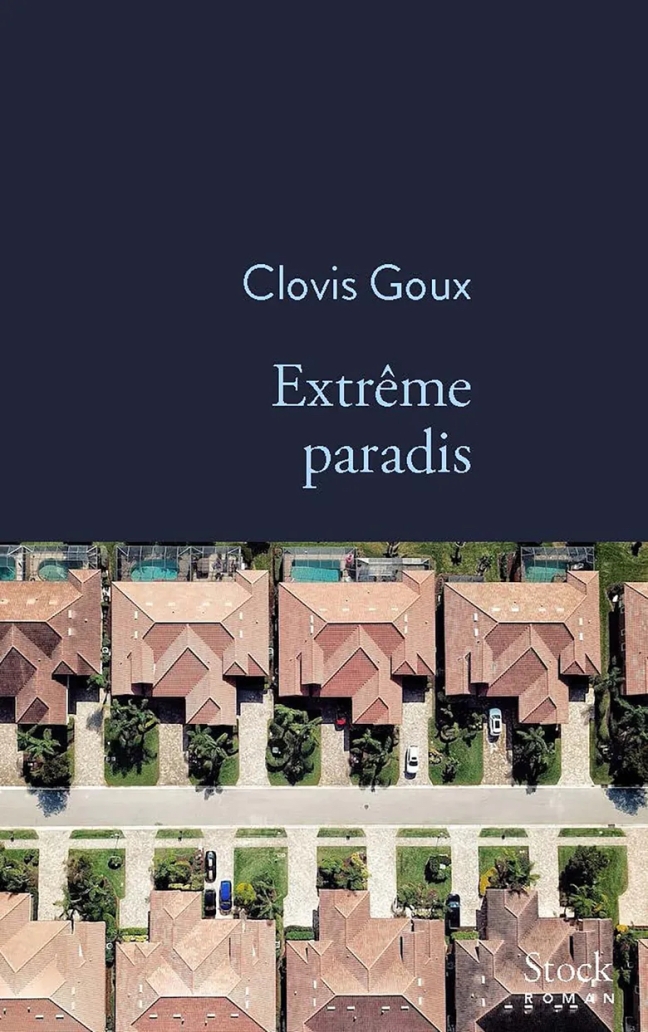
En deux mots
Après le décès de son père en Floride, le narrateur se rend dans cet État qui a fait sécession pour tenter de comprendre ce qui s’est passé dans ce paradis réservé aux personnes âgées. Il va finalement découvrir que derrière les bonnes intentions se cache un monde beaucoup plus sombre. Un monde qui obsédait son père.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Le paradis des vieux est un enfer
Clovis Goux imagine la sécession de la Floride pour y établir les VUF, les Villages-Unis de Floride. Dans cet État réservé au plus de 55 ans, le narrateur vient enterrer son père qui avait choisi ce petit paradis. Une dystopie habilement construite, avec humour et suspense.
Quand il apprend la mort de son père, le narrateur, qui est pigiste à Paris, décide de prendre l’avion pour la Floride. Didier, son géniteur, avait choisi de s’installer dans ce nouvel État, baptisé VUF (Villages-Unis de Floride). Réservé au plus de 55 ans possédant un patrimoine conséquent, il promet aux retraités de couler des jours heureux sous le soleil. Ici, pas d’insécurité – pour ne pas qu’elle s’endorme, la police est appelée quand deux voiturettes de golf s’entrechoquent – pas de cimetière, mais des circuits de golf et des barbecues pour entretenir la convivialité. «Les hommes portaient des casquettes ou des panamas, des polos ou des chemisettes colorées, des bermudas kaki et des Birkenstock, les femmes des visières, des marcels ou des T-shirts pastel sur des joggings ou des leggings, des sandalettes ou des Crocs. Tous avaient des cheveux blancs parfaitement coiffés et des lunettes de soleil. Des couples de vieux sortaient du mall en poussant des caddies remplis de fournitures, ils saluaient leurs connaissances au passage et formaient bientôt de nouveaux groupes au hasard de leurs rencontres pour commenter les bonnes affaires qu’ils venaient de réaliser, les prévisions météo ou les derniers potins des Villages. On prenait rendez-vous pour un barbecue, un concert virtuel des Beach Boys ou une partie de padel. On s’informait de la bonne santé de chacun, les sourires étincelaient, les rires fusaient et l’on s’étreignait de généreux hugs à tout bout de champ. De ce joyeux ensemble émanait le sentiment d’une communauté soudée, d’une utopie accomplie, d’un monde nouveau.»
Arrivé sur place, il apprend que la mort de son paternel serait due à un accident après une mauvaise chute dans son salon, sur un coin de table. Mais comme la législation impose la crémation et la dispersion des cendres, il n’y a pas de cadavre. Ce qui va perturber le journaliste qui décide d’enquêter. Il interroge le chauffeur, un taiseux, et la femme de chambre, un peu plus bavarde. Il va réclamer le certificat de décès et tenter d’en apprendre davantage auprès de l’inspecteur Anderson, chargé des formalités.
Au fil des jours, il va découvrir comment fonctionne la communauté, mais aussi que son père était obsédé par les affaires criminelles au point de rassembler une solide documentation sur tous les faits divers et cold cases de la région: «Les documents photographiques réunis par mon père étaient accompagnés de centaines de notes manuscrites, de plans à main levée et d’articles de presse classés méthodiquement dans des chemises selon les lieux où les faits s’étaient déroulés. L’ensemble redessinait la carte de Floride aux couleurs du mal, esquissait une géographie souterraine qui obéissait aux seules lois de l’ultra-violence.» Michelle, l’amante du père, puis bientôt du fils, va pouvoir éclairer un peu sa lanterne.
Les codes du thriller vont permettre à Clovis Goux d’explorer les travers de ce communautarisme bâti sur la peur des jeunes, sur le dangereux repli sur soi. Je me souviens avoir vu, lorsque je voyageais en Floride, des publicités pour un village érigé par la Walt Disney Company et qui promettait un tel petit paradis avec sécurité renforcée, caméras de surveillance empêchant toute intrusion, pelouses au cordeau et personnel de maison à disposition. Cette dystopie élargit le champ et accentue le trait. Ici, on en supporte pas les jeunes pour s’arroger l’illusion d’une éternelle jeunesse. On ne supporte pas la mort pour entretenir l’illusion de l’immortalité.
Les enfants gâtés du XXe siècle, nourris de pop culture (les virées au cinéma proposées par le père à son fils les ont construits tous les deux), ont voulu un monde aseptisé et vont se retrouver dans l’univers de J.G. Ballard et notamment Super-Cannes. La preuve, une nouvelle fois, que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Un enfer que se construit à partir d’une oisiveté voulue – sans penser aux conséquences – et qui va déboucher sur la haine, la violence, le lynchage. D’une extrême à l’autre, en quelque sorte.
Extrême paradis
Clovis Goux
Éditions Stock
Roman
280 p., 20,90 €
EAN 9782234093843
Paru le 17/01/2024
Où?
Le roman est situé principalement aux Etats-Unis, en Floride. On y évoque aussi Paris et une ferme dans les Dombes.
Quand?
L’action se déroule dans un futur plus ou moins proche.
Ce qu’en dit l’éditeur
Dans un avenir imminent, la Floride a fait sécession avec les États-Unis afin de fonder une fédération de communautés privées réservées aux seuls retraités: les Villages. Dans ce luxueux paradis artificiel conçu par et pour les seniors, la mort, le crime et la jeunesse ont été éradiqués au profit du divertissement. L’étrange décès d’un résident français vient cependant bouleverser l’équilibre instauré.
Accident? Meurtre? Suicide? Précipité dans l’univers outrancier des Villages-Unis de Floride, le fils du défunt part sur les inquiétants chemins qui ont menés son père à sa perte. En fouillant dans le passé, ce journaliste déboussolé par le deuil réveillera les vieux démons de la région. En cherchant la vérité, il basculera dans l’envers du décor. Alors les Villages dévoileront leur vrai visage.
Satire, dystopie ou anticipation? Avec force et humour Extrême paradis interroge nos ambiguïtés face à la violence comme les dérives communautaristes de nos sociétés: et si la sauvagerie était une nécessité? Et si la vieillesse était le futur de l’humanité?
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Benzine mag.
Paris la douce (Caroline Hauer)
Blog Littéraflure
Blog Voyages au fil des pages
Les premières pages du livre
« I Cool Aqua
1
L’école fantôme
La découverte d’une école maternelle au sein des Villages-Unis de Floride fut un véritable choc tant son existence, sa présence même, était une monstrueuse aberration, comparable, si je peux me permettre cette analogie, à la construction d’un abattoir dans un parc d’attractions. Et pourtant, malgré son incongruité, malgré son effrayante absurdité, elle est là, sous mes yeux, cachée du reste de l’humanité par une modeste colline boisée, à quelques mètres seulement d’un des bunkers du golf Harold Schwartz où l’armée des Villageois pratique son swing à l’année comme autant de salutations aux feux d’un soleil éternel que de défis lancés à un ennemi invisible.
L’aube point en dessinant en ombres chinoises une ligne d’horizon hérissée de palmiers lorsque j’approche, lampe torche à la main, du bâtiment. Surmontée du drapeau de l’État sécessionniste – une étoile à cinq branches insérée dans un soleil bleu aux rayons rouges et blancs – qui flotte en haut d’un mât, l’école en briques se déploie sur un seul niveau dont les fenêtres aux cadres clairs sont obstruées par d’épais rideaux. En son centre, l’entrée principale se fait sous un fronton de faux marbre supporté par des colonnes doriques. La porte grillagée n’est pas fermée. Par-delà le portique de sécurité désactivé (je ne suis de toute façon pas armé), le faisceau de la lampe révèle un vaste couloir le long duquel sont disposés en vis-à-vis des casiers et des portemanteaux sur lesquels scintillent de petits cirés jaunes au-dessus de bottes de pluie rouges sagement alignées sous des bancs de bois qui filent en perspective. J’approche des casiers métalliques en faisant grincer ma paire de Converse sur le sombre linoléum. Sur chacun figure une plaquette avec un prénom : Judy, Carolyn, Jason… J’en ouvre un au hasard pour constater qu’il est vide.
J’entre maintenant dans une salle de classe et découvre quatre rangées de pupitres accolés à des chaises d’enfant faisant face au bureau de l’instituteur derrière lequel s’étend un vaste tableau noir. Une carte de la Floride est accrochée à son cadre et l’on peut lire RÉVOLUTION inscrit à la craie blanche sur le noir de l’ardoise. Les murs de la classe sont vert d’eau. On y a punaisé des posters d’animaux ainsi que des peintures enfantines. Il y a une mappemonde dans un angle à côté d’un miroir et d’une bibliothèque. Je m’approche. Le cercle lumineux balaye les livres, en révèle quelques titres : Les Aventures de Tom Sawyer, La Case de l’oncle Tom, Les Quatre Filles du docteur March, Max et les Maximonstres, Charlie et la Chocolaterie, Le Magicien d’Oz, Le Royaume fantôme… Je ne connais pas ce dernier ouvrage et tends la main pour m’en saisir : contre toute attente le rayonnage bascule vers moi lorsque je tente de l’extraire du bout des doigts et je me retrouve avec un ensemble compact, étonnamment léger, dans les bras. Sans un bruit, je remets en place les faux livres en remarquant que le reste de la bibliothèque est également composé de ces mêmes blocs qui d’ordinaire, vendus au mètre, servent à décorer les appartements témoins, les salles d’exposition de marchands de meubles ou les espaces détente de certains fast-foods. En revenant sur mes pas, je constate que les dessins d’enfants sont des reproductions : de simples photocopies couleur.
J’explore à présent la cantine : un réfectoire, des tables rondes et basses entourées de petites chaises, des néons au plafond, un distributeur de plateaux et de couverts, un buffet à bain-marie, un buffet réfrigéré débranché… Ici comme dans tout l’édifice, chaque objet semble à sa place, prêt à l’emploi, mais étrangement orphelin, dénué de sens, soulagé de sa fonction, dans l’attente d’un signal qui déclencherait une série d’actions. Une porte vitrée mène aux cuisines : la pièce est vide. Sur le sol carrelé, il y a seulement un balai à franges gisant à côté d’un seau à essorer.
Dans les toilettes face aux miroirs et aux lavabos, il y a des urinoirs pour adultes et pour enfants, pas de portes aux WC. Je tourne l’un des robinets, mais l’eau ne s’en écoule pas. Plus loin, je pénètre dans une salle de repos avec une dizaine de lits d’enfants. Ils sont faits au carré, à l’identique ou presque : une couette et un oreiller à motifs, voitures pour les garçons, poupées pour les filles. La pièce est aveugle. Il y a un miroir face à l’entrée.
En sortant par la porte arrière qui ouvre sur la cour de récréation, je me retourne vers l’école avec l’étonnante impression qu’à la manière des poupées russes, le bâtiment cache une reproduction de lui-même à échelle réduite. Au-dessus de moi, le soleil tente de dissuader l’arrivée de ténébreux nuages à l’horizon et le ciel se décline en un strident dégradé qui va du pourpre au jaune soufre en passant par le vert cuivré, soit les prémices d’un des fameux cocktail skies vénérés ici-bas. Le brouillard matinal surgi des marais environnants recouvre un périmètre délimité par des grillages et des arbustes. Je pose alors le pied sur le mot Earth, soit la première case d’une marelle peinte sur le sol en caoutchouc, et l’image d’un lutin en ciré jaune sautant à cloche-pied dans un tapis de brume (avec ses petites bottes de caoutchouc rouge !) jusqu’à la case Heaven frappe mon esprit. Devant moi il y a un toboggan et des balançoires. En m’approchant du portique, je constate qu’une des trois balançoires a été décrochée. Et je comprends à cet instant précis que c’est ici que mon père a trouvé la mort.
2
Le Vampire de la Goutte-d’Or
Un mois plus tôt, j’étais à Paris en train de tirer les vers du nez au Vampire de la Goutte-d’Or lorsqu’un numéro inconnu s’afficha sur mon téléphone. Je laissai la messagerie se charger du mystérieux appel. Après quelques années laborieuses dans le monde de l’entreprise où mes seules joies furent les repas thématiques de la cantine (pour le Nouvel An chinois les caissières étaient habillées en geishas et un orchestre de mariachis anima la semaine mexicaine), je me retrouvais au chômage ou plutôt en boîte de nuit. C’est sous les flashes d’un stroboscope qu’un compagnon de boisson me proposa, une nuit particulièrement arrosée, de «piger» pour le journal dont il était le rédacteur en chef adjoint. Je lui opposai le fait que je n’avais jamais pris la plume pour écrire un mot. «Ça tombe bien, moi non plus!» répliqua-t-il dans un grand éclat de rire avant de commander une nouvelle tournée. Et c’est ainsi que je devins journaliste.
Ma mission était simple: interviewer des freaks, déformer leurs propos, inventer des faits et prier pour que mes «sujets» ne trouvent pas mon adresse après avoir lu mon « papier ». Avec le Vampire de la Goutte-d’Or, ça allait être compliqué: il habitait à côté de chez moi, dans des caves aménagées rue Myrha. Longs cheveux noirs ondulés et graisseux, yeux bleus translucides maquillés au khôl, teint verdâtre parsemé de boutons d’acné, toujours vêtu d’une redingote noire moisie, d’un pantalon en velours, de chemises à jabot et de bottes de l’armée allemande, le Vampire dénotait dans ce quartier peuplé en majorité d’immigrés. Il était le seul à faire peur aux hordes de gamins des rues qui avaient fui la misère d’un pays en guerre pour semer la terreur dans les lavomatics du coin ainsi qu’aux mamas en boubou qui faisaient régner l’ordre sur le pavé et se signaient lorsqu’elles le croisaient : la patte de poulet qu’il arborait en pendentif (en exhalant une redoutable odeur de camphre) était le signe certain qu’il pratiquait le vaudou dans son terrier.
Murs tapissés de velours rouge, crânes d’animaux montés en lampes de chevet, mannequin démantibulé en table basse, mandalas d’insectes morts, Christ inversé, Sainte Vierge profanée… Son logis souterrain était un savant mélange entre la caverne d’un sorcier, l’antre d’une goule et la salle à manger d’Ed Gein. Ma première question fut simple: comment faisait-il pour se laver? Sa réponse, expéditive : d’un ongle peint en noir, il me désigna un bac à sable dans un recoin obscur de la cave voûtée avant de me dérouler les grandes lignes de son parcours ; en rupture avec des parents pharmaciens à Rouen, il avait découvert Aleister Crowley et le LSD durant ses années chez les jésuites avant de former Kadaverik Likidator avec deux amis de pensionnat (Lucifred à la basse, Muinomednap à la batterie). Le groupe fit rapidement son trou au sein de la scène black metal hexagonale, leur répertoire se composant d’un seul morceau, Life Is Death, joué ad nauseam sous l’influence de drogues dures, lysergiques de préférence. La légende voulait qu’ils parvinssent ainsi (grâce également à un volume sonore défiant l’entendement) à faire vomir leur public. Le Vampire avait-il des problèmes de voisinage ? « Seulement le jour où la concierge a trouvé un pigeon crucifié sur ma boîte aux lettres. Une déclaration d’amour d’une de mes fans », répondit-il avec un large sourire halluciné qui découvrit des canines limées en pointes. Son surnom lui était-il monté à la tête? Je profitai de cet instant d’incertitude pour lui demander la direction des toilettes. Il me dirigea vers un seau en métal près du bac à sable. Tandis que j’urinais dans le récipient, j’interrogeai mon répondeur. Une voix lointaine m’informa en anglais qu’il était arrivé un terrible accident à mon père. Il était décédé. Il fallait que je rappelle au plus vite. La foudre s’abattit sur moi au moment où je reboutonnais mécaniquement ma braguette, pulvérisant mon crâne, mon cœur et le reste de mon corps en mille particules. Anéanti, je revins au ralenti auprès du Vampire en balbutiant d’une voix blanche : « J’ai… perdu… mon… père… » Il y eut un moment de vertige qui sembla durer une éternité avant qu’il ne réplique d’une voix lugubre: «T’inquiète pas mon pote, t’en trouveras bien un autre.» Sans plus attendre, je regagnai au plus vite la surface de la terre.
3
Les Ailes de l’enfer
1 235 km/h, 10 000 mètres d’altitude, l’Airbus A380 fonçait au-dessus de l’Atlantique alors que je commandais un nouveau bloody mary à l’hôtesse de l’air. J’avais par le passé interviewé l’une de ces belles femmes entre deux âges, perpétuellement en jet-lag, toujours trop maquillées, pour les besoins d’un article sur les films diffusés dans les avions (qui étaient mutilés pour respecter les sensibilités du plus grand nombre, les programmateurs évitant de proposer 747 en péril, Les Ailes de l’enfer ou Des serpents dans l’avion), et j’avais appris que l’une de leurs missions durant les vols était de clouer les passagers sur leurs fauteuils afin d’éviter tout risque d’incident, d’accident et de procès envers la compagnie aérienne. C’est pour cela que les hôtesses offraient suffisamment d’alcool aux voyageurs (mais pas trop) pour calmer leur nervosité (difficile de ne pas penser à la faucheuse en grimpant dans un avion) tandis qu’on les hypnotisait à coups de comédie romantique.
Je n’avais pas le cœur à voir un film avec Sandra Bullock. Labouré par les griffes du chagrin, je sanglotais en regardant la mer de nuages défiler à travers le hublot comme un suaire sans fin ou un rouleau de sopalin. La mort brutale de mon père avait révélé la nature intime des choses : tout était plus vif, plus violent, plus précis, d’une douleur infinie. La dernière conversation téléphonique que j’avais eue avec Didier tournait en boucle dans mon crâne. C’était en novembre, il m’avait appelé pour me proposer de passer Noël en sa compagnie. C’était le seul moment de l’année où les Villages autorisent leurs citoyens à recevoir des membres de leur famille et aux moins de cinquante-cinq ans à résider quelques jours en Floride. « Tu verras c’est le paradis ici, m’avait-il dit avec enthousiasme. On n’a pas le temps de s’ennuyer : on peut jouer au golf toute la sainte journée et il y a de super soirées rock organisées dans les clubs. On va vraiment s’éclater ! Allez viens, je te paye le billet. » La perspective de me retrouver à danser sur Sympathy for the Devil en compagnie de mon père et de retraités cramés aux UV me fit froid dans le dos et je déclinai son offre sous le prétexte d’un « papier » à rendre durant cette période. « Bon, tant pis, dit-il, visiblement déçu. N’oublie pas de m’envoyer ton article quand il sera publié (mon père était mon plus fidèle lecteur, j’en étais à la fois flatté et un peu embarrassé), on remettra ça l’année prochaine. Je t’embrasse, fiston. » Ce fut la dernière fois que j’entendis le son de sa voix et je regretterai à jamais de lui avoir menti ce jour-là. Si j’avais accepté sa proposition, peut-être serait-il en ce moment même en train d’enlacer une splendide sexagénaire sur Hotel California au lieu d’attendre ma visite, les pieds devant, dans la cellule réfrigérante d’une morgue.
Le plus dur avait été d’annoncer son décès à ma mère. Même s’ils s’étaient quittés depuis la nuit des temps (je ne les avais jamais vraiment connus ensemble, l’époque était volage et la fidélité une valeur «bourgeoise» pour les jeunes hippies), un profond attachement les unissait encore. « Mais qu’est-ce qu’il a pu bien se passeeeeeer? hurla-t-elle en éclatant en sanglots au bout du fil. Je n’aurais jamais dû le quitteeeeer… Si j’avais été là rien ne lui serait arrivéééé! Tout ça c’est ma fauuuuute!» Je raccrochai en lui disant que j’en saurais plus une fois sur place.
En regardant le parcours du long-courrier se dessiner en pointillé entre l’Europe et les Amériques sur l’écran face à moi (nous entrions à présent dans le triangle des Bermudes et j’en profitai pour commander un nouveau bloody mary), je me demandais une fois de plus ce qui avait poussé mon père à franchir le pas pour partir vivre là-bas. Après des années dans la fonction publique, la retraite avait sonné quand il m’annonça, lors d’un déjeuner dans un turc de la rue du Faubourg-Saint-Denis où il avait ses habitudes, qu’il quittait Paris pour les Villages-Unis de Floride.
« Je n’ai pas envie de finir ma vie dans cette ville pourrie, me dit-il en attaquant des keftas à coups de fourchette. La seule chose qui me retient ici, ce sont ces boulettes. Et toi bien sûr mon chéri. Mais tu es un grand garçon désormais. Tu voles depuis longtemps de tes propres ailes et tu n’as plus besoin que je te paye ta place de cinéma. »
Le souvenir du premier film qu’il m’avait emmené voir, le King Kong de Cooper et Schoedsack, surgit alors dans ma mémoire et je revis avec émotion le dieu singe combattre furieusement un T. rex pour sauver Fay Wray de ses crocs, au cœur de la mystérieuse île du Crâne. Didier aimait le cinéma et m’inocula le virus des salles obscures, attisa ma curiosité en me racontant les séquences clés de ses films préférés : le carnage final de Taxi Driver, la séance de roulette russe de Voyage au bout de l’enfer, la scène de la douche de Psychose. Il fut l’un des premiers à faire l’acquisition d’un magnétoscope, mais m’interdit de regarder Massacre à la tronçonneuse. Pour m’en faire une idée, je dus me contenter de la jaquette de la cassette vidéo (Éditions René Chateau) où un maboul en costard, portant un masque de chair, me fonçait droit dessus arme à la main, et surtout de la bande-son qui parvenait la nuit jusqu’à mon lit lorsque Didier regardait ce film banni. Entre les grincements du prélude, les rires déments d’un maniaque, les hurlements féminins incessants et le vrombissement démoniaque de la scie mécanique, j’ai ainsi imaginé Massacre à la tronçonneuse avant de le voir quelques années plus tard : le chef-d’œuvre de Tobe Hooper se révéla beaucoup moins violent que dans mon esprit, mais beaucoup plus dérangeant, me plongeant pour la première fois au cœur d’un cauchemar organique, d’une expérience physique comparable à celle d’un bad trip dans la chambre froide d’un boucher. »
Extraits
« Les documents photographiques réunis par mon père étaient accompagnés de centaines de notes manuscrites, de plans à main levée et d’articles de presse classés méthodiquement dans des chemises selon les lieux où les faits s’étaient déroulés. L’ensemble redessinait la carte de Floride aux couleurs du mal, esquissait une géographie souterraine qui obéissait aux seules lois de l’ultra-violence, composait un nouveau type de guide touristique invitant non à découvrir les splendeurs du Sunshine State mais bien à en explorer les égouts. À travers la masse d’informations réunies, je vis un point de fuite, je vis une architecture d’os et de viscères s’élever dans le ciel, je vis la dérive d’un esprit qui bascule peu à peu dans le vide, celui de quelqu’un qui perd le fil, qui se retrouve prisonnier du labyrinthe qu’il est en train d’échafauder. Et je sus à ce moment précis que, si je voulais découvrir la vérité, je devais suivre ce guide. » p. 92-93
« Surgis de nulle part, les Villageois affluaient vers une large bâtisse beige aux façades aveugles, le Hollywood Mall, comme si c’était jour de marché en France, dans une petite ville de Provence. Les voiturettes de toutes les couleurs prenaient d’assaut les places de parking et les seniors se retrouvaient sous les palmiers pour former des groupes qui papotaient. Les hommes portaient des casquettes ou des panamas, des polos ou des chemisettes colorées, des bermudas kaki et des Birkenstock, les femmes des visières, des marcels ou des T-shirts pastel sur des joggings ou des leggings, des sandalettes ou des Crocs. Tous avaient des cheveux blancs parfaitement coiffés et des lunettes de soleil. Des couples de vieux sortaient du mall en poussant des caddies remplis de fournitures, ils saluaient leurs connaissances au passage et formaient bientôt de nouveaux groupes au hasard de leurs rencontres pour commenter les bonnes affaires qu’ils venaient de réaliser, les prévisions météo ou les derniers potins des Villages. On prenait rendez-vous pour un barbecue, un concert virtuel des Beach Boys ou une partie de padel. On s’informait de la bonne santé de chacun, les sourires étincelaient, les rires fusaient et l’on s’étreignait de généreux hugs à tout bout de champ. De ce joyeux ensemble émanait le sentiment d’une communauté soudée, d’une utopie accomplie, d’un monde nouveau. Je consultai le plan du Hollywood Mall dessiné par mon père afin de me diriger sur le parking. » p. 108-109
À propos de l’auteur
 Clovis Goux © Photo Patrice Normand
Clovis Goux © Photo Patrice Normand
Clovis Goux est journaliste indépendant. Il a écrit La Disparition de Karen Carpenter (Actes Sud, 2017), et chez Stock Chère Jodie (2020) et Les Poupées (2022). (Source: Éditions Stock)
Page Facebook de l’auteur
Compte X (ex-Twitter) de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur
Tags
#extremeparadis #Clovis Goux #editionsstock #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #NetGalleyFrance #MardiConseil #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie






 Cécile Coulon © Photo Julien Bruhat
Cécile Coulon © Photo Julien Bruhat


 Vénus et Cupidon © Galleria dell’Accademia di Firenze
Vénus et Cupidon © Galleria dell’Accademia di Firenze
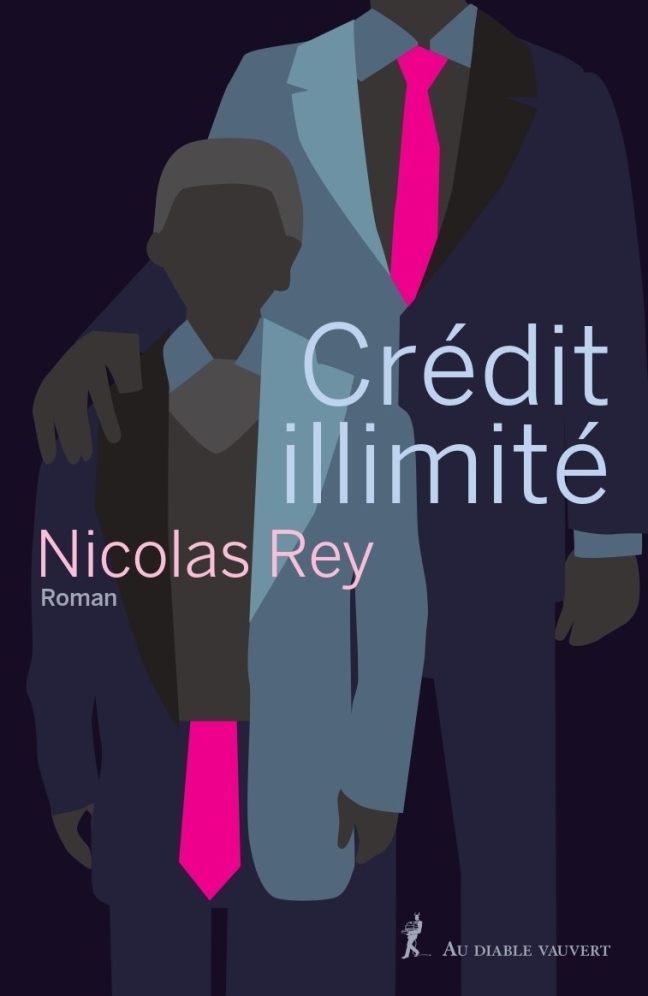


 Nicolas Rey © Photo JP Baltel
Nicolas Rey © Photo JP Baltel


 Brenda Navarro © Photo Idalia Ríos
Brenda Navarro © Photo Idalia Ríos


 Marcia Burnier © Photo DR
Marcia Burnier © Photo DR