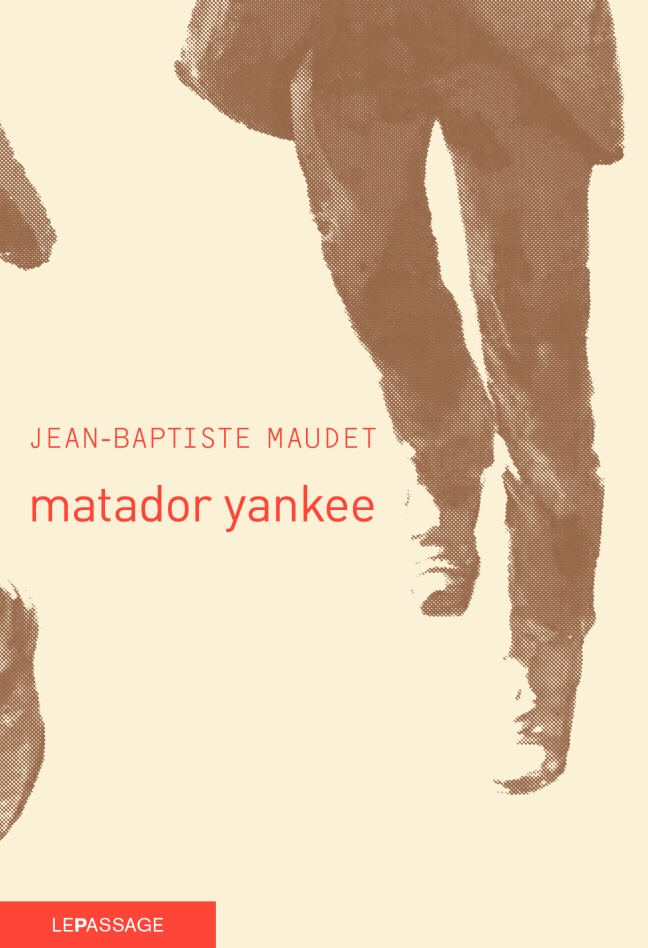En deux mots:
Lors d’un voyage en ex-URSS Edgar rencontre Ludmilla. C’est le coup de foudre qui va l’entraîner à un mariage blanc pour sortir la belle du pays. Arrivés en France, il rend sa liberté à son épouse et lui offre un vrai mariage d’opérette. Divorces et mariage vont alors se suivre, nous offrant une splendide traversée du siècle.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
Le mariage est une vie dans la vie*
En imaginant le couple formé par Edgar et Ludmilla, Jean-Christophe Rufin nous offre d’une traversée des années soixante à nos jours, doublée d’une réflexion sur la vie de couple. Une joyeuse épopée, un opéra tragi-comique, un vrai régal!
Voilà sans doute l’un des meilleurs romans de l’année! S’agissant de l’œuvre du président du jury du Prix Orange du Livre 2019 – dont j’ai la chance de faire partie pour cette édition – je vois déjà les sourires de connivence et les soupçons de favoritisme au coin des lèvres des «incorruptibles». Du coup, je me dois de mettre les choses au point d’emblée. Je n’ai fait la connaissance de Jean-Christophe Rufin que lors de notre rencontre – éphémère – en mars dernier et c’est par curiosité que j’ai lu ce roman, sans pression d’aucune sorte. J’avoue toutefois que j’aurais été peiné qu’il ne me plaise pas, tant l’homme m’a paru sympathique et bien loin des préciosités auxquelles on entend quelquefois résumer les académiciens.
Sympathique, à l’image d’Edgar, sorte de prolongement romanesque de l’auteur qui s’est essayé lui aussi aux remariages avec la même femme. Une expérience qu’il a pu mettre à profit en imaginant cette extravagante traversée du siècle et en y joignant une bonne dose de romanesque.
Je me prends même à l’imaginer suivant les préceptes oulipiens en s’imposant la contrainte des sept mariages, histoire de pimenter une histoire qui ne manque pas de sel. Le défi – parfaitement relevé – consistant alors à trouver une logique à cette succession d’épousailles et de divorces.
Comme le tout s’accompagne d’une bonne dose de dérision, voire d’autodérision, on se régale, et ce dès cet avertissement introductif: «Avant de commencer ce périple, je voudrais vous adresser une discrète mise en garde: ne prenez pas tout cela trop au sérieux. Dans le récit de moments qui ont pu être tragiques comme dans l’évocation d’une gloire et d’un luxe qui pourront paraître écrasants, il ne faut jamais oublier que Ludmilla et Edgar se sont d’abord beaucoup amusés. Si je devais tirer une conclusion de leur vie, et il est singulier de le faire avant de la raconter, je dirais que malgré les chutes et les épreuves, indépendamment des succès et de la gloire éphémère, ce fut d’abord, et peut-être seulement, un voyage enchanté dans leur siècle. Il faut voir leur existence comme une sorte de parcours mozartien, aussi peu sérieux qu’on peut l’être quand on est convaincu que la vie est une tragédie. Et qu’il faut la jouer en riant.»
Après un débat sans fin, l’idée est émise d’aller voir en URSS comment on vit de l’autre côté du rideau de fer. Paul et Nicole, Edgar et Soizic prennent un matin le volant de leur superbe Marly pour une expédition qui leur réservera bien des surprises, à commencer par cette femme nue réfugiée dans un arbre dans un village d’Ukraine et dont Edgar va tomber éperdument amoureux. Le mariage étant la seule solution pour qu’elle puisse l’accompagner en France, une première union est scellée. Mais Edgar se rend vite compte qu’en vendant des livres en porte à porte, il ne peut offrir à son épouse la belle vie dont il rêve et préfère lui rendre sa liberté. Un divorce par amour en quelque sorte.
Et une preuve supplémentaire que les crises peuvent être salutaires parce qu’elles contraignent à agir pour s’en sortir. Edgar se lance dans la vente de livres anciens et s’enrichit en suivant les vente aux enchères pour le compte de bibliophiles, Ludmilla suit des cours de chant.
Il suit sa voie, elle suit sa voix. Ils finissent par se retrouver, par se remarier. Pour de bon, du moins le croient-ils. Mais alors que Ludmilla commence une carrière qui en fera une cantatrice renommée, les ennuis s’accumulent pour Edgar, accusé de malversations et qui ne veut pas entraîner Ludmilla dans sa chute. Un second divorce devrait la préserver…
Rassurez-vous, je m’arrête là pour vous laisser le plaisir de découvrir les épisodes suivants qui vont faire d’Edgar une sorte de Bernard Tapie, qui après avoir monté une chaîne d’hôtels aux activités très rentables s’est lancé dans le BTP, a monté une équipe cycliste avant de se lancer sur le terrain du luxe et des médias et de Ludmilla une diva, notamment après avoir été consacrée à Hollywood. Dans ce tourbillon, ils vont se retrouver comme des aimants, tantôt attirés et tantôt repoussés.
Dans la position du témoin, de l’enquêteur qui entend en savoir davantage sur les raisons qui ont motivé mariages et divorces, le narrateur s’amuse et nous fait partager cette extraordinaire traversée du siècle. Jean-Christophe Rufin est indéniablement au meilleur de sa forme!
*Honoré de Balzac, Physiologie du mariage (1829).
Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
Jean-Christophe Rufin
Éditions Gallimard
Roman
384 p., 22 €
EAN 9782072743139
Paru le 28/03/2019
Où?
Le roman se déroule principalement en France, mais nous emmène tout autour de la planète, d’Ukraine aux États-Unis et d’Italie en Afrique du Sud.
Quand?
L’action se situe de 1958 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
«Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, le divorce…
Edgar et Ludmilla… Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur, un brin escroc, et d’une exilée un peu « perchée », devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était en somme : « ni avec toi, ni sans toi ». À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s’aimer.
Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu’en Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. J’ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l’après-guerre jusqu’aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux.
Parfois, je me demande même s’ils existeraient sans moi.» Jean-Christophe Rufin.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
La Croix (Stéphanie Janicot)
Libération (Frédérique Roussel)
Var-Matin (Laurence Lucchesi – entretien avec l’auteur)
Le blog de Squirelito
Blog motspourmots.fr (Nicole Grundlinger)
Blog Chez Laurette
Blog La bibliothèque de Delphine-Olympe
Jean-Christophe Rufin parles des Nouvelles lois de l’amour dans l’émission «Livres & vous» d’Adèle Van Reeth © Production France Culture
Jean-Christophe Rufin présente « Les Sept Mariages d’Edgar et Ludmilla » à La Grande Librairie de François Busnel © Production France Télévisions
Jean-Christophe Rufin invité de l’émission de Stéphane Bern À la bonne heure! sur RTL
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« PROLOGUE
Ludmilla et Edgar.
Edgar et Ludmilla.
Il m’est impossible d’imaginer ce qu’aurait été leur destin l’un sans l’autre.
J’ai eu le privilège de les connaître tous les deux, ensemble et séparés.
Ce qui a été écrit sur eux, leurs succès, les scandales auxquels ils ont été mêlés, leur réussite éclatante et leurs périodes de crise, voire de déchéance, rien ne peut être compris sans entrer dans le détail du couple qu’ils ont formé.
Cependant, de cela bien peu ont parlé et pour cause. L’essentiel de cette question est resté caché. Ils se sont livrés avec complaisance à la mise en scène de plusieurs de leurs mariages et de quelques-unes de leurs séparations, mais ils n’ont fait connaître au monde – et avec quel éclat – que ce qu’ils voulaient bien montrer. Ces représentations correspondaient à ce que le public attendait d’eux et non aux sentiments, aux émotions, aux joies et aux déchirements qu’ils ressentaient vraiment.
Voilà ce qui, plutôt, m’intéresse et que je compte vous livrer. Je suis un des seuls à les avoir longuement interrogés sur ces questions, à partir du début des années 2000 et jusqu’à leur mort. J’ai ajouté à ces souvenirs une enquête minutieuse qui m’a mené de Russie en Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. Tous ces lieux ont servi de décor à ces deux personnages, et même à trois, si l’on veut bien considérer que leur vie commune était un être particulier, fait de leurs deux personnalités en fusion.
Avant de commencer ce périple, je voudrais vous adresser une discrète mise en garde: ne prenez pas tout cela trop au sérieux. Dans le récit de moments qui ont pu être tragiques comme dans l’évocation d’une gloire et d’un luxe qui pourront paraître écrasants, il ne faut jamais oublier que Ludmilla et Edgar se sont d’abord beaucoup amusés.
Si je devais tirer une conclusion de leur vie, et il est singulier de le faire avant de la raconter, je dirais que malgré les chutes et les épreuves, indépendamment des succès et de la gloire éphémère, ce fut d’abord, et peut-être seulement, un voyage enchanté dans leur siècle. Il faut voir leur existence comme une sorte de parcours mozartien, aussi peu sérieux qu’on peut l’être quand on est convaincu que la vie est une tragédie.
Et qu’il faut la jouer en riant.
Chapitre I
Ils étaient quatre, deux filles et deux garçons, à rouler dans une Marly couleur crème et rouge pour relier Paris à Moscou. Cette voiture était en 1958 l’image même de la modernité. Elle rompait avec le vieux modèle de la « Traction » Citroën et entendait rivaliser avec les américaines. Simca, le constructeur, l’avait offerte pour cette expédition, séduit par l’idée de faire admirer sa production dernier cri aux foules soviétiques.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu une Marly? Pour les besoins de ce récit, je suis allé admirer le modèle de la collection Schlumpf, à Mulhouse. C’est une espèce de grosse baignoire de tôle, au ras du bitume, tout en longueur et en chromes, pas le véhicule idéal pour affronter de mauvaises routes. Or, en cette fin du mois d’avril, dans une Europe de l’Est à peine remise de la guerre et occupée par les Russes, les ornières creusées par les camions et les chars étaient profondes. Le gel formait de véritables rails dans la boue et la Marly avait souvent bien du mal à s’en extraire.
Qui parmi les quatre voyageurs avait pris l’initiative de cette expédition ? Paul, vingt-trois ans, le plus âgé du groupe, revendiquait volontiers la paternité du voyage. Mais il y mettait plus ou moins de force en fonction des circonstances. Lorsque tout allait mal, qu’ils étaient obligés de pousser la voiture, de marcher des heures pour trouver le carburant qui les dépannerait ou lorsque les averses détrempaient leur campement et les faisaient patauger dans des flaques glacées dès le réveil, Paul ne semblait plus trop pressé de prendre à son compte un tel calvaire. Mais dès que le soleil revenait, faisait verdir les champs, dès que des portions asphaltées permettaient de rouler à vive allure, les fenêtres ouvertes, en chantant tous les quatre, il recommençait à se vanter d’avoir conçu ce projet fou.
En vérité, c’était plutôt à Nicole, sa compagne, que revenait le mérite – ou l’imprudence – de cette aventure. Fille d’un ouvrier typographe de Rouen, elle avait été élevée dans le culte de l’URSS. Son père parlait avec tendresse de la « Patrie des Travailleurs » et il avait pleuré, cinq ans plus tôt, la mort de Staline. À Paris où elle était venue suivre des études de médecine, Nicole mettait un point d’honneur à défendre les idées de sa famille, malgré les sarcasmes des jeunes bourgeois qu’elle côtoyait. Elle était l’amie de Paul depuis un an. Otage de l’amour, ce fils de notaire parisien, étudiant en droit et destiné à succéder un jour à son père, était tout sauf un révolutionnaire. Il subissait sans protester les plaidoyers communistes de sa compagne. Il avait compris qu’elle vivait un douloureux dilemme : plus elle s’éloignait de son milieu, plus elle avait besoin d’en défendre les valeurs. Parfois cependant, en entendant son amie lui décrire les charmes de la Révolution bolchevique, il ne pouvait s’empêcher d’exprimer des doutes. Nicole protestait. La discussion devenait violente et sans issue car personne ne voulait renoncer à ses certitudes. Un beau jour, Nicole proposa de trancher ce débat: «Et si on allait voir sur place, en URSS, ce qu’il en est?»
Lancée d’abord comme un défi, l’idée d’un voyage en Union soviétique avait occupé toute l’activité de Paul et de Nicole ces derniers mois. Il leur avait fallu avant tout régler l’épineuse question des visas. Le pays était en pleine déstalinisation. Sous la direction de Khrouchtchev, il s’engageait dans une confrontation planétaire avec les États-Unis. Montrer que le socialisme pouvait apporter le bien-être aux masses, ce qui, à l’époque, voulait dire leur fournir une machine à laver, une voiture et un téléviseur, faisait partie de la stratégie de communication du nouveau pouvoir. Des journalistes occidentaux étaient invités à témoigner ; ils étaient strictement encadrés et conduits dans des villes, pour y voir ce qu’on avait décidé de leur présenter. Quel que fût leur talent, ces professionnels restaient suspects aux yeux des opinions occidentales. Faire témoigner des jeunes, leur laisser traverser le pays, pouvait constituer un extraordinaire coup de pub pour le régime communiste. À condition, bien sûr, que les jeunes en question offrent des garanties et viennent dans un esprit « constructif ». Paul et Nicole constituaient, chacun à sa manière, des profils rassurants pour les autorités soviétiques. Le général de Gaulle, en cette année 1958, revenait au pouvoir. Son scepticisme à l’égard de l’Alliance atlantique était apprécié à Moscou. Par un oncle du côté maternel qui était député gaulliste, Paul se fit recommander auprès de l’ambassadeur de l’URSS à Paris. Les références impeccablement communistes de la famille de Nicole lui permirent par ailleurs d’actionner un réseau de camarades à même, sinon de convaincre les autorités soviétiques, du moins de les rassurer. Les visas furent finalement accordés mais les jeunes gens prirent l’engagement de soumettre leurs textes avant toute publication au ministère de l’Information à Moscou. Ils acceptaient aussi d’être accompagnés dans leur parcours en territoire soviétique par un commissaire politique, pudiquement dénommé « guide touristique ». Enfin, ils s’engageaient à obtenir le soutien d’un grand magazine populaire, afin de donner à leur témoignage – contractuellement positif – un large retentissement.
L’autre fille de l’expédition était une certaine Soizic. Elle avait quitté sa Bretagne natale pour suivre à la Chaussée-d’Antin une formation courte de dactylo. C’était une grande rousse plutôt futile qui n’avait jamais beaucoup aimé les études. Passionnée par la mode, le cinéma, les boîtes de nuit, elle avait vu dans cette idée de croisière automobile une occasion de s’amuser. La perspective de se faire prendre en photo à son avantage et de se trouver un jour dans les pages d’un grand magazine – Paris-Match était partenaire de l’aventure – l’excitait beaucoup. Son flirt du moment lui avait proposé ce voyage. Elle le connaissait depuis peu, mais en était tombée très amoureuse. C’était Edgar, le quatrième membre de l’expédition.
Edgar, notre Edgar. Le voici pour la première fois, lui que nous allons suivre tout au long de cette histoire. Je dois m’arrêter un peu pour le présenter.
Lorsque l’on a connu quelqu’un à plus de quatre-vingts ans, il est difficile de reconstituer ce qu’il a pu être à vingt. La tentation est grande d’affecter le jeune homme des mêmes qualités et des mêmes défauts que l’âge et les épreuves ont révélés. Ce n’est pas toujours pertinent. Cependant, d’après les témoins de l’époque, deux traits de personnalité qui caractérisaient le jeune Edgar resteront présents chez le vieil homme que j’ai côtoyé: l’énergie et la séduction.
L’énergie n’était pas chez lui synonyme d’agitation. C’était plutôt une plante à croissance lente qui était loin d’avoir pris sa pleine dimension. Au moment de ce voyage, cette énergie était encore enfermée au-dedans de lui comme une arme serrée dans un coffre. Pourtant, elle transparaissait dans la vivacité de ses gestes, dans sa bonne humeur matinale, dans son optimisme en face des obstacles, et il n’en manquerait pas au cours de ce voyage.
La séduction, il l’exerçait immédiatement sur ceux qui croisaient sa route. Elle est bien difficile à définir. Seule certitude : elle ne venait pas de qualités physiques particulières. Que dire de remarquable sur son apparence? Une petite cicatrice sur sa pommette droite – chute de vélo dans son enfance – déformait un peu son visage et attirait le regard de ses interlocuteurs. Ses mains fines et longues étaient toujours en mouvement. Ses cheveux châtains, en broussaille sur le front, étaient coupés court vers la nuque, comme le voulait la mode. Rien de bien exceptionnel, en somme. Cependant, il se dégageait de lui un charme puissant. À quoi tenait-il ? Sans doute à la manière unique qu’il avait de mettre de l’élégance dans tout. Ce n’était pas une élégance recherchée, coûteuse, plutôt un talent inné grâce auquel il tirait parti des moindres détails de son apparence pour donner une impression d’aisance et de naturel. Par exemple, il était d’une taille moyenne mais, sur les photos, on jurerait qu’il est très grand. Cette illusion était due à sa minceur, à sa silhouette construite autour de lignes verticales mais aussi, et peut-être surtout, à une manière de se tenir droit, de regarder loin, qui suggérait l’idée de hauteur, d’élévation. Son visage était longiligne, étroit et osseux pour un garçon de son âge. Cette sécheresse de traits ne rendait que plus séduisante l’expression juvénile de ses yeux noisette aux paupières grandes ouvertes et de sa bouche encore charnue, avide, mobile, qui mettra longtemps à s’amincir. Quand il m’a été donné de le connaître, Edgar avait perdu sa lippe depuis belle lurette et ses orbites s’étaient creusées sous d’épais sourcils gris. Pourtant, il conservait l’expression qu’on retrouve sur son visage de vingt ans : ironique, pleine de gaieté, espiègle et intelligente.
L’autre garçon de l’expédition, Paul, n’était certainement pas triste et il était mieux charpenté qu’Edgar. On aurait même pu dire qu’il était beau. En réalité, à part ses cheveux noirs bouclés, rien de remarquable ne se dégage de lui sur les photos de l’époque. Quand il est à côté d’Edgar, toute la lumière semble aller vers celui-ci. Je me méfie de ma fascination mais j’ai fait le test auprès de plusieurs personnes, hommes ou femmes, et tous sont saisis par la même impression : dès qu’Edgar figure sur une image, il la dévore.
Cette puissance de séduction était pour lui comme une déesse protectrice. Il était arrivé à Paris sans le sou à dix-huit ans. Il quittait Chaumont où il avait vécu jusque-là avec sa mère qui travaillait dur sur les marchés. Il ne connaissait personne dans la capitale et voyait fondre à toute vitesse son petit pécule…
Or voilà que trois jours seulement après son arrivée, Edgar aperçoit dans la rue un automobiliste dans un élégant costume bleu clair qui regarde sa Mercedes en se grattant la tête : une de ses roues venait de crever. Aussitôt, il se propose pour la changer. L’homme accepte bien volontiers. Il est amusé par ce gamin débrouillard et souriant qui lui évite de salir un complet tout neuf. Plutôt que de lui jeter trois sous, il a l’idée de l’engager comme garçon de courses dans son étude de notaire. Le précédent venait justement de partir au service militaire. »
Extrait
« – Le premier, un mariage blanc. Ou tout comme: l’URSS, pas de visa, pas de papiers…
– Bref, éluda Edgar.
¬– Le deuxième, un mariage d’opérette. La Rolls rose, le frac et, derrière, l’escroquerie et presque la prison.
Elle jeta un petit coup d’œil dans la direction d’Edgar. Leurs yeux riaient mais il baissa le nez.
– Le troisième, un mariage de convenances.
Ingrid avait redressé la tête d’un coup. Mieux valait ne pas en dire plus, sauf à la rendre indirectement responsable de ce troisième mariage, ce qu’elle contestait avec vigueur. Ludmilla glissa sur cet épisode et passa vite au suivant.
– Le quatrième, un mariage pour les médias, Paris-Match, Point de vue, strass et paillettes.
Ingrid se détendit.
– Le cinquième, conclut lugubrement Edgar, un mariage d’exil. »
À propos de l’auteur
Écrivain, médecin et diplomate, Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française. Engagé dans l’humanitaire à Médecins sans frontières, il a mené de nombreuses missions en Afrique, en Amérique Latine, dans les Balkans en Europe, avant de devenir président d’Action contre la faim dont il est resté président l’honneur. Il est notamment l’auteur de Les Causes perdues, prix Interallié 1999, Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, Globalia en 2006, Le Collier rouge en 2016. Auteur également de plusieurs essais, il a publié Check-point en 2015. (Source: France Culture)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
Tags:
#lesseptmariagesdedgaretludmilla #jeanchristopherufin #editionsgallimard #hcdahlem #roman #unLivreunePage. #livre #lecture #books #littérature #lire #livresaddict #lectrices #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #rentreelitteraire #rentree2019 #RL2019 #RentreeLitteraire2019 #LitteratureFrancaise #lundiLecture

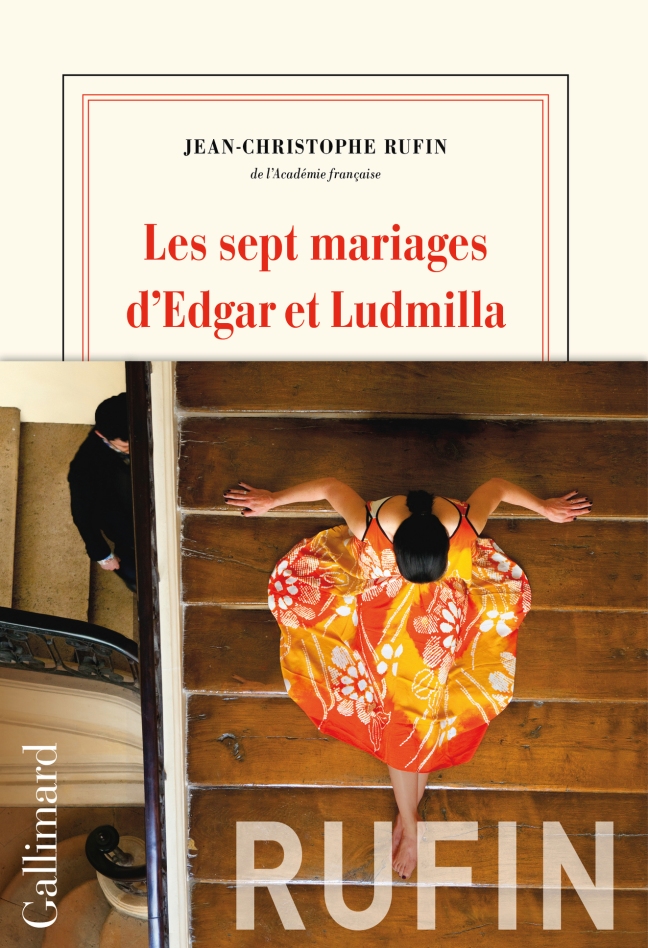




















 Carte du Doggerland réalisée par William E. McNulty et Jerome N. Cookson © National Geographic Magazine
Carte du Doggerland réalisée par William E. McNulty et Jerome N. Cookson © National Geographic Magazine