En deux mots
Arrêtée par la police, la narratrice est incarcérée à la Manouba, la prison pour femmes de Tunis. C’est pour elle le début d’un calvaire, les conditions de détention étant très difficiles. Mais c’est aussi la découverte d’un monde où l’humanité et la dignité parviennent à se faire une place dans cette cellule surpeuplée.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Derrière les murs de la Manouba
Pauline Hillier a fait partie des Femen. C’est lors d’une action de protestation en 2013 qu’elle a été arrêtée et incarcérée dans la prison de femmes de Tunis, la Manouba. Une expérience qu’elle relate dans ce roman bouleversant.
Quand on se retrouve isolée du monde, dans une cellule surpeuplée et proche de l’insalubrité, alors la moindre petite attention est bonne à prendre. Pour la narratrice, brutalement jetée dans cet univers carcéral, la possibilité de conserver un livre est une bénédiction. Cet exemplaire des Contemplations de Victor Hugo va très vite devenir un viatique lui permettant de ne pas sombrer. Mieux, c’est dans les marges et dans les espaces encore vierges qu’elle pourra prendre des notes, raconter son vécu et rassembler la matière de ce qui deviendra Les Contemplées en hommage à l’auteur des Misérables.
Si ce n’est qu’en toute fin de volume que Pauline Hillier expliquera ce qui l’a conduite dans cette cellule en 2013, on sent bien qu’elle n’a rien oublié de son séjour, des premières minutes à celles de sa libération. Il faut dire que cette expérience ne peut que marquer fortement ceux qui la subissent. La violence y est omniprésente, d’abord assénée par ceux qui sont censés faire respecter la loi, les gardiens et le personnel administratif jusqu’à la directrice qui n’a pas trouvée meilleur moyen pour se hisser au rang de ses collègues masculins que d’être encore plus sévère et plus tyrannique qu’eux. Elle fait de sa «machine carcérale» un concentré d’inhumanité et encourage les gardiennes à la sévérité, pour ne pas dire la brutalité. On comprend alors la détresse de la Française jetée dans une cellule qui répond à ses propres règles, avec des détenues plus ou moins dangereuses et dont elle ne comprend pas la langue. Les policiers l’avaient du reste prévenue, c’est bien l’enfer qui l’attend.
Mais la peur n’est pas la meilleure conseillère. Pour pouvoir tenir, elle se rend bien compte qu’elle doit faire profil bas et essayer de se fondre dans la masse, voire à se trouver des alliées.
Mais c’est presque par hasard qu’elle va trouver le moyen de gagner sa place et même de jouir d’un statut particulier. En prenant la main d’une codétenue et en lui expliquant ses lignes de vie, elle va s’improviser chiromancienne. Ce faisant, elle fait rentrer de l’humanité – voire de la sensualité – dans ce monde où le libre-arbitre et la force font loi. Prendre la main d’une prisonnière n’est alors plus un geste anodin, mais le début d’une histoire. De confidence en confidence, on va voir se déployer les histoires individuelles, découvrir Hafida, Samira, Fazia, Boutheina et les autres. Alors, il n’est plus question de crimes et délits, mais de solidarité et de sororité. Alors on soutient une femme enceinte, on compatit à la tragique histoire de cette femme violée que son père tout comme la police préfère ne pas croire et qui va finir incarcérée, accusée du meurtre de son agresseur. Ou encore de cette autre détenue, coupable de ne pas avoir été en mesure de donner un héritier mâle à son mari. Miroir inversé d’une société qui a érigé le patriarcat en système absolu que le dévoiement de la religion accentue encore, La Manouba devient alors le creuset d’un combat souterrain, d’une humanité qui défie la violence. Alors un carré de chocolat, un bout de savon, un pas de danse, quelques secondes passées sous la douche ou encore quelques pas en plein air deviennent les symboles de la résilience, du refus de l’obscurantisme.
Si le récit de Pauline Hillier est aussi bouleversant, c’est parce qu’il donne à cette tranche d’autobiographie une valeur universelle. En entrant avec elle dans cette prison et en partageant son quotidien, c’est bien contre l’injustice et l’absolu d’un pouvoir dévoyé que l’on s’élève. Avec la force d’un Midnight express féminin, l’ex-militante Femen trouve dans l’écriture le moyen de poursuivre un combat qui, s’il est loin d’être gagné, fera bouger les lignes ou, au moins soutenir ces femmes détenues qui retrouvent ici un visage. Car, comme l’écrivait justement Victor Hugo dans les Contemplations…
Rêveurs, tristes, joyeux, amers, sinistres, doux,
Sombre peuple, les mots vont et viennent en nous ;
Les mots sont les passants mystérieux de l’âme.
Les Contemplées
Pauline Hillier
Éditions La Manufacture de livres
Roman
204 p., 18,90 euros
EAN 9782358879415
Paru le 8/02/2023
Où?
Le roman est situé principalement dans une prison de Tunis. On y évoque aussi Paris.
Quand?
L’action se déroule en 2013.
Ce qu’en dit l’éditeur
À l’issue d’une manifestation à Tunis, une jeune française est arrêtée et conduite à La Manouba, la prison pour femmes. Entre ces murs, c’est un nouvel ordre du monde qu’elle découvre, des règles qui lui sont dictées dans une langue qu’elle ne comprend pas. Au sein du Pavillon D, cellule qu’elle partage avec vingt-huit codétenues, elle n’a pu garder avec elle qu’un livre, Les Contemplations de Victor Hugo. Des poèmes pour se rattacher à quelque chose, une fenêtre pour s’enfuir. Mais bientôt, dans les marges de ce livre, la jeune femme commence à écrire une autre histoire. Celle des tueuses, des voleuses, des victimes d’erreurs judiciaires qui partagent son quotidien, lui offrent leurs regards, leurs sourires et lui apprennent à rester digne quoi qu’il arrive.
Vibrant d’humanité, Les Contemplées, roman autobiographique enflammé, nous livre l’incroyable portrait d’un groupe de femmes unies face à l’injustice des hommes.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Le JDD (Karine Lajon)
France Culture (Le cours de l’histoire)
Blog Ju lit les mots
Blog Vagabondage autour de soi
Blog de Christophe Gelé
Blog de Philippe Poisson
Blog Médiapart (Hedy Belhassine)
Pauline Hillier présente son roman Les Contemplées à La Grande Librairie © Production France Télévisions
Les premières pages du livre
« Il est vingt heures, le soleil se couche sur Tunis. Dans la voiture, un flic me met en garde : là où je vais ça ne va pas être facile, il va falloir rester sur mes gardes et me méfier de tout le monde. Je ne sais pas où l’on me conduit, personne ne m’a expliqué. Des gens ont parlé en arabe autour de moi toute la journée, des officiers de police ont passé des coups de fil, d’autres m’ont observée gravement pendant de longues minutes avant de pousser de grands soupirs, une avocate a fait un passage éclair, toute en sueur, l’air affolé, une pile de dossiers sous le bras et des lunettes de soleil sur la tête, m’assurant qu’elle ferait tout son possible pour me sortir de là, mais personne ne m’a exposé le programme. Ça a eu l’air de leur sembler évident. Pourtant, plus les heures passent et plus rien pour moi ne l’est. Mon cerveau colle en vrac des images sur les mots que le flic prononce : « Il y a des tueuses. Il faut faire attention. Il ne faut pas leur faire confiance. Elles te dépouilleront, elles te frapperont, ou même pire. Il y a des folles là-bas. » Je serre les dents. Je sais qu’il veut me faire peur. Il guette ma réaction dans le rétroviseur mais j’évite soigneusement son regard. Je ne veux pas lui donner satisfaction. Je joue la fille qui en a vu d’autres, moi qui en ai vu si peu pourtant. Je scrute le paysage par la fenêtre en essayant de recueillir un maximum d’informations. Les rues défilent dans la pénombre. Des automobilistes, des motards et des piétons sont emportés par leurs trajets quotidiens, l’air concentré ou absent. Quelques arbres sans feuilles et recouverts de poussière tremblent au passage des camions. Un chien errant lève la patte contre un tronc puis repart en trottinant. Devant une épicerie une bande de pigeons a pris d’assaut un sac de semoule éventré, un homme sort les bras en l’air pour les chasser. Nous poursuivons notre course. Les passants se font plus rares. Je guette les panneaux pour tenter de localiser l’endroit où nous allons, mais la plupart sont en arabe. Les rues se ressemblent et la ville devient vite un labyrinthe dans lequel le chauffeur semble tourner volontairement en rond pour me perdre. Comme si je n’étais pas déjà assez paumée.
Voilà des heures qu’on me trimballe d’un endroit à l’autre. Mes poignets menottés passent de mains en mains, les mains me traînent de lieu en lieu. On me crie des choses en arabe sans prendre la peine de les traduire. On tire sur ma laisse comme sur celle d’un animal apeuré. La pénombre est partout à présent, elle enveloppe les silhouettes, se répand dans les rues, entre dans la voiture, m’écrase contre le siège en cuir, pénètre ma gorge et mes oreilles, me gagne tout entière. Après des kilomètres de façades, la voiture de police ralentit enfin, passe sous un imposant fronton et s’engouffre dans un couloir sombre. « Bienvenue à la Geôle », me lâche le conducteur dans un rire moqueur. Un frisson me saisit tandis que la voiture s’enfonce dans la gueule béante du monstre. Les portes se referment sur moi en un boucan sinistre, grilles qui s’entrechoquent, gonds rouillés qui grincent, lourdes chaînes qu’on attache. Cette fois ça y est, le système carcéral vient de m’engloutir. Il n’a fait qu’une bouchée de moi. Je déglutis en même temps que lui, une énorme boule dans ma gorge.
Le flic gare la voiture mais je n’ai plus franchement envie d’en sortir. Il descend, ouvre ma portière et m’attrape par le coude. La suite du trajet se fait à pied. Toujours menottée, je suis escortée par deux officiers le long d’un chemin en terre battue. J’en profite pour repérer un peu les lieux. Un imposant mur d’enceinte surplombé de fils barbelés nous coupe du monde. Au bout du chemin, la silhouette lugubre d’un bâtiment en béton se détache. Sur la droite, une cour grillagée enferme plusieurs dizaines d’hommes, jeunes pour la plupart, pieds nus dans la poussière. Ils s’agglutinent le long du grillage pour lorgner la curiosité qui débarque, cherchent mon regard sans toutefois oser m’interpeller. Des gardiens les surveillent de loin d’un œil menaçant, matraque à la ceinture. De l’autre côté sur ma gauche, un groupe patiente en file indienne devant un homme accroupi qui leur distribue de la nourriture. Une louche de bouillie rouge jetée dans un cul de bouteille en plastique, et au suivant. Mon estomac se noue à l’idée de prendre ici mon prochain repas. Mais je n’ai pas le temps d’y penser davantage car les policiers me poussent dans le dos pour que j’accélère le pas. Nous parvenons jusqu’à l’entrée du bâtiment, grimpons les trois marches en ciment du perron puis pénétrons à l’intérieur. Un halo verdâtre enveloppe la pièce. Verts les murs, vert le sol, verts les meubles, verts les gens, vert l’air qu’on respire. Je deviens verte moi aussi, sitôt entrée, saisie à la gorge par une puissante odeur d’égouts et de corps sales. Un épais comptoir de bois traverse le hall principal. Massif, on le croirait taillé d’un seul bloc, tout comme l’homme au guichet avec lequel mon escorte entame la discussion. Ce père fouettard doit bien faire dans les cent kilos. Derrière lui les longues étagères en bois sont vides, si ce n’est l’épaisse couche de poussière ocre qui recouvre les planches. Le seul objet que je remarque est un énorme registre. On me place dos au mur et on m’ordonne de ne pas bouger. Le temps passe. Des gardiens, en pantalon noir et chemise beige, matraques, menottes et clés à la ceinture, déambulent d’un couloir à l’autre. Ils sont gras, suants et effrayants. La seule femme de la bande ne détonne pas, bien que sa démarche boiteuse et son regard bigleux lui donnent un côté cartoon assez comique. Elle s’approche de moi, caresse une mèche de mes cheveux, et m’assène un gros sourire dégueulasse encore plus glaçant qu’un mauvais regard, avant que des détenus l’interpellent du fond du couloir. Elle repart en claudiquant comme une oie, les pieds en dedans et le pas saccadé. Je me penche discrètement pour essayer de voir les cellules, à gauche, puis à droite, sans parvenir à distinguer grand-chose hormis des enfilades de barreaux à la peinture écaillée. À intervalles réguliers des colonnes de détenus passent devant moi. Ils ont des mines patibulaires : menaçantes, hébétées ou brisées de fatigue. Ils sont sales, débraillés, pieds nus et beaucoup d’entre eux ont des cicatrices ou des plaies récentes sur le visage. Il y a des adolescents aussi. Slumdogs misérables qui passent et repassent une serpillière ou un balai à la main. Ils servent de larbins aux gardiens qui les sifflent et leur gueulent des ordres. Ils obéissent, tête penchée, comme de pauvres petits forçats. Sur le sol je remarque à plusieurs endroits des taches de sang frais. Des scénarios sordides me passent par la tête. Je me concentre pour ne pas paniquer et pour parer à toutes les éventualités. Au milieu de ma gueule déconfite deux pupilles s’allument, noires et brillantes. Mes poings se serrent, mes muscles se tendent, pour la première fois de ma vie je me prépare à me battre. Mes mains sont prêtes à taper n’importe où, n’importe comment, à s’agiter dans les airs, à se balancer de gauche à droite, comme elles le pourront. J’ai la sensation assez nouvelle de devoir défendre ma peau. Je ne sais pas du tout comment m’y prendre mais je taperai dans le tas s’il le faut. Pourtant pour l’heure il n’y a guère que mes pensées angoissées et quelques mouches opiniâtres qui m’assaillent. Est-ce que je perds déjà la boule ? Prisonnière depuis quelques heures et déjà en roue libre. La vraie bagarre a en fait lieu à l’intérieur de mon crâne, la peur et la raison se livrent un terrible round. Au loin j’entends des voix de femmes qui appellent. De temps en temps un gardien répond à leurs demandes, ici de l’eau, là du feu. Je suis terrorisée à l’idée de me retrouver en cellule avec elles. Je les imagine aussi effrayantes que leurs alter ego masculins. Je ne veux pas passer la nuit avec elles. Je préférerais encore être mise à l’isolement. Je veux parler à un avocat, à l’ambassade, à quelqu’un qui pourrait répondre à mes questions, m’expliquer ce qui m’arrive. Je suis tombée au fond d’un puits mais aucune mission sauvetage ne semble se mettre en branle pour me tirer de là.
Même les deux flics qui m’ont accompagnée me faussent compagnie. La paperasse remplie ils prennent congé du tenancier sans même me jeter un regard. Ils redescendent l’allée centrale, remontent dans leur voiture, repassent sous le fronton, roulent dans les rues de la ville, arrivent au commissariat, garent leur voiture, montent les escaliers, dévissent leur casquette, se recoiffent avec leurs mains, retirent leur uniforme, remettent au clou leurs menottes, allument une cigarette et rentrent à la maison. Je voudrais qu’ils m’emmènent. À la maison. Je voudrais être sur le canapé lovée entre leurs femmes et eux pendant que le repas mijote. À la maison. Je voudrais enfiler leur pyjama et me coucher dans leur lit douillet. À la maison. Je voudrais être n’importe où mais pas ici. Je ne veux pas rester. Je me sens comme une enfant abandonnée un premier jour d’école. Une école de film d’horreur. Le bureau du maître en face de moi est énorme, son cahier d’appel démesuré, et moi toute petite, de plus en plus petite, et déjà mise au coin. Mais au pied du mur il n’y a pas de trou de souris par lequel m’enfuir. L’ogresse boiteuse revient vers moi. Elle attrape mes poignets sans ménagement et les libère de leurs menottes. Puis ses doigts de géante se referment autour de mon biceps et elle me tire vers elle. Ça y est, elle m’emporte dans son antre pour me dévorer. Je panique, les battements de mon cœur s’accélèrent, mon ventre se tord, je suis à deux doigts de crier à l’aide. Mais finalement rien ne se passe, à peine quelques mètres plus loin elle dégaine son trousseau de clefs, ouvre une grille et me pousse à l’intérieur. Je découvre mon auberge pour la nuit. Elle est déjà pleine à craquer. Ici je ne sais pas si c’est bon signe. Dès que je pénètre dans la pièce les mises en garde menaçantes du flic remontent à la surface : « Des tueuses. Des folles. Te dépouilleront. Te frapperont. Ou même pire. » C’est quoi pire ? Elles ne peuvent quand même pas me tuer ? Elles n’ont pas le droit. Et de qui dois-je me méfier au juste ? Des gardiennes ? Des détenues ? Des jeunes ? Des vieilles ? De celles qui sourient ou de celles qui restent dans leur coin ? De celles qui ont l’air sûres d’elles ou des discrètes ? Je les dévisage une à une pour tenter de repérer les tueuses, les psychopathes, les violeuses, les mangeuses de bébés. Mille horreurs me passent par la tête. Des images confuses sur la prison me reviennent en mémoire. J’essaye de me souvenir, ça pourrait servir. Je me remémore ce film, l’histoire d’une Américaine emprisonnée à tort pour trafic de drogues. Est-ce qu’on la frappait et la dépouillait ? Est-ce qu’on la violait ? Est-ce que de vieilles détenues la tripotaient sous la douche ? Je ne me souviens plus. Je suis épuisée. Je voudrais dormir mais que m’arrivera-t-il si je ferme les yeux ? Alors je reste à l’affût, le doigt sur la détente. Quelque chose s’est enclenché à l’intérieur de moi. Couteau aux dents, je suis prête à l’affrontement. À l’intérieur de mon crâne un petit coach s’agite. Il fait les cent pas et essaye de se montrer rassurant : « Ça va aller ma grande, tu sais te battre. S’il faut te défendre tu le feras, tu en es capable. Ne montre pas que tu as peur. Elles ne sont pas plus fortes que toi. Tu sais comment frapper. Aux endroits stratégiques, tu te souviens ? Mais si ! On avait fait un cours de self-défense. Tu vas te souvenir, fais un effort ça va revenir. Le nez, oui c’est bien ! Par en dessous voilà. Et le menton ? Par au-dessus bravo ! Des coups nets et précis pour leur montrer que tu sais y faire. Tiens-toi prête. Elles vont voir à qui elles ont affaire. Tu n’as pas peur d’elles, tu n’as peur de rien ! » Je m’accroupis en vitesse contre le premier mur que je trouve histoire de me faire oublier. Le petit coach dans ma tête continue son speech « C’est un genre de Koh-Lanta tu vois. Sans plage ni cocotiers d’accord, mais l’objectif est le même : boire, manger, faire les bonnes alliances, gagner des épreuves de survie et des jeux de conforts, vivre quoi. Tout va se jouer très vite, il faut mettre en place ta stratégie ». Je suis tellement absorbée dans ces pensées survivalistes que je ne prête pas attention à l’autre petit coach, le raisonnable, celui qui pense que le flic a sûrement dit ça pour me faire peur, celui qui passe sa main fraîche sur mon front brûlant pour me calmer et qui chuchote à mon oreille « ne tombe pas dans la parano, respire profondément, essaye de dormir un peu ». Je l’entends mais je ne l’écoute plus depuis longtemps. Les pensionnaires ont pourtant l’air plus misérable que dangereux. Leurs visages sont fermés mais elles n’ont pas de balafres sur les joues. Leurs vêtements sont sales et froissés, leurs cheveux emmêlés, et toutes semblent exténuées. La boiteuse bigleuse me jette une bouteille d’eau, une couverture et un tapis de sol puis referme la grille. La pièce doit faire dans les vingt mètres carrés. C’est une boîte vide et nue, refermée par un mur de barreaux. Où que je sois dans la pièce je peux voir et être vue par le gardien au comptoir ce qui me rassure beaucoup. Je suppose qu’il me protégera en cas d’attaque. Ou plutôt j’espère, que la violence ne viendra pas de lui, d’eux tous qui rôdent dans les couloirs et me reluquent à chacun de leur passage, l’œil lubrique et affamé.
Nous sommes une bonne trentaine dans la cellule, des vieilles, des jeunes et même un bébé d’à peine un an qui titube en chaussettes sur les tapis. La puanteur y est insoutenable. Un mélange de pisse, de merde, de sueur et de crasse. Dans ce pot-pourri je ne parviens même plus à identifier la nature et l’origine des effluves. Je ne saurais dire si l’odeur de pisse qui me pique le nez vient des toilettes à ma gauche, de la paillasse sous moi, des jupes de la petite vieille qui tremblote à ma droite, ou du pyjama souillé du bébé. Pauvre petit gosse. Est-ce qu’il se souviendra de sa détention juvénile ? Est-ce que ces visages désolés imprégneront sa mémoire ? Est-ce qu’il sait qu’il est enfermé ? Est-ce qu’il comprend que tout ça n’est pas normal ? Combien sont-elles dans cette pièce qui, comme lui, n’ont rien à faire là ?
J’ai pu voir lors de mon passage au commissariat comme on jetait sans façon les prévenues en prison. Je n’avais pourtant rien d’une criminelle. Mais pourquoi se fatiguer ? En attendant de savoir, allez hop tout le monde au cachot. Même les vieilles, même les adolescentes, même les mères, même les petits gosses en pyjama. Alors on les souille les pyjamas. Dans cette saleté ambiante à quoi bon se retenir ? D’ailleurs je me souillerais bien moi aussi. Qu’est-ce que ça changerait ? Je refuse d’aller aux toilettes, des latrines sommaires dans un coin de la pièce, à peine dissimulées par un muret à mi-hauteur et sans autre système d’évacuation qu’un broc en plastique. J’ai peur de ce que j’y verrais, peur des cafards, peur des merdes, peur des cafards sur les merdes. Mais leur odeur est partout sur moi, sur ma peau, sur mes cheveux, dans mes vêtements et dans ma bouche. Je ferme ma veste jusqu’en haut et coince mes mains dans mes manches, je rentre à l’intérieur de moi-même comme un escargot dans sa coquille puis je me roule en boule sur mon tapis et remonte mon coude sous ma joue. La nuit est tombée, il fait frais à présent. Une vieille sanglote en secouant la tête et en déclamant des vers misérables. Est-ce qu’elle prie ? Est-ce qu’elle se lamente sur ce qui lui est arrivé ? Je voudrais la consoler. Non, ça n’est pas vrai, je voudrais qu’elle arrête de pleurer, je voudrais qu’elle se taise, je voudrais qu’elles la ferment toutes, je voudrais le silence, je voudrais qu’elles dorment, je voudrais être la seule éveillée dans la pièce, je voudrais la vision rassurante d’une masse ronflante et inoffensive. Je me méfie surtout des plus jeunes et ne les quitte pas des yeux. Elles ont formé un petit cercle et font tourner des cigarettes, en en allumant toujours une avant que l’autre ne s’éteigne, de sorte que le feu ne se perde jamais. Elles ne m’ont adressé la parole que pour m’en demander. Elles se moquent pas mal du reste, de qui je suis, de comment je vais. Elles seraient curieuses à la rigueur de savoir ce qui m’a conduite dans ce trou, mais elles sont trop fourbues de froid et de tristesse pour trouver, en français, les mots pour m’interroger. J’observe leurs mains aux ongles sales attraper la cigarette, la porter à leur bouche et la passer à leur voisine. Quels tours de passe-passe ces mains ont-elles joué ? Quels sont leurs talents cachés ? Savent-elles voler, frapper ou tuer ? Savent-elles crocheter les serrures? Faire disparaître des cadavres ? Qui sont ces femmes dont je partage la chambre et la peine ? »
Extraits
« En tailleur sur mon lit, je me lance pour commencer un petit inventaire des objets en ma possession. Des pantoufles, une chemise à fleurs, un pantalon XXL, deux culottes, un soutien-gorge déchiré sans baleines, une brosse à dents, une assiette, un stylo et un livre de voyage. J’étale tous mes biens devant moi, comme après une séance de shopping. Ça n’est pas Byzance, mais c’est mon trésor. Je comprends toutefois que quelques objets fondamentaux vont vite me faire défaut, comme des couverts, du papier toilette, du savon ou du dentifrice. J’ai pu observer ce matin que mes codétenues étaient bien équipées, brosses à cheveux, gel douche, shampoing, serviettes de toilettes, vêtements propres, c’est qu’il doit bien y avoir des solutions pour se procurer du matériel. » p. 40
« Toutes voulaient que je vienne m’asseoir près d’elles sur un seau, au pied d’une couchette ou en haut d’un lit superposé, pour une séance particulière, souvent généreusement rémunérée en cigarettes, morceaux de chocolat ou poignées de «glibettes», des graines de tournesol blanches et délicieusement salées, que les détenues achètent par sachets avec leurs coupons de cantine et grignotent à n’importe quelle heure de la journée. À tous les étages, les rideaux se tiraient pour assister au spectacle. La moindre de mes déclarations provoquait des cris, des rires, des interpellations bruyantes à travers la pièce ou des youyous. Si la Cabrane n’avait pas mis un terme aux festivités, je crois qu’elles auraient duré toute la nuit. » p. 53
« La Cabrane ne m’a plus adressé la parole depuis notre partie de dominos pourtant dans les jours qui suivent je vois mon quotidien s’améliorer comme par magie. Dès le lendemain matin, je comprends que le vent a tourné. » p. 85
« Je suis autorisée à aller pour la première fois à la promenade, un véritable événement dans un quotidien d’enfermement. La cour carrelée de cinquante mètres carrés n’est pas franchement propice à la randonnée mais j’en profite pour faire quelques longueurs entre les lignes de linge qui sèche. J’ai vraiment besoin de me dégourdir les jambes. Après des jours de confinement dans des pièces exiguës, allongée sur ma couchette la plupart du temps, les effets de l’immobilisme commencent à se faire sentir. Mes muscles sont ankylosés comme après un long voyage en train. La récréation ne dure qu’une dizaine de minutes mais chacune d’entre elles est savourée jusqu’à la dernière seconde. Rassérénée d’avoir pu prendre un peu l’air, revoir le ciel et sentir le vent sur ma peau, je supporte mieux le reste de la journée. Je l’occupe comme je peux, entre tâches quotidiennes, lecture et bavardages. Les filles me racontent leurs vies, me montrent des photos de leurs enfants, m’informent sur l’avancement de leur procès. Elles poursuivent mon éducation aussi, sur les mœurs de la prison, ses codes, son vocabulaire, ses lignes rouges et ses zones grises. Elles me racontent les couleurs de leurs campagnes, les odeurs de leurs jardins, le goût de leur cuisine, me vantent les beautés de leurs régions, des tapis de Kairouan aux poteries de Nabeul. Elles m’imprègnent de leur culture, me parlent leur langue et me l’apprennent. En immersion dans cet univers je fais rapidement des progrès et parviens de mieux en mieux à communiquer. Je glisse d’un bout à l’autre de la cellule, me faufile entre les lits, et deviens peu à peu louve parmi les louves, membre adoptée du pack. » p. 88
« À présent, mes vingt-sept codétenues ne me rendent plus visite qu’en des apparitions fugaces de fantômes. Certains jours je crois apercevoir la silhouette cambrée de Souad qui traverse la rue, le visage radieux d’Hafida derrière une poussette, le sourire éclatant de Fuite en terrasse d’un café, ou les mains tannées de Boutheina dans le métro, égrenant un chapelet. Dès que je les touche elles disparaissent, comme des bulles de savon. La nuit, les fantômes envahissent mes rêves. Je ferme les yeux et je suis de retour à la Manouba, mais mes camarades m’en veulent et refusent de m’adresser la parole. D’autres fois elles prennent les traits de nourrissons hurlant dans des petits berceaux de fer alignés dans une cave, ou de membres de ma famille (ma mère et ma sœur la plupart du temps) tambourinant contre une porte dont je n’ai pas la clé. Cependant, abstraction faite de ces visions éphémères dont je ne parle à personne, je me targue de m’être réconciliée avec cette période marquante de mon passé, et de l’avoir, comme on dit, « digérée »». p. 168
« J’ai écrit ce livre, pour que tout ne disparaisse pas à jamais sous la poussière. Le temps de quelques pages j’ai voulu faire exister celles qui avaient été injustement oubliées. Ce roman d’adieu est pour elles. Aux femmes de la Manouba. À toutes les prisonnières. Aux rejetées. Aux rebues. Aux innocentes. Aux coupables. À mes sœurs du Pavillon D, pour qui je n’ai pas eu le temps d’apprendre à dire au revoir. Besslama. » p. 180
À propos de l’auteur
 Pauline Hillier © Photo Vincent Loison
Pauline Hillier © Photo Vincent Loison
Pauline Hillier est née en Vendée et écrit depuis l’adolescence. Après des études de gestion culturelle à Bordeaux et une expatriation à Barcelone, elle écrit son premier roman, À vivre couché, paru en 2014 aux éditions Onlit. Membre du mouvement international FEMEN de 2012 à 2018, elle participe à de nombreuses actions, en France comme à l’étranger. En 2013 elle est arrêtée à Tunis suite à une manifestation pour la libération d’une militante tunisienne. Son roman Les Contemplées lui a été inspiré par son séjour en prison. (Source: La manufacture de livres)
Page Facebook de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur
Tags
#lescontemplees #PaulineHillier #lamanufacturedelivres #hcdahlem #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #prison #Tunisie #coupdecoeur #premierroman #roman #primoroman #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairieManifestation, Tunis, prison, incarcération, détention, femme, cellule, solidarité, sororité, codétenue, livre, lectures, Victor Hugo, poésie, tueuse, voleuse, victime, erreur judiciaire, dignité, libération, humanité, autobiographie, injustice, patriarcat, machisme, procès, tribunal, Tunisie,

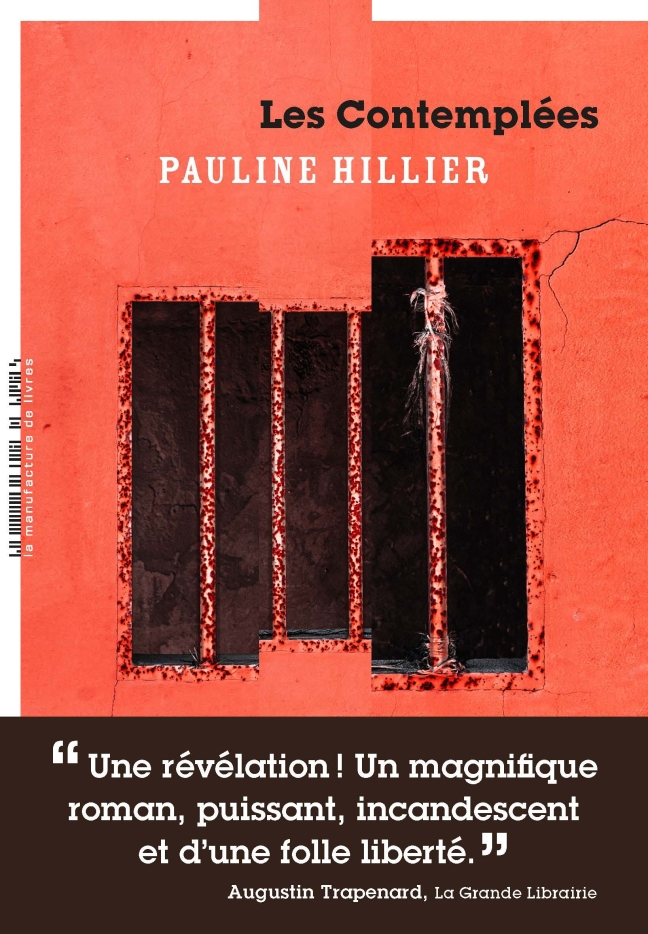










 Laurie Cohen © Photo DR
Laurie Cohen © Photo DR

 Arnaud Friedmann © Photo JC Polien
Arnaud Friedmann © Photo JC Polien








