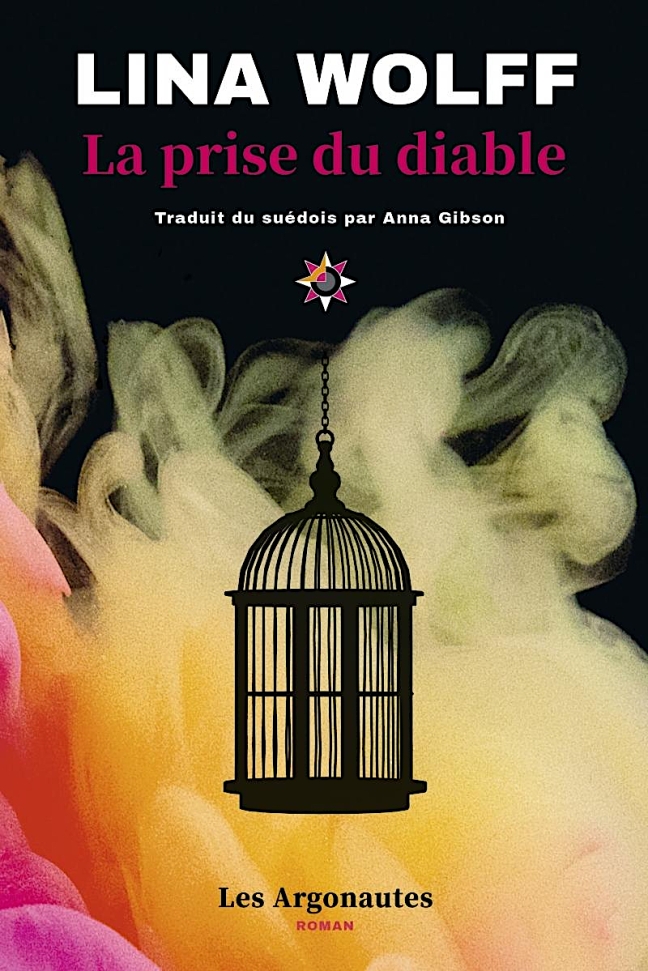
En deux mots
Florence respire l’amour. La jeune scandinave qui s’installe en Toscane avec son amant ne s’imagine pas que son idylle va tourner au cauchemar, à la relation toxique. Alors Minnie essaie de fuir Mickey.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
«L’amour, ce pauvre mot, si galvaudé, si maltraité»
Lina Wolff, en retraçant l’histoire d’une relation toxique entre une Suédoise et son amant florentin, réussit un roman puissant sur l’emprise. Construit comme une mécanique implacable, il est aussi troublant que révoltant, fascinant que dérangeant.
Lorsqu’elle arrive à Florence, la jeune femme scandinave voit partout des amants. La grande ville toscane respire l’amour. Aussi n’a-t-elle pris qu’un billet aller pour rejoindre l’homme qu’elle aime. Il a beau être laid, au point où les gens qui les croisent se demandent ce qu’ils font ensemble, leur relation s’installe dans la durée. Elle change sa garde-robe, le rase, l’entraîne au club de sport. Désormais, il a dû sex-appeal et commence à attirer les femmes. Et à mentir. La vidéo qu’il lui présente en train de soulever de la fonte ne peut qu’avoir été tournés par une femme. Son intuition le la trompe pas, il n’y a qu’à regarder la façon dont il jette son regard sur la personne qui le filme.
«Tout s’accélère maintenant. Ça commence par des inflexions ou des insinuations qui dégénèrent en disputes, qui dégénèrent à leur tour en querelles spectaculaires. À quelques reprises, les voisins cognent au mur en criant Ho, vous allez vous calmer, oui?, Ce n’est pas possible, pense-t-elle. Ceci n’est pas la réalité. Je ne suis pas quelqu’un dont le comportement pousse les voisins à cogner aux murs. Je suis une personne réfléchie, calme, qui se maîtrise. Mais quand elle s’entend hurler, elle comprend qu’elle se trompe. Son image d’elle-même est déformée, pas besoin d’être anorexique pour se voir autrement qu’on n’est.»
Alors la jalousie s’installe. Et va tourner à la paranoïa. Minnie, comme la surnomme cet homme qui la veut aussi silencieuse et discrète que la souris, va bien tenter d’oublier son Mickey, d’abord en se jetant dans d’autres bras puis en prenant la fuite jusqu’à la Nouvelle-Orléans, mais là-bas aussi les choses ne se passent pas comme prévu et la Louisiane d’après Katrina devient un enfer.
Ce qu’il y a de fascinant dans ce roman, c’est sa mécanique. Comme une montre mécanique de haute précision, Lina Wolff insère un rouage après l’autre. Entraîné par le précédent, il forme un ensemble inextricable dont il impossible de sortir. La chronologie des faits semble inéluctable, l’issue programmée. Jamais peut-être n’a-t-on mieux décrit l’emprise, cette dépendance dans laquelle on s’enfonce comme dans un marais puant.
La prise du diable est tellement forte qu’il est impossible de fuir. À moins d’entrer à son tour dans la danse, de se rapprocher du démon et de son manège plutôt que fuir. C’est à la fois palpitant et révoltant, comme si la domination masculine était inscrite dans la relation. L’ironie, voire la poésie, venant en contrepoint de la violence, de l’horreur des situations.
Comme dans ses précédents romans parus chez Gallimard – Les Amants polyglottes (2018) et Bret Easton Ellis et les autres chiens (2019) – Lina Wolff explore la force magnétique du désir face à la rationalité des faits. Quand on voit le piège se refermer, mais qu’on se laisse quand même prendre.
Décidément, il n’y a vraiment pas d’amour heureux.
La prise du diable
Lina Wolff
Éditions Les Argonautes
Roman
Traduit du suédois par Anna Gibson
272 p., 22,90 €
EAN 9782494289307
Paru le 5/01/2024
Où?
Le roman est situé principalement en Italie, à Florence. On y voyage aussi jusqu’en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Une jeune femme scandinave s’installe à Florence où tout lui semble étranger et écrasant: les toits de tuiles, les tours des églises, l’homme qu’elle a rencontré. Elle se dit qu’elle vient d’une région trop froide, et qu’il pourrait être celui qui réchauffera la terre gelée en elle. La Prise du diable est l’histoire de cette femme, de son corps et de son esprit. Du pouvoir qu’elle a sur l’homme qu’elle tente de changer, et du pouvoir de plus en plus fort qu’il exerce sur elle.
Dans un récit haletant et dérangeant, Lina Wolff nous entraîne au cœur des mécanismes de l’emprise, et sonde la folie misogyne déguisée en normalité de notre société contemporaine.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Blog L’élégance des livres
Les premières pages du livre
« En arrivant à Florence, la première chose qu’elle remarque et qui la stupéfie, ce sont les couples. Ils sont partout, sous les arcades voûtées du centre-ville, et un entrelacs de solives noires court au-dessus de leur tête. Tout est brûlant et grandiose, aux antipodes de ce qu’elle avait imaginé autrefois, quand son train avait marqué un long arrêt en gare de Florence. De larges flocons de neige tombaient doucement sur ce qui lui était apparu alors comme une ville frêle, froide, endormie. Or à présent, donc : des amants partout dans la chaleur. On les entend par les fenêtres ouvertes et même à travers les murs de l’appartement. Des cris de femmes suivis un peu plus tard de murmures et de rires.
– Est-ce que tout le monde baise comme ça tout le temps ?
– Oui. Tu trouves ça bizarre ?
– Non, dit-elle. Pas du tout.
Elle pense qu’elle est pour sa part issue d’un coin particulièrement aride, qu’elle a beaucoup à apprendre, et que cet homme est peut-être celui qui l’aidera à pénétrer cette réalité nouvelle. Les tuiles couleur ocre se déploient devant eux depuis le toit-terrasse de l’appartement. Vue d’en haut, Florence est la ville du deuxième chakra, celui du bas-ventre, dont la couleur est l’orange. L’ocre orangé est l’une des couleurs dominantes de cette ville. Tout coïncide, se dit-elle. Ça y est, tout coïncide, enfin.
La sueur se dépose sur leur peau telle une pellicule permanente. Elle aime l’odeur de sa sueur. Elle aime tout chez cet homme, bien qu’il soit si terriblement laid. Ses cheveux sont longs, noirs, mal peignés, et il les ramène sans cesse vers ses tempes et ses joues comme s’il voulait se cacher. Mais un tel visage n’est pas dissimulable et elle approche ses mains pour repousser la tignasse de l’homme jusque derrière ses oreilles. Il dit qu’il a honte. Elle dit qu’il a tort : son visage donne une dimension supplémentaire à sa virilité. De plus, il contraste délicieusement avec la grâce féminine de la ville. Il esquisse un sourire incrédule, presque timide. Les gens qu’ils croisent dans la rue le dévisagent, avant de tourner leur regard vers elle, puis de nouveau vers lui. Il dit que c’est la première fois que ça lui arrive.
– Ils nous regardent ainsi parce qu’ils ne comprennent pas comment quelqu’un comme toi peut être avec quelqu’un comme moi, dit-il.
Mais certaines femmes le comprennent. Elles le comprennent même très bien. Et manifestent leur intérêt de la manière propre à certaines femmes latines. Un jour au parc, alors qu’ils sont assis sur un banc, une femme s’approche pour boire à la fontaine voisine. Se plaçant juste à côté de lui, elle se penche de telle façon que son cul se retrouve à moins de cinquante centimètres de son visage. Il sourit avec satisfaction.
– C’est parce que je suis avec toi, chuchote-t-il. D’habitude, elles ne me voient même pas.
Naturellement, elle envisage la possibilité qu’il soit déjà en train de lui mentir. Mais elle ne s’y attarde pas. Il est là, après tout, à côté d’elle, détendu, les bras écartés et posés sur le dossier du banc, avec l’odeur de sa sueur qui monte de ses aisselles. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Il est inoffensif ; il rebute toutes les femmes sauf elle. Il n’est rien de plus qu’un petit gros inoffensif. Plus tard, elle songera (amèrement) que les petits gros inoffensifs, ça n’existe pas.
Rapidement, les femmes se prennent à le remarquer de plus en plus. Cela le ravit, elle le voit bien, et au début elle ne peut s’empêcher d’en sourire. Cette transformation, après tout, c’est à elle qu’il la doit. C’est elle qui est aux manettes. Elle qui ramasse tous ses t-shirts gris délavés et les jette. Elle qui fait en sorte qu’il s’achète des chemises en lin de couleur claire, un déodorant, un nouveau jean.
– Un jean, explique-t-elle, peut créer un corps ou le ravager, au choix.
Par exemple, on ne peut pas porter un jean délavé avec des chaussures noires, étroites et brillantes, dont le talon claque contre les pavés à chaque pas.
– À moins de vouloir passer pour un vendeur de guidages pour poids lourds, ajoute-t-elle.
– Mais c’est à peu près ce que je suis, non ?
Elle rit, gênée.
– Oui, c’est vrai. Mais ça ne devrait pas t’empêcher de garder tes belles chaussures noires pour les enterrements et porter plutôt des baskets au quotidien.
Il absorbe et apprend. Il la suit dans le centre commercial et achète docilement tout ce qui, d’après elle, pourra lui aller. Lorsqu’elle lui suggère de se raser entièrement la tête, ou de ne laisser qu’un millimètre de tapis noir, comme Shane dans la série The Walking Dead, il va voir sur Internet et acquiesce.
– Mais mon visage alors ? s’inquiète-t-il l’instant d’après. Les gens vont avoir peur !
– Je crois que tu auras l’air différent. Comme si tu ne cherchais pas à dissimuler quelque chose. Comme si tu étais fier de ton côté effrayant.
Il obéit. Tôt le matin, avant que la chaleur ne dépose une membrane poisseuse sur la ville, elle court avec lui dans les parcs. Peu à peu, le gras du bide s’estompe. Elle l’emmène à la salle de sport ; pendant qu’elle fait des abdos sur le tapis, il exerce ses biceps devant le miroir.
– J’ai l’air d’un cazzone, constate-t-il. Une bite géante occupée à faire des tractions. C’est parce que je n’ai plus de cheveux.
Elle rit. Elle adore l’entendre parler ainsi, prononcer des gros mots en transpirant, elle l’écoute telle une affamée. Là d’où elle vient, il y a si peu de place pour l’auto-ironie.
La transformation continue. Salade tous les soirs, fruits au petit déjeuner et, en guise de garniture, des tonnes de sexe pour que la virilité s’exhale par chacun de ses pores lorsqu’il quitte l’appartement. Elle se tient à la fenêtre. Satisfaite (mais naïve), elle contemple son œuvre, son miracle, faire sa sortie dans le monde.
Les aspects pratiques doivent être définis et réglés le plus tôt possible, pour qu’ils sachent tous deux à quoi s’en tenir.
– Bien sûr, dit-il. Vas-y.
Tout d’abord : quand elle a acheté son billet de train, elle a pris un aller simple, oui, il a bien entendu. Pas de billet de retour. Après tout, elle n’avait aucune idée de ce qui allait se passer une fois sur place. Mais son boulot alors ? Elle doit bien avoir un boulot, là-bas, chez elle ? Non, elle a donné sa démission. Elle n’avait plus la force de continuer. Elle haïssait cet emploi, il la dévorait, une petite bouchée d’elle était engloutie chaque jour, et à la fin elle en a eu marre.
– Tu as démissionné ?
– C’est ça.
Un matin elle s’est décidée. Elle est allée voir le chef, lui a expliqué qu’elle en avait assez de la vie de bureau, de la moquette couleur chair et des encadrements de fenêtres marron, et qu’elle avait en conséquence décidé de quitter son travail.
Il s’inquiète.
– Mais de quoi vas-tu vivre ?
– De toi, dit-elle.
L’espace d’un instant il a l’air exactement aussi effaré qu’elle l’espérait.
– Quoi ?
– Pourquoi, tu n’as pas assez d’argent ? Moi qui te prenais pour le genre d’homme sur lequel on pouvait compter.
La terreur semble s’être agrippée à ses traits.
– Oui, bien sûr, mais…
Elle rit et ajoute qu’il n’a pas de raison de flipper. Elle a de quoi vivre.
– Combien ?
– Assez pour ne pas devoir te faire payer pour le sexe.
Il toussote nerveusement. Elle dit que c’était une blague. Que c’est plutôt lui qui pourra se reposer sur elle le cas échéant. Il dit qu’il n’a jamais fait cela. Jamais profité d’une femme, jamais abandonné un poste, jamais eu de l’argent « comme ça » sur son compte en banque. Elle hausse les épaules. On est tous différents. Il dit qu’il vient d’une famille d’agriculteurs. Chez lui, dès lors qu’on choisissait de quitter la terre, il n’était pas question de démissionner d’un boulot sans en avoir auparavant décroché un autre. Elle hausse à nouveau les épaules. Comme je le disais, on est tous différents. Si elle reste longtemps à Florence, il faudra qu’elle s’active à un moment donné, qu’elle suive une formation et prenne un job, peut-être dans l’industrie, peut-être traduire des modes d’emploi. De plus, elle a toujours voulu apprendre l’interprétation simultanée et, à Florence, il existe deux écoles. OK, dit-il. C’est possible. Elle peut habiter chez lui quelque temps, comme ça elle n’aura pas à payer de loyer. Si elle a envie de rester un moment en Italie, chez lui, c’est OK. Elle pourra faire à dîner le soir. Comme ça ils seront quittes.
Elle fait le tour de l’appartement sous les toits, qui lui apparaît comme un royaume céleste. Deux salles de bains avec une douche dans chacune d’elles. Les toits de tuile, la coupole de Santa Maria del Fiore dominant tout le reste. Quelqu’un fredonne en bas dans la cour. Les jardinières du voisin débordent de fleurs. Le frigo contient du vin blanc bien froid. Les couronnes des pins se détachent sur le fond du ciel et, au crépuscule, une odeur acidulée de sève brûlée entre par la fenêtre de la chambre à coucher.
Les premiers temps, elle éprouve un contentement intense qui ne la quitte pratiquement pas. Dieu a créé la femme, et elle est pour sa part en train de créer l’homme. Peut-être est-ce pour cette raison que ça va déraper dans les grandes largeurs. Car le récit où elle croit vivre n’a au fond jamais existé. La femme ne crée pas l’homme. Aucune légende ou représentation historique n’en témoigne. Cependant, il apparaît bien vite que cette transformation qu’il lui doit lui ouvre sans cesse de nouvelles portes. Au dîner, il parle joyeusement des femmes qui lui ont signifié leur approbation pendant la journée. L’une est venue chercher son café à la machine qui se trouve pile devant son bureau, et pendant tout le temps que le café coulait, elle a gardé son fantastique cul tourné vers lui, comment donc est-il censé travailler dans ces conditions ? Il rit, non sans timidité, car il est encore suffisamment rondouillard pour ça. Elle sent qu’il veut qu’elle rie avec lui. Elle ne le fait pas. Il poursuit son histoire. Il aimerait tellement qu’elle puisse se réjouir, elle aussi, de la tournure favorable inespérée qu’est en train de prendre son existence. Il lui montre une vidéo de lui en train de faire des pompes sur les poings, beaucoup de pompes d’affilée, avec un grand sourire.
– Qui a pris cette vidéo ? demande-t-elle.
– Giorgio.
– Je ne te crois pas.
– Mais si, c’est Giorgio.
– C’est une femme qui te filme.
– Comment le sais-tu ?
– Ça se voit à ton expression, tu essaies de l’impressionner, tu ne sourirais pas ainsi à un homme.
Il la dévisage un instant. Puis :
– Tu es paranoïaque. Moi qui te croyais au-dessus des autres, comme une rose au bout d’une tige de chardon. Mais tu piques, en fait.
– Pourquoi ne pas te contenter d’avouer ? D’ailleurs, les roses aussi ont des épines. Dis-moi qui a tourné cette vidéo.
La vérité finit par sortir. Un nom de femme. Elle se met à crier.
– Comment veux-tu que je me sente en sécurité quand tu pars au travail ?
Elle lit dans son regard de la surprise, mais aussi la réponse à sa question. Cette réponse est très simple. Il ne s’agit pas d’elle et de sa sécurité. Il s’agit de son plaisir à lui et des hauteurs qu’il va pouvoir atteindre désormais.
Au quotidien, malgré la peine qu’il commence déjà à lui causer, il est d’un commerce agréable. Il se douche deux fois par jour et dépose ses chemises neuves chez le teinturier, si bien qu’elles sont toujours impeccablement repassées. Il porte un parfum de qualité ainsi qu’une lotion unisexe de marque espagnole dont il s’enduit le crâne. Intérieurement, elle le surnomme « Le Propre-sur-Lui ». Elle l’examine et découvre avec étonnement qu’il ne lui inspire presque aucune irritation. Elle l’observe, et il l’observe en retour. Il lui fait remarquer qu’elle est incroyablement silencieuse. Comme une petite souris, dit-il, ajoutant qu’il a toujours souhaité avoir une femme discrète comme une petite souris. Une Minnie Mouse qui ne fait pas d’histoires.
– Une Minnie Mouse ?
– Oui. Tiens, cela te va bien. Ça te dérange si je t’appelle Minnie ?
Elle hausse les épaules.
– Si je suis Minnie, alors il va de soi que tu es Mickey.
Il se regarde dans le miroir.
– Peut-être pourrais-tu me trouver un autre nom ?
– Par exemple ?
– Il toro ? Il toro divino ?
Ils rient. Elle enchaîne.
– Mickey c’est très bien. Qu’est-ce que tu veux dire quand tu dis que je ne « fais pas d’histoires » ?
Ah oui, réplique-t-il. C’est ça qui est formidable chez elle : elle parle toujours à voix basse et, quand elle s’active dans l’appartement, on ne l’entend pas. Même quand elle ouvre et referme les portes, les armoires, les placards, etc., elle le fait en silence.
C’est parce qu’elle a horreur du bruit, dit-elle. Et que les gens bruyants l’effraient.
– Tu es une princesse fragile.
– Pas du tout. Je sais me servir d’une perceuse et faire marche arrière avec une remorque, alors ne dis pas ça. Pour moi c’est une insulte.
– Mais, Minnie, ça ne me dérange pas si tu veux être un peu fragile avec moi. Les femmes fortes nous rendent faibles, nous les hommes. Si nous n’avons pas la possibilité d’être forts, que veux-tu que nous fassions de toute cette virilité qui nous encombre ?
Elle réfléchit.
– D’accord. Je veux bien être un peu faible. Maintenant que tu le dis, je sens que ça fait longtemps que j’en ai envie.
– Tu es parfaite, dit-il. Parfaite pour moi.
Elle est contente. Elle perçoit dans ses paroles un compliment de bon augure. Ce qu’elle ne saisit pas sur le moment, c’est que le compliment contient aussi une mise en garde. Elle doit continuer à être parfaite pour lui. Ne pas profiter de la première occasion venue pour saboter cette perfection qu’il croit percevoir chez elle. Sur le moment, elle se demande plutôt comment elle va réussir à masquer ses innombrables défauts afin de continuer à être parfaite à ses yeux. En réalité bien sûr, elle sait comme lui que sa perfection est une chimère. Ses défauts sont si nombreux que, si elle voulait en dresser la liste, elle ne saurait pas par où commencer. L’aspect physique, à vrai dire, elle n’a même pas la force d’y songer. Dès qu’elle prend du poids, par exemple, son apparence devient molle et blanchâtre, le gras se dépose autour de sa taille, elle devient grassouillette de partout, comme un cylindre, ou un genre de chamallow. Si elle reste trop longtemps au soleil, ses traits se dissolvent, des taches de couperose se répandent sur son nez et sur ses joues. Et ses cheveux ont toujours été raides et épais, plus proches du crin de cheval que du cheveu humain. Pour ne mentionner que quelques détails. Un autre défaut est la phobie sociale qui la submerge parfois. Cette peur des autres est mal vue dans son pays natal, mais bien plus encore dans un pays latin tel que celui-ci, où la vie sociale constitue l’arène même de l’existence. Où l’on doit oser faire sa place, parler d’une voix forte, occuper la scène, laisser la pièce de théâtre se déployer autour de soi sans lâcher son propre rôle, qui est un rôle central par définition. Le Propre-sur-Lui ne serait pas content s’il découvrait toute l’ampleur de la faculté qu’elle a de se dérober au monde et de se réfugier au fond d’elle-même. Dans son pays, il lui arrive de ne pas quitter son appartement pendant des jours parce qu’elle n’en a tout simplement pas le courage, et si elle le fait quand même, elle choisit les horaires où personne ne sera dehors. Pourquoi ? Elle n’en sait rien. Une autre de ses petites particularités, c’est que depuis ses études de traductrice et ses jobs occasionnels d’interprète, il lui arrive dans les situations de stress de ressasser son ressenti de façon compulsive, dans toutes les langues qu’elle connaît. Si elle n’y arrive pas, si un mot lui fait défaut, alors elle reste bloquée, incapable de passer à autre chose. Dans ce cas, elle se fige littéralement, car si elle continue ce qu’elle faisait, alors qu’elle n’a pas trouvé le mot qu’elle cherchait dans telle ou telle langue, une malédiction risque de se déclencher. Qui en a décidé ? Elle l’ignore, mais sait qu’il en est ainsi, et, parfois, il lui suffit de penser à quelque chose d’une certaine manière pour donner naissance à une sorte de réalité miniature, qui menace aussitôt d’enfler, de se répandre partout et de prendre possession de l’autre réalité, celle, à l’extérieur, qu’elle est en train de vivre. Voilà encore un défaut qu’il n’apprécierait pas : le fait qu’elle croie à certaines choses qui ne s’expliquent pas rationnellement. Ce n’est pas qu’elle y pense en permanence. »
Extrait
« Tout s’accélère maintenant. Ça commence par des inflexions ou des insinuations qui dégénèrent en disputes, qui dégénèrent à leur tour en querelles spectaculaires. À quelques reprises, les voisins cognent au mur en criant Ho, vous allez vous calmer, oui?, Ce n’est pas possible, pense-t-elle. Ceci n’est pas la réalité. Je ne suis pas quelqu’un dont le comportement pousse les voisins à cogner aux murs. Je suis une personne réfléchie, calme, qui se maîtrise. Mais quand elle s’entend hurler, elle comprend qu’elle se trompe. Son image d’elle-même est déformée, pas besoin d’être anorexique pour se voir autrement qu’on n’est. » p. 45
À propos de l’autrice
 Lina Wolff © Photo Gustav Bergmann
Lina Wolff © Photo Gustav Bergmann
Née à Lund en 1973, Lina Wolff est considérée comme l’une des voix les plus fascinantes de la littérature scandinave d’aujourd’hui. Son premier roman, Bret Easton Ellis et les autres chiens (Gallimard, 2019), rencontre instantanément le succès. Avec son deuxième ouvrage, Les Amants polyglottes (Gallimard, 2018), elle remporte en 2016 le prix August, le plus prestigieux des prix littéraires suédois. Elle est également la traductrice suédoise de Gabriel García Márquez, Roberto Bolaño et Karina Sainz Borgo. (Source: Éditions Les Argonautes)
Page Wikipédia de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#laprisedudiable #LinaWolff #editionslesargonautes #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteratureetrangere #litteraturecontemporaine #littératurescandinave #littératuresuedoise #littératurenordique #romanseuropéens #MardiConseil #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie






 Mélanie Richoz © Photo DR
Mélanie Richoz © Photo DR


 Karina Sainz Borgo © Photo DR
Karina Sainz Borgo © Photo DR


 Nathalie Yot © Photo Marc Ginot
Nathalie Yot © Photo Marc Ginot




 Tanguy Viel © Photo Nadine Michau
Tanguy Viel © Photo Nadine Michau













