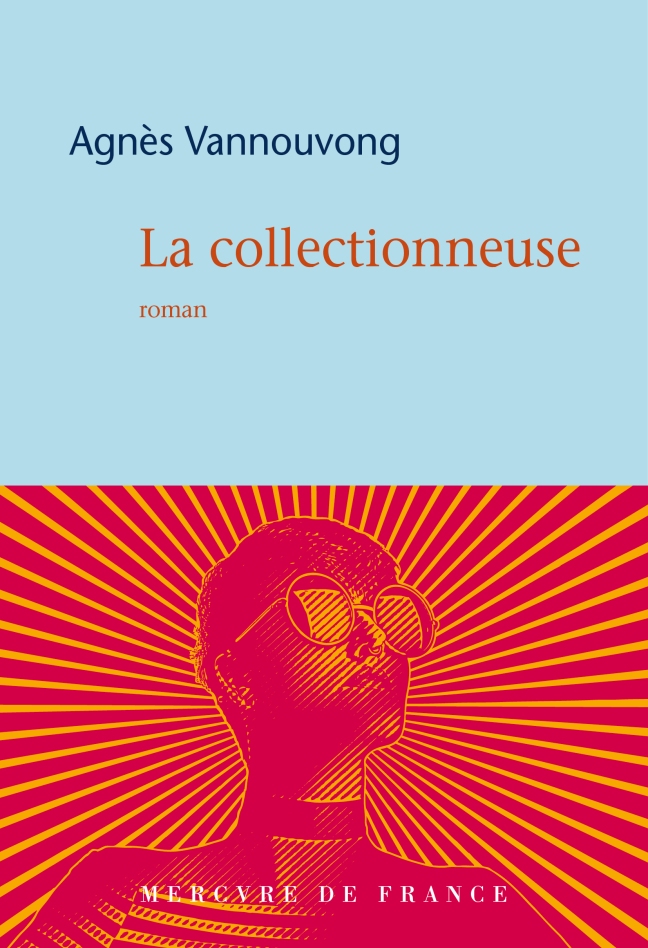En deux mots:
David écrit des biographies de musicien dans un appartement avec «Une vue exceptionnelle» sur Paris qu’il partage avec Émile, neurochirurgien. Le couple que l’on imagine sans histoire va être rattrapé par son passé lorsque le fils que David voulait adopter vient consulter Émile.
Ma note:
★★★ (bien aimé)
Ma chronique:
Ma vie et celle qui m’attendait
Avec une plume toujours aussi délicate, Jean Mattern nous offre un court et intense roman intimiste qui explore la vie de David et d’Émile, un couple –presque – sans histoires.
Jean Mattern, responsable du domaine étranger chez Grasset, poursuit parallèlement sa carrière de romancier. Une vue exceptionnelle, son cinquième roman, fait suite à Septembre et Le Bleu du Lac – qui vient de paraître en poche dans la collection Points – qui ont permis aux lecteurs d’être séduits par un style aussi classique que délicat, sobre et sensuel dans des registres pourtant bien différents. Cette fois, il s’agit d’explorer la relation d’un couple homosexuel né au hasard d’une rencontre.
Voilà près de vingt-cinq ans que David partage la vie d’Émile, qu’ils vivent une vie à priori sans histoires dans le bel appartement situé sur le front de Seine avec «vue exceptionnelle», notamment sur l’île aux cygnes où ils se sont rencontrés. À l’époque David apprécie ce havre de calme et de verdure, célèbre pour la réplique de la Statue de la Liberté qui y a été érigée. Il ignore que l’endroit est un rendez-vous prisé de la communauté gay. Émile pour sa part vient régulièrement y chercher un partenaire, histoire d’agrémenter une vie entièrement consacrée à sa carrière professionnelle. Il est alors interne et entend se spécialiser en neurochirurgie. S’ils n’imaginent pas alors faire leur vie ensemble, ils ne tardent cependant pas à se retrouver, à s’apprécier jusqu’au jour où David propose à Émile d’emménager chez lui.
Si ce roman se lit avec autant de plaisir, c’est qu’il est construit comme un tableau impressionniste. Les petites touches successivement ajoutées pour former l’image finale sont les différentes voix qui viennent enrichir le scénario initial et donner profondeur et densité à cette relation de couple à priori bien ordinaire. David puis Émile nous donnent leur version, suivis puis Clarice qui fait son jogging sur l’île aux cygnes et croise régulièrement David. Trois histoires personnelles qui vont s’entrecroiser et s’enrichir avec d’autres protagonistes. On y découvrira que David, expatrié à Londres, était prêt à s’engager avec sa compagne de l’époque et à adopter son fils lorsque cette dernière s’est rapprochée du père de l’enfant, l’abandonnant à son rêve de paternité. C’est alors qu’il avait décidé de s’installer à Paris. Du côté d’Émile, on va découvrir qu’il aurait dû hériter d’une librairie à Bar-sur-Aube en Champagne, mais avait préféré quitter la province pour pouvoir vivre plus sereinement une sexualité «différente».
Habilement, Jean Mattern fait ressurgir ce passé au fil de circonstances qui vont mettre Émile et David au pied du mur, comme ce jour où le neurochirurgien retrouve en consultation un homme en lequel il reconnaît celui qui aurait pu devenir le fils adoptif de son compagnon. Bien entendu, il est tenu au secret professionnel. Mais peut-il simplement faire fi de cette rencontre? Des tourments intérieurs qui vont entraîner autant de questions sur les petits secrets et les grands hasards, sur l’essence d’une vie et sur les curieuses routes que nous empruntons tous, souvent plus inconsciemment que consciemment.
Une vue exceptionnelle
Jean Mattern
Sabine Wespieser Éditeur
Roman
136 p., 16 €
EAN 9782848053295
Paru le 29/08/2019
Où?
Le roman se déroule en France, principalement à Paris. On y évoque aussi Londres.
Quand?
L’action se situe de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
David déserte Londres quand la femme dont il s’apprêtait à adopter le petit garçon le quitte. À Paris, il s’installe dans un appartement avec une grande baie vitrée sur la Seine. Lorsqu’un homme l’aborde sur un banc de l’île aux Cygnes, en contrebas de chez lui, il accepte sans arrière-pensée de lui montrer sa vue exceptionnelle.
Vingt-cinq ans plus tard, David et Émile habitent ensemble le lieu de leur rencontre. Émile, jeune interne à l’époque, est à présent un neurochirurgien réputé. David, tout à ses biographies de musiciens oubliés et à sa vie harmonieuse avec Émile, est parfaitement heureux. Mais la courte période où il a failli devenir père se rappelle à lui comme un rêve obsédant… et le vertige le saisit. Émile le sait, dont les certitudes et la froideur clinique vacillent le jour où, sur son carnet de rendez-vous, il voit inscrit le nom du fils perdu de son compagnon.
Subtil interprète de la complexité des émotions, Jean Mattern interroge ici, avec beaucoup de délicatesse, ces vies que nous aurions pu vivre si le destin en avait décidé autrement.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Toute la culture (Julien Coquet)
Blog culture 31
Page des Libraires (Juliet Romeo, Librairie La Madeleine, Lyon)
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« ÉMILE
Une vue exceptionnelle, il commença par me dire que son appartement possédait une vue vraiment exceptionnelle. Je trouvais ça incongru dans sa bouche, sur ce banc tout au bout de l’allée des Cygnes où je venais de m’asseoir à son côté. Il avait l’air perdu, mais pas de la manière dont les hommes qui fréquentent cet endroit feignent de s’y être égarés. Je lui souris, ne sachant comment poursuivre la conversation.
En avais-je même envie? Il m’intriguait, la situation était insolite. Je lui souris une nouvelle fois.
Je ne suis pas du genre à m’épancher sur le passé, à me retourner en arrière. Pourtant, depuis quelques jours, je ne cesse de penser à cette première rencontre entre David et moi. Ce n’est nullement l’heure des bilans, il n’y a aucune raison pour cela. Mais, la semaine dernière, j’ai opéré mon jumeau: un homme né le même jour que moi. À quelques heures près, quelques minutes
peut-être, nous avons le même âge. C’était la première fois de toute ma carrière que cela m’arrivait. Quand je lui ai expliqué les risques de l’opération, l’homme s’est mis à pleurer. J’ai vu des patients fondre en larmes ou éclater en sanglots des centaines de fois, et de toutes les manières. La plupart du temps, je suis mal à l’aise et ne sais pas comment réagir, car ma volonté de rassurer ne me dispense pas d’exposer clairement le fait qu’aucune opération au cerveau n’est sans risque et, quand mes explications provoquent une réaction aussi forte, il m’est difficile de préserver cet équilibre entre optimisme et réserve. Aucune tumeur ne s’enlève en un tour de main, comment peut-on imaginer autre chose? Bien entendu, j’aspire à être celui qui guérit, celui qui sauve des vies. C’est le métier que j’ai appris, le seul que j’aie toujours voulu faire. J’ai conscience de ma responsabilité, de mon rôle, et toutefois, je ne me suis jamais tout à fait habitué à ce poids. Quand le regard d’un patient me rappelle entre deux crises de larmes que je suis celui qui tient sa vie entre mes mains, cela m’est insupportable. La neurochirurgie est certes devenue une discipline high-tech, il n’empêche, ce sont encore mes dix doigts qui réussissent ou qui condamnent. Mais cet homme, mon jumeau, ne m’embarrassa pas, comme tant d’autres avant lui, qui ont bruyamment exprimé leur angoisse. Il me toucha, pleurant ainsi en silence. «Ce n’est pas pour moi que j’ai peur. Je sais qu’une mort sur la table d’opération serait sans douleur. Je pense à mes enfants si vous… si l’opération ne marche pas. C’est trop tôt pour eux, ils ne sont pas prêts. J’ai encore des choses… des choses à vivre avec eux… » Il s’arrêta net, s’excusa, se ressaisit.
Un peu plus tard, je vérifiai dans son dossier médical: trois garçons, tous les trois encore étudiants. Aucune trace de leur mère dans les numéros d’urgence qu’il avait indiqués. En cas de décès, j’aurais à prévenir l’aîné. Vingt-trois ans. Je savais qu’il me faudrait chasser cette idée de mon esprit avant d’entrer au bloc. Cela n’avait aucun sens non plus de lui accorder un statut particulier du fait de sa date de naissance. Nous avions le même âge, et alors ? Aucune comparaison n’était possible. C’était un patient comme un autre. L’opération s’est bien déroulée. L’homme est en rémission et je pourrai bientôt le rendre à ses trois garçons.
DAVID
Comme souvent, je me suis levé un peu avant toi. Ces heures du petit matin, quand la nuit n’est pas encore tout à fait vaincue, me sont précieuses, j’aime ces moments où tout semble possible, et je ne me lasserai jamais d’observer les reflets des premiers rais de lumière sur l’eau. Cette grande baie vitrée est une bénédiction, ouverte sur le ciel parisien et surtout sur la Seine juste en contrebas, c’est un peu comme si je disposais de la meilleure loge à l’opéra pour moi tout seul, le spectacle est différent à chaque fois, et bien que je prenne plaisir à prolonger le plus possible ce temps à moi dans le silence et la lumière argentée de la nuit finissante, il m’arrive souvent de retourner dans le lit où tu dors encore, je te réveille en te caressant tout en douceur, parfois je te fais l’amour sans prononcer un mot, comme pour partager ces débuts avec toi, ces premiers instants du jour qui renaît, et tu me traites bien sûr de sentimental à la table du petit déjeuner quand je te dis mon bonheur, mais ce n’est pas la seule différence entre nous, car, pendant que j’écris des biographies de musiciens ou d’artistes oubliés dont l’existence ne changera le cours des choses pour personne, tu opères, tu sauves des vies et modifies la trajectoire de tant de biographies, et pas seulement sur le papier. Cette pensée me donne parfois le vertige. »
À propos de l’auteur
Jean Mattern est né en 1965 dans une famille originaire d’Europe centrale. Il suit des études de littérature comparée en France à la Sorbonne, avant d’être responsable des droits étrangers aux éditions Actes Sud puis responsable des acquisitions de littérature étrangère aux éditions Gallimard, principalement pour les collections «Du monde entier» et «Arcades». Il est aujourd’hui éditeur responsable du domaine étranger chez Grasset. Dans chacun de ses romans, la question de la transmission occupe une place prépondérante: après Les Bains de Kiraly (Sabine Wespieser éditeur, 2008) – qui a été traduit en sept langues –, il publie, toujours chez Sabine Wespieser éditeur, De lait et de miel en 2010, puis Simon Weber en 2012, et, en mai 2018, Le Bleu du lac, très remarqué par les libraires et la critique. Aux éditions Gallimard il a publié un roman, Septembre (2015), ainsi qu’un essai, De la perte et d’autres bonheurs (2016), dans la collection «Connaissance de l’Inconscient». Son nouveau roman, Une vue exceptionnelle, est paru pour la rentrée littéraire 2019. (Source: Sabine Wespieser éditeur)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
Tags:
#unevueexceptionnelle #JeanMattern #sabinewespieserediteur #hcdahlem #roman #unLivreunePage. #livre #lecture #books #littérature #lire #livresaddict #lectrices #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #rentreelitteraire #rentree2019 #RL2019 #RentréeLittéraire2019 #LitteratureFrancaise #lundiLecture