Prix Medicis étranger 2023
Sacré Meilleur roman lusophone par le magazine Transfuge
En deux mots
Désormais recluse à l’Hôtel Paradis, résidence pour personnes âgées, Dona Alberti enregistre ses mémoires sur un petit magnétophone. Mêlant ses souvenirs, ses lectures et son quotidien, elle raconte avec beaucoup de sensibilité sa vie qui s’en va.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Dona Alberti n’en a pas fini avec la vie
Couronnée par le Prix Medicis étranger, Lidia Jorge raconte dans Misericordia la vie de Dona Alberti, pensionnaire d’une résidence pour personnes âgées. Avec humour, émotion et sensibilité.
Quand la nuit vient l’envelopper, Dona Alberti joue avec elle. Aux questions qu’elle pose, combien y a-t-il de villes au monde? Quelles sont toutes les capitales? De quel pays Bakou est-elle la capitale, il le faut trouver une réponse. Une belle manière d’aiguiser sa mémoire, de se rappeler ce Grand Atlas qu’elle feuilletait quand elle était encore dans sa maison.
Car désormais Dona Alberti vit à l’Hôtel Paradis, une résidence pour personnes âgées. D’avril 2019 à avril 2020, elle a enregistré son quotidien et ses souvenirs sur un magnétophone. Ce roman en est la « transcription infidèle », car les 38 heures sont résumées et livrées sans les sentiments perçus à l’audition, mais aussi structuré et divisé en chapitres, accompagné de titres. En d’autres mots, une manière habile pour Lìdia Jorge de mettre en scène son travail d’autrice.
Voici donc défiler le personnel, entre ceux qui s’impliquent et s’intéressent aux résidents, Salomé, Maria Lina, Lila, Lilimunde et ceux qui préfèrent les ignorer. Lilimunde, sans doute l’une de ses préférées, parce que sa venue s’accompagne d’un parfum de bergamote, de tilleul, de cèdre et de pivoine. Mais on verra au fil du livre combien ces effluves peuvent varier en fonction des occupations et des relations de l’aide-soignante. L’occasion aussi de souligner l’importance des odeurs et des parfums dans ce récit qui éveille à la sensualité.
Voici aussi défiler les autres résidents, avec leur passé, leurs histoires, mais aussi leur quotidien, pas toujours très rose, comme ce jour où M. Paiva avait tenté de fuir et s’était cogné à une vitre. Ou quand un autre résident ne s’est pas relevé. Le tableau dans l’entrée où s’affichent les portraits des pensionnaires devient alors une sorte de macabre décompte des décès, à mesure que les photos sont décrochées, comme une sorte d’avertissement.
Voici enfin la vie de Dona Alberti elle-même, au fil des jours et des nuits. Ces nuits qui la hantent et qu’elle combat durant ses insomnies. Ces nuits qui sont la métaphore d’un mot qui n’est jamais prononcé, la mort. Ces nuits peuplées de questions, simples ou métaphysiques, de Bakou à l’univers.
Mais, si elle a parfois du mal à trouver ses mots, elle se bat. Elle va chercher à profiter de chaque instant, d’un (trop) bref coup de fil de sa fille exilée à des milliers de kilomètres, de la visite d’un jeune homme chargé de lui faire la lecture.
Désormais pour elle tous les menus détails de l’existence sont importants. L’invasion des fourmis dans l’établissement puis leur éradication devient une épopée, tout comme ce confinement imposé presque en catimini et qui – malgré les dégâts qu’il cause – va resserrer les liens entre le personnel et les pensionnaires. N’est-ce pas là l’essentiel?
C’est à la demande de sa mère, et en s’inspirant de sa vie, que Lidia Jorge a écrit ce livre. Ce qui donne encore davantage de sel aux réflexions de Dona Alberti sur cette fille qui la délaisse et ne prend plus le temps d’écouter sa mère, sur cette romancière qui n’arrive pas à bien finir ses livres, sur ce pessimisme qui semble l’habiter.
À l’inverse, on peut lire entre les lignes le respect de la fille pour cette mère qui se bat, la culpabilité face à ses absences trop répétées, l’admiration pour les paroles qu’elle découvre, la poésie qui émane des enregistrements ponctués de courts poèmes. Alors le roman devient un hymne à l’écriture, à ces mots que l’on ne veut ou ne peut pas dire et qui trouvent ici toute leur puissance, parce qu’ultimes. Une manière aussi de transcender la mort, de «faire l’amour avec l’univers».
Misericordia
Lidia Jorge
Éditions Métailié
Roman
Traduit du portugais par Elisabeth Monteiro Rodrigues
416 p., 22,50 €
EAN 9791022612920
Paru le 18/08/2023
Où?
Le roman est situé au Portugal, dans un lieu qui n’est pas précisé.
Quand?
L’action se déroule d’avril 2029 à avril 2020.
Ce qu’en dit l’éditeur
Une vieille dame enregistre sur un petit magnétophone le journal d’une année de vie en maison de retraite. Sa fille, l’écrivaine Lidia Jorge, retranscrit les textes et leur rend leur force littéraire en suivant les pas de ce personnage extraordinaire qui a gardé une mémoire intacte, une imagination fertile, une curiosité pour les autres et une attention réelle à la beauté du monde, en dialoguant avec la mort comme avec un adversaire légitime. Ce texte constitue un condensé incroyable de force vitale, de dérision, de révolte et de foi dans la vie. Avec des instants mémorables de la relation entre une mère et sa fille. Tout cela transforme ce récit en un témoignage admirable sur la condition humaine. Misericordia est une véritable prouesse littéraire. Un récit à la fois brutal, ironique et aimable, un mélange de larmes et de rires qu’on n’oublie pas. Il nous montre une femme exceptionnelle portée par l’immortalité de l’espoir.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
RTBF (Sophie Creuz)
Le Devoir (Christian Desmeules)
France Culture (Guillaume Erner)
En Attendant Nadeau (Gabrielle Napoli)
Arte (L’invitée)
Blog La Viduité
Blog Sur la route de Jostein
Je lis, je blogue
Lidia Jorge présente «Misericordia» © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
« VISITEUR
Vous êtes prié d’attendre patiemment à la porte que quelqu’un vienne ouvrir. Ne sonnez pas deux fois. Nous vous recevrons dès que possible.
Les dimanches et les jours fériés, le visiteur pourra venir une demi-heure plus tôt que l’horaire indiqué pour le confort du résident.
Mais le visiteur est invité à laisser aux portails tout signe de tristesse : à l’intérieur, le résident attend votre joie.
Ici, tous ensemble, nous sommes une famille paisible : admirez les belles fleurs de notre jardin avant de pénétrer dans cette maison. Cette résidence est un parterre magnifique et les résidents, nos pétales les plus chéris.
Il est à noter que, pour le respect de votre dignité, nous vous qualifierons tous de madame ou de monsieur. Aidez-nous à conserver l’étiquette qui vous est due.
La Direction
Ana P. de Noronha
18 novembre 2018
HÔTEL PARADIS
C’est un lieu de plaisir
Un lieu d’apprentissage
Un lieu pour séjourner
Un lieu de convivialité
Un lieu d’amitié
Un lieu de tendresse
Un lieu d’affection
Un lieu pour s’embrasser
Un lieu pour se serrer dans les bras
Un lieu pour danser
Un lieu où tous
Ensemble nous sommes frères.
Adorons, chantons
Signons-nous, alors.
Définition poétique composée par nos Résidents.
25 décembre 2018
ARCHIVE 210
Les textes qui suivent correspondent à la transcription d’une archive audio d’une durée de 38 heures contenant les témoignages de Maria Alberta Nunes Amado, enregistrés entre le 18 avril 2019 et le 19 du même mois de l’année suivante, sur un Olympus Note Corder DP-20. À l’instar de cas similaires, il s’agit d’une transcription infidèle comme il ne pourrait en être autrement. De sorte que l’ordre, les sauts de page ainsi que les titres ne sont pas de son ressort. Les marqueurs d’oralité ont aussi été retirés de son discours. La trace de ses rires et de ses larmes également. Mais les mots, la respiration et le rythme correspondent entièrement à l’original. Notons que la musique qui accompagne certaines de ces pages, comme le populaire “Miserere” chanté par Zucchero Fornaciari et Luciano Pavarotti, ou le “Miserere mei, Deus” de Gregorio Allegri, ainsi que les autres extraits musicaux, tels que les anciens boléros, les rumbas et les paso doble, ont été omis. Soulignons encore l’importance des 38 notes écrites de la main de la susnommée qui ont fortement contribué à l’ordonnancement de ce livre, notes que Nina Nuñez Mercedes a toutes rangées dans une enveloppe. À laquelle quelqu’un a joint une bague, des boucles d’oreilles, un collier de perles et encore un petit sac en tissu. À l’intérieur du sac, un billet manuscrit plié, un bloc de six feuilles vierges au format A8, et un petit crayon taillé au couteau, de marque Viarco.
1 ATLAS
Là où je suis, même au printemps, quand les jours ont d’ordinaire la même durée que les nuits, la nuit est toujours plus longue que le jour. Sachant cela, c’est précisément au beau milieu de la nuit que la nuit vient à ma rencontre, en me posant des questions inimaginables comme si elle était cet antique chat gris nommé sphinx. Je parle de cette nuit qui connaît mes croyances les plus profondes, mes gloires et mes défaites, tous mes secrets enfouis, même ceux qu’on ne raconte jamais à personne, surtout ceux qui ont trait aux doux souvenirs de l’amour. Plus exactement, pendant que je dors, elle est calme, mais à un moment je me réveille et la provocatrice me tourne déjà autour, elle avance en direction de mon corps, se pose sur mon lit et m’interroge comme une institutrice qui voudrait me prendre en faute. Ce n’est pas facile.
La nuit dernière, sa bouche sombre, confondue avec l’obscurité la plus sombre, a commencé par me poser une question à laquelle il était impossible de répondre : elle a voulu savoir combien de villes il y a dans le Monde. Mais je connais les ruses de la nuit, aussi ne me trouve-t-elle jamais complètement démunie. Devant pareille question, je lui ai répondu que je savais bien que la Terre est une chose et que le Monde en est une autre. Le Monde est beaucoup plus vaste que la Terre et jusqu’à présent, d’après mon gendre, on n’a encore découvert aucune autre planète qui ait été habitée, encore moins des villes situées en dehors de l’espace terrestre. Comment pouvais-je lui répondre ?
Ainsi, j’ai réussi à soulever ma tête de l’oreiller et j’ai regardé la nuit en face pour lui dire : “Pose-moi une question raisonnable si tu veux que je te donne une réponse cohérente.” À ce stade, la nuit semble avoir pris conscience qu’elle ne parlait pas à une ignorante en matière de villes et elle a changé d’idée, elle a seulement voulu vérifier combien de capitales il y a sur Terre. J’ai imaginé le Globe Terrestre que j’utilisais sur ma table de nuit, instrument que j’ai laissé là-bas, dans ma vraie maison, et j’ai trouvé que là encore il était impossible d’énumérer toutes les capitales existantes. Néanmoins, je me suis mise à compter sur les doigts, en parcourant tout d’abord l’Europe, d’ouest en est. J’ai mentionné Lisbonne, Dublin, Londres, Madrid, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Rome, Vienne, Belgrade, Bucarest, Kiev, et je filais déjà vers la Russie quand je me suis embrouillée dans mes calculs et la nuit, comprenant que je n’arriverais jamais au bout, a renoncé à l’exploit colossal qu’elle m’avait assigné. Maligne, elle m’a alors demandé de mentionner uniquement les villes que ma fille aurait déjà visitées. Mais je lui ai répondu : “Pas ça. Je ne veux pas mêler le nom de ma fille au cauchemar de la nuit, je veux qu’elle reste associée aux belles choses de la vie, celles qui se passent loin de ces murs nus. Laisse-moi tranquille…” Mais, malgré tout, la nuit s’est obstinée.
Elle s’est obstinée, elle a voulu savoir où se trouvait cette ville capitale du nom de Reykjavik, pensant que je n’identifierais pas ce mot du fait de son étrangeté et qu’elle pourrait par là même s’asseoir sur mon cœur, le comprimer et le faire s’arrêter. Mais je lui ai répondu du tac au tac, triomphante, sans hésiter : “Reykjavik est en Islande, une île qui possède un volcan très dangereux, qui envoie des bouffées de fumée dans tout le nord de l’Europe quand il entre en activité, il bouche la lumière du soleil et s’unit aux nuages. À cause de toute cette fumée, il y a de ça quelques années, ma fille a été retenue plusieurs jours dans une ville du Canada…”
Devant cette réponse, la nuit est restée sans voix. Qui d’autre aurait pu par hasard lui répondre mieux que moi ? Malgré tout, la nuit ne renonçait pas. La nuit s’est déplacée de l’autre côté de la Terre et a voulu savoir où se trouvait Karachi. Elle persistait à vouloir me prendre en défaut. Mais elle n’a pas réussi parce que j’ai répondu aussi sec : “Ah, oui, tu parles du Pakistan. Ah ! Ah ! Seulement j’en sais beaucoup plus que toi, triste nuit noire. Car Karachi n’est plus la capitale de ce pays, la capitale s’appelle désormais Islamabad. Je l’ai appris dans Le Grand Atlas du Monde de l’édition Civilização, avant qu’il ne s’abîme. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Vaincs-moi, nuit, si tu en es capable…” l’ai-je défiée.
Nous en étions là, au lieu de renoncer elle a tourné autour de mon corps, agité ses ailes sombres, sombres comme la nuit la plus sombre, et m’a demandé, ripostant à mon défi avec une ferveur redoublée, si je savais de quel pays la ville de Bakou était la capitale. “Comment ça s’écrit ?” ai-je demandé. Avec un K, a-t-elle répondu. Aussitôt, j’ai vu le mot Bakou défiler devant mes yeux comme dans un film, ce nom net, tracé, découpé sur un territoire en Asie du Sud-Est, adossé à la mer Caspienne, et j’étais sur le point de prononcer le nom du pays, sans la moindre hésitation, quand, soudain, le mot a disparu de ma vue.
Comme si un râteau avait brassé ma mémoire, emportant les lettres vers une zone hors de ma portée, sans savoir comment, le film avait disparu. Zou, zou. Au lieu du nom précieux que j’étais sur le point de prononcer, seulement le vide. Bakou, écrit avec un K, a vacillé dans le noir de ma pensée et, autour, il n’y avait plus le moindre pays. La nuit me regardait, fixait son regard sans yeux sur les miens, elle triomphait de moi. Mon ignorance, à ce moment-là, est devenue insupportable. Comment pourrais-je continuer à affronter cette nuit terrible qui se moquait de moi, dans l’obscurité de la chambre ? Comment ? J’ai réfléchi, réfléchi, sans quitter des yeux ceux de la nuit, contenant son avancée, la gardant le plus possible à distance, et à cet instant j’ai trouvé une issue.
Sans jamais détourner mon regard du corps innommable de la nuit, j’ai réussi à redresser un peu la tête, j’ai attrapé mon portable sous mon oreiller, j’ai ouvert la coque, l’écran1 s’est éclairé, j’ai appuyé sur une touche et je suis restée à l’écoute. À l’autre bout du fil, j’ai compris que celui à qui je téléphonais décrochait mais ne disait rien. J’ai encore attendu et rien. Là, c’est moi qui ai parlé : “Écoutez, j’ai une question à vous poser. Par hasard, vous savez où se trouve une ville du nom de Bakou ?” Celui qui se trouvait à l’autre bout du fil a gardé le silence, j’entendais sa respiration comme s’il était là, à mes côtés, mais il ne prononçait pas un seul mot. J’ai attendu, j’ai insisté : “Oui, Bakou, s’il vous plaît, ça s’écrit avec un k…”
Alors sa voix a résonné distinctement, grave, un tambour en action près de mes oreilles : “Vous savez quelle heure il est, madame ? Vous savez qu’il est quatre heures du matin ? Qu’est-ce qui vous prend de me téléphoner à une heure pareille pour m’interroger sur une ville nommée Bakou ?” Je me suis excusée mais il ne m’écoutait pas, ses paroles recouvraient les miennes : “Ah, cette fois, vous ne vous en tirerez pas, votre fille sera au courant de tout. Ah, c’est sûr. Attendez-vous au coup…”
Je me suis tenue prête. À son intonation, j’ai compris qu’il continuerait à protester sur le même ton, je n’envisageais même pas comment cette conversation pourrait prendre fin, j’ai donc appuyé sur la touche pour raccrocher, j’ai appuyé le plus lentement possible, désireuse d’annihiler le son, désireuse d’imaginer que cela aurait été une très bonne chose que cet appel n’ait pas eu lieu. Qu’il n’ait jamais eu lieu. Et je suis restée comme ça, le téléphone à la main, attendant qu’il me rappelle, ou qu’elle-même le fasse un peu plus tard, là-bas de l’autre côté de la Terre, le temps pour lui de l’appeler et qu’elle, à son tour, me demande depuis très loin pourquoi je téléphonais à la maison à quatre heures du matin.
Mais cela ne s’est pas passé ainsi. La nuit avait regagné sa place, sans qu’il y ait eu entre nous deux une perdante et une gagnante, et je n’ai plus entendu la moindre rumeur, pendant que je gardais le téléphone bien serré dans la paume de ma main, dans l’attente de ce qui pouvait arriver. Jusqu’à ce qu’un oiseau printanier passe en chantant à proximité. Dans le rectangle de la fenêtre, l’aube rose est apparue et le plafond blanc a surgi rosé au-dessus de ma tête annonçant un nouveau jour. Et tandis que le mot Bakou n’apparaissait pas inscrit sur la feuille bleu-vert de la carte du pays dont il est la capitale, je pensais à la clarté qui, à cet instant, devait éclairer la maison qui est restée là-bas, avec ses tables, ses chaises, ses fenêtres, ses draps et ses rideaux, et son secrétaire avec son étagère haute où j’ai laissé mes journaux intimes et mon Atlas perdu.
19 avril 2019
La pluie est entrée par un petit
trou – En moins d’un éclair
elle a inondé le Monde.
2 VEILLE
Je suis restée couchée à attendre que les heures passent et que le mot que j’avais trouvé puis aussitôt perdu, au cours du combat avec la nuit, me vienne naturellement à l’esprit, j’entendais les coucous dehors et le sifflement des merles, et je me réjouissais à l’idée de l’arrivée du printemps. Je parcourais en pensée les pages de mon Atlas avant qu’il n’ait été détruit, je le feuilletais dans ma tête sans aucune hâte. En effet, si le nom du pays dont Bakou est la capitale n’apparaissait pas dans la matinée, il arriverait sans doute dans le courant de l’après-midi. Je suis de ces personnes qui ne pensent pas que l’espoir est le dernier à mourir. Je pense que l’espoir est simplement immortel. Ce nom absent, qui a interrompu la confrontation avec la nuit, surgirait sûrement quand on l’attendrait le moins. J’ai totalement confiance dans les lois de la pensée. Elles me guident et m’apportent la paix.
Aussi, sachant par avance que le mot que je cherchais se présenterait de lui-même, je suis restée à l’écoute des manifestations du matin à l’intérieur, à mesure que les oiseaux au-dehors abandonnaient les alentours des casuarinas et que les bruits domestiques, issus de l’activité même de la maison, s’entremêlaient. Pour des raisons que j’ignore, parfois mon traversin fonctionne comme un haut-parleur. Nombre des sons lorsqu’ils atteignent l’oreiller s’amplifient sous ma tête. Ainsi, encore tôt, j’ai perçu la camionnette d’approvisionnement qui approchait en roulant doucement, puis elle stoppait et repartait. Le camion à eau a vrombi scandaleusement près du portail de l’entrée, et ce qui m’avait tout l’air d’une bonbonne de gaz a roulé sur le pavé avec fracas. Comme elle n’a pas heurté le muret des parterres, quelqu’un l’en aura empêchée. Qui avait pu la retenir ? Le klaxon d’une voiture a retenti, un sifflement aigu, par négligence, certainement. Une fille a braillé depuis une fenêtre, ce qui ne devrait pas arriver, certaines ont déjà été renvoyées pour avoir crié moins que ça. Les hurlements de la fille en réponse au son du klaxon ont été tout aussi stridents. Qui pouvait-elle être ? Si je ne me trompe pas, c’était la voix de Lurdes Malato.
C’était elle ?
Entre-temps, ici juste en dessous, à l’étage inférieur, quelqu’un s’est mis à déplacer des meubles lourds d’un côté à l’autre. Puis, quelqu’un a activé les touches du piano, et quelqu’un a crié près de l’ascenseur à l’étage supérieur pour qu’on le libère. Quelqu’un a répondu que l’engin était arrêté à la cave, dans la zone de la buanderie. Une conversation dont on percevait les cris mais pas les mots. L’ascenseur a fini par atteindre cet étage. Il y a eu des éclats de rire. Je savais ce qui se passait. Ce sont les mouvements de la veille, et la veille apporte toujours des dérangements. Pauvres de nous, résidents. Tant d’énergie le long des couloirs, en revanche nulle âme qui vive dans l’encadrement de la porte pour nous dire bonjour. J’ai encore pensé à actionner la sonnette afin que quelque chose se produise. J’ai attrapé la poire pour la presser, mais je suis restée immobile, craignant que cette voix, que j’avais entendue crier à une fenêtre, n’appartienne de fait à Lurdes Malato, et qu’elle-même en personne, les mains sur les hanches, n’entre dans ma chambre pour se plaindre de mon appel. J’ai gardé la poire dans ma main très longtemps, si longtemps que le temps a cessé de compter. C’est ainsi que – à force d’attendre, en ouvrant les yeux, j’ai trouvé sur le seuil de la porte la personne de Nina Mercedes.
Nina a avancé vers moi, j’ai attendu qu’elle se penche sur mon visage et me couvre comme elle seule savait le faire. Mais rien de tel ne se produisait, car la jeune Portoricaine, à mesure qu’elle approchait, ramassait des objets tombés qu’elle entendait remettre à leur place. Comme à tant d’autres occasions, la moitié des objets qui protègent mon repos pendant la nuit s’étaient éparpillés autour de mon lit. La jeune fille énumérait les choses à mesure qu’elle les prenait par terre – la bouteille d’eau, la montre, la photo, le sac en tissu, le stylo, les chaussettes pour dormir, d’abord l’une puis l’autre. Même le portable était tombé sur le plancher. Nina l’a ramassé. Elle a approché son visage du mien. Et m’a dit à l’oreille : “Estuviste otra vez luchando con tu Atlas ? Y a quién llamaste esta noche ? Seguro que un día me vas a contar lo que le pasó a ese libro malvado2 .”
Elle parle bas, elle porte les mêmes chaussures à semelle souple que les autres, mais elle marche silencieusement dans le couloir comme si elle était pieds nus. De toutes, c’est elle qui a les mains les plus douces, le mot le plus gai. Parfois, je me demande si Nina est cette personne que j’ai en tête, ou si c’est moi qui la magnifie. La vérité est que tous désirent être lavés et habillés par Nina Mercedes. Tous font appel à elle et la veulent à proximité, et moi, un matin agité comme celui d’aujourd’hui, j’ai eu la chance de tomber sur Nina. Une récompense pour ne pas avoir appuyé sur la sonnette pendant que tant d’autres sonnaient en même temps dans le couloir. Nina m’a demandé : “Qué es lo que pasó a tu Atlas ? Cuéntamelo, niña3 …” J’ai répondu : “Un jour où tu auras le temps de t’asseoir ici sur le lit à côté, à ce moment-là je te raconterai.”
Nina me levait, et sa façon de faire était agréable, mais je ne lui raconterai jamais comment, par une nuit d’hiver, dans la maison que j’ai laissée là-bas, une pluie inattendue, mêlée au tonnerre, est entrée par le trou de l’installation téléphonique, s’est infiltrée le long du mur, s’est accumulée dans un coin de la salle à manger et s’est déversée dans le panier à revues. Je ne raconterai à personne, pas même à Nina, les déboires qui ne sont qu’à moi. Je ne lui raconterai pas comment j’avais laissé, par hasard, dans ce panier, Le Grand Atlas du Monde, alors que sa place était sur le secrétaire. Seulement les objets sont comme les êtres humains, ils cherchent leur lieu de perdition lorsqu’ils doivent se perdre. Donc, au cours de cette nuit orageuse, l’eau de pluie, poursuivant son chemin imparable, en s’infiltrant jusqu’à atteindre le coin de la salle à manger, a transformé tout ce qui était papier accumulé dans le panier en osier en une masse informe, sans que je ne me rende compte de rien. Quand je suis tombée sur la paperasse trempée, il était trop tard. À la pluie et à l’orage a succédé le beau temps, et la catastrophe était là. Le Grand Atlas était encore reconnaissable mais il était perdu. Dans l’espoir de le récupérer, je l’ai même mis au soleil, je l’ai encore passé au sèche-cheveux et au fer à repasser. Rien n’y a fait. J’ai détaché les feuilles une à une, mais elles étaient collées les unes aux autres et, à mesure que je les séparais, de grandes taches blanches remplissaient l’espace où auparavant se trouvait la représentation des océans, des mers, des continents, des pays, des pages bien indiquées sur lesquelles j’étudiais le monde à ma manière. Je n’allais pas encombrer la vie de Nina avec des anecdotes aussi intimes, j’ai simplement dit à Nina : “Beaucoup d’agitation court dans cette maison. Y aura-t-il un concert demain ?”
Elle a répondu : “No va a haber, no, Alberti. Nos sigue faltando el señor Peralta, y sin él, no hay conciertos.”
Nina a lavé mon visage avec du coton imprégné d’eau de rose, puis d’eau claire, elle m’a parfumée, mis mon collier, ma bague avec la pierre bleue, elle m’a accroché mes pendants d’oreilles et installée dans le fauteuil roulant qu’elle appelle charrette. Elle m’a demandé : “Quieres ahora tu tabla de plástico, tu hojita de papel y tu lapicerito ? O quieres esperar al caer la tarde ? Si quieres te escribo las fechas para toda la semana, lo hago con mucho gusto. Así, tú, Alberti, reservas toda la fuerza de tus manos para escribir tus pensamientos. Quieres hacerlo ahora, o prefieres escribir por la noche?”
Je lui ai dit qu’il était déjà tard, que j’écrirais mes notes quand la nuit viendrait. Elle a poussé la charrette le long du couloir. Dans mon dos, je l’entendais dire buenos dias à gauche et à droite, à mesure qu’on croisait ceux qui rentraient déjà. Dona Marcela, qui marchait sans difficulté, arrivait en annonçant qu’on était le samedi saint. En passant à sa hauteur, je lui ai fait signe et lui ai demandé si elle regagnait déjà sa chambre, la 214, à quoi elle a répondu : “Non, non je ne vais pas dans ma chambre. Mais quelle drôle d’idée ? Je vais dans l’au-delà…” Nina a commenté : “Qué lejos, qué lejos está ese sitio, doña Marcela…”
Nina me conduisait par le couloir en direction du Salon Rose. Les images des chalets nordiques enneigés exposées sur le mur me regardaient, certains semblaient rire, au vu de la forme des portes et des fenêtres peintes. Après une nuit de lutte, une belle matinée de samedi était là, j’ai pensé. J’ai fait un gros effort pour reconstituer la page où se trouverait Bakou, mais il me manquait la représentation de l’Atlas.
20 avril 2019
Samedi saint ! – Avec le souvenir de mon Atlas
et un peu de chance – Même mes
espoirs échapperont
à la mort.
3 LE PARTAGE
C’est la deuxième fois que je passe le dimanche de Pâques dans cette demeure. Même ici, loin de celle qui a été ma maison, c’est un grand jour. Sachant par avance que je n’aurais pas à nouveau droit à la présence de Nina, j’ai pensé à Lilimunde, la gamine brésilienne qui sent un mélange de cèdre et de bergamote. J’y ai tellement pensé qu’à mon réveil, j’ai senti mes poignets humides et j’ai eu l’illusion que ma peau exhalait le parfum de cette eau de Cologne. J’ai appelé fort : “Lilimunde, c’est toi qui es là ?” Mais non, malheureusement, ce n’était pas elle.
Le bruit que j’entendais émanait de deux filles qui, une fois entrées dans ma chambre, se sont mises à aller et venir, très pressées, et tout en déplaçant mes vêtements elles parlaient et riaient très fort. Je suis restée silencieuse à les écouter, dans l’attente qu’elles s’adressent à moi, mais elles ne me saluaient pas car elles discutaient avec entrain de leurs virées nocturnes et de ce qui leur arrivait dans le noir. Ceci étant, j’ai insisté : “Qui est là ? Vous ne me dites rien ?”
Elles ne répondaient pas. Elles pouffaient plutôt avec des éclats de rire mal contenus, penchant leur tête en arrière comme si elles voulaient partager leur rire avec le plafond de la chambre. J’ai encore répété plusieurs fois, bonjour, aujourd’hui c’est dimanche de Pâques. Mais elles me mettaient mon maillot de corps et mon chemisier, m’enfilaient mes bas et mon pantalon, sans me voir, leurs rires passaient à côté de mon corps et par-dessus ma tête, elles levaient mes bras comme si elles maniaient des pièces métalliques au milieu d’une usine. J’ai redit bien fort : “Bonjour, Jésus a ressuscité, on dit.” Lurdes Malato, oui c’était bien elle, a pris le téléphone et parlé au loin : “OK, vers cinq heures de l’après-midi, je serai là.” La grande fille qui l’accompagnait a commenté, on va avoir une fête, ma vieille. Sans même m’avoir dit bonjour ou un autre mot de salutation, elles m’ont conduite jusqu’à la Salle Bleue où se déroulerait le déjeuner de Pâques.
Si elles l’ont fait exprès, elles ne m’ont guère impressionnée – Je sais que le bonheur est une denrée très rare. On doit le garder sur le cœur quand il nous touche de près, en remplir toutes les poches de notre âme, pour servir de bouclier quand son contraire se produit, aussi ne me dérangeaient-elles pas outre mesure, je me tenais prête. Les filles m’ont installée à table, elles ont poussé mon fauteuil roulant de manière à ce que ma poitrine frôle la nappe, elles sont parties, toujours sans m’avoir dit bonjour. Mais j’ai levé les yeux et j’ai senti à proximité une bonne source de bonheur – la salle était comble, sur les murs il y avait des décorations de Pâques et mes compagnes de table m’ont saluée. Je leur ai communiqué toute ma joie. Et si je ne me rappelle pas le déjeuner de Pâques de l’année dernière, celui-ci je ne l’oublierai pas.
Dans la salle à manger, il y a douze tables pour soixante-dix personnes. À la nôtre, nous sommes six plus moi, et on s’entend bien. Entre les tables, des filles couraient, pressées et agitées. Comme toujours elles m’avaient placée face à la fenêtre, et j’ai pu regarder le ruban de la mer. J’aime être assise de ce côté car même loin, si je ne distingue pas l’entrée de la baie, je sais comment sont les vagues. Certains points sombres sont sûrement des bateaux, et si ce n’est pas le cas, j’imagine qu’ils le sont. Autrement, le menu du déjeuner était ordinaire, mais pour compenser dona Rita de Lyon a reçu un cadeau de Pâques de son fils, pilote d’avion, et elle l’a partagé avec ses voisines de table. Moi, j’ai eu droit à une amande fine, à la liqueur d’amaretto, confiserie française*, a dit dona Rita. Mais dona Ema, non. Dona Ema a apporté à table un lapin en chocolat et ne l’a partagé avec personne car ses proches lui avaient recommandé de le manger seule. Devant nous, Ema a ôté l’aluminium, elle a cassé le lapin en petits bouts et a savouré toute seule son cadeau de Pâques.
Dona Fátima a demandé si c’était bon, mais Ema ne s’en est pas émue, elle ne lui en a même pas fait goûter une miette. Luísa de Gusmão a déclaré comprendre parfaitement qu’une personne qui reçoit un petit lapin en chocolat le jour où l’on célèbre la Résurrection veuille le manger seule, mais qu’elle devrait alors le faire dans sa chambre, en privé, comme l’exigent les bonnes manières. Dona Luísa de Gusmão se dit descendante de comte, bien qu’elle n’oblige personne à la traiter de comtesse. Pour dona Luísa, manger un lapin en chocolat en entier, à une table où se trouvent sept personnes, est la preuve qu’il y a des gens qui ne pourraient jamais faire partie de la noblesse. Nous ne sommes pas tous égaux. De son côté, dona Julieta a versé quelques larmes, car elle aurait aimé que quelqu’un dans le monde au-dehors ait pensé à son déjeuner.
Dona Joaninha Amaral, au contraire, a dit que cela lui était égal que personne ne se souvienne d’elle, qu’il y avait bien d’autres choses avec lesquelles s’amuser. Tôt le matin, elle s’était promenée dans le jardin de la résidence et elle avait vu comme les roses avaient éclos. Dona Joaninha a décrit les roses qui semblaient la regarder en lui disant, emporte-nous avec toi, emporte-nous avec toi, femme. Les pétales étaient tous retournés, désireux d’être cueillis sur leur tige pleine d’épines et de sauter dans ses bras. Mais elle n’aime pas toucher à ce qui ne lui appartient pas, même lorsqu’il s’agit d’un bien commun comme c’est le cas du jardin de l’Hôtel Paradis. Car ces roses ne seraient-elles pas, par hasard, à tous ceux qui entretiennent la résidence ? Dona Joaninha est fille de poissonnier, mais elle est bien élevée, elle n’avait pas touché à une seule rose puisqu’elle n’y était pas autorisée.
Entre-temps, une tranche de gâteau avait fait son apparition dans chaque assiette, et dona Fátima a dit à dona Ema qu’elle ne devrait pas toucher au gâteau de Pâques vu qu’elle avait déjà mangé toute seule son lapin argenté. Estimant qu’une part lui revenait, dona Ema a tendu le bras, a pris la plus grosse et l’a avalée. J’ai beaucoup regretté de ne plus écrire mon journal comme avant pour noter la scène du déjeuner de Pâques, avec tous les détails, comme j’aurais tant aimé le faire. Mais entre-temps il a fallu changer de sujet, car en pleine conversation sur le partage de la nourriture des pas faisaient irruption dans la salle. Cela se passait derrière moi parce que j’étais tournée vers la mer. J’ai pensé que ce devait être les quatre veuves, et je ne me suis pas trompée. J’ai reconnu leurs voix avant même qu’elles ne chantent.
L’une d’elles a crié très fort comme si elle s’adressait à une classe d’enfants : “Quelqu’un sait ce que signifie Alléluia ?” Un grand silence s’est fait, personne n’a rien dit, et moi je savais ce que cela signifiait, mais comme j’avais le dos tourné, j’ai décidé de rester silencieuse à regarder le ruban de la mer. Elles insistaient avec leur question. Alors que je m’apprêtais à dire que cela signifiait Louons le Seigneur, l’une des veuves a couvert ma voix : “Eh bien on va interpréter Alléluia, Alléluia !” Et elles se sont mises à chanter comme si c’était un opéra. Heureusement que j’avais le dos tourné, vu que je ne suis pas très attachée à ces quatre femmes, mais leurs voix je les aime.
Plus qu’aimer, je les apprécie véritablement. Il y a des voix qui devraient surgir du ciel, elles ne devraient pas avoir besoin d’enveloppe corporelle. Derrière moi, j’entendais leur chant émouvant et, à la fin, tout le monde a applaudi, de bien faibles applaudissements pour de si belles voix. Une jeune fille s’est souvenue de tourner mon fauteuil et j’ai pu vérifier que c’étaient elles, habillées en blanc et en rose. Elles ressemblaient à des bonbons.
Dans la vallée ou sur la colline, j’adorerai
J’adorerai, j’adorerai.
Alléluia, alléluia !
Elles chantaient. J’ai fermé les yeux, je ne les aime pas. Mais elles chantaient et on ne voyait pas le temps passer. Si vous ne chantez plus, allez, allez-vous-en, ai-je pensé lorsqu’elles se sont tues et s’attardaient encore car elles réclamaient toujours plus d’applaudissements. Ces derniers étaient désormais plus longs que la chanson et elles ne partaient toujours pas. Et les voilà qui sortaient à présent, en secouant leurs vêtements blanchâtres, les quatre veuves endimanchées. Il est difficile de croire que ces personnes aient en elles des voix pareilles, je le répète, maintenant que je suis toute seule avec mes pensées. Après le déjeuner, dona Joaninha Amaral a dit, elles chantent très bien ces femmes, elles nous distraient toujours, et elle a voulu pousser mon fauteuil roulant. J’apprécie beaucoup la gentillesse de dona Joaninha. Qu’aurait été mon dimanche de Pâques si elle n’avait pas été là ? En poussant mon fauteuil le long du couloir, elle disait : “Dona Alberti, je vais vous laisser dans votre chambre, installée confortablement devant la fenêtre grand ouverte, à regarder la Nature. Il est difficile de croire qu’un jour comme celui-là, votre fille soit là-bas…” Mais nous n’avons pas atteint le bout du couloir.
Une fille désormais à la retraite, du nom d’Hermínia, en service bénévole, nous appelait pour retourner au salon. Nous y sommes retournées. Et là, oui, quelque chose se passait. J’ai fermé les yeux car ce que je voyais était plus que ma vue ne pouvait supporter. J’ai même demandé à la jeune retraitée de s’arrêter à mi-parcours. Je voulais me remettre de ma surprise, je ne voulais pas qu’on me voie envahie par le trouble qui m’assaillait. Je n’aurais jamais imaginé – Près du piano, debout, se trouvaient mes voisins de la Maison Blanche, ceux de la Quinta Ferrari et ceux de la Villa Almanjar. Je les ai tous regardés des pieds à la tête et j’ai trouvé qu’ils étaient les plus belles créatures du genre humain que j’avais jamais croisées. Je les ai comptés, en tout ils étaient huit voisins. Ils étaient venus me rendre visite. Le chant des quatre veuves, qui n’étaient plus là, a nimbé mes oreilles et je me suis sentie m’élever au-dessus du plancher. Des alléluias sortaient de mon cœur, faisant trembler mon poignet droit. Mais je me suis agrippée au fauteuil, j’ai pris un mouchoir dans le sac que je porte toujours autour de mon cou, et je leur ai demandé, calmement, comme si je les attendais : “Quelles nouvelles m’apportez-vous de notre monde ? Est-ce que tout est toujours pareil par là-bas ?”
L’un de mes voisins s’est penché vers moi et m’a demandé : “Savez-vous qui vous rend visite ?”
Je me suis vexée : “Pour l’amour du ciel, monsieur Frank, je suis capable de décrire vos maisons, à qui elles ont appartenu avant que vous ne les habitiez, en quelle année c’est arrivé, et pourquoi vous les avez achetées, beaucoup plus chères que vous n’auriez dû les payer. Je connais le nom de tous les présents et de ceux qui manquent. Ma question est différente : dans vos maisons, et dans celle qui a été la mienne, par là-bas, tout va bien ? Les pelouses ne sont pas marron, avec toute cette sécheresse ?”
“Tout va bien, dona Alberti, mais il faudrait quelques gouttes de pluie. Les jardins en ont plus besoin que la bouche le pain…” a dit la voisine de la Maison Blanche. Et j’ai répondu : “Ah ! Les jardins et les arbres, aussi. Parce que le jardin n’est finalement qu’un agrément, mais les arbres, pour le climat, sont la vraie clé de voûte. Si les grands arbres ne libèrent pas d’oxygène, il n’y a pas d’humidité possible, et donc il n’y aura pas de jardin. Il y a des espèces végétales qui disparaissent. Mais ce n’est pas seulement la flore qui change, mes amis, comme vous le savez, la faune aussi. On dit qu’entre les immeubles et les maisons neuves parmi les plus modernes surgissent des sangliers qui fouissent dans les jardinières. L’infirmier Marlon m’a raconté qu’il y a quelques jours, ils ont trouvé un renard près d’ici qui buvait dans une piscine et se roulait sur la pelouse. Ce qui signifie que les espèces sauvages commencent à cohabiter avec les espèces domestiquées et avancent en direction des familles humaines. Nous sommes tous des créatures, c’est bien vrai, mais il convient de séparer les espèces. C’est le monde qui change. N’est-ce pas ?”
Tous ont répondu oui, ils se sont penchés vers moi, ils m’ont parlé et m’ont écoutée, à la différence de ce qui se passe ici à l’intérieur où personne ne m’écoute au-delà de deux mots, moi seule écoute les autres. Mes voisins, au contraire, m’ont parlé, puis ils ont déposé des cadeaux sur mes genoux et ils ont dit que je comprenais parfaitement combien le monde est en transition. Et moi, enchantée par ce qui m’arrivait, je ne m’en suis pas tenue là, j’ai ajouté : “Je suis enfermée ici mais je suis au courant de tout ce qui se passe sur Terre et pas seulement. Ce à quoi j’ai assisté au long de ma vie me suffit à imaginer ce qui va se passer ensuite. Et, si Dieu le veut, bien que la Nature soit désorientée, la vie va s’améliorer. L’avenir sera une splendeur…”
Mes voisins étaient très contents, en me regardant, en m’ouvrant les cadeaux, ils ont continué à me parler. Et moi j’ai dit ça car je voulais qu’ils comprennent que je suis toujours à la hauteur de recevoir sereinement mes visites, au milieu d’un salon rempli de voix, d’enfants, de rires, de quelques pleurs, de quelques petits dérapages émotionnels, de gâteaux, de bonbons, de bananes et de chemises de nuit, parce que c’est dimanche de Pâques. Mes voisins riaient de bonheur parce qu’ils me retrouvaient telle que j’étais en quittant ma maison, ils ont fait une ronde autour moi et c’était comme si nous dansions. Dona Joaninha ne s’est pas éloignée, elle a écouté attentivement, intervenant d’ailleurs dans plusieurs sujets. Ce n’est pas grave. Cela a été un grand jour, grâce à mes voisins, un des plus beaux jours de ma vie. Quand j’ai fermé les yeux, dans ma tête, des scènes de toutes les couleurs se sont mêlées.
4 LE PARFUM
Celle qui avait été la plus ancienne employée de la maison, qui avait assisté à la transformation de l’Hôtel Paradis en complexe résidentiel, celle qui garde la mémoire vivante de toutes ces étapes, c’était elle, Hermínia, qui m’avait accompagnée au salon, et au départ de mes visiteurs c’est elle qui m’a ramenée dans ma chambre. Personne amère, elle a encore essayé de briser ma joie. Elle m’a dit : “Ne vous faites pas d’illusions, dona Alberti, les jours comme celui-ci, les voitures font la queue le long de l’avenue, elles tournent encore et encore sur la petite place devant. Mais c’est seulement ces jours-là. Les proches viennent décharger leur culpabilité avec des mamours en tout genre. Je les appelle les journées où on vide son sac. Je ne parle pas de soulager son remords, qui est un sentiment honorable. Pas celui-là. Le sac est le lieu où chacun enferme la peur de ce que les autres disent de nous. Ils viennent ici juste pour combattre leur peur. Une honte. Des feux d’artifice pour que les autres voient. Je suis ici depuis trop longtemps. Je les reconnais au premier coup d’œil…” L’ancienne employée a mis un doigt sur son œil et l’a écarté, découvrant l’intérieur de sa paupière.
Les murs du couloir ont répondu ? C’est comme ça que j’ai répondu.
Je l’ai seulement remerciée de m’avoir tenu compagnie. Elle pouvait désormais partir, Mme Hermínia avait déversé son fiel et accompli son devoir. J’avais sur mes genoux, entre mes mains croisées, l’intention de tenir bien fermement la joie apportée par mes voisins. Et, par un heureux hasard, elle serait redoublée. En effet, il devait être dans les six heures de l’après-midi quand j’ai perçu une rumeur dans le couloir, c’était dona Joaninha qui entrait dans la chambre, avec un beau bouquet de fleurs dans les bras. Elle était exubérante.
Finalement elle aussi avait eu des visites. Des cousines éloignées, qu’elle croyait mortes, étaient bien en vie et elles étaient venues la voir, elles lui avaient offert un énorme bouquet* qu’elle désirait partager avec moi. Des roses, des marguerites et des branches de gypsophile ont rempli le vase de l’entrée. Les roses, véritablement roses, embaumaient, c’était un vrai bout de printemps qui pénétrait dans ma chambre. Dona Joaninha Amaral a dit que l’arôme des roses la rendait folle. Le chant des oiseaux aussi. Dona Joaninha s’est assise sur le lit d’à côté, qui heureusement est toujours vide, et elle s’est mise à parler des fleurs mêlées à sa vie passée. Et ses yeux souriaient au point de se fermer. Elle a dit : “À cette époque de l’année, je me souviens énormément de mes amours…” Et elle a continué à sourire de plus en plus : “Mes amours et les fleurs, ce sont deux choses qui vont de pair.” Et elle a alors raconté comment l’amour était entré dans sa vie. Toute jeune encore, un jour de printemps, elle était allée à la plage avec son petit ami et en était revenue avec un autre. Comme elle avait été heureuse, ensuite, avec les deux. Elle n’avait jamais pu choisir entre l’un et l’autre, elle n’avait d’ailleurs pas eu à le faire, mais elle ne racontait l’histoire de sa vie que maintenant, parce que tous les deux étaient morts. Et elle a relaté comment elle avait fait en sorte qu’ils ne se rencontrent jamais au fil des années, en vivant dans la même localité, et comment la vie avait été agréable de cette façon, partagée. Le samedi matin avec l’un, la nuit du dimanche avec l’autre. Pour être franche, elle était sûre que les deux hommes avaient fini par apprendre l’existence de l’autre, mais s’ils l’avaient su, cela ne les avait pas dérangés. Finalement, tous les trois avaient été heureux jusqu’à la fin. Trois veinards.
Et, pendant que le parfum des roses se répandait dans toute la chambre, dona Joaninha s’est remémoré certains de ses pas de deux avec une gaieté printanière que je n’entendais plus chez personne depuis bien longtemps. Au souvenir de ses moments de gloire, le visage de dona Joaninha ressemblait à l’image de Notre-Dame de la Foi. Ses yeux et ses joues resplendissaient. Et j’ai pensé : Béni soit l’effet du printemps, car sous son vent bénéfique, tout luit, tout se reproduit et se multiplie, même pour ceux dont l’amour est un souvenir.
Et elle a parlé et parlé, et moi je lui posais des questions et elle répondait, mais à vrai dire mon ressenti était différent, car tout en pensant à la vie exubérante de dona Joaninha, je pensais aussi à la mienne. Comme dona Joaninha se déplace avec agilité, avant qu’elle ne parte, je lui ai demandé de prendre mon bloc-notes et d’avoir la gentillesse de détacher une feuille très délicatement et de la placer sur le support acrylique. Elle m’a remis la feuille impeccablement détachée par les pointillés et m’a encore attrapé le crayon avec une bonne glisse. J’ai remercié : “Merci beaucoup, dona Joaninha, vous êtes toujours la bienvenue.” Puis j’ai laissé ma compagne de table partir, ses pas disparaître dans le couloir pour que je puisse tracer, au milieu de la page blanche, le mot qui avait trotté dans mes pensées pendant tout le dimanche de Pâques. En majuscules, avec le plus grand soin que ma main le permet, j’ai écrit: BAKOU.
21 avril 2019
Mon Dieu – Le coucou est si petit et sa voix
si forte. Si malin son œuf
et moi si bête – Ce nid ne sera pas
attaqué.
5 LA LECTURE
Il était environ sept heures du matin quand j’ai senti mon téléphone vibrer sous mon traversin. Difficile d’atteindre le téléphone, ma main avait du mal à l’extirper de là où il était. Quand j’ai enfin réussi à répondre, j’ai entendu une voix me dire en portugais, essayez maintenant, s’il vous plaît. La voix passait l’appel à mon interlocutrice. C’était elle. J’ai crié autant que ma voix le permet : “J’écoute, parle, parle, j’entends !”
Elle allait se mettre à parler. J’ai écouté et sa voix a surgi si distinctement qu’elle semblait naître de l’intérieur de l’oreiller. J’ai entendu ma fille dire : “C’est juste pour te souhaiter de Joyeuses Pâques. Là où je suis, le réseau est très mauvais, je n’ai pas pu appeler hier, je ne sais pas ce qui se passe…” Je m’apprêtais déjà à la remercier et à l’interroger sur sa santé, ses problèmes, ses vêtements et la date de son retour, quand j’ai compris que l’appel avait été interrompu.
J’ai gardé le téléphone entre mes mains très longtemps dans l’attente, mais sans le moindre résultat. Pour me consoler, j’ai pensé à l’exploit que cela représente – quelqu’un est allongé sur un lit devant l’océan Atlantique, et quelqu’un d’autre, de l’autre côté de la mer, à la pointe extrême d’un autre continent, près de l’océan Pacifique, peut dire, C’est juste pour te souhaiter de Joyeuses Pâques, et à l’entendre, celui de ce côté-ci se retrouve réconforté. Car je sais maintenant qu’elle est en territoire hispanophone, mais elle est accompagnée par quelqu’un qui parle la langue de sa patrie. J’ai donc dormi paisiblement pendant la dernière heure du matin. Heureusement qu’il y a des phases comme ça, tranquilles, dans notre vie.
Le deuxième moment de cette journée que j’aimerais beaucoup consigner de ma propre main, pour m’en souvenir à jamais, maintenant qu’il fait déjà nuit noire, s’est produit après le déjeuner. Je somnolais, assise, dans mon fauteuil, quand j’ai entendu une rumeur. J’ai ouvert les yeux et j’ai vu un très grand jeune homme devant moi. Je suis habituée à ce genre d’apparitions, et j’ai aussitôt imaginé qu’il s’agissait d’un volontaire d’une association de jeunes bénévoles chargés de distraire, pendant une heure, sous la coordination de Bianca, l’animatrice, les résidents de l’Hôtel Paradis. Le jeune homme s’est installé. Une fois qu’il a été assis, j’ai remarqué qu’il était très laid. Il avait des sourcils très épais et, quand il riait, il découvrait des dents blanches, trop blanches et puissantes. Très laid. Il a sorti un journal de son sac à dos, mais je l’ai prié de ne pas le lire. “Pourquoi ?” a-t-il demandé. “Parce que”, ai-je répondu, et je lui ai expliqué que dernièrement les journaux et les informations télévisées me rendaient triste.
Le jeune homme a insisté pour en connaître la raison, j’ai encore hésité à répondre mais j’ai fini par dire la vérité. Je lui ai expliqué que, depuis un certain temps, j’étais écœurée par le récit de tant de tragédies, d’escroqueries, de vols, de gens morts sur des bateaux pneumatiques sans atteindre de rives, de guerres, de bombes, d’enterrements avec des cercueils sur le dos de foules révoltées. C’est le monde dans son désordre continu et cet effondrement n’en finit jamais, lui ai-je dit. Parce que les journaux ne révèlent jamais la fin des tragédies, ils se bornent à les annoncer et à les décrire sous leurs couleurs les plus sombres, ai-je ajouté. Ils sont le portrait permanent du désordre sans ordre en vue. Alors j’ai décidé, par moi-même, de mettre fin à cet effondrement, en l’ignorant. Puisque je ne peux pas combattre ces tristes réalités, je renonce à les connaître. Autrefois, c’était différent.
Le jeune homme de l’Association de Boa Vontade a eu l’air déçu. “Un renoncement ?” a-t-il repris. Oui, j’ai acquiescé. Avant j’avais l’habitude de demander qu’on me lise les informations, mais maintenant je ne veux plus. Dans la vie, naturellement, le bien succède au mal, dans les journaux, au contraire, on ne fait qu’ajouter du mal au mal, j’ai dit. J’ai précisé cependant que j’aimais toujours écouter lire, à présent que je n’y arrivais plus par moi-même. J’ai précisé encore que passé la première ligne, toutes les autres se confondent et tremblent comme si le papier produisait de petits éclairs qui m’aveuglent. Le jeune homme aux sourcils épais, très laid, s’est mis à fouiller dans son sac à dos pour en sortir de petits paquets de feuilles rangées dans des pochettes transparentes. “J’ai une nouvelle pour vous”, a-t-il dit, après avoir sondé le contenu des pochettes. J’ai voulu savoir de quoi parlait la nouvelle qu’il avait l’intention de lire. Le jeune homme aux sourcils épais a répondu : “Elle parle de la vie d’un instituteur chilien qui a inspiré une très belle histoire.” Mais je me suis méfiée : “Très belle et très triste, n’est-ce pas ? Si elle est plus belle que triste, d’accord. Sinon, je m’en passe.”
“Plus belle que triste, je vous assure”, a-t-il répondu, et il s’est mis à lire l’histoire d’un instituteur du nom de Gálvez.
Le garçon lisait bien, très bien même. Même si la nouvelle ne parle que de misères, de persécutions, de déportations et de tristesses, comme je l’avais imaginé, la voix du jeune homme parvenait à être plus belle que les malheurs qu’il lisait. Les sourcils trop épais, sur son teint très sombre, avec ses dents trop blanches et puissantes, se sont mis à se modifier sous mes yeux à mesure que le garçon lisait les phrases surprenantes, que je ne réussissais pas à retenir mais qui éclairaient la fluidité de cette voix. Et une fois évoqués les malheurs et les tristes voyages accomplis entre les continents par le personnage, persécuté par un dictateur assassin, le jeune homme que j’avais auparavant trouvé très laid a lu admirablement le dernier volet de l’histoire de cet instituteur du nom de Gálvez. Il s’agissait d’un rêve, le rêve de don Gálvez, comme l’appelait le jeune homme dans sa lecture. Le jeune homme a lu les lignes brèves qui mentionnaient le rêve – Dans sa vie passée, là-bas dans sa patrie, cet instituteur s’était consacré avec un tel dévouement à sa mission, qu’une nuit, peu avant de mourir, exilé en Europe, il avait rêvé qu’il était revenu dans l’école de son pays lointain pour enseigner les verbes réguliers aux enfants, et le rêve avait été à ce point intense et réel qu’il s’était réveillé au petit matin les doigts couverts de poussière de craie. Le jeune homme laid a rangé les feuilles dans la pochette et a déclaré : “Comme vous voyez, ça finit bien.”
Je n’ai rien répondu.
Je suis restée quelques instants à réfléchir à la fin de cette histoire, car je tardais à saisir le sens de ce dénouement surprenant. Pour comprendre l’épisode dans sa totalité, il fallait imaginer le rêve du retour de l’instituteur dans son école, l’imaginer devant les tout-petits, imaginer son rêve dans la pénombre du sommeil, voir l’instituteur dans le rêve tracer des lettres blanches sur un tableau noir, imaginer ensuite le réveil de l’instituteur et l’image de ses doigts couverts de poussière de craie. Imaginer ensuite ce que l’instituteur avait imaginé, qu’il aurait souhaité que son imagination corresponde à la réalité, l’imaginer encore en véritable citoyen trahi, j’ai été stupéfaite par la façon dont on peut, par si peu de choses, déclencher un sentiment de si grande tristesse. J’ai regardé le jeune homme qui avait été laid, il me paraissait beau désormais, et je me suis sentie faiblir, me laisser aller, comme cela arrive habituellement avec ma fille, et je n’ai pas voulu alimenter ce sentiment de faiblesse qui mouillait mes yeux.
Enfin j’ai dit : “Oh ! Oui, ça finit très bien. Mais ceci étant, ce n’est rien d’autre que l’histoire d’un instituteur et de son fils, un récit très court. Et un récit très court, même quand il correspond à la vérité, est toujours plus proche du mensonge. Quand je lisais, j’aimais les gros livres, ceux qui ressemblent à la vie d’une personne qui se déploie au long du temps. Et j’aimais lire des livres sur des personnages remarquables et non sur des instituteurs qui meurent vaincus, sans faire d’histoire.” Le jeune homme a consulté sa montre mais il n’avait pas l’air pressé. “Alors quels livres aimiez-vous ?” a-t-il demandé.
Je suis restée incrédule à regarder le jeune homme aux sourcils épais.
C’était le premier jeune de l’Association de Boa Vontade qui me posait une pareille question. Ma familiarité avec ce jeune homme grand et maigre devenait exagérée. Je suis restée vague, je lui ai dit que j’aimais les livres qui parlaient des batailles napoléoniennes, j’en avais lu deux. De la vie des Anglais en Arabie, j’en avais lu un. De la vie des empereurs romains, quand ils commandaient sur tout, j’en avais lu quelques-uns. Un de ces empereurs était homosexuel et aimait un garçon qui est mort ensuite, un nom ressemblant à Antoine, et le chagrin de l’empereur avait été si grand que j’avais moi-même eu envie de pleurer. Et pourtant il avait été très difficile à lire, j’avais passé six mois à essayer de le terminer, sautant des pages quand le sujet échappait à mon entendement, car les noms de ces villes et de ces mers n’étaient pas ceux d’aujourd’hui. Mais maintenant que je ne lisais plus, aussi grosses que soient les lettres, maintenant que je dépendais de qui pouvait lire à ma place, je devais me résigner à de petits récits sur la vie simple des choses, c’était bien aussi, mais pas aussi bien que les gros livres, avec beaucoup de pages, pour que les histoires ressemblent à la vraie existence des gens.
Et on a parlé comme ça pendant plus d’une heure.
Le jeune aux sourcils épais a voulu alors connaître un peu ma vie, mais je n’allais pas lui raconter. De même que je n’ai pas voulu qu’il me raconte la sienne. Je suis très vieille, je sais qu’il faut conserver l’enchantement dans son propre vase, sinon il déborde et il est réduit à néant. Nous restions ainsi, cantonnés à la lecture d’une nouvelle, c’était suffisant pour que notre rencontre ait été parfaite. Je lui ai donc demandé, pour clore cette séance de détente animée par l’Association de Boa Vontade, de relire la même nouvelle. Ce qu’il a fait. Et en lisant les malheurs rien n’était malheureux, parce que tous les mots étaient tendus vers ce moment où l’instituteur se réveille et a les doigts couverts de poussière de craie. Quand il a terminé pour la deuxième fois la lecture de l’histoire de l’instituteur, j’ai remarqué sous les sourcils du lecteur l’existence de ses yeux profonds, ses cheveux tombaient sur un côté dans un beau désordre, et sa silhouette trop maigre, assise un peu de biais, me rappelait la photographie d’un esprit. Je l’ai trouvé beau. Si beau que j’avais mal aux yeux de le voir. À mes yeux, il était maintenant différent, il était la voix précieuse de celui qui lit merveilleusement une nouvelle pour qu’une femme âgée puisse écouter, et sa voix avait eu le pouvoir de révéler la beauté cachée du visage du lecteur. De ses lèvres qui m’avaient paru trop épaisses et de ses dents trop blanches avait surgi une nouvelle admirablement lue, sur un ton juste. Sa beauté, révélée après le dernier mot, était si intense qu’il devenait insupportable de lui faire face. J’ai eu envie que le jeune homme disparaisse vite.
Je ne devrais pas être comme je suis, toujours à attendre le beau, le grandiose, le puissant. Peut-être un peu maladroitement, j’ai levé la main, j’ai renvoyé le jeune homme. Je lui ai dit : “Merci, vous avez fait une bonne action. Vous pouvez partir.” Et il s’en est allé. Je m’en suis voulu. Mais j’ai ce tempérament, je veux trop, je donne trop d’ordres, j’aime trop quelque chose hors de ma portée et, quand je ne l’atteins pas, je cherche désespérément à transformer ce qui existe de façon à rapprocher l’objet défectueux de la réalité inatteignable. Je ne sais pas où mettre mes pensées qui sont beaucoup trop vastes pour le vase de ma tête et la taille de mon cœur. Il était trois heures de l’après-midi. C’est alors qu’on est venu me chercher.
6 DANS LE SALON ROSE
Les pas du jeune homme ont disparu dans le couloir. Je ne savais pas quoi faire de l’écho de cette lecture. Pendant un certain temps, je suis restée immobile, à réfléchir à la signification de cette nouvelle et à sa tonalité, mais immédiatement ce sentiment d’enchantement figé s’est mué en action. Salomé la rapide passait dans le couloir, je l’ai appelée et elle est venue m’aider, efficace et disponible comme toujours. Je lui ai demandé de me descendre au rez-de-chaussée. Je savais qu’à peine franchi le seuil de la grande salle où on racontait que, dans les années cinquante, il y avait eu des bals et des réceptions, des rideaux avec des scènes de chasse, des tableaux avec des paysages anglais sur les murs, et qui était désormais occupée par soixante-dix chaises avec accoudoirs, une télévision suspendue au plafond et un piano au milieu du passage, l’écho de la voix du jeune homme lisant merveilleusement les malheurs de l’instituteur chilien et son rêve de craie m’aiderait à prendre ma décision. Et c’est ce qui s’est passé. Je me suis concentrée sur l’espace qui m’entourait, sur l’ensemble de mes camarades assis, et avant que Salomé ne m’attribue une place quelconque, je lui ai demandé de me laisser là où je pourrais parler à la directrice Noronha.
Salomé m’a fait plaisir. Elle m’a placée dans le passage, entre la porte qui ouvre sur le Grand Hall et celle qui donne sur le cabinet de consultation et la chapelle, et dans cette rangée je n’étais pas seule. Une fois installée, j’ai compris que les deux autres camarades à mes côtés se trouvaient dans la même situation, dans l’attente du passage d’Ana Noronha, la jeune femme qui, depuis quelques mois, était à la tête de l’administration de cette maison. J’ai remarqué également que la télévision n’était pas allumée, chose rare dans un espace où le brouhaha des émissions de l’après-midi permet à peine de nous entendre les uns les autres. Et j’ai pensé que les astres du hasard se conjuguaient en notre faveur, puisque le silence qui régnait là permettrait à la jeune Ana Noronha, désormais directrice, de nous entendre. “Sollicitez-la quand elle passera, mais poliment”, a recommandé Salomé comme si elle craignait que nous abusions. Et bientôt la directrice s’est approchée, mais en nous regardant sans nous voir. La directrice a continué son chemin, très pressée.
En suivant ses mouvements, il m’était difficile de croire qu’un an auparavant, la directrice Noronha avait répondu au nom d’Anita. Elle n’était alors qu’une stagiaire qui rendait visite aux résidents dans leurs chambres dès sept heures et demie du matin. Elle arrivait avec ses chaussures plates en frappant du bout des doigts à chacune des portes, elle demandait la permission d’entrer et, que nous dormions ou non, elle s’approchait de nos lits et se penchait. Elle nous regardait alors posément dans les yeux, son regard parcourait nos visages, contemplant ce qu’ils renfermaient, lentement, comme si elle avait le temps de visiter nos âmes en personne. Elle bavardait avec chacun de nous. On dit qu’elle avait si bien rempli son rôle de stagiaire qu’en quelques mois elle était devenue salariée. Et était aussitôt montée en grade, une ascension surprenante, compte tenu du fait que tout cela s’était produit en l’espace d’un an. Mais si cela signifiait qu’elle avait beaucoup gagné, de mon point de vue il y avait dans tout cela, en contrepartie, une grande perte – elle avait perdu son regard paisible.
Désormais, les yeux de l’ancienne Anita passent rapidement sur toutes les surfaces sans s’arrêter sur aucune d’elles, ils vont et viennent acculés, mouillés, fébriles, et je pense que, parce qu’elle doit tout diriger, elle ne possède plus rien de ce qui avait fait d’elle une personne aimée. Anita transformée en Mme Noronha a perdu la paix de son regard. À mon avis, on ne l’a pas montée en grade mais rétrogradée. Cet après-midi-là, quand on m’a placée dans le passage, elle allait et venait, ne paraissant voir personne. Occupée.
Tellement occupée qu’elle surgissait tantôt du côté du Grand Hall, tantôt du côté du cabinet de consultation, comme si elle faisait le tour de la maison, sans s’arrêter auprès de nous même si mes camarades réclamaient ouvertement son attention. Dona Santanita, assise à ma gauche, au passage de Mme Ana Noronha, en est arrivée à tirer sur le bout de sa jupe. Elle y a mis beaucoup d’ardeur, mais la jupe a échappé à sa main. Au nouveau passage de la directrice, M. Mota, assis à ma droite, s’est levé et a tenté de freiner son pas avec sa canne. La directrice, qui marchait à vive allure avec une liasse de papiers dans les bras, a réussi à avancer, nous laissant derrière elle. Je ne perdais pas espoir, je savais que, si elle se baissait pour leur répondre, j’aurais également ma chance. La télévision était toujours muette et seules des voix s’élevaient du côté de l’ascenseur, parmi lesquelles je reconnaissais celle de dona Joaninha. Certains parlaient fort, mais dona Joaninha riait aux éclats. C’était dans cette direction que la directrice se dirigeait, comme s’il y avait là un centre d’intérêt particulier. Dans le salon, sans le bruit de la télévision, les voix en arrière-fond, bien que sur le simple ton d’une conversation, retentissaient dans toute la pièce. Néanmoins, M. Mota ne renonçait pas. La directrice Noronha, que nous appelions encore récemment simplement Mlle Anita, repassait. Il a crié : “Halte là !”
On raconte que M. Mota a été un bon menuisier, en son temps il avait géré un grand atelier d’où sortaient des meubles pleins de tiroirs et de la taille de maisons. Je le crois. Qui que soit Mota, son cri a fonctionné. “Halte là !” La directrice s’est baissée, ses cheveux longs à hauteur de nos visages, elle a souri à mes camarades. “Allez-y…” a dit Mme Noronha. Ses yeux se sont posés par terre un moment. Elle a écouté. Alors dona Santanita lui a parlé à l’oreille, longuement, sans cesser de remuer les lèvres. Noronha s’est dégagée, elle lui a répondu à haute voix : “Dona Santanita, personne n’a volé votre manteau de printemps. Il a simplement disparu. Mais ici, ces derniers temps, tout ce qui disparaît réapparaît. Il est sûrement dans la buanderie. Ne vous inquiétez pas, je vais le chercher moi-même. Vous verrez, vous pourrez le mettre dès demain…”
Dona Santanita l’a crue : “Ah ! Quelle joie de retrouver ma veste marron.” Et alors la directrice s’est adressée à M. Mota : “Allez-y.” Un sujet très simple. En définitive, M. Mota voulait juste mettre en lieu sûr un billet de vingt euros et il ne savait pas comment faire. Mais dans ce cas il lui faudrait patienter et remettre le billet au secrétariat, Luís Cotovio s’en occuperait. La directrice n’avait pas le temps d’emmener M. Mota jusqu’à Cotovio, mais Cotovio viendrait le voir. M. Mota n’était pas convaincu. “Et moi qu’est-ce que je fais de mon billet entre-temps ?” a interrogé le menuisier la voix pleine d’angoisse. “Tenez-le bien dans votre main, monsieur Mota, ne le lâchez pas, serrez-le fort au fond de votre poche, Luís arrive.” Et la directrice Noronha allait se relever et partir, ses cheveux ont même volé dans une autre direction, mais je ne l’ai pas laissée. J’ai dit : “Et moi je ne suis personne ?”
Noronha a posé la main sur mon épaule : “Quelle idée, dona Alberti. Dites aussi ce dont vous avez besoin.” Là, je me suis mise à trembler, les mots étaient arrimés à mon cœur et refusaient de se détacher. Comme la directrice attendait patiemment mes paroles, j’ai fini par réussir à lui demander : “Madame Ana Noronha, savez-vous par hasard où se trouve une ville nommée Bakou?”
“Bakou ?” a-t-elle interrogé.
J’ai dû répéter le mot plusieurs fois parce que la jeune directrice n’avait pas la moindre idée qu’il existait une ville dans ce monde avec un nom pareil. Et, incapable de reconnaître ce mot, elle allait encore une fois repartir, mais je lui ai dit, avec toute l’énergie de mon âme : “Mademoiselle Anita, je vous demande de chercher sur votre portable, je vous en supplie, parce que j’ai oublié où est située cette ville, dans un pays près de la mer Caspienne dont je ne me rappelle pas le nom, et si j’y pense je peux à peine dormir…” Et comme je me tenais prête, j’ai ouvert le sac que je porte sur la poitrine et je lui ai tendu le papier avec le mot écrit.
Elle a pris son portable, a recopié le mot, tout en regardant en même temps autour d’elle. Le silence inhabituel qui planait sur le salon transformait tous les gestes et toutes les paroles en événements importants. Les rires de satisfaction de dona Joaninha au fond claquaient au milieu du silence, et d’autres voix l’accompagnaient. Pendant ce temps-là, Mme Noronha, très jeune, très bien habillée, très bien chaussée, cherchait sur son portable le mot Bakou, déplaçant ses doigts agiles, d’avant en arrière. Et moi, encore impressionnée par la lecture du garçon aux sourcils épais dont la vie m’avait fait cadeau, je pensais combien il était triste qu’une jeune fille, aussi bien habillée, âgée de trente ans seulement, ne sache pas où se trouvait une ville du Caucase, en Asie méridionale, Bakou. Je ne nie pas avoir éprouvé du dépit. Que savent certains diplômés de nos jours ? Que lisent-ils, qu’écrivent-ils, quelles vétilles étudient-ils à la place de ce qu’ils devraient, pour ne connaître ni l’histoire ni la géographie ? Peu savent lire comme le garçon aux sourcils épais. J’étais dans ces pensées, pendant que la jeune femme pianotait sur le clavier de son portable, quand on a entendu la voix d’une aide-soignante brailler depuis le hall : “S’il vous plaît, allez à la porte d’entrée, M. Paiva veut se sauver !”
“Qui est-ce qui veut se sauver ?”
Les voix animées qui provenaient du fond du salon se sont interrompues. Quelques têtes se sont tournées vers la porte d’entrée. J’ai cherché à faire de même. Je me trouvais loin de l’incident, mais je comprenais qu’une épreuve de force se déroulait sans doute dans la zone de l’accueil entre M. Paiva et l’une des aide-soignantes. À cet instant, la directrice avait déjà refermé son portable où se trouvaient cachées l’Europe et l’Asie, avec toutes les mers et les rivières, et parmi elles le mot Bakou, et parce qu’elle devait superviser en même temps soixante-dix personnes assises, elle s’était envolée vers la zone du hall. La confrontation n’a pas duré longtemps. La bagarre a été rapide. Un choc métallique et des vitres brisées. Mais après quelques cris, M. Paiva était de retour dans le salon, prisonnier des bras de plusieurs filles, et non seulement il avait blessé l’une d’elles, une maigrichonne, celle avec laquelle il s’était battu à la porte, mais il s’était lui-même blessé et il saignait. Noronha en personne aidait à maîtriser l’ardeur du fugitif, qui présentait une belle entaille sur le front des suites de son coup de tête contre la vitre. Finalement ils ont assis M. Paiva, l’ont rassuré, allongé et couvert d’un linge blanc, en attendant les soins. Le brancard improvisé, installé sur le lieu de passage, se trouvait juste à côté de nous. À ma gauche dona Santanita, à ma droite M. Mota. Tous les trois nous avons alors pris conscience de ce qui se passait – Sous les chaises où ils avaient réussi à allonger M. Paiva, … »
À propos de l’autrice
 Lidia Jorge © Photo DR
Lidia Jorge © Photo DR
Née à Boliqueime le 18 juin 1946, Lidia Jorge est diplômée en philologie romane de la faculté des lettres de l’université de Lisbonne, a été enseignante dans l’enseignement secondaire et a exercé cette fonction pendant quelques années en Angola et au Mozambique. Elle a écrit de nombreux romans traduits dans une douzaine de pays, en particulier Le Rivage des murmures, Le Vent qui siffle dans les grues et Les Mémorables. Misericordia (2023) a obtenu de nombreux prix, dont le Medicis étranger. Egalement autrice de sept recueils de nouvelles, ainsi que des pièces de théâtre, de la poésie et des chroniques. Tout au long de sa carrière, elle a reçu 21 prix littéraires. Elle vit à Lisbonne. (Source: Éditions Métailié)
Page Wikipédia de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#misericordia #LidiaJorge #editionsmetailie #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteratureportugaise #litteratureetrangere #litteraturecontemporaine #VendrediLecture #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie






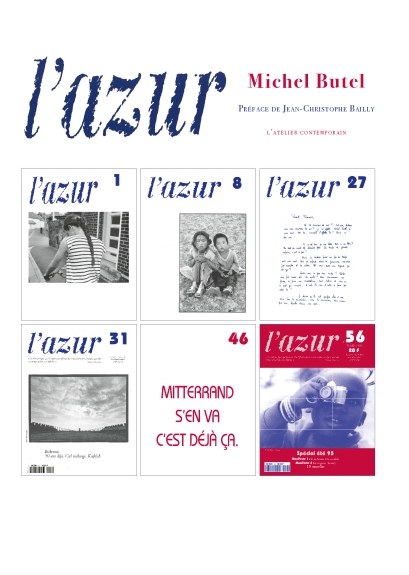

 Michel Butel © Photo Michel Lucas
Michel Butel © Photo Michel Lucas





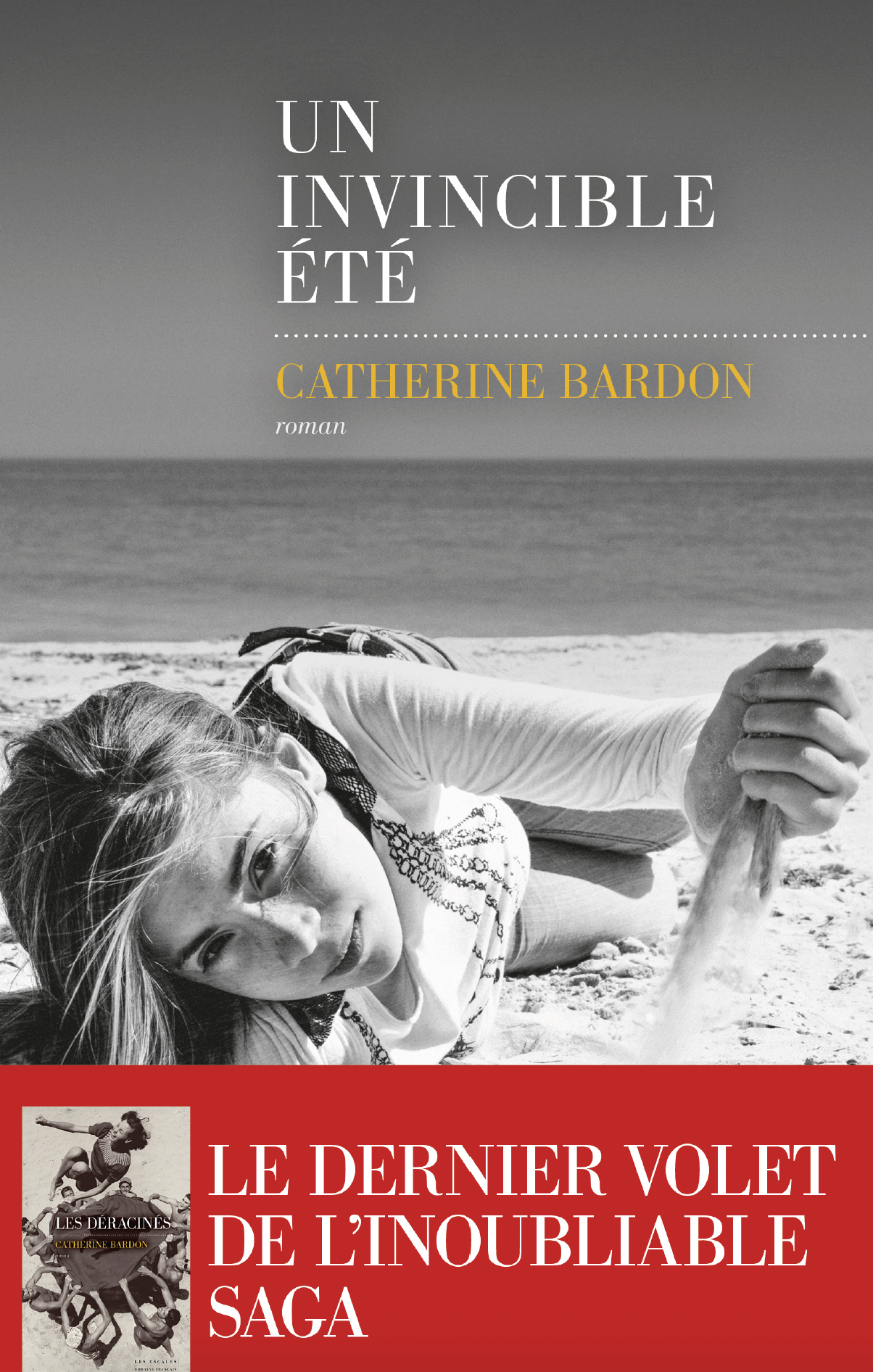
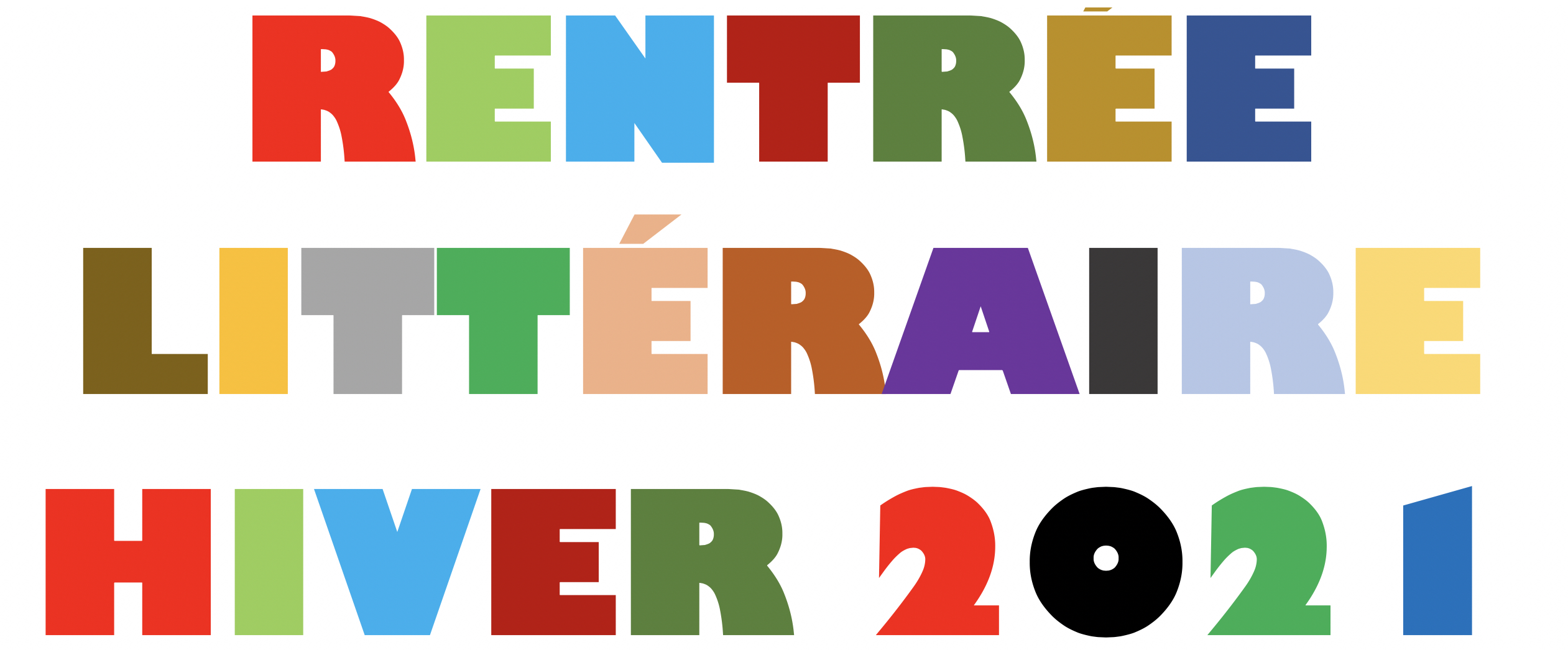




 Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas
Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas



 «Notre plage faisait toujours le même effet à ceux qui la découvraient. C’était magique. Les yeux s’arrondissaient, les lèvres dessinaient un oh ou un ah d’admiration. Puis venait l’envie irrépressible de courir vers la mer, d’enfouir ses pieds dans le sable tendre et de laisser l’eau lécher les orteils.» (extrait de Et la vie reprit son cours) © Catherine Bardon
«Notre plage faisait toujours le même effet à ceux qui la découvraient. C’était magique. Les yeux s’arrondissaient, les lèvres dessinaient un oh ou un ah d’admiration. Puis venait l’envie irrépressible de courir vers la mer, d’enfouir ses pieds dans le sable tendre et de laisser l’eau lécher les orteils.» (extrait de Et la vie reprit son cours) © Catherine Bardon





