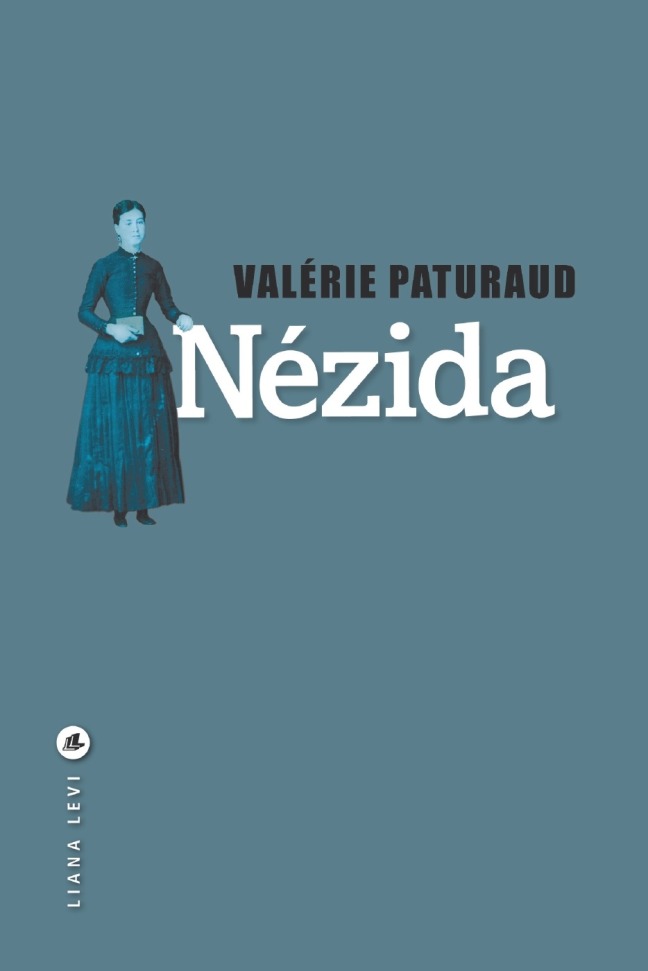En deux mots
Nine Dupré a fui la révolution russe avec sa mère. À Lyon, elle entend se montrer digne de son père en reprenant son métier de parfumeur. Grâce à Léon Givaudan, elle grimpe les échelons jusqu’à représenter la France dans un concours international organisé à Moscou. En revenant sur sa terre natale, sa vie va basculer.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Nine, son père et son parfum
Theresa Révay nous offre une saga familiale et un épisode inédit des relations franco-russes dans ce récit qui retrace la quête de Nine, fille de parfumeur, bien décidée à poursuivre les recherches de son père qui n’a pu fuir la Russie bolchévique. Un roman aussi passionnant que richement documenté.
Nine Dupré est en passe de réaliser son rêve, marcher dans les pas de son père décédé en créant à son tour un parfum. En quittant la Russie avec l’arrivée des soviets au pouvoir, sa famille avait à peu près tout perdu. Alors Nina affiche cette farouche volonté de prouver son talent. Sélectionnée par son employeur, le parfumeur Coty, elle va concourir à Lyon où sera décerné le titre du meilleur jeune parfumeur.
Si sa réalisation a été validée, elle n’est toutefois plus sûre de sa composition, un incendie ayant détruit ses notes et son échantillon.
Si elle ne remporte finalement pas le prix tant convoité, elle fait forte impression auprès de Léon Givaudan qui décide de s’attacher ses services. Une embauche quasi inespérée en cette fin 1934, où les temps dont incertains. Les troubles sociaux viennent se mêler à la peur qui monte avec l’arrivée au pouvoir d’un certain Adolf Hitler.
C’est alors que l’économie de cette industrie naissante connaît de grandes difficultés que Nine va voir sa vie basculer à nouveau. Sous l’égide d’Édouard Herriot, le rapprochement entre la république soviétique et la France va se concrétiser par le développement des échanges et l’envoi d’une délégation russe au sein des usines Givaudan. Lorsque Polina Molotova, la responsable du programme de développement de la parfumerie et de la cosmétique initié par Staline, lui est présentée, la parfumeuse reconnaît les effluves de L’aube rouge, une fragrance qu’elle avait mis au point avec son père et dont il conservait jalousement la formule. Passé le moment de trouble, elle y voit le signe que son père n’est peut-être pas mort et décide d’en avoir le cœur net en retournant à Moscou où elle sera la représentante française lors d’un concours international destiné à la création d’un parfum qui glorifiera la Révolution et le son grand maître, Staline. Un voyage qui va lui réserver bien des surprises…
Après une œuvre déjà riche de grandes fresques historiques comme L’Autre Rive du Bosphore (2014), La vie ne dure qu’un instant (2017) ou La Nuit du premier jour (2020), Theresa Révay explore ici un pan de son histoire familiale, puisqu’elle est la descendante des Givaudan. En ayant pu consulter des archives, mais aussi en consultant une importante bibliographie (voir ci-dessous), elle nous livre le détail d’un épisode assez incongru – il faut bien le dire – des relations franco-russes après la Révolution bolchévique, celui d’une Union soviétique voulant se lancer dans l’industrie du luxe et créer des fragrances propres à entraîner le monde à célébrer sa glorieuse réussite !
On se laisse emporter par cette fresque historique aux fragrances fortes et par la volonté de cette héroïne bouleversée par des sentiments aussi forts que contradictoires.
Ce parfum rouge
Theresa Révay
Éditions Stock
Roman
362 p., 21,90 €
EAN 9782234095892
Paru le 27/03/2024
Où ?
Le roman est situé principalement en France, à Paris et banlieue, notamment à Suresnes, ainsi qu’à Lyon. On y évoque aussi Vernier dans la banlieue genevoise et Moscou.
Quand ?
L’action se déroule en 1934 et les années suivantes.
Ce qu’en dit l’éditeur
Nine Dupré descend d’une lignée de parfumeurs français établie en Russie sous l’empire des tsars. Prise dans la tourmente de la révolution bolchevique, elle a dû fuir avec les siens, après la disparition de son père qui lui a transmis sa passion créatrice. Alors qu’elle travaille désormais à Lyon pour les plus grands noms de la profession, la jeune femme rencontre Pierre Rieux, un ambitieux commissionnaire en parfums, proche du pouvoir soviétique. Lors de la visite d’une délégation venue de Moscou, Nine respire une fragrance dont seul son père détenait la composition. Et si le maître parfumeur avait survécu au pire ?
Entre ambition et passion, Ce parfum rouge dévoile l’univers captivant de la haute parfumerie des années trente et nous emmène sur les traces d’une héroïne éprise de vérité.
« À cet instant, Nine ne ressent plus de colère ni de désarroi. Seulement la détermination du bourreau ou de l’assassin. Tout ici respire l’ambition et la décomposition, le soufre et le mensonge. Elle sort une pipette de sa poche et tend la main vers les produits. Elle a été à bonne école pour le meilleur et pour le pire, elle est devenue parfumeur pour rendre hommage à un homme qui n’a jamais existé, mais Nine Dupré est la fille de son père, une femme qui sait aussi semer le désordre. Il suffit de si peu de choses en vérité, de distraire quelques gouttes d’un flacon, d’exalter une essence de fleur blanche, de libérer quelques molécules. Il suffit d’un rien pour renverser les idoles et défaire les équilibres passés et à venir. »
Bibliographie proposée par Theresa Révay
« Afin de restituer cette époque de la parfumerie, j’ai étudié les numéros de La Parfumerie Moderne parus entre 1908 et 1937. Une revue professionnelle remarquable, fondée à Lyon par René-Maurice Gattefossé.
Je dois beaucoup aux travaux de Félix Cola Le Livre du parparfumeur (Casterman, 1931), de Guy Robert Les Sens du parfum (Eyrolles, 2000), d’Eugénie Briot La Fabrique des parfums (Vendémiaire, 2015), et de Mandy Aftel Essences et alchimie (Éditions Nez, 2022).
J’ai lu avec grand intérêt les œuvres de Constance Classen, Alain Corbin, Geoffrey Jones, Constantin Weriguine, Edmond Roudnitska, Élisabeth Barillé et Catherine Laroze, Ernest Beaux, Nathalie Beaux, Marie-Dominique Lelièvre, Marylène Delbourg-Delphis, Dominique Roques, Dominique Ropion, Firmenich & Cie, Jean-Claude Ellena, Ghislaine Sicard-Picchiottino, Alain Duménil, Élodie Font, Brigitte Proust, Élisabeth de Feydeau, Maïté Turonnet, Jean-Marie Maroille, René Sordes, ainsi que les numéros de la Revue des marques de la parfumerie et de la savonnerie.
La revue olfactive Nez est incontournable, de même que les sites suivants :
https://auparfum.bynez.com
http://www.sylvaine-delacourte.com
http://www.boisdejasmin.com de Victoria Belim-Frolova
http://www.tatousenti.com de Bettina Aykroyd. »
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
L’heure des livres (Anne Fulda)
Blog L’Apostrophée
« Le parfum rouge » de Theresa Révay est le Coup de cœur de Web TV Culture © Production Web TV Culture
Les premières pages du livre
« Suresnes, février 1934
L’eau froide sur son visage lui coupe le souffle. Nine plonge ses mains dans la bassine émaillée, s’asperge le corps. Sa peau frémit. Le poêle est faiblard depuis quelques jours mais elle n’a pas eu le temps de s’en occuper. Elle se frictionne avec une serviette, enfile sa lingerie puis attrape un chemisier, sa jupe trop lâche, la veste sombre du tailleur. D’un geste vif, elle tire le rideau qui occulte la fenêtre de sa chambre. Au-dessus de Suresnes, le ciel de février peine à s’éclaircir. Elle reste immobile quelques instants. Avant une épreuve décisive, elle ressent toujours un étourdissement avec ce goût sous la langue, celui du sang ou de la peur.
Elle tire l’édredon et remplume l’oreiller. Un lit défait, c’est une invitation au désordre et Nine Dupré n’aime pas le désordre. Elle l’a côtoyé de trop près, trop jeune. Désormais, elle a ses astuces pour le tenir à distance. D’un regard, elle survole son domaine. Les traités de chimie sur l’étagère, les carnets et les crayons de couleur alignés sur le bureau, la coiffeuse sur laquelle s’empilent fards, poudriers et bâtons de rouge alors qu’elle aime garder son visage nu, sans artifices. Au-dessus du miroir, le papier peint se décolle à cause de l’humidité. Quand le fils de sa logeuse a proposé de s’en occuper, elle a refusé. Elle ne veut pas de cet homme dans sa chambre.
Elle décroche la blouse blanche de la patère, l’armure qui la rend transparente. Grâce à ce vêtement, elle n’est plus qu’une parmi d’autres et cet anonymat ne lui déplaît pas. Au même moment, dans les pavillons et les immeubles collectifs de cette petite ville de l’ouest parisien, les centaines d’employées de François Coty saisissent aussi leur blouse et leur manteau en criant aux enfants de se dépêcher. D’innombrables talons claquent sur les trottoirs. L’armée est en marche, des bataillons de petites mains qui redessinent le monde des femmes. Certaines peinent pour ne pas glisser sur les plaques de verglas, surtout dans les rues en pente qui dévalent vers la Seine. Le chapeau enfoncé jusqu’aux sourcils, les mains dans les poches parce qu’elle a oublié ses gants, Nine rejoint le flot des ouvrières. Son chemin jusqu’à la Cité des parfums est sans détour : elle n’a pas de petit à déposer à l’école. Sa mère ne manque jamais une occasion de lui en faire le reproche.
Elle avance en somnambule au cœur de l’essaim, une pointe de douleur bat contre ses tempes. Voilà trois mois que sa composition virevolte dans son esprit et qu’elle tente de la saisir par une formule rigoureuse. Elle a réalisé des dizaines d’ébauches, ajustant les éléments au gramme près sans jamais atteindre l’alchimie miraculeuse qui permet à l’intuition d’un parfum de s’incarner en certitude. Sa dernière tentative repose au laboratoire depuis plusieurs jours, le temps de laisser les molécules s’apprivoiser. Trouvera-t-elle encore ce matin ces fausses notes qui la désespèrent ? En apprenant qu’elle aurait l’honneur de représenter la maison Coty au concours des jeunes parfumeurs de la Foire internationale de Lyon, elle avait été emplie de fierté. Un cadeau empoisonné, pense-t-elle à présent.
Elle presse le pas. Ses talons dérapent sur les pavés et elle se rétablit d’un mouvement de reins qui arrache des sifflets d’admiration à des ouvriers du bâtiment. Le C majuscule de Coty s’étire sur le linteau de la porte à double battant sous lequel elle se faufile, les épaules basses. Célèbre dans le monde entier, la signature du Corse qu’on surnomme « le Napoléon de la parfumerie » révèle son ambition. Nine aimerait posséder le centième de cette assurance qui autorise toutes les audaces. Voilà trois ans qu’elle est entrée chez lui un diplôme d’ingénieur chimiste en poche, et rien n’y fait : elle a encore l’impression d’enfiler sa blouse pour la première fois.
Dans la cour intérieure, les voix résonnent entre les bâtiments en brique. On s’interpelle en se rendant aux ateliers mais personne ne s’arrête pour bavarder. Même si le patron dirige son univers depuis son château de Longchamp, son ombre plane. François Coty n’a pas besoin d’être présent pour avoir l’œil à tout. On respecte ce visionnaire autant qu’on craint son autorité. Il a le verbe haut, cinglant, le propre des bâtisseurs d’empires.
– Tu gênes, jolie demoiselle ! En avant !
Jean-Baptiste, le jeune préparateur au visage dévoré de taches de son, la saisit par le bras. Nine s’est arrêtée au beau milieu des marches, perdue dans ses pensées. Elle se laisse entraîner vers les vestiaires en silence. De toute manière, Jean-Baptiste parle pour deux. Un enthousiasme dont il ne se départit jamais alors qu’il règne une tension palpable dans l’entreprise, à l’image de celle du pays. Aussi bien dans les cafés populaires de Suresnes que sous les lambris des salons parisiens, on ne parle que de crise économique et de chômage, de scandales financiers et de corruption.
Nine dénoue son écharpe. Certains portemanteaux sont vides ; chez Coty comme ailleurs, on licencie du personnel pour comprimer les coûts. Elle en profite pour étaler ses vêtements aux effluves de laine humide.
– Il paraît que le grand patron va passer aujourd’hui, murmure Jean-Baptiste. On raconte qu’il est ruiné. Sa femme l’a plumé lors de leur divorce et il a gaspillé une fortune avec ses journaux. Il aurait dû se concentrer sur ses parfums et ses cosmétiques. Ça lui réussit mieux que la politique. M. Roubert lui fera sûrement sentir ta composition. Ne fais pas cette tête, voyons ! On dirait que tu as vu un fantôme. Que redoutes-tu ?
– D’être renvoyée.
L’image s’impose à elle : François Coty, cheveux gominés aux reflets roux, œil de verre d’une fixité glaçante, sanglé dans un costume à la veste allongée, hume une touche en papier buvard avant de lui indiquer la porte avec l’aplomb de celui dont la carte de visite précise qu’il est « artiste, industriel, technicien, économiste, financier, sociologue ». Un monstre sacré d’autant plus redoutable qu’il est devenu un colosse aux pieds d’argile.
– Tu seras renvoyée si tu continues à traînasser, tête de linotte.
Nine emboîte le pas à son camarade. Ils se séparent à l’entrée du laboratoire, chacun se dirige vers sa paillasse. En dépit des fenêtres ouvertes, l’air frais est saturé d’odeurs. Deux chimistes sont déjà au travail, ajustant les flammes de leurs becs Bunsen. Ils accueillent Jean-Baptiste par une plaisanterie mais se contentent de saluer Nine de la tête. Ni l’un ni l’autre n’ont apprécié que le directeur technique Vincent Roubert la choisisse pour participer au concours, marmonnant qu’on le savait sensible à la gent féminine. À leurs yeux, Nine pousse comme du chiendent en ces lieux. Les femmes ne sont bonnes que pour travailler dans les ateliers de conditionnement des fragrances et de baudruchage des flacons, à la rigueur en tant que préparatrices dévouées. Elles n’ont pas à devenir des rivales. Lorsqu’elle a été embauchée, ils ont moqué ses erreurs d’apprentie et n’auraient pas parié un kopeck sur son avenir. Elle a serré les dents et elle est toujours là.
Feignant l’indifférence, Nine se tourne vers les étagères, réconfortée par l’alignement des bouteilles, boîtes métalliques, conges en cuivre étamé et autres pots de faïence. L’environnement familier des produits odorants, des alcools et des sels chimiques a le don de l’apaiser. C’est celui des jours enfuis, des jours heureux.
La matinée est consacrée au rituel quotidien. La jeune chimiste sent et pèse les substances détaillées dans les formules qu’on lui a confiées, veille à dissoudre les résines et les sels aromatiques dans un bain de vapeur avant de mélanger le concentré obtenu à la quantité correspondante d’alcool. Des gestes mesurés qu’elle reproduit avec vigilance. Les vérifications sont des étapes essentielles. Il arrive qu’un flacon contienne un autre produit que celui marqué sur l’étiquette. Nine se méfie aussi de la puissance des senteurs synthétiques ; un jour, elle a ajouté une goutte de trop à un litre d’alcool devenu alors écœurant. Une faute d’inattention impardonnable. « On ne jette pas l’argent par les fenêtres, mademoiselle ! » avait tonné le directeur. Concrète iris, bergamote, coumarine, rose de Bulgarie, lavande, musc kétone… des essences dont naissent des orages. Les murs du laboratoire s’effacent. Elle n’entend plus les murmures de ses collègues, les bruissements dans les alambics, la pétarade des camions qui défilent au-delà du mur d’enceinte. Le sang circule lentement dans ses veines. Lorsqu’elle finit sa dernière pesée, la tête lui tourne.
Le flacon l’attend à l’abri de la lumière dans un placard dont elle s’approche comme d’un tabernacle. Toute fragrance contient un élément mystique, quelques grammes évanescents, le poids de l’âme de son créateur. Jusqu’à aujourd’hui, Nine n’en mesurait pas l’importance. Il est vrai que, pour elle, c’est une première. Elle ne s’attendait pas à ce que Vincent Roubert la distingue parmi ses collègues et pour rien au monde elle ne voulait attirer l’attention. Jusqu’alors, elle se satisfaisait de réaliser les parfums des autres avec les règles de chimie comme tuteur rigoureux pour se tenir droite et traverser les tempêtes. Elle lui était avant tout reconnaissante de lui avoir permis d’intégrer une maison où elle espérait trouver quelque chose qui ressemblait à une famille. Puis, un jour, devant toute l’équipe, il l’avait désignée : « Nous comptons sur vous, mademoiselle Dupré. Vous êtes capable du meilleur, mais il faudra vous faire violence. » Elle avait rougi comme une débutante.
Elle lève la fiole à la lumière. Refroidi et filtré, le parfum ne s’est pas troublé lors des variations de température. La couleur est limpide, légèrement ambrée.
– Mademoiselle Dupré ? Je vous attends. Dépêchez-vous ! Je n’ai pas que cela à faire.
La voix impérieuse de Vincent Roubert la fait tressaillir. Elle serre instinctivement le flacon sur son cœur, saisie d’une folle envie de dérobade. Jean-Baptiste lui adresse des signes d’encouragement. Il est bien le seul. Dans les corridors, on s’écarte devant le directeur qui est responsable de la création depuis une décennie, sous l’égide d’un François Coty dévoré par ses ambitions politiques. Nine trottine avec déférence derrière lui, s’attirant quelques regards compatissants.
C’est toutefois une grande photographie du patron, immortalisé en col cassé et épingle à cravate emperlée, qui accueille Nine dans le bureau. Le regard perçant du maître de la parfumerie moderne cloue la jeune femme sur le seuil. Roubert s’impatiente et tend la main. Elle lui passe sa composition. Lui aussi étudie en premier la transparence du liquide. Il débouche le flacon avant d’y tremper une mouillette, redresse la tête pour éviter d’être distrait par les odeurs de ses propres vêtements, hume le produit avec de rapides inspirations puis expire fortement sans la quitter des yeux ni prononcer un mot. Nine a l’impression de se liquéfier. Le souvenir de son père l’envahit.
– Rappelez-moi l’inspiration de ce travail, mademoiselle.
– L’absence.
– L’absence, c’est le néant, et le néant n’a pas d’odeur.
– Mais la douleur qu’elle suscite en possède une, monsieur. Vive, acidulée, tenace. Une fois qu’elle vous a transpercé, on ne l’oublie pas.
– Je doute que les femmes aient envie de se parfumer à la douleur.
– Il existe pourtant des douleurs exquises, au même titre que des joies mauvaises. C’est le paradoxe des oxymores.
Il hausse les sourcils.
– Je ne vous connaissais pas cette impertinence. Depuis que vous travaillez ici, vous affichez le visage d’une élève docile. Les méchantes langues diraient même ennuyeuse. Mais j’ai l’intuition de vous avoir tirée de la grotte où vous vous complaisiez lâchement et je m’en félicite.
Il vérifie la touche avant de l’écarter.
– Pour votre première tentative, l’équilibre est réussi. Cela ne m’étonne pas de vous. La formule est courte pour une novice. Vous avez retenu la leçon de M. Coty. Sauf rares exceptions, les formules longues comme le bras ne rassurent que les médiocres. La note de tête est incisive, en effet. Et on n’échappe pas au chypre. Je comprends votre hommage au maître. Son harmonie d’exception autour de la mousse de chêne et de l’ambre gris est certes passée à la postérité, mais c’est attendu, non ? Vous vous raccrochez à ce que vous connaissez. Ce qui me surprend, en revanche, c’est cette tubéreuse que je ne reconnais pas…
Roubert plisse les yeux en fouillant dans sa mémoire olfactive riche de centaines de senteurs, parmi lesquelles il a puisé un floral aldéhydé baptisé L’Aimant, ce parfum magnétique destiné aux femmes ardentes que Nine porte le samedi soir quand elle sort dans les bars de Montparnasse.
– La Tuberosis de chez Givaudan, monsieur.
– Une de leurs nouveautés ?
– Oui, monsieur. J’ai pensé…
La jeune femme se met à bafouiller. Aurait-elle dû lui demander la permission ? La société Givaudan, ce n’est pas rien. On ne se sert pas de leurs produits comme dans un bazar ouvert aux quatre vents. Mais comment résister à la tentation ? L’essor de la chimie organique à la fin du siècle dernier a entraîné la plus grande révolution en parfumerie depuis la découverte de l’alcool. Il est désormais inconcevable de créer une fragrance sans rechercher l’harmonie entre ces corps synthétiques et les extraits naturels de fleurs ou de plantes.
– Et vous ne m’avez rien dit ? s’emporte Vincent Roubert. Franchement, qu’est-ce qui vous a pris ? On ne retient pas des échantillons Givaudan en otage !
Deux semaines auparavant, restée seule un soir à travailler, Nine avait éclaté en sanglots. L’échec lui tendait les bras. Elle s’en voulait. Comment osait-elle prétendre à autre chose qu’être une exécutante ? Chacun sait que même le meilleur chimiste peut se révéler piètre parfumeur. L’intuition et le talent qui confinent au génie chez François Coty imposent à d’autres des années de travail après un apprentissage exigeant. Il y a aussi comme une grâce divine et personne ne défie le Ciel. L’espace d’un instant, elle avait détesté Vincent Roubert.
Avant d’éteindre les lumières du laboratoire, elle était tombée sur le carton d’échantillons que venait de déposer le représentant de Givaudan. Ce n’était pas courant, car François Coty avait une prédilection pour leur principal concurrent grâce à qui il avait construit ses plus glorieux succès. Elle avait effleuré les flacons d’un vert émeraude opaque fermés par des bouchons de liège. Sur les étiquettes, une calligraphie élégante précisait les senteurs. En découvrant la première d’entre elles, une pointe d’excitation l’avait traversée. Si les différentes maisons de matières premières de synthèse utilisent les mêmes formules chimiques et souvent des appellations identiques, leurs substances n’ont jamais la même odeur. Tout est une question de pureté et chaque firme possède ses secrets de fabrication pour l’atteindre. Ainsi, Givaudan présente un univers qui lui est propre, éveillant chez un parfumeur un imaginaire singulier. Parmi les plus grands, certains ne jurent que par eux. Ce soir-là, Nine n’était pas rentrée chez elle. Jean-Baptiste l’avait trouvée profondément endormie le lendemain matin à son poste de travail, emmitouflée dans son manteau, la tête posée sur ses bras croisés.
– Je ne veux pas que cela se reproduise, compris ? poursuit Roubert. Cette Tuberosis vous a sauvé la mise mais je suis incapable de dire si vous l’emporterez. Le choix du jury se fera à l’aveugle. Voyez les modalités avec ma secrétaire. Le comité d’organisation a fourni le même contenant pour la dizaine de participants. Ils craignent qu’on départage les candidats à l’allure du flacon, ce qui nous donnerait évidemment un avantage.
Son téléphone en bakélite se met à sonner, une secrétaire passe la tête par l’embrasure de la porte pour lui annoncer que M. Coty est au bout du fil. Le grand patron est relié aux satellites de son empire par un réseau de lignes téléphoniques digne d’un petit État et un cycliste en uniforme porte ses missives entre ses multiples résidences et la Cité des parfums.
Le directeur décroche.
– Allez, ouste, et refermez la porte derrière vous !
Nine a l’impression de voler. Elle a remporté la première bataille. Elle se retient de courir. Lorsqu’elle parvient essoufflée au laboratoire, la pièce est déserte. L’horloge au mur indique midi passé. Elle range sa composition dans le placard avec la formule et le flacon tristement banal que lui a remis la secrétaire. N’ayant rien avalé depuis la veille, elle se découvre soudain une faim de loup. Jean-Baptiste doit être attablé chez Yvonne, l’une des meilleures ouvrières de l’usine devenue la patronne du café Le Longchamp où ils ont leurs habitudes. Elle dévale les marches en enfilant son manteau, quand retentit soudain une déflagration.
Le feu ou l’ennemi juré des chimistes. Leur plus grande hantise avec la toxicité des solvants. Nine reste paralysée au milieu de l’agitation, la tête levée vers les hautes fenêtres. Les vitres ont explosé. Des flammes gourmandes se repaissent des bouteilles d’alcools disposées sur les étagères, des eaux de toilette et de Cologne devenues autant de pièges. Un laboratoire est un cénacle de verre et d’acier, d’éclats tranchants, de produits nocifs. Les quatre éléments s’y côtoient : le feu, l’air, l’eau, la terre. Sans oublier l’homme, ce maître des transmutations, sorcier et démiurge, à la merci toutefois d’une flamme volage, d’un geste maladroit qui renverse un trépied ou casse une colonne à distiller. Ce danger, Nine le respecte davantage qu’elle le redoute. Elle n’aurait pas le courage de travailler entourée de combustibles si elle craignait le pire à chaque instant, d’autant que le pire n’est jamais là où on l’attend. Quelques minutes auparavant, elle se trouvait dans cette salle qui brûle. Quelques minutes auparavant, elle tenait dans la main le flacon de son premier parfum. Désormais, il n’y a plus rien. Ni parfum ni formule. Elle se met à trembler comme une feuille.
La sirène d’alerte est assourdissante. Tous les employés ont fui leurs bureaux. Les comptables ont les bras encombrés de dossiers d’où s’échappent des feuilles éparses. Il faut à tout prix empêcher que l’incendie se propage aux entrepôts où sont conservées les centaines de litres d’alcools. Une catastrophe qui réduirait la fabrique en cendres. Heureusement, la plupart des ouvrières sont rentrées déjeuner à la maison, notamment les jeunes mères qui allaitent leurs bébés et dont les horaires de travail ont été aménagés. Celles qui confient leurs petits à la crèche de l’usine se sont aussi absentées pour prendre un repas avec eux. On conduit à l’infirmerie un manutentionnaire avec des brûlures. Vincent Roubert est descendu dans la cour et dirige les opérations, ordonnant aux curieux de reculer. Tout a été pensé pour combattre les foyers d’incendie et la caserne de pompiers a aussitôt reçu l’alerte. Un camion pénètre déjà dans le périmètre. Les parterres sont piétinés, des tuyaux déroulés à la hâte et de puissants jets d’eau orientés vers le premier étage.
– Crénom ! Nine, tu n’as rien ?
Jean-Baptiste déboule à bout de souffle, son caban boutonné de travers. La jeune femme se tourne vers lui. Ses yeux sombres dévorent son visage défait.
– M. Roubert avait validé mon échantillon… Je l’ai laissé là-haut…
– Mais ta formule, elle est bien au coffre-fort avec les autres ?
– Non.
Elle a tâtonné pendant des mois afin d’ajuster les équilibres. Elle connaît les composants, bien entendu, mais elle n’est plus certaine des grammes utilisés pour chacun. Jamais elle n’aura le temps de tout recommencer. Ses efforts sont réduits à néant et avec eux l’espoir insensé de devenir quelqu’un d’autre. Alors que les cendres tourbillonnent sous le ciel laiteux, son camarade l’enlace pour la réconforter.
Ce n’est que quelques heures plus tard que Vincent Roubert reçoit l’autorisation de se rendre dans le laboratoire dévasté. Du verre brisé jonche le carrelage parmi les flaques d’eau sale. Les meubles et les instruments ne sont plus qu’un amas informe de tuyaux tordus. Une odeur âcre imprègne les lieux. Contrarié, le directeur attend des précisions sur la cause de l’accident. Un bec Bunsen resté allumé par mégarde ? L’explosion d’un récipient en verre et l’alcool à distiller qui se serait enflammé ? Il suffit de quelques secondes. D’un souffle. Le capitaine des pompiers se permet une allusion goguenarde à une mésaventure de Jean-Louis Fargeon, le parfumeur de Marie-Antoinette, qui le premier avait installé ses ateliers sur ces coteaux. Roubert lui lance un regard noir. Il n’est guère d’humeur à plaisanter. Il se tourne vers ses troupes, frottant furieusement ses lunettes rondes avec un mouchoir.
– Bon, on cesse de traînasser, messieurs. Il nous reste une petite heure de travail. Répartissez-vous au mieux. Mademoiselle Dupré, je devine à votre visage que votre échantillon fait partie des dommages collatéraux. Lyon, c’est quand, déjà ?
Nine, tétanisée, reste muette.
– L’ouverture de la foire est le jeudi 8 mars, monsieur, s’empresse de préciser Jean-Baptiste.
– Votre formule, vous l’avez mise à l’abri comme je vous l’ai appris, j’espère ?
Elle secoue la tête et il lève les bras, exaspéré.
– Dans ce cas, il n’y a pas une seconde à perdre. Les produits sont à la réserve qui a été épargnée, Dieu soit loué ! Le temps est court, je vous l’accorde, mais le défi n’est pas insurmontable. Le règlement m’interdit de vous aider mais j’ai confiance en vous. Vous parviendrez à la reconstituer.
– La Tuberosis, monsieur ? dit-elle d’une voix rauque.
Vincent Roubert jette un coup d’œil sur le petit tas de débris où brillent des éclats émeraude. L’essence, il la sent encore. La note caractéristique de l’absolue de tubéreuse reproduite et sublimée par la maison Givaudan, cette firme de réputation mondiale.
– Aux grands maux les grands remèdes ! Allez chercher un autre échantillon chez Léon Givaudan. Je vais l’appeler pour le prévenir. Ses bureaux sont rue Ampère, au numéro 36. Demandez au chauffeur de vous emmener. Inutile de perdre du temps.
Une demi-heure plus tard, des manifestants en colère encerclent la camionnette ornée de la griffe de François Coty qui rallie d’ordinaire Suresnes à sa fastueuse boutique de la place Vendôme. Au beau milieu de la chaussée, des dizaines d’hommes vocifèrent. La pression de la foule fait osciller la voiture. Jean-Baptiste se mordille les lèvres. Le chauffeur étant introuvable, c’est lui qui a pris le volant en criant à Nine de monter à côté de lui. Alors qu’ils franchissaient le pont sur la Seine à toute allure, il lui avait demandé de lui indiquer le chemin. Le nez plongé dans un plan trouvé dans l’habitacle, elle l’avait guidé de son mieux jusqu’à ce point mort.
Ils sont maintenant pris au piège. Un inconnu frappe du poing contre la vitre. Furieux, Jean-Baptiste l’injurie. Nine lui agrippe le bras, le suppliant de se taire. Un peu plus haut, des cars de police se mettent en travers de la route.
– Pourquoi ces crétins ne nous laissent-ils pas passer ? s’emporte-t-il. On ne va tout de même pas s’en prendre à la Chambre !
– Si, justement. Je l’ai lu dans le journal, ces gens-là veulent renverser la République.
– Quand on m’emmerde, moi aussi je veux renverser la République !
– Tu n’es pas un ancien combattant trahi par des politiciens corrompus.
– Mon père est mort comme un chien au Chemin des Dames. J’ai toutes les raisons d’en vouloir à la terre entière.
Un peloton de gardes mobiles remonte la file de voitures au petit trot ; les fers de leurs chevaux arrachent des étincelles aux pavés.
– Je continue à pied.
– Pas question, Nine ! C’est trop dangereux.
– Ce n’est plus très loin. Quelques rues après la place. Je t’attendrai là-bas.
– Dieu sait combien de temps je vais rester coincé ici. Je ne peux pas abandonner la camionnette. M. Roubert me tuerait. Il vaut mieux que tu rentres directement chez toi après ton rendez-vous. Mais fais attention, je t’en supplie !
Nine se penche pour embrasser son ami sur la joue puis ouvre la portière. Les vociférations montent d’un cran. La tête rentrée dans les épaules, elle se fraye un passage jusqu’au trottoir et longe les magasins dont les rideaux de fer ont été baissés. En prévision de l’émeute, on a retiré les grilles qui protègent les troncs des arbres et débarrassé tout ce qui pouvait servir de projectiles. Des pancartes sur les cafés annoncent la couleur : « Le 6 février, nous ne servirons ni les politiciens ni le gouvernement… » Depuis le soi-disant suicide en janvier d’un maître escroc répondant au nom d’Alexandre Stavisky, ces rassemblements enflamment le pays. La République est ébranlée tant l’affaire se révèle crapuleuse. Un détournement des économies de petits épargnants mâtiné de faux bons bancaires, de policiers véreux, de magistrats indélicats et d’hommes politiques au comportement si condamnable qu’ils ont entraîné la chute du gouvernement radical-socialiste quelques jours auparavant.
Une dizaine de réfractaires surgissent d’un bistrot en brandissant des chaises. « À bas les voleurs ! À bas les assassins ! Les métèques, dehors ! » Ils se ruent vers un cordon de policiers armés de matraques, leurs képis plantés bas sur le front. Heurtée dans le dos, Nine est projetée contre un immeuble. Des points noirs dansent devant ses yeux. Jean-Baptiste a raison, c’est trop dangereux. Mieux vaut rebrousser chemin. Mais alors qu’elle tente de faire demi-tour, le tourbillon des protestataires l’en empêche. Les clameurs et le fracas des vitres brisées attisent d’anciens cauchemars. Un bref instant, elle croit entendre les coups de feu des bolcheviques et respirer les émanations des maisons en bois moscovites qu’ils pillent et incendient. La nausée aux lèvres, elle se plaque contre un mur en tentant de se raisonner. Elle n’est plus une enfant, voyons ! Ce n’est pas la révolution russe. Personne ne veut la tuer. Elle reprend son errance, essaye de discerner les numéros de la rue Ampère tandis que le crépuscule descend sans que les becs de gaz ne soient encore allumés.
– Mademoiselle ? Vous êtes Nine Dupré ?
Un inconnu la saisit aux épaules.
– C’est bien vous qui venez de la part de Vincent Roubert ?
Elle s’accroche au regard qui fouille le sien, acquiesce.
– Dieu soit loué ! Je vous cherchais. Suivez-moi, vous alliez dans une fausse direction.
Comme elle chancelle, l’inconnu glisse un bras autour de sa taille pour lui faire traverser la rue, de l’autre il écarte les passants. Quelque peu hébétée, Nine songe que cet homme d’un certain âge, sans manteau et tête nue, risque de prendre froid à cause d’elle. Une concierge, l’air inquiet, monte la garde près d’une imposante porte d’entrée.
– Vous l’avez trouvée, monsieur Givaudan ? À la bonne heure ! Ah, mon Dieu, mais c’est qu’elle saigne, la petite !
Nine porte la main à son front. Le sang sur ses doigts. Comme autrefois.
– Ce n’est rien, les rassure-t-elle d’une voix blanche.
– Je vous trouve bien courageuse, bougonne Léon Givaudan. J’ai chapitré Roubert quand j’ai su qu’il vous avait envoyée ici. On était pourtant prévenus que la soirée allait être difficile. À croire qu’à Suresnes vous vivez dans un autre monde !
Il lui prend son manteau, puis une secrétaire l’emmène se rafraîchir et lui apporte du désinfectant. Nine soigne de son mieux sa pommette tuméfiée, passe ses doigts dans ses cheveux ébouriffés. Elle a le teint blême, des cernes, les lèvres pâles. Lorsqu’elle revient enfin dans le bureau de Léon Givaudan, les lampes allumées réchauffent les bois laqués et les reliures en maroquin dans la bibliothèque. Dehors, la nuit est tombée sur Paris. Un alcool blanc est posé sur un guéridon en bronze.
– Vodka. La fille d’Étienne Dupré ne prendra sûrement pas autre chose. Je me joins à vous.
Elle s’étonne.
– Comment savez-vous ?
– J’ai posé la question à Vincent Roubert lorsqu’il a mentionné votre nom de famille. Une légende de la profession comme votre père, cela ne s’oublie pas. Je l’ai rencontré autrefois à Moscou. Il était l’une des personnalités les plus brillantes de la colonie française. Je suis honoré de faire votre connaissance, mademoiselle.
Quand Nine saisit le verre à facettes, sa main tremble. Léon Givaudan l’observe d’un regard gris bienveillant. Sous la moustache poivre et sel, ses lèvres esquissent un sourire comme s’il cherchait à la rassurer. Le cœur de Nine se dilate. Un élan qu’elle n’a pas ressenti depuis longtemps réveille en elle la petite fille tempétueuse. Le désarroi de cette épouvantable journée se dissipe. Elle se surprend à redresser les épaules.
– Za Vashé zdarovié !
– À la vôtre !
Ils vident leur verre d’un trait. D’un air espiègle, Léon Givaudan jette le sien par-dessus son épaule tout en se retournant pour suivre sa trajectoire des yeux tandis qu’il se brise sur le parquet.
– Ouf ! J’aurais eu l’air malin si je les avais fracassés.
Derrière lui, une collection de flacons à parfum en porcelaine est exposée dans une vitrine. Nine s’en approche pour en examiner les personnages, cupidons ou grotesques de la comédie italienne, musiciens et bergères, mais aussi les singes facétieux et les oiseaux de paradis. Des étuis en galuchat voisinent avec des vinaigrettes, des boîtes à mouches et des nécessaires de poche en écaille. Çà et là brillent les résilles filigranées en or qui enserrent des écrins de cristal. L’insouciance, la poésie, la coquetterie du XVIIIe siècle. De charmants petits riens.
Comme cet homme aime l’allégresse, songe Nine.
Léon Givaudan est assis à son bureau, jambes étendues, chevilles croisées. Les ailes de son nœud papillon se détachent contre son col blanc amidonné à l’ancienne. Nine a retiré ses chaussures pour se blottir dans le fauteuil. Voilà deux heures qu’ils discutent à bâtons rompus, comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Lui n’a pas d’enfants, elle n’a plus de père. Ces deux-là se sont trouvés par un crépuscule de soir d’émeute.
À quelques encablures à vol d’oiseau, des manifestants érigent des barricades, lancent des projectiles sur les gardiens de la paix, tranchent les jarrets des chevaux de la Garde. D’anciens combattants appartenant aux ligues nationalistes s’élancent à l’assaut de la Chambre des députés. Pris de panique, les gardes mobiles tirent à bout portant sur la foule. Le sang coule sur les pavés de la capitale comme jamais depuis la Commune. À la lueur des torches, la République tangue tel un bateau ivre.
Léon a tiré les rideaux de velours pour éteindre la nuit. Selon les recommandations diffusées par le poste T.S.F., il n’est pas prudent de sortir. On conseille de patienter à l’abri. Drôle de défi pour quelqu’un qui a plutôt l’habitude d’aller vite et d’aller loin. Prendre le temps, c’est tellement contraire à son tempérament. Enfant, déjà, il dévalait à la tête de ses camarades les pentes de la Croix-Rousse pour se rendre à l’école. Combien de fois s’est-il écorché les genoux en dérapant sur les marches ? En 1895, il a fondé sa société alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de la majorité. Selon le Code civil, il n’avait même pas le droit de vote. Ils étaient deux, avec son frère aîné, à se lancer dans l’aventure, complices et solidaires, mais c’était bien lui, le garçon de vingt ans aux rêves pleins la tête, qui n’avait peur de rien.
Un brin nerveux, il fait tourner le verre entre ses doigts. En d’autres circonstances, il serait allé prendre le pouls de la ville place de la Concorde. Il préfère toujours se forger sa propre opinion. On lui reconnaît une prescience intuitive des êtres et cette qualité n’est pas pour rien dans sa remarquable réussite. Il choisit ses collaborateurs et ses clients avec la même sagacité. Mais il reste sagement calfeutré dans son bureau de réception à observer du coin de l’œil cette jeune femme qu’il n’attendait pas.
Nine Dupré flotte dans un tailleur dont la coupe laisse à désirer. Les traits affirmés de son visage offrent un équilibre de beauté romane. Nul cosmétique pour les sublimer ou les déguiser. Elle est vulnérable, sa sincérité d’autant plus désarmante que son regard trahit ses tourments. Elle redoute la violence de la rue et il veut lui épargner d’y être à nouveau confrontée. Il a remarqué le bleu qui se dessine peu à peu sur sa pommette et ce frémissement à l’évocation de son père disparu. Lui aussi a perdu le sien alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Il ne la connaît pas et pourtant il comprend ses silences.
Quel âge pouvait-elle avoir lorsqu’il a rencontré Étienne Dupré en 1910 ? Deux, trois ans ? Il se rappelle un homme au profil aquilin, le crâne poli comme un marbre que soulignaient d’imposants favoris, sa nature méfiante qu’il déguisait sous une affabilité pointilleuse. Sa luxueuse parfumerie de la rue du Pont-des-Maréchaux à Moscou ne désemplissait pas. Léon était loin d’être le seul à faire ce voyage devenu incontournable depuis le milieu du XIXe siècle. L’aristocratie russe parlait le français jusque dans ses rêves et la France offrait à l’empire la quintessence de ses artisans et industriels d’excellence. Joailliers, parfumeurs, soyeux, fourreurs, modistes venaient s’établir sans crainte, assurés de faire fortune. L’épouse et les filles adolescentes du tsar Nicolas II privilégiaient toutefois les bouquets impériaux de François Coty ou d’Ernest Beaux, et le talentueux Étienne Dupré n’avait pas eu le temps de détrôner ses rivaux. Les Romanov étaient tombés sous les balles des révolutionnaires ; les entreprises, les commerces et les demeures décorées d’œuvres d’art des expatriés français avaient été confisqués par le nouvel État. À discerner ce soir son sillage de flammes et de cendres, Léon a l’impression déconcertante que Nine Dupré emporte ce douloureux passé avec elle.
– Je ne vous laisserai pas rentrer seule, n’ayez crainte. Mais peut-être seriez-vous plus rassurée de dormir chez votre mère plutôt qu’à Suresnes ? La solitude, je connais bien. C’est une fausse amie.
Nine a perdu la notion du temps. Elle se laisse bercer par cette voix à l’intonation singulière, grave et légère à la fois. Or, le chagrin qu’elle y décèle la surprend. Les hommes qu’elle connaît sont avares en confidences. Elle interroge Léon du regard.
– Mon épouse est décédée il y a bientôt cinq ans. Notre appartement m’était devenu insupportable. Je pensais trouver une certaine consolation en déménageant à Neuilly avec vue sur le Bois. Mais chaque soir à mon retour du bureau, les branches que je vois par mes fenêtres sont nues et je n’ai personne à qui parler. Je n’entends que ma plume qui griffe mon papier à lettres. J’écris comme on dresse des brise-lames. Pour faire barrage au silence. Ce ne sont pas les murs qui conservent notre désarroi mais les replis de notre cœur, n’est-ce pas ? Et un cœur, hélas, on l’emporte partout avec soi.
Anne-Marie et lui, quelques années de mariage seulement, des poussières au regard d’une vie. Ils n’étaient plus si jeunes lorsqu’ils s’étaient enfin trouvés. Elle lui avait redonné goût à la connivence, à un avenir dessiné à quatre mains. Il l’avait tant aimée pour cette espérance. Et cette douceur. Si différente de la passion de sa première union, lorsqu’il s’était élancé du haut de la falaise avec une femme que les convenances lui interdisaient d’épouser, une Américaine divorcée à laquelle il n’avait pas résisté, qu’il avait imposée envers et contre tout. Mais ce mariage-là s’était tenu à Londres, tellement loin des siens. Douze années tumultueuses et l’échec d’un divorce. Il est plusieurs vies dans une vie, Léon Givaudan en est persuadé. De cette vérité, si seulement il pouvait convaincre la jeune femme avec laquelle il dérive.
Nine tire une bouffée de sa cigarette et retient la fumée. L’âpreté est la bienvenue. On lui a enseigné très jeune à puiser un réconfort dans la beauté. Aussi est-elle apaisée par l’élégant mobilier en bronze patiné, les ornements d’acanthe, les cuirs fauves et les marbres noirs, une sobriété virile que tempèrent les soieries d’ameublement. Cela fait longtemps qu’elle n’a pas parlé sans retenue. Ceux de sa génération détestent ressasser un passé qui a déchiqueté leur enfance. Ils gardent les yeux fixés sur l’avenir, aussi obscur et incertain soit-il. Quant à sa mère et ses proches, exilés de la Russie impériale, ils se sont transformés en statues de sel depuis bientôt vingt ans. Il n’y a pourtant rien à espérer à regarder derrière soi. Les Rouges ont vaincu. Staline et sa clique se glorifient d’avoir détruit Sodome en promettant à l’humanité un monde meilleur, et tant pis pour le sang qui coule d’entre leurs poings.
– Il m’arrive de passer des journées entières sans penser à lui. Je sais être heureuse. Puis une lame de fond me balaye et j’ai l’impression de sombrer. Je n’arrive pas à guérir de son absence… Mon père et moi, c’était une promesse de bonheur qui a été rompue. Le plus souvent, j’évite d’en parler. Qui n’a pas perdu quelqu’un à cause de la guerre ? Vous avez été mobilisé en 1914, monsieur. Vous savez bien que nous sommes tous des orphelins.
– Certains le sont plus que d’autres. Vous avez perdu votre père assassiné par les bolcheviques, mais aussi la terre où vous êtes née et où vous avez grandi. Sans compter son entreprise. Sans doute votre frère pensait-il prendre sa succession ? Il doit être meurtri, lui aussi.
– Mon frère est plus habile que moi. Il a trouvé la parade : la colère et l’action. Avant la révolution, mon père s’apprêtait à transformer la raison sociale de sa firme en « Étienne Dupré & Fils ». C’était sa grande fierté. Si mon journal de petite fille n’avait pas brûlé avec le reste, vous auriez lu dans mes gribouillis « Étienne Dupré, Fils & Fille ».
Léon perçoit une blessure secrète. Il connaît ces premières places accordées à leur fils par les entrepreneurs, une tradition particulièrement maintenue chez les parfumeurs. Roubert lui a néanmoins confié qu’elle était la meilleure de ses élèves. Lors des exercices olfactifs qu’il leur impose une fois par semaine en leur demandant d’identifier une quinzaine de matières premières, elle se trompe bien moins souvent que les autres et il ne lui faut qu’une dizaine d’essais pour reproduire un modèle de parfum, là où ses jeunes confrères s’y reprennent à vingt fois.
– J’ai peur de ne pas arriver à recomposer la formule à temps, murmure-t-elle. Je ne suis pas sûre des proportions.
Il ouvre un tiroir dont il sort un flacon de Tuberosis.
– Dans le doute, forcez la note. Les meilleurs parfums sont ceux de l’excès.
Nine sait que François Coty ne le contredirait pas. S’il ne fut pas le premier parfumeur à utiliser des produits de synthèse, il fut le premier d’entre eux à ne pas redouter leur puissance et à oser célébrer leur insolente modernité.
– L’excès, ironise-t-elle. Faut-il donc être un révolutionnaire pour réussir dans la vie ? L’outrance n’apporte que désolation. Je suis quelqu’un de l’ombre et du silence.
Léon ne se hasarde pas à la contredire, mais ce n’est pas ce qu’il perçoit de son tempérament.
– Où est l’enfant qui notait ses aspirations dans son journal ?
– Elle est morte depuis longtemps et j’ai déposé une brassée de fleurs sur sa tombe.
– Pourtant, cette enfant-là a été choisie pour représenter la maison de mon ami François Coty lors du prestigieux concours des jeunes parfumeurs. Vincent Roubert m’a dit que c’était votre première composition. Je suis flatté que nos créations vous aient inspirée. J’espère que ce sera le début d’une belle histoire entre nous.
Elle lui lance un regard suspicieux. La maison Givaudan est encensée de par le monde pour la qualité constante et la pureté olfactive de ses productions toujours à la pointe de l’avant-garde. En quoi pourrait-elle apporter une pierre à cet édifice déjà notoire ?
– Les parfumeurs qui vous sont fidèles disent que vous portez chance.
– Vous m’en voyez ravi ! Disons que c’est surtout une question de loyauté et de confiance entre eux et nous autres, fabricants de matières premières. Vous le comprendrez en grandissant, chère Nine, car vous devez encore grandir. Comme j’ai l’âge d’être votre père, je me permets cette familiarité. Mais vous avez raison, la chance n’est pas un élément à négliger. Mon frère considère que nous lui sommes redevables pour l’essor rapide de notre affaire.
– Personne ne pense que votre réussite est due à la chance.
– Il faut aussi de la témérité, c’est vrai. Elle seule permet l’innovation. Voilà pourquoi la fortune vous sourira. Peut-être même dès le mois prochain.
Nine déplie ses jambes et se penche pour enfiler ses chaussures. C’est malheureusement une qualité qui lui est étrangère. Elle a peur de son ombre et Vincent Roubert lui a forcé la main. Elle n’a même pas eu le courage de refuser de prendre le risque de le ridiculiser.
– Vous a-t-on dit que j’étais le président du jury cette année ?
– Non, je l’ignorais, fait-elle, le rouge aux joues.
– Lyon est ma ville natale. Je n’y habite plus, hélas, mais elle demeure très chère à mon cœur. Mon frère et moi y possédons des manufactures de produits chimiques et pharmaceutiques. Le feu ne nous a pas épargnés non plus. Le dernier incendie a ravagé deux bâtiments de six cents mètres carrés et fait exploser six dépôts d’alcools. C’était il y a trois ans. Aucune victime à déplorer, heureusement. Nous avons rebâti sans attendre, comme toutes les fois précédentes. Après chaque destruction, chaque échec, nous avons toujours rebâti. En mieux.
En lui remettant le flacon, il retient sa main entre les siennes.
– Lyon a fait de mes frères et moi ce que nous sommes. Elle est le berceau de notre inspiration. Xavier, Claudius et moi, nous lui devons tout. Vous verrez, c’est une ville qui vous enseigne l’audace.
Elle regrette d’être venue avant que ses contusions se soient résorbées, mais elle rend visite à sa mère une fois par semaine, qu’il vente ou qu’il neige. Un manquement l’aurait inquiétée et Nine cherche à lui éviter toute anxiété. Son frère s’en charge pour deux.
– Où vas-tu habiter ? Une semaine toute seule dans une ville de province que tu ne connais pas, c’est beaucoup. Pourquoi veulent-ils que tu passes autant de temps là-bas ? Dis-leur que tu refuses.
Sophie Dupré s’active autour du samovar pour préparer le thé. Ses omoplates pointent sous le châle que Nine lui a offert pour Noël. Des mèches grises s’échappent de son chignon enroulé à la hâte. Elle dépose une tasse en porcelaine devant sa fille, lui tend avec insistance une assiette de petits gâteaux rances.
– Lyon, ce n’est pas la jungle, maman. Ils ont l’eau courante et l’électricité. Même le téléphone, paraît-il.
– Ne te moque pas. J’ai des raisons de me faire du souci. Regarde-toi dans un miroir, ma pauvre chérie. Pour une fois, tu devrais t’arranger un peu. C’est idiot de travailler chez Coty sans en profiter. Dieu sait ce que les gens doivent penser.
Nine mord dans un biscuit pour ne pas répondre. Sa mère est une artiste. Elle vernisse comme personne les coups de griffe qui égratignent le cœur. Un talent qui a pris son envol de façon inversement proportionnelle à son existence qui s’est recroquevillée dans ce trois-pièces étriqué, bas de plafond, saturé de réminiscences de la Russie impériale, avec une vue imprenable sur une cour aveugle où un érable n’en finit pas de mourir. Sophie Dupré ou les regrets éternels. La femme de Loth. Celle qui se retourne et se statufie. Dans le livre de la Genèse, Loth réussit à s’enfuir. Une chance qui n’est pas donnée à tout le monde.
Nine observe les mains tavelées, les veines qui courent sous la peau, l’alliance en or que retient un anneau de médiocre qualité pour l’empêcher de glisser de l’annulaire. Tassée dans son fauteuil, sa mère boit son thé noir comme s’il s’agissait d’un nectar. Le camée épinglé sur son col de chemise est de travers. Nine se retient de le redresser. Cette prisonnière volontaire n’échappera jamais au passé et ses deux enfants ne peuvent l’y abandonner sans la trahir. Dès son arrivée, Nine a remarqué ses lèvres pincées. Son frère a dû encore dépenser sa paye au jeu ou faire le coup de poing contre des communistes lors d’une manifestation. L’autre soir, il y a eu de nombreuses victimes à la Concorde. Alexandre appartient à la ligue Solidarité française qui compte deux morts et une vingtaine de blessés parmi ses rangs. En l’apprenant par les journaux, Nine s’est demandé s’il pouvait en être, mais le téléphone du secrétariat de l’usine n’a pas sonné. Elle a été rassurée car les mauvaises nouvelles n’attendent pas. En dépit de tout, Alexandre est son frère. Son aîné qui ne grandira jamais. La porte de sa chambre reste close. Aucun bruit ne leur parvient. Nine tend toutefois l’oreille, aux aguets, une habitude de son enfance. Lorsqu’ils ont échoué là tous les trois elle avait douze ans, et lui, à quinze ans, se prenait déjà pour un homme. Une posture d’autorité pour dissimuler qu’il avait aussi peur que sa mère et sa sœur.
Elle fait tenir la tasse ébréchée en équilibre sur une pile de journaux où s’entassent de vieux exemplaires de L’Ami du peuple, le quotidien nationaliste et xénophobe fondé par François Coty dans lequel Alexandre écrit des chroniques au vitriol, et d’autres de Renaissance, un bulletin antisoviétique publié par les émigrés russes. Sa mère ne jette jamais rien. Les publications jaunissent, les tiroirs ne ferment pas, les armoires sont obèses. Une fois par mois, Nine consacre son dimanche à faire le tri, ce qui revient à vider l’océan avec une cuillère, emportant quelques journaux pour alimenter son poêle défaillant. Bien qu’elle n’ait pas un sou vaillant, Sophie Dupré écume les brocantes de son quartier d’Auteuil et celles de Boulogne-Billancourt où les familles exilées se défont de leurs derniers oripeaux. Cette gardienne de la mémoire russe sans une goutte de sang slave reconstitue son passé confisqué avec les objets d’autrui – modestes icônes, étoffes défraîchies, bougeoirs et lithographies de pacotille, petites cuillères en argent aux armoiries inconnues… Une somme de chagrins anonymes qui embaument ce tombeau avec leurs senteurs de lilas et de poussière blanche.
– Je suis envoyée à Lyon parce que je participe à un concours dédié aux jeunes parfumeurs.
Sa mère relève brusquement la tête. Nine lui explique la décision de Vincent Roubert. Son travail acharné pour présenter une composition cohérente. L’incendie et la rencontre avec Léon Givaudan. Cette bienveillance. Leur connivence inattendue.
Le pouls de Nine s’emballe.
– Tais-toi, maman ! Tu le penses tellement fort que je t’entends comme si tu criais !
Elle ne supportera pas d’entendre sa mère dire tout haut ce qu’elle lit dans son regard. Oui, elle est indigne de la mémoire de son père. Non, elle n’a pas hérité de son talent. Oui, tout cela est une hérésie. Et Sophie Dupré de rester silencieuse, recroquevillée sur son siège, les mains jointes comme en prière, accablée par son amour défunt et toutes ses peurs, réelles et imaginaires. C’est un petit miracle. Certains mots peuvent tuer.
Les fenêtres disjointes laissent passer un filet d’air glacé bien que Nine les ait calfeutrées avec du papier carton. À Moscou, les doubles vitres de leur demeure les protégeaient d’un froid autrement plus mordant. Sa mère resserre le châle autour de ses épaules. Nine étouffe, saisie de compassion. Elle la revoit épinglant ses cheveux avant d’enfiler sa robe noire pour aller travailler. Sa mère traversait la ville en tramway jusqu’à Montparnasse. Nine devait découvrir seulement bien plus tard qu’elle n’était pas l’assistante du directeur du restaurant La Closerie des Lilas, mais qu’elle passait ses soirées au sous-sol à assurer la propreté des lieux d’aisances.
Et pourtant, aucune complicité n’est née de leurs défaites.
Aux premiers temps de la guerre, tout avait été presque facile. La France et la Russie étaient alliées. Bienfaitrice au Comité des femmes de France de Moscou, Sophie Dupré veillait sur les soldats russes accueillis dans l’hôpital créé dans une dépendance de l’usine Dupré. Elle y emmenait sa petite fille qui leur offrait les bonbons réputés de chez Siou. Puis étaient venus les vents mauvais de l’insurrection bolchevique, les pillages et les bombardements, la faim et le froid, le typhus qui rongeait une ville réduite à la misère. Des certificats de protection avaient été délivrés par le consulat de France. Le nouveau gouvernement avait quitté Petrograd pour s’installer au Kremlin, imposé la réquisition des maisons avant l’expropriation des biens, mais sans indemnités.
Les Dupré avaient patienté avec les industriels et commerçants français, convaincus que tout allait finir par s’apaiser. Aucun peuple ne peut vivre dans le chaos. Leur choix n’en était pas un. On n’abandonne pas en un claquement de doigts sa fortune et ses souvenirs familiaux, deux cents employés, des magasins à Moscou et Petrograd, l’avenir de ses enfants. On n’abandonne pas le travail d’une vie pour retourner dans un pays dont on ne sait presque rien même si l’on en détient le passeport. Une France qui sort exsangue de quatre années de guerre. Même si ses compatriotes partaient les unes après les autres, Sophie était restée, refusant d’obéir à son époux qui lui demandait de se mettre à l’abri. Chaque fibre de son être était à lui depuis le jour de leur mariage. Elle avait une foi absolue en sa capacité à les protéger, elle et leurs enfants, jusqu’à ce petit matin où Étienne Dupré avait été emmené par les gardes rouges pour ne jamais revenir.
Le choix, une nouvelle fois, n’en était pas un. Il y avait eu les papiers délivrés par le Bureau des rapatriements, les visas de sortie, le voyage vers l’exil dans un wagon à bestiaux depuis Moscou en ces maudites journées de février 1919. Le trajet à pied jusqu’à la frontière finlandaise. Une valise et des baluchons abandonnés dans la neige. Et une mère et sa fille qui s’égarent en chemin. Depuis, entre elles, l’harmonie n’est jamais revenue. Leurs émotions sont rêches, empreintes de tristesse ou de colère, parfois adoucies par des notes de nostalgie et une tendresse improbable. Toujours à contretemps. C’est à en crever de solitude.
Sophie Dupré n’attend de sa fille qu’un gendre et des petits-enfants. Il y a bien eu ce fiancé presque parfait. Un exilé lui aussi, un Russe blanc, un vrai de vrai par le sang et le patronyme. Nine avait vingt ans et la lassitude chevillée au cœur. Elle avait cédé sous les coups de butoir maternels, acceptant de rentrer dans le rang en épousant ce garçon au regard d’un bleu trop pâle. Il avait un corps blanc et souple. Il faisait l’amour comme on se noie. Quelque chose s’était cabré en elle la veille du mariage. Son frère avait crié qu’elle déshonorait leur famille. Sa mère avait sangloté.
– Je vais me rendre à Lyon parce que Vincent Roubert me fait confiance. Je pense que papa aurait été fier de moi.
Le silence est assourdissant. Le cœur de Nine se serre. Elle perpétue une mémoire. Elle est l’héritière d’Étienne Dupré même si sa mère aurait tout donné pour que cela soit Alexandre. Encore un non-dit. Hélas pour Sophie Dupré, c’est bien sa fille qui porte cette ambition de rendre le monde plus beau, une aspiration que partagent Jacques Guerlain, François Coty, Vincent Roubert, Ernest Beaux et tant d’autres. Une folie douce à laquelle ces artistes ont dédié leur vie. Car il faut être fou ou prophète pour chercher à séduire par le plus énigmatique des cinq sens, celui qui alerte au danger, suscite la répulsion ou invite à la volupté, qui reconnaît le langage archaïque et sacré des aromates, des fleurs et des alcools. L’odorat, ce sens vulnérable à l’encens qui parle aux Cieux, aux suaves accords d’une fraîcheur innocente comme aux puissantes émanations de corps enfiévrés. Sensible, surtout, aux éblouissements nés de l’imaginaire de ces magiciens qui exaltent le secret des peaux qui se répondent, subliment la passion et annoncent la vérité. »
À propos de l’autrice
 Theresa Révay © Photo Astrid di Crollalanza
Theresa Révay © Photo Astrid di Crollalanza
Theresa Révay est romancière. Elle a notamment publié L’Autre Rive du Bosphore (prix Historia du roman historique 2014), La vie ne dure qu’un instant (prix Simone Veil 2017) et La Nuit du premier jour (2020). Ce parfum rouge est son onzième roman. (Source : Éditions Stock)
Page Wikipédia de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte X (ex-Twitter) de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice
Tags
#ceparfumrouge #TheresaRevay #editionsstock #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #NetGalleyFrance #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #parlerdeslivres #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie




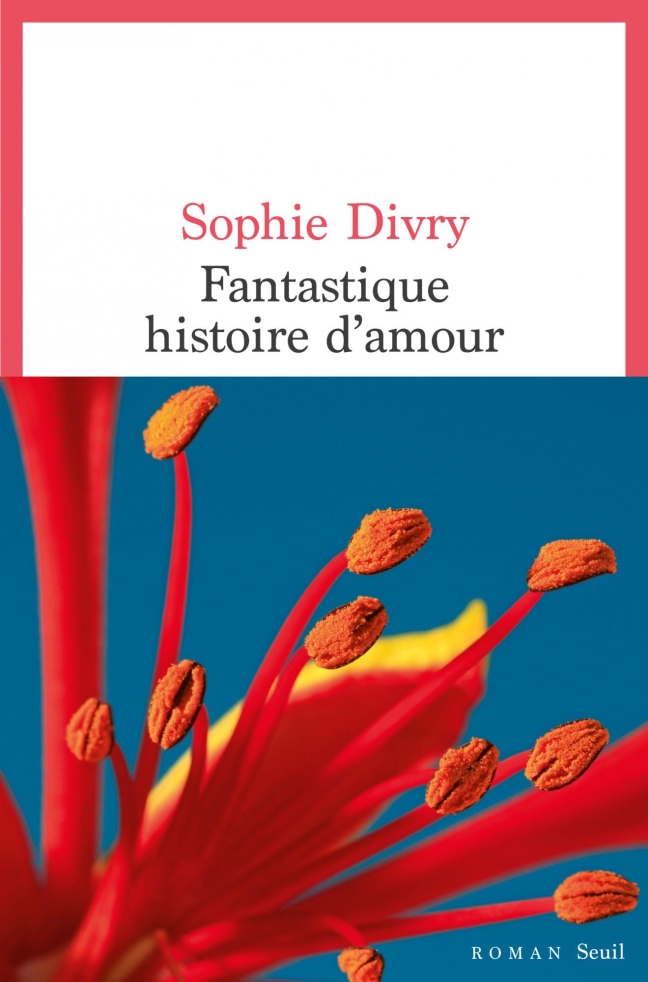


 Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot
Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot







 Isabelle Rodriguez © Photo Chloé Vollmer-Lo
Isabelle Rodriguez © Photo Chloé Vollmer-Lo


 Aurélien Delsaux © Emmanuelle Lescaudron
Aurélien Delsaux © Emmanuelle Lescaudron


 Carole Fives © Photo Francesca Mantovani
Carole Fives © Photo Francesca Mantovani

 Paola Pigani © Photo Melania Avantazo
Paola Pigani © Photo Melania Avantazo