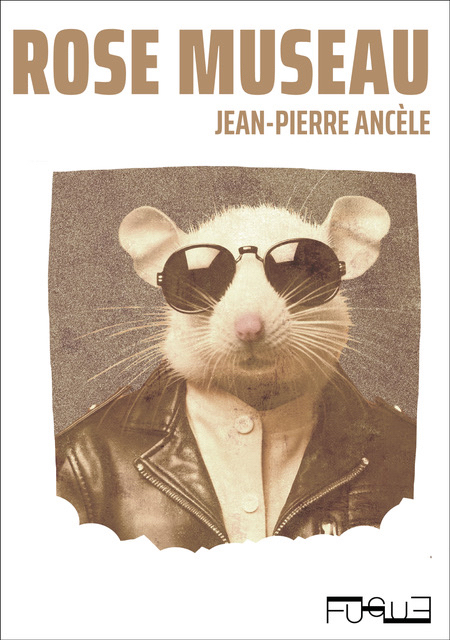En deux mots
Une jeune fille qui quitte son Kansas natal pour New York, un jeune homme, descendant d’une famille juive viennoise va tenter de redorer le blason de sa famille, une intouchable va réussir à quitter l’Inde pour étudier à l’Université de Columbia, un jeune californien va chercher à se construire un avenir en passant par le Julliard School. Autant de destins qui vont se croiser dans ce roman choral très réussi.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
«La malédiction de l’espoir»
Voilà un premier roman qui fera date ! En entremêlant des parcours très différents, Renaud Rodier réussit une vaste fresque pleine de bruit et de fureur, mais aussi de résilience et d’humanité. Dans leur quête, les personnages vont se croiser et s’enrichir de leur confrontation.
Voilà sans conteste l’un des romans les plus aboutis de cette rentrée. Après un prologue un peu déroutant – la confession d’un homme qui court sur un pont qui n’a pas de fin – on va découvrir les différents personnages au fil des chapitres, à commencer par Lauren Bairnsfather.
Née à Kiowa, un trou perdu du Kansas, la jeune fille va mener une vie solitaire, perchée dans la cabane sur un arbre construite par son quincailler de père, qui passe le plus clair de son temps à bricoler dans son garage. Avec son voisin Kip, tout aussi secret qu’elle, ils vont connaître un parcours scolaire assez tourmenté, qui va culminer lors du bal de fin d’année, dont Lauren sera l’une des rares survivantes. Car c’est avec un fusil mitrailleur qu’un élève va se venger de toutes les humiliations et frustrations subies. Il va transformer la fête en un bain de sang. Lauren décide alors de partir pour New York.
Aaron Friedmann est quant à lui le descendant d’une famille juive de Vienne. Son grand père a échappé aux camps de la mort pour se réfugier à New York. Une histoire qu’il ne découvrira toutefois que bien des années plus tard, après la représentation de Brundibár au Metropolitan. Ce n’est en effet qu’en 1983, après avoir interprété un rôle dans cet opéra pour enfants écrit en 1942, et qui fut mis en scène dans le camp de Theresienstadt, qu’il pourra reconstituer le parcours de sa famille.
Émilie Ruelle est fille d’expats, passant de Rio à Caracas, avant d’atterrir à Mumbai en Inde. C’est là qu’elle fera la connaissance d’Aashakiran Yengde, ou plus simplement Aasha, une intouchable qui va devenir sa meilleure amie. Jusqu’au jour où elle est congédiée pour un vol de bijoux qu’elle n’a pas commis. En rupture de ban, Émilie part alors aussi à New York, plus précisément à l’Université de Columbia.
Quand Kip prend à son tour la parole, c’est pour nous donner sa version de l’histoire, et dévoiler ce que Lauren ignore.
Puis ce sera le tour d’Aasha de rétablir quelques vérités sur ses rapports avec son père, ses relations avec Émilie et sur le financement des ses études dans la prestigieuse Caltech.
Nathaniel Bridge vit pour sa part à Monterey en Californie avec son père Adam. Par un soir de tempête, ils recueillent Olivia, tombée en panne non loin de leur villa. La belle naufragée restera finalement sept ans aux côtés du scénariste et de son fils, avant que ce dernier ne quitte l’adolescence et la Californie pour la Juilliard School de New York.
Puis vient le tour de Harry Bairnsfather de dévoiler un secret de famille, après avoir raconté sa rencontre avec sa femme Becky. Et souligner, pour l’ancien Marine revenu du Vietnam en pièces, que «le mariage, encore plus que la guerre, lui a enseigné que les mensonges sont parfois plus utiles à la survie que la vérité.»
Dans la seconde partie du livre, comme vous vous en doutez, l’auteur va faire se croiser les différents personnages. Émilie va entrer dans la vie de Lauren, puis les deux nouvelles amies vont assister l’une après l’autre à une pièce de théâtre dans laquelle joue Nathaniel. Aaron quant à lui, croisera Lauren sur la grande-roue de Coney Island, ou plus exactement fera croire au hasard de cette rencontre. C’est aussi lui qui fera la connaissance d’Aasha dans les eaux du lac Baïkal. Mais arrêtons-là. Je vous laisse découvrir par vous-mêmes ces fils tissés entre les uns et les autres, cette habile construction romanesque qui permet de mieux cerner, page après page, la personnalité et la psychologie de personnages auxquels on s’attache très vite, notamment en raison de leurs failles et de leurs doutes.
Renaud Rodier a réussi une fresque d’une grande humanité qu’il a lui-même très joliment résumée : «L’histoire tournerait autour de quatre protagonistes, des antihéros esquintés par leur enfance, et de leur quête de l’âme sœur, cet «autre moi» fantasmé, seul à même de les arracher à leur spleen. Une sorte de quête baudelairienne, où l’Idéal et le Beau seraient incarnés par une figure distante et fugitive qui manifesterait ce gouffre croissant entre ce qu’ils étaient et ce qu’ils auraient été capables d’être, la malédiction de l’espoir.»
Les échappés
Renaud Rodier
Éditions Anne Carrière
Premier roman
400 p., 23 €
EAN 9782380823035
Paru le 5/01/2024
Où?
Le roman est situé aux États-Unis, à Kiowa dans le Kansas, à New York, dans le Massachusetts, à Monterey et Los Angeles, en Californie et Basse Californie, à Coaldale, Nevada et à Ogunquit dans le Maine. On y évoque aussi Vienne, Jérusalem, le Missouri, Moscou et le parcours du Transsibérien, l’île de Tristan da Cunha, Ushuaïa et la région de la Terre de feu, le désert chilien d’Atacama, l’Équateur, Londres, Paris et enfin Lukla au Népal, non loin de l’Everest.
Quand?
L’action se déroule de 1979 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Lauren, étouffée par le silence d’une bourgade du Kansas, part se réfugier à New York après une fusillade meurtrière dans son lycée. Aaron, héritier d’un empire mafieux à la mort de son père, peine à mettre ses ressources au service de ses victimes. Émilie, talentueuse interprète aux Nations-Unies, perd la parole à la suite d’une simple erreur de traduction. Nathaniel, star planétaire, décide de disparaître pour fuir ces superproductions qui le consument. Aashakiran, une intouchable née dans un bidonville de Mumbai, cherche son avenir à travers l’oculaire d’un télescope, jusqu’à oublier ses origines. Leurs histoires se chevauchent. Leurs exils les rapprochent.
Renaud Rodier s’impose, grâce à ce premier roman, comme le formidable cartographe d’une génération en déshérence. Ode à l’audace, à la résilience et à la recherche de soi dans un monde en constante transformation, Les Échappés transcende les frontières et voit dans nos blessures les plus intimes quelque chose d’universel.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Actualitté (Hocine Bouhadjera)
La presse du soir (Entretien avec l’auteur)
Les premières pages du livre
« Prologue
Un jour, il y a bien longtemps, je me suis réveillé à même le bitume, sur ce pont désert où j’allais passer le reste de ma triste existence. Il faisait nuit noire. Remarquez, il fait toujours nuit ici, quelle que soit l’heure. Je suis plongé dans une obscurité perpétuelle que seul érafle le halo orangé et tremblant des lampadaires, tous les cinquante mètres. Le soleil semble avoir abandonné sa course puérile avec les ténèbres. Icare l’a sans doute embarqué dans sa chute, pour aller s’abîmer dans les flots mugissants qui m’entourent dans un grand plouf. Même les étoiles et la lune manquent à l’appel, comme si leur timidité naturelle avait finalement eu raison d’elles.
À première vue, rien ne distinguait vraiment cette créature d’acier et de béton armé d’autres ponts à haubans. Ses dimensions impressionnantes lui conféraient une certaine majesté, soit, mais ses éléments de structure étaient somme toute assez banals. Son tablier accueillait une autoroute à quatre voies parfaitement rectiligne. De gigantesques pylônes supportaient son poids grâce à de longs câbles obliques qui lui donnaient un côté toile d’araignée. Je me suis penché sur le garde-corps pour regarder en bas, mais n’ai vu que cette nappe de brume qui colle aux piles. À ma grande tristesse, ce brouillard gris et gras ne s’est jamais suffisamment dissipé pour me laisser entrevoir cette mer que le pont cherche à enjamber. Par gros temps, ce dernier se met néanmoins à onduler avec le ressac et à hululer dans la nuit sans étoiles. J’entre alors en communion avec la houle, en joignant mes gémissements aux siens.
J’étais totalement seul mais ne m’en inquiétais pas outre mesure. Je m’attendais encore à croiser le chemin d’un véhicule ou d’un piéton sous peu. Une âme charitable rirait de ma confusion, m’expliquerait où je me trouvais et m’offrirait un café brûlant pour me réchauffer. Je n’ai abandonné tout espoir de secours que bien plus tard. Mon isolement s’est peu à peu transformé en exil ; une forme de solitude en a remplacé une autre. Pour une raison que j’ignore, le pont n’a jamais été inauguré, ou a été laissé à son sort.
N’escomptez pas que je vous dise combien d’années se sont écoulées depuis mon arrivée. Je n’en ai pas la moindre idée. Au début, j’ai pourtant bien essayé de garder la notion du temps. Je consultais ma montre Casio toutes les cinq minutes mais elle s’est arrêtée au bout de quelques mois. Satanées piles chinoises ! Puis j’ai compté les jours. N’ayant aucune certitude que mon horloge biologique reste synchronisée avec une horloge atomique, j’ai dû me faire une raison, et laisser du temps au temps, de manière littérale. Parfois, j’ai l’impression que je suis ici depuis une dizaine d’années ; d’autres fois, depuis un siècle. Tout dépend de mon humeur. La vérité se situe sans doute entre les deux, si je me fie au vieillissement de mes mains. À mon réveil, j’étais encore un homme dans la force de l’âge, avec de belles paluches larges et vigoureuses. À présent, elles sont pareilles aux serres d’un rapace, avec leurs griffes longues et courbes, brisées par endroits. Je ne les examine plus que très rarement, car il n’y a rien de plus déprimant que les mains d’un vieux. Bien des années après que ma montre s’est arrêtée, je l’ai jetée par-dessus bord, dans un geste de colère, comme pour dire merde au temps qui passe, en traître, sans avertissement. Je ne l’ai pas entendue s’écraser dans l’eau comme je l’avais espéré. C’était un jour de mauvais temps. La mer l’a engloutie sans un bruit, comme le pont m’a moi-même englouti.
Après quelques tergiversations, je me suis mis à explorer cette foutue passerelle. Je me suis dirigé d’abord vers le sud, ou du moins la direction que je désignais comme telle. Faute de pouvoir m’orienter avec les astres, je m’en suis remis à l’arbitraire, sans résistance stérile. Le premier jour, j’ai trotté une quinzaine d’heures, à un rythme soutenu, ne m’arrêtant pour uriner qu’une ou deux fois, au travers du garde-fou pour ne pas poisser la chaussée immaculée. J’ai couvert une distance d’environ soixante-dix kilomètres, avant de m’effondrer. Quand j’ai rouvert les yeux, un cheeseburger, des frites et une bouteille de Coca-Cola étaient apparus comme par magie, soigneusement alignés à ma droite. Ce mauvais tour aurait dû me décontenancer, mais je crevais de faim. Quel festin ! Le steak haché était juteux à souhait, les petits pains moelleux, les frites croquantes et très salées, le Coca-Cola glacé. J’étais loin de me douter que je me nourrirais de fast-food pour le restant de mes jours – chaque maudite journée. Mes repas ne sont livrés que quand je suis inconscient.
Au bout de deux ou trois mois, je me suis rebellé contre ce régime alimentaire de redneck. J’ai entamé une grève de la faim, en refusant de dormir. J’ai tenu soixante-douze heures puis me suis écroulé, saoul de fatigue. À mon réveil, un cheeseburger m’attendait sur le macadam, rendu plus appétissant par le jeûne. J’ai mis mes principes de côté.
Le deuxième jour, j’ai parcouru dix-neuf kilomètres à peine, en clopinant. Mes pieds couverts d’ampoules m’ont fait atrocement souffrir. Le troisième jour, j’ai serré les dents pour couvrir une distance de soixante-quatre kilomètres. Le quatrième, rebelote. Je n’ai réellement compris la gravité de ma situation que ce soir-là, même si un pont déserté et une nuit sans fin auraient dû me mettre la puce à l’oreille bien auparavant, je le reconnais volontiers. Sur la base de mes calculs, j’avais déjà parcouru deux cent vingt kilomètres, soit une cinquantaine de plus que le viaduc Danyang-Kunshan, qui détient le record mondial. Entre parenthèses, rien n’indique que ce pont soit asiatique, africain, américain ou européen. Il est dépourvu de toute signalisation routière. Le béton et l’acier sont muets, et tous les ponts se ressemblent, où que l’on se trouve, n’est-ce pas ? N’importe, je pouvais être certain, au-delà de toute marge d’erreur, que l’ouvrage sur lequel je me trouvais n’appartenait pas au monde d’où je venais. Les ponts d’une telle dimension ne passent pas inaperçus, idiot ! Leur inauguration fait les gros titres. Le viaduc de Millau ou le pont de l’Øresund sont mondialement connus. Ne parlons même pas du Golden Gate ou du pont de Brooklyn. La race humaine est fière de ces passages vers l’au-delà, même s’ils sont presque tous moches.
Le lendemain, je me suis dit que j’étais mort et me suis donc demandé si je me trouvais en enfer ou au purgatoire. Vu qu’aucun démon ne m’avait encore avalé pour le plaisir de me chier dans la gueule d’un moine défroqué, la seconde option me parut plus probable. Mais qui sait ce que le diable nous réserve ? Lucifer avait peut-être conclu qu’errer éternellement dans les limbes était un châtiment suffisant pour mes péchés d’antan. Qui étais-je pour questionner le jugement d’un ange, même cornu ? Cela dit, je me rappelle avoir pensé que je ne méritais pas un tel traitement. À cette époque, j’en savais encore assez sur mon compte pour me considérer comme un honnête homme – pas un saint, mais un gars légèrement au-dessus de la moyenne. Je n’ai plus d’éléments à ma disposition afin d’étayer cette évaluation des bonnes mœurs, malheureusement. Malgré tout, je préfère faire confiance à l’homme que j’étais jadis. Pourquoi devrais-je douter de lui ? Je vous le concède, le purgatoire est supposé nous pousser à l’introspection et à en déduire, invariablement, que nous n’étions qu’une petite merde sur terre. Repentez-vous ! Repentez-vous ! Si c’est le cas, la tête pensante derrière tout ce cirque est un béotien. Comment faire acte de contrition pour mes outrages passés alors que je ne me souviens même pas de ce que j’ai fait ?
J’ai interrompu cette première expédition vers le sud après environ neuf cent soixante kilomètres de marche. Cette volte-face indiquait-elle une faiblesse de caractère? une forme d’inconstance? ou simplement du pragmatisme? Combien de kilomètres sommes-nous censés parcourir dans une direction avant de comprendre que nous n’allons pas dans le bon sens? J’ai rebroussé chemin et suis remonté vers le nord. Je ne sais pas exactement quand j’ai dépassé mon point de départ. Bêtement, j’avais négligé de marquer son emplacement avec un bout de tissu. Ici, chaque endroit est identique au précédent et au suivant. Le nord est en tout point semblable au sud. Le climat n’y est pas plus froid, ni plus humide. Quelques jours ou semaines de beau temps font place à des tempêtes ravageuses. Les jours calmes sont les jours heureux. Les jours tumultueux… Mes chaussures de sport, bien que neuves à mon arrivée, s’étaient déjà désintégrées. Je les avais laissées bien en évidence au milieu de la chaussée pour marquer l’endroit de ma régression en un animal qui marche pieds nus. Je ne les ai pas retrouvées quand je suis revenu plus tard sur mes pas. Un cyclone les a peut-être emportées, ou elles se sont envolées au paradis des chaussures, pour services rendus. Je me suis vite habitué à marcher pieds nus, quoi qu’il en soit, leur plante étant déjà couverte de cors épais. Si mes godasses me manquent encore de temps en temps, c’est parce qu’elles me rappellent un monde où les hommes savent faire autre chose que des ponts et des cheeseburgers.
J’ai mis fin à mon exploration septentrionale au bout de dix mille kilomètres. Cette fois, j’avais de bonnes raisons de tourner les talons. J’avais en effet découvert que chaque kilomètre patrouillé me faisait perdre un souvenir. Des bagatelles, tout d’abord – si triviales que je ne remarquais même pas leur disparition. À savoir, si j’avais aimé jouer au bridge, ou la gastronomie mexicaine. Petit à petit, cependant, je me suis mis à oublier des éléments plus significatifs de ma biographie – par exemple, le museau de mon premier chat, ou la couleur de l’aube. Le genre de choses qui ne nous manquent que lorsqu’on s’aperçoit qu’elles se sont évaporées ; un peu comme des diapositives de vacances que l’on ne projette jamais, mais que l’on pleure chaudement dès qu’on ne les trouve plus dans le carton poussiéreux où on les avait rangées. Ces mémentos m’avaient servi de tampon contre le pont. Ils m’isolaient de son influence néfaste, un peu comme la semelle en caoutchouc de mes défuntes chaussures. Si peu de choses nous séparent de l’animal…
Ensuite est venu le tour de ma profession, de mes convictions politiques, de ma religion, des traits de mon propre visage. Un grand vide-greniers ! Quand le nom de mon père est aussi passé à la trappe, j’ai été vraiment choqué, car j’avais fait tout mon possible pour me le rappeler. J’avais dressé une liste de souvenances que je n’étais pas prêt à sacrifier sans combattre. Le nom de mon paternel était de celles-là. Penaud, j’ai rebroussé chemin, en espérant que le sud me restituerait ce que le nord m’avait dérobé. Le nom de ma mère a suivi. Mon affection pour l’un et l’autre avait donc été aussi égale qu’elle pouvait l’être, puisque je n’oublie jamais qu’une chose à la fois, juste une, une par kilomètre. J’ai trouvé un peu de réconfort dans cette idée.
En dépit de mes craintes, je me suis obstiné à sillonner le pont. Que pouvais-je faire d’autre ? Me figer où j’étais, manger le même cheeseburger tous les jours et attendre des orages royalement indifférents à mes doutes ? C’est exactement ce que j’ai fait, pourtant, lorsque l’odeur de ma femme s’est dissipée. Quelle claque ! Je suis resté à cet emplacement pendant quelque temps, des mois, probablement. Ma montre ne fonctionnait déjà plus, mais je ne l’avais pas encore balancée par-dessus bord. J’avais de toute façon cessé de compter les jours, les kilomètres. J’étais au milieu du pont, parce que chaque point sur une ligne d’une longueur infinie est nécessairement son milieu. Je sais, ce type de réflexions me donne la migraine, à moi aussi. Les êtres humains ne sont pas faits pour les vérités métaphysiques. Vous avez probablement de l’aspirine dans le placard de votre salle de bains ; moi pas, et je ne peux donc pas me permettre de songer à des trucs comme ça.
Dès lors, je suis resté là, sans bouger, sauf pour aller uriner et déféquer par-dessus la rambarde, deux fois par jour. Je n’étais pas encore devenu un sauvage. Au fil des ans, ces mouvements microscopiques se sont inexorablement additionnés, et ma première fois avec une fille a disparu elle aussi. C’est troublant, non ? Que ma première fois ait eu plus d’importance à mes yeux incolores que l’odeur de ma femme. Il est tout à fait possible que mon épouse ait été ma première amante ; ou peut-être avions-nous divorcé ? Circonstances atténuantes. Pourtant, cette histoire m’a beaucoup tracassé. Les oubliettes de ma mémoire, si avides qu’elles soient, respectent en effet la hiérarchie de mes affects. Même le chaos a besoin d’un semblant d’ordre. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi l’odeur de mon épouse avait préséance sur le nom de ma mère ; et encore moins que les seins probablement asymétriques d’une adolescente leur aient grillé la politesse. Voyez-vous, la mémoire a cela de commun avec le pont qu’on ne sait jamais très bien quand on est arrivé à mi-chemin.
Le pire, ici, c’est qu’on se souvient très bien du type de données que l’on oublie. La case subsiste, mais elle se vide. Par exemple, j’étais marié, j’en suis certain, mais je ne me rappelle plus ma femme. Plus déroutant encore, on ne désapprend que sa propre existence. Tout le reste demeure : l’histoire avec un grand H ; la géographie ; les sciences, etc. Même les faits divers ! Je préférerais avoir complètement perdu la tête, m’être transformé en légume. Mais je suis toujours un homme. Aucun doute possible. Je peux distinguer mon pénis en ce moment même. Il n’est pas beau à voir d’ailleurs. La verge flasque d’un ancêtre a toujours quelque chose de honteux, l’attitude servile d’un mouchard. Je digresse, pardonnez-moi. En résumé, je me souviens du monde, de ses sottises, de sa grâce. C’est juste ma petite vie qui a foutu le camp.
Plutôt que de brader mon passé pour des pauses toilettes, je me suis remis en route. Vous seriez surpris, vraisemblablement soulagés, par le nombre de souvenirs que la mémoire peut contenir. J’ai dû faire des centaines de deuils, et j’ai sangloté à chaque fois. Je n’ai pas honte de le dire, même si j’espère que je n’étais pas un pleurnicheur, autrefois. Souvent, je me demande si la mer que j’entends rugir sous le pont n’est pas faite des pleurs d’autres malheureux qui m’auraient précédé, et dont les cadavres auraient été emportés par une vague d’écume, comme mes chaussures. Une grande mer de larmes. N’est-ce pas de quoi toutes les mers sont faites?
Un jour, le rire de ma fille s’est tu. Je me suis refusé à faire un pas de plus, et suis donc resté au même endroit, longtemps, très longtemps. Je pissais et chiais où je dormais et mangeais ; je m’en fichais royalement. Par sédimentation, cela a fait un beau tas d’excréments, presque aussi haut que la glissière de sécurité. Que je ne sois pas mort, avec toute cette merde, tient du miracle. Partout ailleurs, j’aurais déclenché une épidémie de choléra, emportant avec moi la population d’une ville moyenne. Le pont ne montre cependant aucun empressement à me faire crever. Au début, je pensais mourir vite, avec toute cette pluie et cette malbouffe. Pourtant, je n’ai jamais attrapé le scorbut, ou même une simple grippe. Ici, on ne trépasse qu’au rythme des souvenirs que l’on égare. C’est ainsi que le temps est compté. Vous êtes familiers avec les heures et les minutes, bien évidemment ; mais saviez-vous que le système sexagésimal a ses origines dans la civilisation sumérienne ? qu’il repose sur le nombre des phalanges d’une main si l’on exclut le pouce? N’est-ce pas éminemment humain que de chercher à réduire quelque chose d’aussi immense et intangible que le temps à un bidule qui tient dans la paume de la main ? Vous vous en moquez ? Vous avez tort. Le temps est la plus précieuse des monnaies. Alors, vous devriez vous renseigner sur le taux de change. J’aurais aimé savoir ça avant d’atterrir ici – qu’au final du final, la vie humaine se mesure en souvenirs.
Malgré ma détermination, j’ai fini par me faire piéger par mon propre esprit. À quoi bon te souvenir de ta fille si tu ne la revois jamais ? me susurra-t-il, sournoisement. Je repartis à l’aventure. Toutes les réminiscences que je piétinais appartenaient à mon enfant, dorénavant. Au bout de quelques semaines, défait par le chagrin, je me suis arrêté à nouveau, pour de bon cette fois, juste avant d’oublier son nom, Lauren, au prochain pas. Je suis resté au même endroit depuis lors, en ce lieu précis que rien ne différencie de tous les autres. Et je ne bougerai plus d’un pouce. Je suis sûr que son nom est mon dernier souvenir. Il ne peut y en avoir d’autres. C’est l’ultime item de mon registre. Si son nom s’évapore, je disparais. Peut-être qu’un jour ma gamine me retrouvera sur un tas de merde aussi haut que l’Everest et me dira d’une voix douce, un peu timide : Papa ? D’ici là, je continuerai à manger des cheeseburgers et des frites, ainsi qu’à écouter les vagues de larmes qui s’écrasent contre les pylônes du pont, en contrebas.
I
Plaines
LAUREN BAIRNSFATHER
Une ville en carton-pâte du Midwest, en plein centre du milieu, a servi de décor à mon enfance. Ce genre de villes-étapes que l’on traverse en auto, à vive allure, sans un regard en arrière. Kiowa avait connu des jours meilleurs, à défaut de jours heureux. La grande majorité de ses habitants ne pouvait rien espérer de mieux qu’une vie de dur labeur sans récompense terrestre : dans de vastes exploitations agricoles qui se noyaient lentement dans le maïs et les dettes ; dans des usines rouillées où le silence avait remplacé le vacarme du plein-emploi ; dans des commerces de détail en sursis qui faisaient encore crédit à des clients vivant eux aussi sur du temps emprunté. Malgré tout, ces pauvres bougres se pressaient chaque dimanche pour remercier le Seigneur dans les dizaines d’églises qui ponctuaient le paysage sans vraiment rompre son horizontalité monotone. Yeats aurait pu dire d’eux que leur « cœur chantait comme un oiseau heureux dans une cage d’argent(1) ». Leur foi les enchaînait à une terre qui n’aspirait qu’à se débarrasser d’eux pour retrouver le calme de son passé amérindien.
Je suis née là, par une soirée étouffante de juin 1979 – événement anecdotique que même le journal du coin omit de signaler, mais que mes parents s’obstinèrent toujours à qualifier de « petit miracle ». Pendant plus d’une décennie, Harry et Becky Bairnsfather avaient prié chaque soir pour ma venue, agenouillés au pied du lit, avant de se coucher. Cette naissance tant de fois différée, fruit d’une grossesse tardive, s’apparentait nécessairement à un don du Ciel, une adaptation moderne de l’histoire d’Abraham et Sarah.
Nous vivions à la périphérie sud-ouest de la ville, à la lisière même des champs, dans une maisonnette rouge d’un étage que seule sa couleur chatoyante distinguait du millier de boîtes autrement identiques qui composaient le quartier de Sunflower. Rien de plus trompeur que ce joli nom floral qui peinait à masquer la triste réalité d’un étalement périurbain tracé à l’équerre, où alternaient une vingtaine de maisons en briques, une rue poussiéreuse, vingt autres logis, une supérette échouée au milieu d’un parking vide, et ainsi de suite, à l’infini. Dans ce quartier d’ouvriers blancs, les hommes se levaient tôt pour maintenir leur famille juste au-dessus du seuil de pauvreté, sans jamais oser s’imaginer du côté est de la route 281, à Lemon Park (les maisons y avaient toutes deux étages) ; ils se couchaient, tard, tourmentés par la perspective de devoir s’exiler au nord de la route 400, à Blue Hills, où les Latinos, les Afro-Américains et les quelques Amérindiens trop têtus pour partir dans des réserves vivotaient dans des taudis.
Dans la limite de leurs maigres moyens, mes parents avaient fait de leur mieux pour recréer une propriété « type Lemon Park » en miniature : un minuscule jardin d’Éden entouré de hauts massifs de fleurs, où la pelouse restait bien verte toute l’année alors que celle des voisins tournait au jaunâtre dès le mois de juin. Notre maisonnette n’offrait aucun luxe superflu mais sentait bon la lessive et le sucre. Des nappes en dentelle, des oreillers chamarrés et des courtepointes décorées de motifs représentant des oiseaux et des arbres dissimulaient le marron foncé de nos meubles d’occasion.
Native de Kiowa, ma mère avait abandonné une carrière d’infirmière qui lui avait fait voir du pays pour se consacrer pleinement à son foyer. Toute mon enfance, elle me dispensa le surcroît d’amour qu’elle avait accumulé lors de ses années infertiles. Chaque après-midi, je la retrouvais à l’endroit exact où je l’avais laissée, au bout de l’allée du jardin, dans la même position : le bras levé vers moi dans un salut joyeux. Vers l’âge de sept ans, j’ai fini par me demander si elle n’était pas l’un de ces androïdes domestiques que j’avais vus à la télévision, qui s’éteignait automatiquement dès le départ de leur propriétaire. Après des semaines d’hésitation, j’ai enfin trouvé le courage de l’interroger à ce sujet. Elle a acquiescé en souriant : « C’est un peu ça, ma puce. Quand tu t’en vas, maman s’éteint. » Le lendemain matin, elle a traîné un vieux câble électrique derrière elle, et fait mine de le débrancher dès que je me suis assise dans le bus, se figeant comme un robot. Mes camarades et moi nous sommes mis à rire. Elle a alors répété ce petit rituel tous les matins, mimant des poses de plus en plus absurdes, pour notre plus grand plaisir, pendant des années. Maman était la plus parfaite des mères. Là fut peut-être sa seule erreur, car je défie quiconque de se sentir digne d’un tel amour.
À première vue, rien ne différenciait mon père, un modeste quincaillier de son état, des autres hommes de notre quartier. Il portait les mêmes casquettes, les mêmes chemises en flanelle, les mêmes shorts cargo. Comme eux, il partait travailler six jours sur sept au centre-ville, où des immeubles du XIXe et les petits commerces qu’ils abritaient s’effritaient doucement, jusqu’à disparaître du jour au lendemain, remplacés par les hangars laids et ordinaires d’une économie franchisée. Comme eux, il dédiait l’essentiel de son temps libre au bricolage, occasionnellement à la pêche. Ses seules singularités étaient qu’il abhorrait la chasse, avait voté pour Jimmy Carter (même la deuxième fois !) et passait ses soirées à lire des livres empruntés à la bibliothèque municipale d’Oak Street. Avare de ses mots, il ne manifestait que très rarement sa grande intelligence, et seulement en privé. Il se fondait dans le paysage de Kiowa et disait « Howdy do! » comme tout le monde.
Rien, pourtant, ne le prédestinait à une vie de quincaillier dans un trou paumé du Midwest. Né à Chicago, cet élève brillant aurait dû accéder aux plus belles études supérieures et faire carrière. À dix-huit ans, par patriotisme, par naïveté, mon père avait fait l’erreur de s’enrôler dans l’armée, juste avant que le grand public se rende compte que la guerre du Vietnam était injuste. Comme tant d’autres, volontaires ou pas, il avait sacrifié son innocence pour un pays schizophrène qui honorait ses soldats morts au front mais crachait sur ceux qui avaient eu l’outrecuidance de survivre. Peut-être aurait-il pu reprendre le cours de sa vie, s’inscrire à l’université, se laisser pousser une crinière, se joindre aux manifestations pacifistes ; puis se couper les cheveux et étrangler ses idéaux en nouant une cravate pour oublier aussi bien les donneurs de leçons que la guerre. Mais il avait rencontré ma mère, une infirmière à la voix douce qui avait pudiquement recouvert ses plaies de compresses à l’hôpital militaire de Fort Riley. Après sa convalescence, il l’avait suivie à Kiowa, préférant l’amour à des ambitions qui lui semblaient maintenant bien dérisoires, une petite vie normale aux mensonges que les vies « meilleures » exigent.
Rien n’indiquait qu’il regrette ce choix, même s’il roulait parfois les yeux quand nos voisins érigeaient Reagan, cet « acteur de série B », en messager du Ciel. Ma mère et moi suffisions à son bonheur ou, tout au moins, à son contentement. D’un naturel peu démonstratif, il exprimait son affection au travers de menus services : en lavant la vaisselle ou en repassant une robe pour maman et, dans mon cas, en m’aidant à faire des projets en sciences pour l’école (qu’il finissait toujours seul) ou en me passant sous le manteau des romans que ma mère trouvait trop déprimants pour une enfant.
Son garage était son havre de paix, un endroit mystérieux où il se réfugiait dès qu’il le pouvait et où maman et moi n’étions admises qu’en cas d’impérative nécessité, après trois coups bruyants à la porte. Je lui demandais parfois ce qu’il y faisait. « Je répare des trucs… », me répondait-il. La même vieille tondeuse à gazon lui servit d’excuse à maintes reprises. Chaque fois que je l’entendais sangloter derrière la lourde porte d’acier, mon esprit enfantin pressentait qu’il essayait de se rapiécer lui-même. Par malheur, il n’avait pas les outils de précision nécessaires à une tâche d’une telle complexité. Il n’y avait pas de rayon « cœur brisé » dans sa quincaillerie, ni même au Home Depot qui venait de s’installer dans la zone commerciale et finirait par achever son négoce.
Pendant toute mon enfance, j’ai observé la moindre nuance de son comportement, ses silences en particulier, afin de déchiffrer les hiéroglyphes de son âme. Papa faisait parfois preuve de ces hésitations coupables, bien que presque imperceptibles, qui trahissent les clandestins – comme lorsqu’il s’arrêtait une ou deux secondes de trop sous le fronton de notre église ou le porche d’un ami avant de s’autoriser à entrer. Un jour, quelque part, il avait franchi une frontière invisible et s’était retrouvé en terre étrangère ; une terre à laquelle il avait prêté serment d’allégeance sans pourtant totalement céder son cœur.
Notre famille et nos amis ne se lassaient jamais de me dire que j’étais la copie crachée de ma mère, dont la beauté discrète et paisible – anachronique – touchait jusqu’aux âmes les plus vulgaires. La faute à nos cheveux blond vénitien et nos yeux verts, sans doute. Ce compliment m’agaçait. En négatif, il marginalisait mon père, le moins séduisant de mes géniteurs, alors que c’était dans le miroir opaque de sa solitude que je me reconnaissais le plus. J’aurais préféré avoir ses yeux gris striés d’or.
Tous les espoirs de mes parents se concentraient sur moi. Ils semblaient n’avoir aucun rêve qui leur soit propre. Tout juste ma mère souhaitait-elle reprendre le travail après m’avoir élevée. Mon père se mettait à grogner dès que le mot retraite était prononcé. Leur passé, quant à lui, était une histoire triste qu’ils avaient rangée sur le plus haut rayon de notre bibliothèque, hors de portée d’une fillette. Ce qui touchait à la famille de papa, surtout, était tabou. Elle ne nous rendit jamais visite, même pas pour Thanksgiving. Depuis mon plus jeune âge, j’ai donc senti que j’avais la responsabilité de tenir la plume pour un happy end, ce « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants » que la plupart des auteurs négligent de développer parce que la félicité est encore moins intéressante qu’un voyage au Dakota du Nord. Mes parents ne m’ont pourtant pas mis la pression pour que je devienne astronaute ou une bonne mère chrétienne – rien de tout cela. « Nous voulons juste que tu sois heureuse », me disaient-ils, sans me fournir de manuel.
Je suis souriante sur chacune des photographies de notre album de famille prises durant mon enfance. Mes sourires sont larges, francs, un peu naïfs, comme ceux de ma mère. Sur ces photos mes parents ont l’air joyeux, eux aussi. Mon album est plein de barbecues chez des proches, de fêtes foraines à Dodge City, de séjours en camping. Rien de bien extraordinaire ; seulement le genre de choses que les agents immobiliers font miroiter aux acheteurs lorsqu’ils affirment que les villes comme Kiowa sont « un endroit idéal pour élever des enfants », en omettant de mentionner que depuis la vague de délocalisations il valait mieux fermer sa porte à clé et éviter les promenades du soir, même à Sunflower. Peut-être étais-je vraiment heureuse, à l’époque ? Peut-être n’ai-je douté des joies affichées qu’après coup ? Peut-être ne suis-je plus capable de comprendre comment l’on peut se satisfaire du type de vie que vendent les agents immobiliers ? Quoi qu’il en soit, je ne peux me défaire de l’impression que ces clichés ne disent pas la vérité, ou toute la vérité. Je ne crois pas que mon album fabule, en tout cas pas sciemment. C’est juste qu’avec le temps les nuances de l’âme s’estompent autant que les couleurs sur les vieux Polaroid. Le doux-amer s’altère, se simplifie, devient doux.
Je me souviens, par exemple, que le visage de ma mère s’assombrissait quand notre serveur à Applebee’s (un restaurant de grillades où nous dînions un vendredi par mois) lui demandait, sans tact : « Vous êtes combien ? », et qu’elle lui répondait : « Trois, comme d’habitude… » Elle aurait voulu d’autres enfants, que mon père lui refusait, craignant pour sa santé fragile. Ils étaient en effet trop âgés pour songer à une deuxième grossesse, du moins sans risque. Chaque fois que je lui réclamais un petit frère ou une petite sœur, maman se justifiait évasivement : « Ma puce, je dépense déjà tout mon amour pour toi. » Je savais qu’elle mentait, car un régiment de bambins quémandeurs n’aurait pu épuiser son grand cœur. Ma mère ne ratait d’ailleurs jamais une occasion de remplir la maison. Anniversaires, Noël, Halloween, 4 Juillet : toutes les excuses étaient bonnes. Elle donnait des fêtes extravagantes où toute la marmaille du quartier était conviée, avec force cadeaux, trampolines et clowns. Trop fier pour admettre qu’il n’avait déjà plus les moyens de financer cette lubie, papa n’avait d’autre choix que de s’accommoder de ces invasions répétées. Pour l’amadouer, ma mère lui suggérait de construire un fortin ou une scène avant la fête, lui donnant ainsi une excuse légitime de passer encore plus de temps que de coutume à bricoler dans son garage.
Enfant, je ne me sentais pas à l’aise en compagnie d’autres mioches ; des gosses heureux, en tout cas, ceux qui passaient leurs samedis matin à jouer au base-ball dans la rue et se débinaient comme des lièvres dès qu’ils cassaient le pare-brise d’une voiture garée là par erreur, en hurlant de rire ou de terreur selon l’identité de son propriétaire. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi leurs émotions – ô combien incertaines et fugaces ! – s’exprimaient avec une telle violence, confinant à l’hystérie. Je faisais toujours de mon mieux pour donner le change, en me joignant à leurs jeux ou à leurs chamailleries, surtout quand ma mère m’épiait, mais leur présence me fichait le cafard.
Seul le fils de nos voisins mitoyens, Charles, que tout le monde appelait Kip, faisait exception à la règle. Lors de nos célébrations, il ne se fatiguait même pas à faire semblant et demeurait en retrait, dans un coin du salon, en attendant que ça se passe. Sa maison était une réplique identique de la mienne, mis à part sa couleur brique terne. Seule une petite allée séparait nos chambres, qui se faisaient face. Malgré cette symétrie apparente de nos situations, nos réalités respectives n’auraient pas pu être plus contraires. Ses parents, Charlie et Olivia, se disputaient sans arrêt. Leurs cris, des bruits de verre cassé et aussi parfois des coups sourds nous obligeaient à augmenter le volume de la télévision. Lorsque leurs altercations dégénéraient, Kip se réfugiait chez nous. Ma mère l’accueillait toujours les bras ouverts : « Kip ! Entre, mon trésor ! Dis-moi, tu as un petit creux ? » Charlie et Olivia – qui travaillaient de nuit, lui à l’usine de tracteurs à la sortie de la ville, elle dans un bar pour routiers sur la 101 – oubliaient souvent de lui faire à manger avant de partir ou en rentrant se coucher à l’aube. Selon l’heure, maman lui préparait des œufs brouillés, du pain perdu ou un cheeseburger, le seul plat qu’elle savait vraiment cuisiner. Après la première bouchée, Kip lui décochait un sourire de satisfaction, et elle le gratifiait d’un baiser sur le front. Cette marque d’affection, pourtant loin d’être exclusive, ne manquait pas d’agacer mon père. Il se mettait alors à pester contre un tiroir qui coulissait mal, une bouilloire entartrée.
Plutôt que de subir sa mauvaise humeur, Kip et moi nous retranchions alors vers ma cabane en bois, perchée dans un arbre au fond du jardin. Mon père avait passé des semaines à transformer un vieux chêne tordu en théâtre de mon enfance. La veille de son inauguration officielle, lors de mon septième anniversaire, il m’avait remis une grosse clé qui ne servait à rien puisque la porte n’avait pas de serrure, puis m’avait enjoint de monter pour faire le tour du propriétaire.
« Tu viens pas avec moi, papa ?
— Non, ma chérie. C’est ton endroit rien qu’à toi.
— Comme ton garage ? »
Le visage de mon père s’était décomposé, mais il était parvenu à me répondre avec un filet de voix : « En plus lumineux. Allez ! Monte ! »
Depuis la plateforme, qui ne devait pas se situer à plus de trois ou quatre mètres du sol, le monde en contrebas m’était apparu à la fois plus petit et plus grand. Ce qui m’avait semblé colossal – mon père, ma ville – était soudain ramené à ses dimensions modestes. Mais j’avais aussi pressenti que le champ de mon existence ne se limiterait pas à mes parents, ni à Kiowa. D’en bas, papa m’avait observée, la tête levée, la main en visière, un sourire déjà nostalgique au coin des lèvres. Je l’avais salué d’un geste de la main, telle une passagère de transatlantique, puis étais entrée dans la cabine qui fournirait un univers inépuisable aux rêveries vagabondes de mon enfance.
La cabane en bois, et surtout Kip dans la cabane en bois m’ont donné un avant-goût de mon avenir. Nous y avons passé d’innombrables heures à lire, dessiner, regarder des films sur une vieille télévision jetée à la casse que mon père avait réussi à ranimer, et à taire l’important pour mieux le souligner. Ses grands yeux noisette furent les dépositaires de tous mes secrets et mes peines – même si, à l’époque, ceux-ci se résumaient à des intuitions d’événements futurs. Kip, lui, ne s’apitoyait jamais sur son sort, même lorsqu’il était couvert de bleus que ses tee-shirts toujours trop grands dissimulaient mal. Il servait déjà de souffre-douleur à la moitié des gamins de Sunflower – surtout à Jack, le fils d’un courtier en assurances taciturne que toute la ville savait cocufié par sa femme. Tout prédisposait mon ami au rôle ingrat de victime expiatoire : sa pâleur et sa silhouette filiforme, ses vêtements d’occasion, son hygiène douteuse, et un trouble de l’élocution à mi-chemin entre le bégaiement et le zozotement, qui ne l’affligeait qu’en présence des autres, jamais quand nous étions seuls. Kip « incarnait » Kiowa, sa splendide décadence, son ennui tourbillonnant. Rien de surprenant, donc, à ce que ses rejetons lui pissent dessus.
Kip était mon aîné de quelques mois mais avait tellement besoin d’une grande sœur que je me comportais comme telle. Je l’escortais sur le chemin de l’école, partageais mon sandwich avec lui à la cantine lorsque Jack lui volait sa gamelle, l’aidais à faire ses devoirs, lui lisais des contes des frères Grimm pour lui donner du courage. Un soir d’hiver, alors que nous parcourions Hansel et Gretel à la lueur d’une chandelle, ses yeux se sont illuminés. Il m’a implorée d’adapter cette histoire pour lui, pour nous. Je ne m’en croyais pas capable, mais comment trahir cette confiance qui frôlait la foi ?
Uwe et Elke fut mon premier texte. Cette petite fable relatait les aventures d’un frère et d’une sœur de sang royal qui s’évadaient d’un château noir gouverné par leur oncle, un roi fou qui avait usurpé leur trône, après avoir appris que ce dernier avait l’intention de les assassiner avant leur majorité. Kip adorait cette histoire – surtout le passage où le roi finit par se noyer dans un étang gelé que nos héros l’avaient convaincu de traverser en imprimant dans la neige fraîche, à l’aide d’une chaussure suspendue à une branche, de fausses empreintes de pieds. « Quel couillon ! » avait pouffé Kip lors de ma première lecture. J’ai peu à peu découvert le pouvoir vengeur de la littérature en redressant les torts faits à maints opprimés. Que j’aimais leur donner le dernier mot !
Plus la situation familiale de Kip empirait, plus nous nous abritions dans ma cabane pour rêvasser. Depuis les cimes, les esclandres venus de sa maison ne semblaient qu’un écho déclinant. Là-haut, nous nous croyions hors de portée des lois des adultes, jusqu’à ce que leur juridiction universelle nous rattrape. Une fin d’après-midi – je devais avoir dix ou onze ans –, j’ai trouvé Kip recroquevillé dans la pénombre, en pleurs. Il ne sanglotait pas comme mon père le faisait parfois dans son garage. Ses larmes étaient étrangement calmes ; une goutte tombait lentement, puis une autre, comme autant de concessions à la gravité. Je l’ai pris dans mes bras jusqu’à ce qu’il m’apprenne que sa mère avait quitté le foyer.
« Kip, c’est pas la première fois, ai-je tempéré.
— Non, mais cette fois c’est pour de bon, a-t-il articulé. Olivia m’a dit qu’elle m’aimait. »
Kip avait hélas souvent raison lorsqu’il s’agissait d’interpréter les augures. Sans que mes parents le sachent, je l’ai aidé à s’installer dans la cabane. Dès que mes parents avaient le dos tourné, j’apportais à Kip de quoi manger, des vêtements de rechange, des comics. Au bout d’une semaine environ, après un signalement de notre école, deux policiers qui empestaient la cigarette sont venus interroger mes parents. Une fois assis autour d’un café, papa leur a appris que nous ne l’avions pas vu depuis quelque temps, tout en gardant les yeux posés sur moi. Maman, elle, serrait un coussin brodé contre sa poitrine. Après nous avoir demandé si Kip prenait du crack – ma mère a écarquillé les yeux –, les agents nous ont dit de ne pas nous inquiéter. Les fugueurs revenaient presque toujours. Leur attitude dénotait une indifférence blasée. Kiowa se dépeuplait. Que pouvions-nous y faire, hein ? Quand ils ont pris congé, ma mère leur a offert une boîte de biscuits, comme si elle espérait les motiver à faire leur travail.
Kip a voulu décamper le soir même. « J’peux pas rentrer chez moi, Charlie me tuerait. J’dois aller chercher Olivia.
— Mais tu sais même pas où elle est ! ai-je objecté.
— Olivia adore les couchers de soleil, plus que tout, plus que moi. Je la retrouverai en suivant le soleil. »
Kip a essayé de me dissuader de l’accompagner, mais rien n’y a fait. En suivant l’exemple de Uwe et Elke, nous avons planifié notre fuite. J’ai volé trois jours de provisions dans la cuisine et une carte routière dans le garage. Les premières vingt-quatre heures allaient être cruciales. Il nous faudrait mettre le plus de distance possible entre nos poursuivants et nous. Nous nous sommes donc résolus à passer par Blue Hills, le quartier malfamé, afin de rejoindre la gare de marchandises, dans l’espoir de sauter dans un train à destination de la Californie.
Nous avons pris le large juste avant l’aube. Après avoir longé la frontière sinueuse entre Sunflower et la campagne environnante, nous avons traversé en courant la route 400, qui séparait notre quartier de Blue Hills. À première vue, cette zone était bien loin des histoires effrayantes que les adultes racontaient à son sujet. À cette heure matinale, les rues désertes ressemblaient à celles de notre quartier, quoique un peu plus sales, il est vrai. Les bennes à ordures débordaient. Un peu plus tristes, aussi, puisqu’une maison sur quatre était condamnée et couverte de graffitis. Juste une question de nuances. Mais plus nous nous rapprochions de la gare, plus Blue Hills se peuplait d’ombres, des indigents qui vivaient sous des tentes de bâche bleue ou dormaient sur un bout de carton, à même le sol. Un vieux clochard afro-américain drapé dans deux manteaux d’hiver malgré la chaleur ambiante nous a apostrophés : « Hé, les mômes ! Vous auriez pas un penny ?
— Non, monsieur, désolée », me suis-je excusée.
Le mendiant a saisi une bouteille de vodka vide dans son caddie rempli de détritus et nous l’a jetée à la figure, nous manquant de peu.
« Sale fils de pute ! a protesté Kip.
— Tu crois pas si bien dire, mon pote, haha ! » a ricané le vagabond, avant de passer son chemin.
Un peu plus loin, une prostituée latina d’une cinquantaine d’années qui n’avait pas encore fini sa nuit alors que le soleil s’était levé depuis une heure a hélé Kip à son tour : « Chéri, t’as pas envie de devenir un homme ?
— Euh… Ben, si, a-t-il admis, un peu gêné, en tirant sur son tee-shirt.
— Viens voir maman, lui a-t-elle dit en lui faisant signe de se rapprocher.
— T’es pas ma mère, sale conne ! s’est écrié Kip.
— Qu’est-ce que t’en sais, mon lapin ? »
Nous avons ensuite traversé un vaste terrain vague en louvoyant entre des canapés éventrés et des carcasses de voitures brûlées, pour arriver enfin à la gare de marchandises. Celle-ci paraissait abandonnée. Les fenêtres du bâtiment principal étaient soit brisées, soit barricadées. Nous nous sommes faufilés par un trou dans le grillage de clôture qui interdisait l’accès aux voies de garage. Deux ou trois trains rouillés étaient stationnés là. Nous avons trouvé un wagon vide où nous cacher mais un vigile nous a aperçus, nous obligeant à prendre nos jambes à notre cou. Dépités, nous avons passé le reste de la matinée et une partie de l’après-midi à parcourir des champs de maïs vers l’ouest. À bonne distance de Kiowa, nous avons bifurqué vers le sud pour rejoindre la route 400. Quand nous avons enfin distingué une station Texaco, le visage de Kip s’est éclairé. « On va faire de l’auto-stop !
— Mon père m’a toujours dit de ne jamais monter dans la voiture d’un inconnu, ai-je bredouillé piteusement.
— Pas une voiture, un camion. Olivia travaillait dans un bar pour routiers, tu te souviens ? Je sais comment leur parler, c’est des mecs bien. »
Angoissée, j’ai prétexté un besoin pressant pour aller réfléchir aux toilettes. Lorsque j’en suis ressortie une dizaine de minutes plus tard, l’un des deux policiers qui m’avaient interrogée m’a attrapée par les épaules. L’autre passait des menottes à Kip, un peu plus loin, sur le parking. Kip et moi avons fait le trajet du retour sur la banquette arrière de leur voiture de patrouille, en silence, sirènes éteintes. Une fois au commissariat, le shérif Brown, sans doute frustré par sa cote de popularité déclinante auprès d’une populace qui blâmait son supposé laxisme, nous a fait jeter en cellule puis nous a passé un savon depuis derrière les barreaux. Nos pères sont venus nous récupérer. Ils ont dû promettre au shérif de nous donner une correction pour qu’il accepte de nous relâcher. Papa est parvenu à garder son calme jusqu’à ce que, une fois chez nous, ma mère se mette à me couvrir de baisers.
« Mais qu’est-ce qui t’a pris, Lauren ? a-t-il explosé.
— Je voulais juste aider Kip à retrouver sa maman.
— J’ai toujours su que c’était un oiseau de malheur, ce gosse ! Je ne veux plus que tu le voies ! C’est compris ?
— Mais Kip est comme mon frère ! » ai-je protesté, outrée.
Mon père m’a giflée, sèchement, pour la première fois de ma vie. Dans le silence qui a suivi, nous avons entendu d’horribles appels de détresse depuis la maison mitoyenne. Ma mère a couiné « Kip ! » et esquissé un mouvement instinctif vers la porte de la cuisine, avant que mon père la rattrape par le bras. Maman l’a supplié de la laisser s’en charger, car Charlie l’écouterait, elle. Mais il lui a rétorqué que certains problèmes devaient se régler d’homme à homme. Comme pour appuyer son propos, papa s’est armé de la batte de base-ball qu’il réservait aux « camés » qui auraient eu la mauvaise idée de s’inviter chez lui.
Les hurlements ont cessé dès que mon père est entré chez les voisins, faisant place à un calme inquiétant, indéchiffrable. Après une attente interminable, papa est rentré à la maison, le visage fermé.
« Qu’as-tu fait, Harry ? s’est inquiétée ma mère.
— J’ai réglé le problème. Régler des problèmes, c’est mon métier. »
Quelques jours plus tard, Kip était de retour à l’école, apparemment indemne. J’ai cherché à l’aborder, mais il a réussi à m’éviter en accélérant le pas. Lors d’une récréation, j’ai fini par le coincer au détour d’un couloir. Il m’a lancé un regard d’animal pris au piège. Quand j’ai avancé une main maladroite vers sa joue, il a reculé d’un bond. Je lui ai dit que nous pouvions passer outre l’interdiction de mon père et nous rencontrer en secret, ici, ou mieux encore à Lemon Park, jusqu’à ce que tout revienne à la normale.
« Je… J’peux pas, a-t-il bégayé.
— Tu es puni toi aussi ?
— Je… je… j’dois y aller. Mon co… cours co… co… mmence.
— Attends ! Je t’écrirai une histoire, hein ? Et je la laisserai dans ton casier.
— U… U… Uwe et El… Elke se sont noyés dans le la… la… lac. End of story. »
Kip s’est ainsi éloigné de moi sans explication, malgré mes efforts répétés pour rétablir le contact. Je le voyais encore presque tous les jours à l’école, mais nous évoluions dorénavant dans des univers parallèles, chacun régi par ses lois. Au fil des ans, le souvenir de notre amitié est devenu de plus en plus difficile à distinguer de ces contes que j’écrivais autrefois pour lui – des récits qui m’avaient émue, changée même, mais dont j’avais oublié le thème.
Le reste de mes années de collège a défilé comme mes parents l’avaient souhaité, sans heurts, dans cette banalité anonymement placide de Sunflower, jusqu’à ce que mon enfance finisse dans un murmure. Le matin de mon premier jour de lycée, ma mère a oublié de traîner son vieux câble électrique quand elle m’a accompagnée au car scolaire. J’ai tout d’abord été soulagée, car j’avais eu peur d’être placardée « fille à sa maman » par mes camarades. Mais lorsque le bus a négocié son premier virage, congédiant l’image de cette femme aux bras ballants, j’ai versé une larme pour une époque qui venait de s’achever.
Chaque fois que j’essaie de me remémorer mon adolescence, les premières images qui me reviennent ressemblent à ces scènes de film en time lapse où une foule effrénée court autour d’un protagoniste parfaitement inerte au milieu du cadre. On pressent que l’action véritable se déroule ailleurs, en dehors du champ de la caméra. Le décor, en lui-même, n’avait rien de très exceptionnel. Mon lycée, Liberty High, se situait dans la zone limitrophe entre Sunflower et Lemon Park, mais du côté de ce dernier. C’était, avec l’Indian Springs Mall qui venait d’ouvrir ses portes dans la zone commerciale, l’un des rares lieux où les adolescents « sudistes » se mélangeaient, sans aller jusqu’à inclure les « nordistes » de Blue Hills, qui avaient leur lycée à eux, Washington High. Si la majestueuse façade en pierre de Liberty créait l’illusion d’une vénérable institution, ses larges couloirs tapissés de casiers bleus où les élèves cadenassaient leurs identités incertaines et ses murs couverts de maximes bariolées qui dissimulaient mal le vide d’esprits incurieux étaient plus conformes à Kiowa. Il ne s’agissait pas de l’un de ces « lycées à problèmes », comme Washington High, où les élèves devaient montrer patte blanche en traversant des portiques de sécurité ; juste un endroit où une jeunesse ingrate venait hurler son mal de vivre devant les victoires anecdotiques de son équipe de football sur la pelouse vert amer d’un stade.
Ma première rentrée des classes m’a fait penser à un triage médical en temps de guerre. À peine avaient-ils mis un pied dans le vestibule que les bizuts se sont fait catégoriser en quatre groupes – vert, jaune, rouge ou noir – selon la gravité de leur état. On leur assignait ensuite un rôle laissé vacant par la classe précédente : surdoué, brute, perdant, salope, etc. Je me serais satisfaite bien volontiers d’une étiquette rouge, « sans intérêt ». On vit cependant en moi l’une des grandes gagnantes de cette loterie, destinée à remporter une multitude de titres lors des concours de popularité, un honneur normalement réservé aux demoiselles bien habillées de Lemon Park. Des filles que je ne connaissais que de vue se sont mises à me suivre partout, jusqu’aux toilettes, pour solliciter mon opinion sur des sujets qui m’étaient étrangers et, par ailleurs, m’indifféraient. Lizzie, une jolie brune qui habitait à deux rues de chez moi et voyait dans un bon mariage le seul moyen de monter dans l’échelle sociale, me demanda par exemple : « Laurie, Steve vient de me faire passer un petit mot qui dit : Quoi de neuf ? Tu crois qu’il a cassé avec Brittany ?
— Steve ?
— Steve Harding, le fils du maire ET le wide receiver des Bulldogs !
— Ah, ok. Réponds-lui : Rien de spécial, et toi ? Comme ça tu verras ce qu’il a à te dire. »
Deux secondes plus tard, Emma, la fille du juge Paulson, un chrétien évangélique qui aurait aimé pouvoir prononcer la peine de mort pour des infractions mineures du code de la route, me consulta à son tour : « Laurie, j’ai pris trois kilos. Tu crois que je devrais faire le régime Atkins avant de ressembler à une vache ? Sinon Jack ne s’intéressera jamais à moi.
— Tu devrais plutôt rejoindre l’équipe d’athlé. Une place vient de se libérer. Quant à Jack, euh, je te recommande de l’éviter.
— Parce qu’il vient de Sunflower ?
— Non, bien sûr que non, lui ai-je répondu en rougissant.
— Oh ! J’oubliais que tu viens de là aussi ! Désolée. C’était ton mec au collège ?
— Certainement pas ! C’est juste que, enfin, fais attention quoi », l’ai-je avertie, ce qui n’a fait que piquer sa curiosité, car Emma aimait s’encanailler.
Une partie de moi mourait avec chacun de ces bavardages inutiles. Je lisais – voulais ! – du Jane Austen mais m’étais malencontreusement retrouvée coincée dans une sitcom. Les garçons, eux, n’allaient pas jusqu’à me suivre aux W.-C., mais me faisaient passer des Quoi de neuf ? auxquels je me contentais de répondre Rien de spécial sans ajouter de Et toi ? aguichants. Ma vie lycéenne avait la saveur d’additifs alimentaires, trop sucrée, trop salée pour être saine. Mes nouvelles « amies » et moi pouvions passer des journées entières à arpenter l’allée centrale du mall en slalomant entre les tipis en plastique qui étaient censés la décorer, dans un aller-retour perpétuel du stand de friandises au Wendy’s, sans jamais rien acheter à manger car l’odeur qui en émanait suffisait à nous sustenter. William Blake croyait que « le chemin de l’excès mène au palais de la sagesse ». Je doute qu’il ait jamais mis les pieds en Amérique, où l’excès ne mène qu’à l’obésité.
Alors que ma mère se laissait facilement berner par mes bonnes notes et mes soirées pyjama, papa, lui, savait reconnaître un écran de fumée.
« Quelque chose ne va pas, ma chérie ? Des problèmes au lycée ?
— C’est juste, hum, tu sais, cette période du mois.
— N’en dis pas plus ! »
Quand mon père m’ouvrait ainsi la porte de son confessionnal, j’étais tentée de tout lui dire, d’avouer une mélancolie qui ressemblait de plus en plus à une inaptitude au bonheur. Lui m’aurait comprise sans explication de texte. Mais je ne m’en sentais pas le droit, au vu des espoirs placés en moi. Papa n’insista jamais assez. Les personnes qui taisent de vrais chagrins ont, peut-être, trop de respect pour les silences coupables.
Sans que je ne m’en rende vraiment compte, mes mensonges par omission se sont peu à peu transformés en mensonges par affirmation. Je crois que cette mutation a débuté le jour où Steve m’a invitée à aller voir un film. Ne pouvant me défausser sur Lizzie, qui préférait feindre un manque d’intérêt à son encontre, je lui ai répondu que j’avais un copain – un étudiant plus âgé – en lui faisant promettre de garder le secret. Dès le lendemain, j’ai fait face à un barrage de questions dans les toilettes du lycée.
« Il a quel âge ? m’a interrogée Emma.
— Euh… dix-neuf ans.
— Dix-neuf ans ! a piaffé Lizzie. Il s’appelle comment ?
— Hum, Kevin. Mais vraiment, je vous supplie de ne pas…
— Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés ?
— Il y a quelques mois. Vous vous souvenez de la dernière fête foraine à Dodge City ? Il a de la famille là-bas.
— Et ton Kevin, il est mignon ?
— Très, mais dans un genre mauvais garçon, ai-je précisé pour faire plaisir à Emma.
— On veut tout savoir ! »
Pour une première, je m’en suis plutôt bien tirée. Je me suis donc mise à utiliser Kevin comme excuse quand je voulais m’économiser un navet au cinéma, un match de football ou une beuverie dans les bois – surtout ces dernières, parce que j’étais effrayée par ce qui arrivait aux filles lorsqu’elles s’éloignaient un peu trop de la clairière où les lycéens de Liberty faisaient la fête autour d’un feu. J’ai bientôt commis un faux pas qui aurait pu me coûter cher quand Emma et Lizzie m’ont demandé pour la énième fois quelle matière Kevin étudiait.
« Anglais et littérature.
— Pas les sciences politiques ?
— Il vient de changer de majeure. C’est encore possible en deuxième année. »
Cette gaffe m’a incitée à professionnaliser mon approche en consacrant un journal intime à ma relation fictive avec Kevin. J’y décrivais sa vie, son apparence physique, nos rendez-vous et tout ce qui pouvait me passer par la tête. Dans un premier temps, Kevin s’est conformé au stéréotype de l’artiste écorché, un romantique attentionné dans ses bons jours, mais qui devenait agressif dès qu’il avait trop bu. Petit à petit, je me suis néanmoins prise d’affection pour lui. J’ai étoffé son personnage de complexités et contradictions attachantes, jusqu’à l’aimer suffisamment pour lui donner ma « virginité » le jour de mes dix-sept ans. Je n’ai jamais perdu de vue le fait que Kevin n’était que le produit de mon imagination. Cela dit, la fiction a une faculté surprenante d’occuper les espaces laissés libres par la monotonie du quotidien. Notre idylle n’était hélas pas destinée à durer. Un jour, Emma m’a informée que son cousin étudiait lui aussi la littérature à l’université de Chicago et a suggéré une rencontre. « Carrément ! » me suis-je exclamée. Quelques jours plus tard, Kevin me quittait pour une autre – une étudiante, elle – avec un SMS laconique pour tout adieu : Bébé, c’est fini pour nous. À plus. K
Le vendredi suivant, je suis allée à une fête qu’Emma avait organisée chez elle, une énorme maison de style victorien, en l’absence du juge Paulson, bien évidemment. Sans l’ombre protectrice de Kevin, je me suis sentie vulnérable au bord d’une piscine où les filles barbotaient seins nus ; puis dans un salon où une vingtaine de garçons se rentraient dedans en beuglant : « If you’re under eighteen you won’t be doing any time / Hey, come out and play » sur un morceau des Offspring ; dans une cuisine où Jack et son équipe de football s’écrasaient des canettes sur la tête pour un peu plus s’abrutir ; ou dans une salle de bains où Lizzie et Emma vomissaient tour à tour en pleurnichant : « Où est Steve ? » et « Mon père va me tuer ». J’ai trouvé une chambre libre à l’étage et me suis allongée sur un lit à baldaquin. Sans que je l’aie vu entrer, Steve s’est assis à mon côté.
« J’ai la tête qui tourne, m’a-t-il avoué.
— C’est le monde qui tourne, idiot, et nous qui restons immobiles dans ce trou à rats. »
Par dépit, par épuisement, j’ai laissé le fils du maire Harding me débarrasser pour de bon d’une innocence qui semblait bien superflue sur le matelas du juge Paulson. Mon manque d’allant lui a vite fait perdre ses moyens. Steve n’a cessé de s’excuser pendant les dix minutes qu’il lui a fallu pour me dévêtir, me pénétrer, se retirer et sortir de la chambre après avoir vérifié trois fois que personne ne se trouvait dans le couloir. Bye Kevin.
La semaine suivante, j’ai passé toutes mes pauses enfermée dans les toilettes de peur que Steve m’ait dénoncée. Quand j’ai eu vent des rumeurs qui circulaient à propos de mon « trouble alimentaire », j’ai dû me résoudre à quitter cet abri de fortune et ai plongé à nouveau dans le marécage de la vie lycéenne, mais j’ai suffoqué bien vite sans l’échappatoire fournie par Kevin. À la cantine, j’observais les gothiques, les intellos et les gays blottis dans les recoins les plus reculés de la cafétéria avec une certaine jalousie. Une erreur de casting avait été commise à mon entrée au lycée car ma place était là-bas, à la périphérie.
« Laurie, surtout ne te retourne pas, mais le monstre n’arrête pas de te mater, m’a chuchoté Emma un jour.
— Le monstre ?
— Ouais, à ta droite. Le mec avec un tee-shirt de Korn. Sois discrète surtout.
— C’est juste Kip, Emma. On est dans le même cours de chimie.
— On m’a dit qu’il tue des chatons, genre, pour le plaisir.
— C’est juste un fan de metal…
— Ouais, comme j’te dis. Sois prudente, hein ? S’il t’emmerde dis-le-moi de suite et je demanderai à Jack de lui donner une leçon.
— N’en fais rien, d’accord ? Kip ne ferait jamais de mal à une mouche. »
Kip et moi n’avions pas échangé un mot depuis plus de six ans. J’avais, moi aussi, remarqué qu’il m’épiait depuis quelque temps. J’avais l’habitude des regards insistants des garçons, mais celui de Kip me rendait mal à l’aise. Je n’y détectais aucune luxure ou malveillance – seulement une certaine ironie, ce qui était bien pire.
Que je sache, Kip n’avait jamais rien fait pour mériter sa réputation au lycée. Ses cheveux longs, ses yeux cernés, sa peau d’une pâleur extrême, sa voix éraillée et sa passion pour la musique hurlante indiquaient simplement qu’il se trouvait au bas de l’échelle. Je ne lui connaissais aucun ami, aucune tribu. Kip traînait son spleen dans les couloirs – une solitude contagieuse qui maintenait tout le monde à distance, même nos professeurs. Son arrivée dans une classe suffisait à la réduire au silence ; son départ, à déclencher des soupirs de soulagement. S’il y avait quelque chose de monstrueux chez lui, c’était au sens étymologique du terme. La masse des lycéens se trouvait d’un côté de la ligne, et lui de l’autre. Kip m’a affirmé plus tard que « parfois les lieux humains créent des monstres inhumains(2) ». Mes camarades, chacun d’eux, avaient besoin d’un paria pour renforcer leur sentiment d’appartenance. Je suis peut-être une merde, mais au moins, moi, je ne suis pas un taré.
Pendant toutes ces années, Kip n’avait jamais fait la moindre tentative pour reprendre contact avec moi. Il évoluait dans mon angle mort, là où les formes ne sont plus visibles mais où les mouvements sont encore perceptibles. Jusqu’à ce qu’il en sorte de manière fortuite. Lors de mon dernier semestre, je suis arrivée en retard pour le déjeuner et n’ai trouvé aucune chaise libre à la cafétéria. Les seules places encore disponibles se trouvaient à la table de Kip. Personne d’autre n’osait s’y asseoir. J’ai oublié un instant l’ordre établi et me suis attablée face à lui. J’étais loin de me douter à l’époque que ce choix par défaut changerait le cours de ma vie, et de bien d’autres. Sans lever les yeux de son plateau, Kip a grommelé : « C’est bon, c’est fini tes conneries, Laurie ?
— Je fais juste une petite pause, Kip. Rien de permanent.
— Si ça te fait plaisir de croire ça. »
Kip et l’art divinatoire. Dès la fin du sixième cours, Jack et trois de ses gros bras de l’équipe de football lui ont fracassé le crâne contre un casier, puis l’ont roué de coups de pied. Tout le lycée a rappliqué comme un seul homme. Rien de mieux qu’un lynchage pour tromper l’ennui.
Lorsque Kip a cessé de se débattre, Jack a déchargé sa bile : « Laisse Lauren tranquille, sale chien ! J’te bute si tu lui adresses la parole encore une fois ! »
J’ai dû me frayer un chemin dans la cohue en jouant des coudes. « Jack, arrête ça tout de suite ! l’ai-je supplié.
— Te mêle pas de ça, Lauren. Je fais ça pour ton bien. »
Cette remarque machiste m’a fait sortir de mes gonds. J’ai giflé Jack, avec une force insoupçonnée, comme si j’étais possédée par une autre.
« Salope ! Il te baise, hein, c’est ça ?
— Dis un mot de plus et je raconte tout – tout ! – au proviseur. »
Jack a levé la main mais Emma s’est interposée juste à temps. Le visage tordu de haine, Jack a persiflé : « On se reverra très bientôt, vous deux », avant de se laisser entraîner par sa copine vers la bibliothèque.
Nos camarades, éberlués par ce renversement soudain de l’ordre naturel, nous encerclaient encore.
« Fichez le camp ! ai-je fulminé. Tous ! Le show est terminé. »
Les vautours s’en sont allés en maugréant et nous ont enfin laissés seuls. Je me suis agenouillée au côté de Kip et ai tâté son visage, ses bras, ses jambes avec précaution, afin de confirmer qu’il n’avait rien de cassé.
« T’aurais pas dû te mêler de ça, a-t-il toussoté entre deux gémissements.
— Laisse-moi t’accompagner à l’infirmerie. Tu pourrais avoir une commotion.
— Nan, pas besoin ! Ces connards tapent comme des fillettes.
— Je peux au moins te raccompagner chez toi ? J’ai la voiture de ma mère aujourd’hui.
— Tu t’souviens d’où j’habite ? » m’a-t-il répliqué, moqueur, avant de cracher du sang par terre.
Nous avons rejoint ma voiture en titubant, bras dessus, bras dessous. Dès que nous nous sommes engagés dans notre rue, nous avons repéré la Dodge de Charlie, garée devant chez lui.
« Merde. Mon père est encore à la maison. Son quart commence à 8 heures les jeudis. Il ne peut pas me voir comme ça. Tu connais la Colline solitaire, à l’est de la 61 ?
— Kip, je devrais t’amener à l’hôpital. Tu n’as pas l’air bien, vraiment.
— J’ai juste besoin d’un peu d’air frais. »
Le lieu-dit « Colline solitaire » était le point culminant du comté, un îlot pelé qui surplombait des champs. La légende locale voyait en elle un tumulus indien protégé par une malédiction ancestrale, alors qu’il ne s’agissait que d’un simple accident géologique, un rocher qui résistait mieux à l’érosion que le reste du paysage. Les Kiowas ne nous avaient laissé en héritage que leur nom et leur mystère.
J’ai garé la voiture sur un chemin de terre à la base de la butte et servi de béquille à Kip jusqu’à son sommet. Sous l’effet du soleil couchant, la platitude des plaines en ce début de printemps s’est animée de mille nuances de rouge, de rose, d’orange et de gris.
« Ça te plaît, Laurie ?
— C’est splendide. On se croirait sur une île. Tu viens ici souvent ?
— Non, juste de temps en temps. »
Kip m’a confessé plus tard qu’il s’y rendait au moins une fois par semaine pour contempler le coucher de soleil.
« L’infini ! me suis-je émerveillée.
— À cette altitude, tout ce que tu peux distinguer autour de toi se trouve à une distance maximale de cinq kilomètres et demi. L’horizon n’est qu’une simple équation, tu sais. » Il a écrit d≈√2hr du bout du doigt dans la terre sèche et repris : « Plus haut tu te trouves, plus tu vois loin. Mais même en haut de l’Everest ton horizon ne se situera qu’à deux cent trente kilomètres. Notre comté est plus large que ça. C’est triste, non ? Depuis que j’ai appris ça, j’ai l’impression que l’horizon n’est qu’une ruse pour rednecks.
— Une ruse ?
— Ouais, pour nous faire croire que nous aussi on a le droit de rêver, alors que la fin de notre monde est là, juste au bout de notre nez. »
Le soleil a commencé à disparaître sous l’horizon.
« Je préfère me dire que notre liberté est à portée de main », lui ai-je dit en poussant de l’index l’astre vers le bas, jusqu’à ce qu’il s’efface totalement.
Les couleurs de mon adolescence ont changé dès que Kip est rentré en scène, comme si j’avais appliqué un filtre. Avant nos retrouvailles, ma vie était teintée de bleu, un bleu pâle et froid, telle la lumière d’un néon après avoir rebondi contre un mur d’hôpital. En sa compagnie, ma palette a tourné au jaune, le jaune des Grandes Plaines, de l’or couvert de poussière, de la poussière couverte d’or. Nous passions le plus clair de notre temps à sillonner le comté dans sa voiture ou la mienne, autant par choix que par nécessité, car nous ne pouvions pas prendre le risque d’être vus ensemble en ville. Jack n’aurait pas toléré ce défi de plus à son autorité. Alors que je considérais les Grandes Plaines comme rien de plus qu’un no man’s land qu’il me faudrait traverser un jour pour m’évader, Kip, lui, voyait dans leur immensité irréelle le seul avant-goût de divin auquel il aurait jamais droit. Le moindre point de repère sur ce panorama sans relief le fascinait.
« Regarde ça, Laurie ! me lançait-il souvent en me signalant un arbre esseulé au milieu d’une mer d’herbes hautes.
— Cet arbre, là ?
— C’est pas incroyable qu’il ait survécu si longtemps, tout seul, comme ça ? »
La plus paumée et déprimante des bourgades de l’ouest du Kansas lui évoquait des contrées lointaines. Il est vrai que leur nom avait souvent la poésie qui manquait à leur architecture.
« C’est Moscou, ça ? lui disais-je, désappointée.
— T’as pas froid, tout d’un coup ? »
Kip n’avait absolument rien à voir avec l’image qu’il projetait au lycée – celle d’un ado inadapté qui passait ses nuits à occire des démons sur Doom. Sa curiosité d’autodidacte était sans limites – joyeuse, bordélique, vorace. Il se moquait complètement de toute hiérarchie des savoirs, des pratiques culturelles. William Faulkner et Stephen King, Beethoven et Rage Against the Machine se trouvaient tous sur un plan d’égalité. Seul Shakespeare trônait au-dessus du lot. Kip pouvait passer des nuits entières à lire et relire, encore et encore, les mêmes volumes écornés qu’il avait dérobés à la bibliothèque municipale. Quand je m’en suis étonnée, il m’a exposé ses raisons : « C’est juste qu’il avait tout compris au destin, le mec.
— Hum, je ne supporte pas l’idée que notre sort soit prédéterminé par un dieu capricieux, les étoiles, les méfaits de nos ancêtres.
— Faut que tu relises ses pièces, alors, parce que c’est pas du tout ce qu’il dit. La destinée de ses personnages est dictée par leurs propres faiblesses. Quoi qu’ils fassent, ces pauvres cons finissent toujours par se faire rattraper par eux-mêmes. »
Son univers n’était pas plus joyeux que le mien, mais certainement plus riche, plus contrasté. En son absence, je m’étais réfugiée dans l’indifférence, droguée à l’ennui comme d’autres se shootent à l’opium, afin de m’épargner les souffrances qui accompagnent nécessairement toute métamorphose. Devenir femme dans cette société patriarcale – donc un trophée ou une servante, au choix – me faisait peur. Je ne pourrai vraiment exister qu’en m’exilant, pensais-je. N’ayant pas le niveau requis pour entrer à l’université, Kip, lui, n’avait d’autre option que de fouiller les ruines environnantes pour s’y trouver une vie, ou quelque chose y ressemblant. Un jour, par exemple, nous avons visité une bourgade fantôme abandonnée après qu’une tornade l’eut ravagée, un demi-siècle auparavant. Les rares maisons encore debout étaient recouvertes d’une végétation lépreuse.
« Pourquoi m’as-tu amenée ici ? Ce bled est lugubre.
— Quoi, lugubre ? Na ! Te fie pas aux apparences, tu vaux mieux que ça. Les rues bruissent encore des souvenirs des pionniers. Prête-leur l’oreille une seconde. Tu verras bien.
— Oui ! Je les entends ! »
Les colons arpentaient les trottoirs de la grand-rue et vaquaient à leurs affaires, sans se soucier de notre présence.
« Tu vois toujours le fer derrière la rouille.
— J’vois pas quel est le problème avec un peu de rouille. »
Comme lorsque nous étions enfants, nous pouvions passer des heures à ne rien faire. Nous nous allongions dans l’herbe au sommet de la Colline solitaire, ma tête appuyée sur sa cuisse, et regardions le temps passer. Kip me prenait parfois par la main pour m’empêcher de dériver sur l’océan de nos silences. J’ai résisté le plus longtemps possible à la tentation de nous cataloguer, mais je me doutais parfois de ce que Kip ressentait quand ses longs doigts malhabiles caressaient mes cheveux ou s’égaraient sur mon cou. Avec le recul, il serait facile de m’en vouloir de ne pas avoir reconnu et déçu ses espoirs plus tôt. Mais la confusion des sentiments est consubstantielle à l’adolescence.
Pendant toute une saison, nous avons erré dans ce labyrinthe sans murs ; pris des virages à droite et à gauche qui nous ont menés vers autant de culs-de-sac.
« Tu sais où on va, Kip ?
— Plus ou moins. J’essaie de retracer mes pas, même si j’suis jamais passé par ici. »
Kip faisait souvent ce type de remarques qui n’avaient aucun sens mais que je comprenais malgré tout. J’ai appris grâce à lui à accepter que des vérités puissent fleurir sur un terreau de contradictions. Je voulais l’aimer, vraiment. Je l’ai voulu si fort que j’ai cru l’aimer. À cette époque, je savais déjà que la vie était injuste, mais j’avais encore du mal à admettre que mon cœur le soit aussi. Un après-midi, alors que nous nous trouvions sous le gigantesque Meccano des gradins du stade, notre sanctuaire sur le campus, je l’ai laissé m’embrasser. Ce fut mon premier baiser. Steve avait souillé chaque parcelle de mon corps de son haleine alcoolisée, sauf ma bouche, la seule partie de moi qui ne l’avait pas intéressé. Mon premier baiser eut un goût de cigarette, d’eau salée, de fin de printemps. Je fus enfin certaine que j’aimais Kip, mais pas comme il l’aurait souhaité, hélas.
« Je t’aime, Elke.
— Moi aussi, Uwe. »
Je venais d’être admise à l’université de Columbia, et espérais que mon départ pour un job d’été à New York quelques semaines plus tard m’épargnerait la responsabilité de devoir ajouter : comme un frère.
Le surlendemain, mon père m’a intimé de le rejoindre dans son garage à mon retour du lycée. Il a refermé la lourde porte derrière lui et a jeté une pile de photographies sur son établi. La première montrait la scène susmentionnée ; le reste, nos escapades en voiture, prises au téléobjectif. J’ai immédiatement compris que Jack et ses acolytes se cachaient derrière cette sournoiserie. Ils avaient dû nous filer pendant des mois – raison pour laquelle ils ne s’étaient pas attaqués à nous frontalement. Je me suis sentie plus blessée par ma propre négligence que par ce que ces clichés révélaient.
« Et alors ? ai-je osé.
— Mets fin à cette ab… à tout ça, sur-le-champ, m’a ordonné mon père sans préambule.
— Mais c’est ma vie, papa !
— À dix-sept ans on n’a pas de vie, Lauren, juste un futur. Et ce futur te tend les bras. Ne gâche pas tout pour…
— Un moins que rien comme Kip ? On n’a même pas… »
Mon père a frappé son établi du poing avec une telle violence qu’un marteau a sauté en l’air et est retombé sur le sol en ciment en produisant un clac aussi sec que la décision d’un juge.
« Je ne veux rien savoir, bon sang !
— Maman est au courant ?
— Ça la tuerait, Lauren ! Tu sais bien que ta mère a le cœur fragile.
— Elle n’a pas à savoir, papa.
— Nous vivons à Kiowa ! Tout se sait. Quitte-le avant qu’il ne soit trop tard. Kip n’est pas la personne que tu crois. Fais confiance à ton vieux père, je t’en prie.
— Papa, tu commences vraiment à me faire peur. Je suis désolée mais c’est absurde. Notre fugue, c’était il y a si longtemps. »
Mon père s’est laissé tomber à terre, a pris mes jambes dans ses bras et enfoui sa tête dans mon ventre. Je ne l’avais jamais vu dans un tel état. Ce n’est pas son désarroi qui m’a fait plier, mais le fait qu’un homme aussi fier puisse s’abaisser à implorer une ado de la sorte. Il m’a tendu le combiné du téléphone. J’ai composé le numéro de Kip sans réfléchir, tel un automate dépourvu de faculté de jugement.
« Kip ?
— Oui, m’a-t-il répondu d’une voix glaciale.
— Jack nous a pris en photo… Il les a envoyées à mes parents. Ils ne veulent pas qu’on… Enfin, je ne pourrai plus…
— Ok », m’a-t-il interrompue, sans affect apparent, avant de raccrocher.
Papa me serra contre lui jusqu’à ce que je me libère de son emprise et coure vers ma cabane en bois, où je ne m’étais pas abritée depuis bien longtemps. Je ne me suis autorisée à pleurer qu’une fois là-haut. Ce n’est pas ma rupture avec Kip, en tant que telle, qui m’a fait le plus de mal, mais le soulagement répréhensible que j’éprouvais. J’avais saisi la première excuse qui s’était offerte à moi pour ne pas avoir à être la « méchante » de cette histoire. Notre séparation était la faute de mon père, de Jack, de Kiowa, de la jeunesse, de la vie. Pas la mienne. Je me haïssais de m’exonérer ainsi, exécrais ma lâcheté, mon laisser-faire.
Le lendemain matin, une foule compacte se pressait devant mon casier au lycée, subjuguée par une photo montrant deux parias enlacés sur un tumulus. Une deuxième année que je ne connaissais pas déclara : « Malgré ses airs de princesse, j’ai toujours su que c’était une salope. » Après l’avoir bousculée au passage, j’ai déchiré le cliché en morceaux. À ma droite, Kip fixait son propre casier, où un autre exemplaire avait été placardé. Il a ouvert la porte sans rien dire, saisi un manuel de mathématiques puis a rejoint sa salle de cours sans même prendre la peine de le décrocher. Après m’être chargée du sale boulot, j’ai passé le reste de la journée dans une sorte de brouillard. Je me souviens d’avoir contemplé les branches d’un érable rouge caresser les vitres de ma salle de classe et créer un théâtre d’ombres sur le tableau blanc. Peut-être n’étais-je que l’une de ces ombres, la projection de quelque chose de plus réel, de plus tangible qui se trouvait au-dehors, de l’autre côté des fenêtres.
À mon retour chez moi, maman m’a accueillie en frappant des mains. Mon père se tenait derrière elle, l’air sombre.
« Ma puce ! Tu es prête ? s’est-elle enquise, trépignante.
— Prête pour quoi ?
— Pour quoi ? Mais pour ton bal de fin d’année, bien sûr ! J’ai hâte de te voir dans ta robe ! »
Après tout ce qu’il s’était passé, ce fichu bal était la dernière de mes préoccupations.
« Maman, je n’ai plus vraiment envie d’y aller.
— Tu plaisantes ou quoi ? Dis-moi que tu plaisantes !
— Je n’ai même pas de cavalier pour m’accompagner.
— Oh, mais tu ne vas pas te laisser abattre pour si peu ! Je n’avais pas de cavalier non plus, et alors ? Je me suis amusée comme une folle ! Le bal, c’est toujours une nuit magique. Toutes tes copines seront là. Et tu seras sans doute élue reine.
— Hum, j’en doute… »
Papa a froncé les sourcils, pour me rappeler à quel point ma mère tenait à ces rites de l’Americana. J’ai donc fini par céder. Maman m’a entraînée vers leur chambre à coucher, où m’attendait la robe de soirée rouge écarlate que nous avions achetée en solde à Indian Springs, bien à plat sur le lit, tel un linceul. Elle m’a coiffée et maquillée tout en babillant à propos de ses jeunes années.
« Tu n’avais pas de copain au lycée, maman ?
— Si, le même pendant trois ans. J’étais éperdument amoureuse de lui. C’était le running back des Bulldogs ! Et le plus beau garçon de Kiowa ! N’en dis surtout pas un mot à ton père. Il est un peu jaloux, même du passé.
— Promis. Et pourtant tu es allée au bal toute seule ?
— Oui, a-t-elle lâché. Il y est allé avec une autre. Une jolie fille de Lemon Park. Il a été élu roi, et elle reine, à ma place. Mais je ne vais pas te rebattre les oreilles avec mes vieilles histoires, surtout quand elles sont tristes. Regarde-toi, ma chérie. Comme tu es belle ! »
Il est vrai que cette robe m’allait bien. Maman m’a fait promettre de profiter de chaque instant, de danser jusqu’à en avoir le tournis, de ne pas être « moi », en somme. Mon père, lui, m’a conduite à l’échafaud. Nous n’avons pas échangé un mot lors du trajet.
Comme tous les ans, le bal se tenait dans le gymnase du lycée, par mesure d’économie. Le comité d’organisation avait fait de son mieux pour cacher la misère derrière une profusion de ballons et banderoles aux couleurs criardes. De la mauvaise pop retentissait jusque sur le parvis. De toute évidence, personne ne s’était attendu à ce que j’aie l’insolence de me montrer en public après ma disgrâce. Tous les regards se sont tournés vers moi dès que j’ai fait mon entrée. J’ai même eu l’impression que le volume sonore avait baissé d’un cran. La masse murmurante s’est écartée sur mon passage. J’ai trouvé une table libre, au fond de la salle, où broyer du noir. Emma et Lizzie m’épiaient de loin, mais se sont abstenues de me saluer.
Au bout d’une heure, Steve s’est assis face à moi. Manifestement ivre, il a cherché à m’amadouer : « Je suis contrarié par ce qui t’arrive, Lauren.
— Ta copine nous observe, Steve. Va la rejoindre, ok ? J’ai eu suffisamment d’emmerdes comme ça. »
Extraits
« Le temps est la plus précieuse des monnaies. Alors, vous devriez vous renseigner sur le taux de change. J’aurais aimé savoir ça avant d’atterrir ici — qu’au final du final, la vie humaine se mesure en souvenirs. » p. 13
« Le mariage, encore plus que la guerre, m’a enseigné que les mensonges sont parfois plus utiles à la survie que la vérité. Seul le regard attristé de notre médecin de famille lors d’une consultation de routine m’a fait vraiment douter. Lui n’était pas dupe. J’ai changé de praticien. » p. 119
« En tout état de cause, Lieux a survécu à cette période hasardeuse qu’est la genèse d’un projet. L’idée de base de ce scénario était relativement simple. L’histoire tournerait autour de quatre protagonistes, des antihéros esquintés par leur enfance, et de leur quête de l’âme sœur, cet «autre moi» fantasmé, seul à même de les arracher à leur spleen. Une sorte de quête baudelairienne, où l’Idéal et le Beau seraient incarnés par une figure distante et fugitive qui manifesterait ce gouffre croissant entre ce qu’ils étaient et ce qu’ils auraient été capables d’être, la malédiction de l’espoir. Rien de bien original, Sa particularité résiderait dans le fait qu’il ne serait destiné qu’à un unique «spectateur», Stanley. Nat Bridge finirait bien par réapparaître, tôt ou tard. Mon script lui serait adressé, mais seul Stanley, s’il existait vraiment, serait capable de suivre les indices dont il était parsemé, comme autant de petits cailloux blancs jusqu’à un point de rendez-vous, où je l’attendrais. » p. 322
À propos de l’auteur
 Renaud Rodier © Photo Abigail Auperin
Renaud Rodier © Photo Abigail Auperin
Renaud Rodier est diplômé de Sciences Po Paris. Il parcourt le monde depuis une vingtaine d’années pour fournir une aide humanitaire aux victimes de guerre. Les Échappés est son premier roman. (Source: Éditions Anne Carrière)
Site internet de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte X (ex-Twitter) de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur


Tags
#lesechappes #RenaudRodier #editionsannecarriere #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #MardiConseil #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #roman #livre #primoroman #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie
 Lune Vuillemin © Photo Seb Germain
Lune Vuillemin © Photo Seb Germain








 Cécile Coulon © Photo Julien Bruhat
Cécile Coulon © Photo Julien Bruhat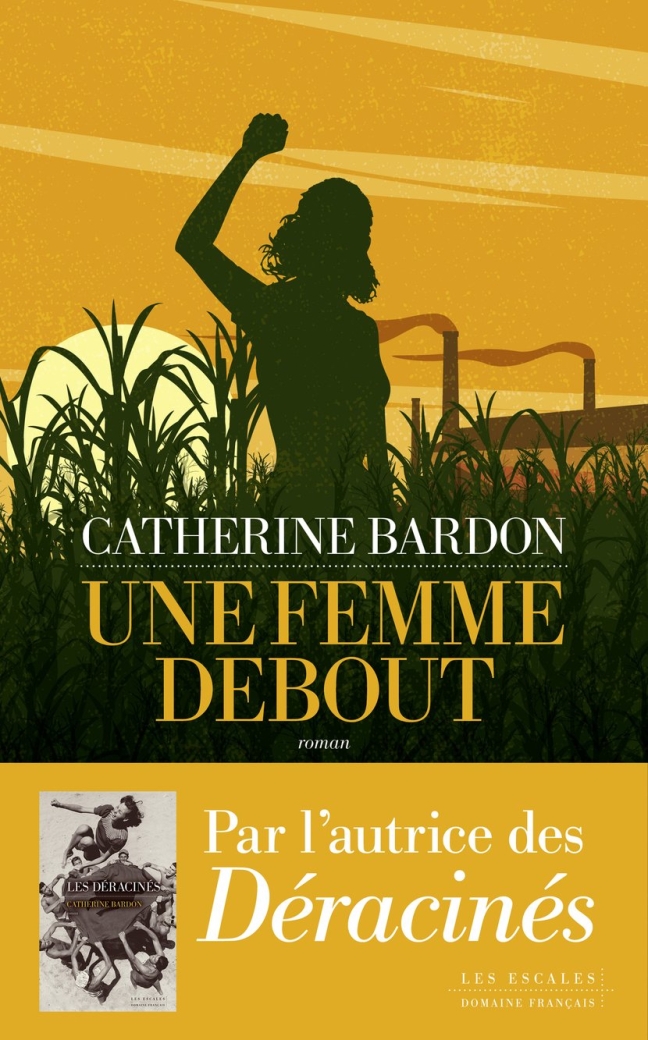
 Sonia Pierre recevant le Prix international de la femme de courage des mains de Micelle Obama et Hillary Clinton. DR
Sonia Pierre recevant le Prix international de la femme de courage des mains de Micelle Obama et Hillary Clinton. DR Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas
Catherine Bardon © Photo Philippe Matsas







 Cyrille Falisse © Photo Chloé Vollmer-Lo
Cyrille Falisse © Photo Chloé Vollmer-Lo

 Renaud Rodier © Photo Abigail Auperin
Renaud Rodier © Photo Abigail Auperin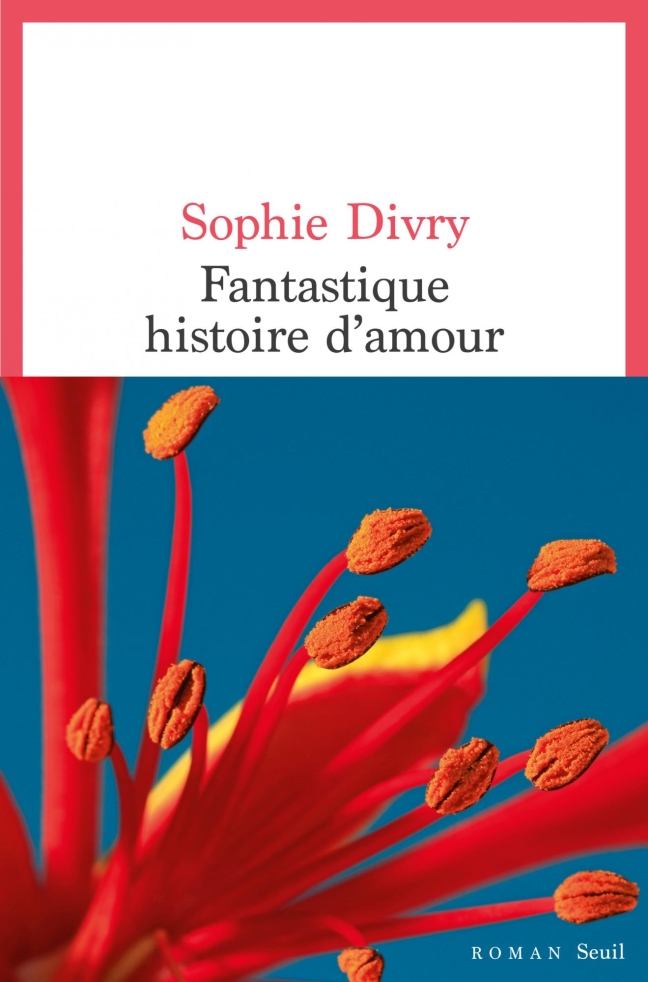

 Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot
Sophie Divry © Photo Bénédicte Roscot
 Violaine Huisman © Photo Beowulf Sheehan
Violaine Huisman © Photo Beowulf Sheehan