En deux mots
Le journaliste Rodolphe Darzens se voit confier la mission de retrouver Arthur Rimbaud, un jeune poète qui a suscité l’attention avant de disparaître mystérieusement. Menant sa difficile mission avec abnégation, il va finir par retrouver l’homme et l’œuvre et contribuer à la gloire de ce prince des poètes.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
L’homme qui a sauvé Rimbaud de l’oubli
Pour son premier roman, Henri Guyonnet a choisi de réhabiliter Rodolphe Darzens. C’est à ce journaliste, émigré russe, que l’on doit la (re)découverte d’Arthur Rimbaud et de son œuvre. Oubliant la biographie et l’hagiographie, son roman est une passionnant enquête, romanesque en diable.
C’est par le plus grand des hasards que Rodolphe Darzens va se voir confier la mission de retrouver Arthur Rimbaud. Lui qui s’intéresse plutôt aux sports et aux courses va se battre en duel avec un collègue. Son patron, qui veut l’éloigner, lui demande de retrouver le poète.
Muni des seules informations à sa disposition, «Il a eu une liaison avec Paul Verlaine et a disparu depuis vingt ans, déterrez-moi des témoins, des révélations, et où se trouve Rimbaud, c’est clair? Et surtout pas de vagues, c’est compris?», le voilà lancé dans une enquête qui va s’avérer aussi difficile que passionnante.
Il commence par se rendre dans une librairie et y déniche un exemplaire des poètes maudits. Sous la plume de Verlaine, il apprend que «que la plupart des œuvres du poète n’ont jamais été publiées ou ont disparu. Une Saison en enfer, parue en 1873, sombra corps et biens dans un oubli monstrueux, l’auteur ne l’ayant pas lancée du tout. Il avait bien autre chose à faire. Il courut tous les Continents, tous les Océans, pauvrement, fièrement…»
Il décide alors de rendre visite à Verlaine, mais leur entrevue ne l’avance guère. Peut-être que l’éditeur pourra davantage le renseigner, lui fournir une adresse?
Comme dans un polar, on va suivre ses pérégrinations à la fois sur les pas du poète et de son œuvre. Car fort heureusement ses ordres de tout brûler n’ont pas été suivis.
Henri Guyonnet a eu la bonne idée de faire alterner les chapitres consacrés à l’enquête avec ceux qui suivent Arthur Rimbaud au même moment. De retour d’Afrique, amputé et aigri, il a trouvé refuge chez sa mère et ses sœurs dans les Ardennes où il va essayer de se soigner pour repartir vers le continent noir. Des éléments biographiques qui donnent au récit toute sa vraisemblance et offrent au lecteur de (re)découvrir l’homme et son œuvre, de mieux comprendre certains de ses poèmes ici placés dans leur contexte.
Au plaisir de la lecture s’ajoute alors la furieuse envie de se plonger dans les recueils désormais passés à la postérité. Voilà encore une vertu de ce premier roman très réussi!
NB. Tout d’abord, un grand merci pour m’avoir lu jusqu’ici! Sur mon blog vous pourrez, outre cette chronique, découvrir les premières pages du livre. Vous découvrirez aussi mon «Grand Guide de la rentrée littéraire 2024». Enfin, en vous y abonnant, vous serez informé de la parution de toutes mes chroniques.
Brûlez tout
Henri Guyonnet
Éditions Anne Carrière
Roman
368 p., 20 €
EAN 9782380822489
Paru le 10/02/2023
Où?
Le roman est situé principalement en France, à Paris, à Marseille, dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières. On y évoque aussi la Russie et l’Abyssinie, Aden et Douai.
Quand?
L’action se déroule de 1885 à 1938.
Ce qu’en dit l’éditeur
Fin du XIXe siècle. Depuis vingt ans, le silence d’Arthur Rimbaud interroge le Paris artistique. Rodolphe Darzens, jeune pigiste aventureux, se voit confier l’enquête sur sa disparition. Le journaliste infiltre le milieu littéraire d’avant-garde et part à vélo sur la route des Ardennes pour retrouver la trace du poète. Il découvre chez l’un de ses anciens amis vingt-deux poèmes autographes inédits, et décide de les publier dans un recueil intitulé Le Reliquaire. Darzens s’attire les foudres de Verlaine, seul protecteur des œuvres de Rimbaud.
Pendant ce temps, Arthur Rimbaud est rentré d’Abyssinie, malade et amputé. Il séjourne à Roche, dans la ferme familiale, et questionne sa vie, ses amours, sa quête spirituelle et poétique.
Dans un chassé-croisé haletant, Brûlez tout ! mêle la traque du journaliste à la poésie prophétique de «l’homme aux semelles de vent».
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Diversions mag.
Publik’Art
Valentin Roten, libraire, présente «Brûlez tout» de Henri Guyonnet lors d’un entretien avec Isabelle Bratschi © Production Librairie Payot
Les premières pages du livre
« Avant-propos
À la fin du XIXe siècle, Rodolphe Darzens, jeune immigré russe, est chroniqueur dans différents périodiques littéraires et revues. Grâce à Jean-Louis Forain, célèbre caricaturiste, il découvre la poésie d’Arthur Rimbaud et en tombe amoureux. À cette époque, le poète est pratiquement inconnu, et il a disparu depuis près de vingt ans. Darzens entreprend alors une enquête pour reconstituer la vie de Rimbaud et retrouve chez l’un de ses anciens amis vingt-deux poèmes autographes inédits. Ces poèmes auraient dû être brûlés, selon la volonté de leur auteur.
Darzens décide de publier ces textes originaux dans un recueil intitulé Reliquaire. Quelques jours avant le décès ¬d’Arthur Rimbaud, dans l’anonymat à Marseille, le livre paraît.
Le Reliquaire révèle le poète au grand public et lance le mythe du génie des Ardennes.
À partir de cette intrigue historique, l’auteur a laissé libre cours à son imagination pour proposer cette exofiction mêlant la poésie prophétique de « l’homme aux semelles de vent » à la traque du journaliste, tel un voyage initiatique en Rimbaldie.
Ce livre n’est ni un récit historique, ni une biographie sur Rimbaud, mais un hommage au poète, et à celui sans qui certains de ses poèmes célèbres comme « Le dormeur du val », « Ma bohème » ou « Sensation », n’auraient peut-être jamais été connus.
Pour les besoins de l’intrigue, l’auteur a pris des libertés avec certains éléments historiques et personnages, dont Verlaine, qui n’a jamais été impliqué dans l’affaire du Reliquaire.
Prologue
Cimetière de Neuilly-sur-Seine, 1938
Par cette belle matinée d’hiver, le cortège avançait lentement le long des allées du cimetière.
En accompagnant la veuve et sa famille, le froid piquant serrait les témoins dans une assemblée insolite. Journalistes, écrivains, sportifs, industriels, hommes de théâtre, poètes bohèmes, connus ou anonymes ; ils étaient venus nombreux rendre hommage à Rodolphe Darzens.
Un peu à l’écart, une délégation de gens du voyage suivait le convoi. Leurs tenues bigarrées égayaient un peu le tableau.
Dans son testament, le défunt avait souhaité être conduit à sa dernière demeure en corbillard hippomobile. Toquade d’un vieillard sénile ou souvenir de sa jeunesse, son vœu exaucé donnait à la cérémonie ce panache désuet réservé aux personnages célèbres.
Soudain, le cheval noir surmonté d’un toupet blanc, sans doute dérangé par les cris de corbeaux matinaux, claqua du sabot sur l’allée, secoua son licol, hennit et prit le petit trot. Le cocher, sidéré, tirait sur les rênes. On entendit quelqu’un prononcer : « Il a toujours été impatient », et la procession hâta le pas pour se réchauffer.
Arrivés au caveau, certains s’étonnèrent qu’il s’agisse d’une sépulture commune déjà peuplée de quatre journalistes. Ils apprirent que Darzens, chevalier de la Légion d’honneur, ancien directeur du Théâtre des Arts, membre de la Société des gens de lettres, avait fini sa vie dans la misère et que l’Association des journalistes sportifs, en témoignage de ses hauts faits rédactionnels, lui avait réservé une place dans cette sépulture à la gloire des chroniqueurs.
Après la bénédiction du prêtre orthodoxe, Julien Le Cardonnel, du Journal, s’approcha, une feuille à la main et prononça cet éloge : « Ce fut l’une des figures les plus intéressantes du journalisme, des lettres et du théâtre. Darzens fut l’un des créateurs du journalisme sportif et l’un des premiers apôtres du sport en France. Par-dessus tout cela, il fut un grand directeur de théâtre, que le théâtre n’enrichit pas. On emploie, souvent à la légère, l’expression de personnage balzacien, mais s’il est un homme auquel elle convient, c’est bien à l’homme extraordinaire que fut Rodolphe Darzens, dont la personnalité fut diverse, riche, variée comme un personnage de la Renaissance… »
À cet instant, le miaulement guttural d’un chat de gouttière planqué derrière une stèle interrompit le panégyrique. L’orateur fit une pause, eut un sourire discret et reprit : « Né à Moscou de commerçants d’origine basque, il vint à Paris avec une troupe de cirque et commença une carrière journalistique étonnante. Darzens, grand amoureux de la vie, a dirigé vers l’action une imagination qu’il eût pu utiliser pour une grande œuvre littéraire… »
Le public écoutait dans le recueillement l’allocution hagiographique. Certains pourtant se lançaient des œillades sarcastiques.
S’ensuivirent l’homélie du prêtre orthodoxe et le scellement du caveau, ensuite le cortège prit le chemin du retour. Par familles, les petits groupes se reformèrent naturellement. Un bel homme emmitouflé dans un manteau brun au col fourré s’approcha de l’un d’eux.
« C’est qui ? chuchota une femme.
— Marcel Pagnol », répondit son amie.
Pagnol salua le discours mais regretta que l’apologie n’ait pas évoqué l’enquête passionnante sur Rimbaud que Darzens avait initiée le premier.
Son interlocutrice, surprise, lui avoua qu’elle n’avait jamais eu connaissance de cette affaire. Pagnol prit un air entendu et, dans un sourire, de sa voix chaude teintée de l’accent du Midi : « C’est très mystérieux, en fait… mais il gèle ici, je vous raconterai tout cela dans la voiture, si vous voulez bien. » Ils pressèrent le pas.
Les derniers à quitter le cimetière furent les Gitans.
La Grande Russie
Moscou, 1885
Une nuit d’orage. Les éclairs qui déchirent la voûte obscure et profonde révèlent avec brutalité l’horreur sur terre. Des piles de livres que les militaires russes jettent dans un bûcher monstrueux. Les flammes affolées lancent aux fronts des lumières pourpres et fugaces, des cendres étincellent dans l’obscurité. Le fracas du tonnerre ajoute à la terreur, le ciel prend part aux événements. Les uniformes cuirassés tranchent sur les corps mous des pauvres gens, couverts de laines grises comme les cendres. C’est tout ce que voit Rodolphe Darzens du haut de son mètre quatre-vingts, l’autodafé, les livres gémissants, les uniformes et le peuple soumis. L’odeur de livres qui brûlent est particulière, l’encre des mots semble alourdir l’air et le charger d’une vérité à jamais perdue. Rodolphe s’agite derrière le cordon de sécurité des gardes.
Une rixe éclate devant le libraire. Darzens l’apprécie beaucoup, ce M. Bloomfield, l’homme le plus aimable de la rue Arbat. Quand Rodolphe était petit, il lui avait offert son premier abécédaire. Quinze ans qu’ils se connaissent et le voilà sous ses yeux molesté, battu par ces brutes, ces cosaques ! Darzens profite de la mêlée devant l’échoppe pour se frayer un passage dans la foule qui manifeste sa haine du Juif.
Au moment d’enjamber la corde des sentinelles, une main de fer se pose sur son épaule. Il arme déjà son poing, quand il reconnaît son camarade Igor.
« Ne fais pas le con, Rodolphe.
— Laisse-moi, Igor. Tu vois bien ce qu’ils font ! » Il se dégage de la poigne de son ami.
Igor le retient par le bras. « Tu crois que tu vas les arrêter en te battant avec tes poings ?
— Je fais ce que j’ai à faire, lâche-moi !
— Calme-toi, il y a d’autres moyens de lutter. Rentre chez toi et retrouve-moi demain chez Dimitri. On en parlera avec les autres. »
Un officier les observe dans la lumière des torches. Rodolphe, la rage au cœur, se retire.
Le lendemain, dans sa modeste datcha, la famille Darzens est réunie pour le dîner. Rodolphe fait allusion au libraire. Son père, un petit homme rond à moitié chauve, est désolé que ce soit arrivé mais il rapporte, à mi-voix, que Bloomfield vendait des livres interdits…
« Lesquels ? demande vivement le jeune Darzens.
— Je n’en sais rien, et cela ne nous regarde pas ! » réplique le père, qui en profite pour reprocher à Rodolphe ses fréquentations et ses idées révoltées. Il craint pour son commerce de vin. La mère essaie timidement de défendre son fils. Le père s’emporte : « Il n’y a jamais eu de hors-la-loi chez nous ! » appuie-t-il d’un poing sur la table.
Rodolphe jette sa serviette et monte dans sa chambre. La tête dans les mains, assis sur son lit, il se demande s’il est vraiment son fils…
Plus tard, après avoir enjambé le garde-corps de sa fenêtre, il s’accroche à la vigne sauvage et saute dans la rue.
Chez Dimitri est un lieu de rendez-vous clandestin dans le quartier des tanneurs. La maison délabrée ne présente aucune entrée accessible et semble abandonnée. On y pénètre en passant par le jardin derrière la bâtisse, ensuite il faut descendre à la cave.
Rodolphe, après s’être assuré qu’il n’est pas suivi, s’approche de la maison. Il ouvre la trappe, s’engouffre furtivement et retrouve son ami Igor au bas des marches. Celui-ci lui donne l’accolade et le félicite d’avoir su garder son calme. Il faut se faire respecter en restant unis. Plusieurs cerveaux valent mieux qu’un. Il le présente aux nouveaux membres du groupe La Phalange.
L’endroit humide sent le vert-de-gris et la vieille barrique. La seule lumière, blanche et oblique, provient d’un bec de gaz et aboutit sur la dalle poussiéreuse au centre de la pièce. Au fond de la salle voûtée, encombrée de chaises, un comptoir rassemble les invités à la fin des réunions.
L’assistance est composée de jeunes gens, d’intellectuels et d’ouvriers, mais elle reçoit aussi des artistes et des moines orthodoxes. Igor y prend ses missions. Il a introduit Rodolphe dans ce mouvement anarchiste, sentant chez lui la même flamme de révolte contre le pouvoir. Les deux amis se sont connus au collège de Saint-Pancrace au sud de Moscou. Rodolphe, plus jeune que lui de trois ans, le voit comme un modèle. Igor le Magnifique, son surnom au collège, impressionne par ses reparties, sa culture et son allure princière. Darzens rêve de devenir un jour aussi populaire que lui. Il répond toujours présent à ses appels et l’accompagne dans des campagnes clandestines d’affichage.
Le débat porte ce soir sur le pogrom des Juifs et des Gitans. À la suite des votes, l’option pour l’information directe a été préférée à l’affrontement. La non-violence, plutôt que l’imitation des brutes au pouvoir. Cette opération devra se réaliser pendant le discours du voïvode, le représentant du tzar, dimanche prochain sur la place Alexandre-II.
Rodolphe et Igor lèvent la main pour signifier qu’ils en seront. La réunion se termine au comptoir servant de buvette. Dans les échanges concernant l’organisation, ils apprennent que d’autres groupes d’opposants au gouvernement doivent les rejoindre au cours de la manifestation.
Quelques jours plus tard, un cortège officiel décoré de gerbes de fleurs blanches escorte le gouverneur militaire à travers les rues en liesse. Certains pourtant regardent passer le défilé la haine dans les yeux.
À deux pas de la place Alexandre-II, dans l’arrière-salle d’un bistrot discret, se tient une réunion de jeunes activistes russes. Igor et Rodolphe sont désignés pour tracter dans les rues qui mènent à la place. Ils récupèrent leurs paquets d’imprimés, ronéotypés la veille, et attendent les ordres. La consigne est claire : diffuser le maximum de pamphlets et éviter toute arrestation.
Ils sortent sur l’esplanade et se mêlent au flux qui converge vers la tribune, distribuant sous le manteau leurs tracts aux passants. Rodolphe va pour s’engager dans une rue mais Igor le retient : « On reste ensemble. »
Des policiers en civil, un peu à l’écart, surveillent la foule. Rodolphe et Igor ont été repérés. Ils se retrouvent pris à partie par des sbires du tzar, qui essaient de leur arracher les pamphlets. Ils résistent et s’enfuient. Soudain, des cris, des jurons, des bras se lèvent… Une bousculade renverse des femmes, qui hurlent… Un objet noir décrit une trajectoire au-dessus des têtes et atterrit sur la tribune. Panique générale. La bombe, dans un sifflement interminable, tourne sur elle-même, fait long feu mais n’explose pas. Le voïvode, livide, est évacué dans la confusion totale.
La police encercle les manifestants. Rodolphe et Igor se débattent dans la cohue, arrivent à s’échapper et s’enfuient dans les rues désertes. Mais des militaires les poursuivent. Au coin d’une artère, ils les mettent en joue. Des coups partent. Igor titube et s’effondre, touché dans le dos. Darzens essaie de le secourir, son ami le supplie de se sauver. Le regard d’Igor se fige dans ses yeux. Les gardes approchent.
Rodolphe, affolé, prend ses jambes à son cou et détale dans la première traverse. L’officier retient ses hommes : « Laissez-le, on sait où le trouver. »
Darzens déboule chez lui. Il se jette sans un mot dans les bras de sa mère, qui comprend que quelque chose de grave vient d’arriver. Elle lui saisit le visage et le regarde avec son cœur. Il tremble. « Igor est mort, maman. » Elle le serre dans ses bras.
Un moment plus tard, son père entre dans la pièce. « Que se passe-t-il dans cette maison ? » La mère de Rodolphe l’informe doucement que l’ami de son fils vient d’être abattu par la police. « C’est bien triste mais c’est le sort de ceux qui défient l’autorité. Désolé pour toi, mon fils, mais cela vaut mieux ainsi, peut-être. Quelle vie misérable aurait-il mené, ce garçon, toujours dans la lutte, le complot ?… »
Rodolphe se relève d’un bond et court à l’étage en dissimulant à grand-peine sa fureur et son dégoût. Dans sa chambre, il jette quelques affaires dans un sac, sa montre, un médaillon de saint Thomas et saute par la fenêtre pour ne pas affronter son père qui l’appelle : « Rodolphe ! »
Darzens erre pendant des jours et des nuits par les routes et les chemins déserts. Se nourrissant de cueillette ou mendiant sa pitance, il couche où il peut. Effrayé au moindre galop dans son dos, sur ses gardes constamment, il s’épuise sur la route de l’exil. Sa cavale dure sept jours. Il entre enfin dans une petite ville. Un cirque s’est installé sur la place avec un attroupement autour d’une belle Gitane montreuse d’ours…
Retour au Terrier des Loups
Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre,
l’œil furieux : sur mon masque, on me jugera d’une race forte.
J’aurai de l’or : je serai oisif et brutal. Les femmes soignent
ces féroces infirmes retour des pays chauds.
Sur le quai de la gare Saint-Charles à Marseille, en cette fin juillet 1891, l’horloge indique 12 h 30. Dans la chaleur du Midi, les monstres d’acier crachent leurs vapeurs blanches. Au milieu des voyageurs, masses sombres en mouvement ou immobiles, se détache un infirme. Grand, maigre, coiffé d’un casque colonial à large bord, vêtu de cotonnades blanches, le burnous sur les épaules, il est amputé de la jambe droite.
Deux employés de la Compagnie des chemins de fer l’aident maintenant à se hisser dans le train.
L’œil noir, encombré de ses cannes anglaises, il arpente le couloir exigu. Il trouve son compartiment, s’installe sur la banquette de velours mauve et dépose ses béquilles près de lui, afin de dissuader quiconque de s’asseoir à son côté.
Il ouvre le journal. Le Temps annonce la prochaine Exposition universelle. Je devrais me présenter, songe-t-il ironiquement, les yeux brillants de fièvre. Je suis sûr qu’ils n’ont jamais vu une espèce comme la mienne.
Le train s’ébranle. Le regard d’acier du voyageur déchire la foule et le quai disparaît peu à peu. Bientôt, le roulis charitable de l’express apaise l’amputé, qui s’assoupit.
Le lendemain, sur le quai de la gare de Lyon à Paris, un individu vêtu d’une livrée rustique pousse un fauteuil à roues. Il cherche un unijambiste. Il le trouve assis sur ses malles, dissimulé sous un large chapeau colonial. « Vous êtes M. Rimbaud ? »
L’amputé au burnous relève la tête et dévisage le quidam. Il acquiesce après une seconde d’hésitation. Le gars l’aide avec ses bagages, Rimbaud lui recommande de manipuler avec précaution la boîte à chapeaux.
Le domestique le conduit à une calèche. Le voyageur étrange fait abaisser la capote. Il ne veut pas être importuné pendant la traversée de Paris.
Le fiacre se dirige vers l’est, vers la Marne. Par le carreau, Rimbaud observe la vie parisienne. Toutes ces transformations, tout ce changement depuis son départ, sa période, sa saison. Haussmann a fini son œuvre de démolisseur du passé, nous sommes dans une ère nouvelle, se dit-il, songeur. Tout en souplesse, la voiture glisse sur le nouveau ruban d’asphalte des boulevards. Des automobiles se croisent en klaxonnant gaiement. Le coche s’engage dans une rue pavée, Rimbaud retrouve ses sensations cahotantes. Il se penche au carreau, mais rien ne le surprend, le passé est loin derrière. Il esquisse un sourire pourtant quand un facteur de Paris sur un deux-roues dépasse son fiacre.
Oh ! la science ! On a tout repris. […] Et les divertissements
des princes et les jeux qu’ils interdisaient ! […] Géographie,
cosmographie, mécanique, chimie… !
La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde
marche !
Pourquoi ne tournerait-il pas ?
C’est la vision des nombres. Nous allons à l’Esprit.
Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. Toujours pleins
du Nombre et de l’Harmonie, les poèmes seront faits pour rester.
Après un voyage pénible d’ennui, il est de retour dans ses Ardennes. L’envol de corbeaux criards sur un champ de labour détrempé accueille l’enfant du pays.
Seigneur, quand froide est la prairie
Quand dans les hameaux abattus,
Les longs angélus se sont tus…
Sur la nature défleurie
Faites s’abattre des grands cieux
Les chers corbeaux délicieux.
[…]
Sur les fossés et sur les trous
Dispersez-vous, ralliez-vous!…
Les chemins qui sillonnent la campagne, les étangs, les sources claires et au loin les sombres forêts bleues ne recèlent aucun mystère pour lui.
La calèche couverte traverse la Meuse. L’averse mouille le carreau de la portière. Sur les chaussées cabossées, les secousses tourmentent un Rimbaud recroquevillé sur lui-même.
Le coche passe dans une petite ville de Champagne. Une enseigne attire l’attention du voyageur : Bonneterie de belle façon. Rimbaud songe à ce que pourrait rapporter un ballot de dentelles à Aden, transport compris. Les affaires reviennent vite à l’esprit du fils de famille.
Malgré lui, il scrute aux carrefours une trace de son passé. Au détour d’un chemin, un autre Arthur peut-être…
[…] assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur!
La calèche arrive enfin, sous une pluie battante, à la ferme des Rimbaud, près de Roche, « Le Terrier des Loups ».
La grande maison de pierres corrodées avec le toit à pignons et son colombier attenant impose le respect dans la région. Gravé au-dessus de la porte cochère, « 1791 » rappelle glorieusement le centenaire de la grande Révolution.
Une solide paysanne de noir vêtue, raide comme un arbre calciné, attend, immobile sur le seuil de la porte. À son côté, Isabelle, la trentaine vieillissante, trépigne, impatiente de retrouver son frère.
Le fiacre entre dans la cour et achève son voyage. Rimbaud en descend avec peine, ses douleurs ont décuplé pendant le trajet. Il cherche ses appuis. Isabelle veut se précipiter à son aide, sa mère l’en dissuade : « Vous n’irez que s’il vous fait signe. »
Après une courte hésitation, Isabelle accourt néanmoins à la rencontre de son frère. Elle passe son cou sous l’aisselle d’Arthur, pour le soulager. Ils se regardent.
« Salut, sœurette.
— Mon Arthur. Enfin toi ! »
Elle lui sourit. Il répond à son enjouement dans une grimace d’épuisement. Puis s’approche de sa mère qui reste impassible, mais d’un regard bleu intense le dévisage.
Elle est consternée par son état : amputé, les traits tirés, des cheveux grisonnants, si mat de peau qu’il ressemble à un Arabe. Ses yeux fiévreux, d’un bleu métallique, sont d’autant plus pénétrants.
La mère l’accueille d’un fort accent ardennais : « Bonsoir, l’Arthur. T’as l’air bien darne, mon fils, alors, tu viens te requinquer au Terrier ? Je ne te demande pas si tu as fait bon voyage. Tu ne nous as pas ramené du soleil en tout cas. Entre. »
Rimbaud désigne une aile du bâtiment : « Tu as agrandi, on dirait ?
— On verra ça plus tard, tu grelottes. Viens te réchauffer à l’intérieur. »
Le vestibule donne sur le salon et plus loin la chambre de la mère. Un escalier de chêne part sur la gauche, à son pied un guéridon supportant un bassin d’argent. De la cuisine, à droite, Jeanne la bonne salue le fils de famille. Un grand crucifix trône au-dessus de la cheminée. Tout est à sa place. Ça sent bon le vieux chêne et l’encaustique mêlés aux relents de cuisine. Une atmosphère épaisse que Rimbaud reconnaît aussitôt.
« C’est Versailles ici ! » s’exclame-t-il en toussant.
La mère lui demande s’il veut boire quelque chose. Il la remercie : fatigué du voyage, il préfère aller se reposer.
Des images tremblantes de sa jeunesse glissent dans l’esprit embrumé du voyageur. Il revoit les sempiternelles séances de récitation en latin devant la table du repas, la lecture quotidienne des saints livres au salon, la destruction de sa Saison en enfer dans l’âtre… Le cratère d’argent.
« Vous avez vendu le piano ?
— Tu sais, Arthur, on n’a pas trop le temps de s’amuser, ici », dit la mère dans un rictus.
Rimbaud ouvre la malle à chapeaux : « Je vous ai apporté du moka et des fioles de parfum. On se verra tantôt. Tu m’as préparé la chambre du haut, mère ? »
Isabelle, qui le dévore des yeux : « Oui, tout est prêt. »
Il ajuste son moignon dans la jambe de bois, hésite devant l’escalier et enfin se décide. Il monte dans sa chambre comme un pirate, la canne cadence son ascension, l’horloge sonne six heures.
La mère le regarde gravir les marches une à une et songe à voix haute : « Le pauvre, c’est affreux ce qui lui arrive, mais il l’a bien cherché après tout. »
Isabelle fait mine de ne pas avoir entendu : « Comme il est impressionnant. Il a gardé sa fière allure et ses beaux yeux.
— Pour les yeux je veux bien, mais pour ce qui est de l’allure, il va en faire une belle dans les Allées… tiens !
— Vous êtes injuste, mère, le pauvre a tellement souffert, loin de tout… Et personne pour le soutenir.
— Personne ? Et moi ! Vous ne savez pas la moitié de ce que j’ai fait pour lui. Et voilà ma récompense : un infirme. Allez, Isabelle ! Ne restez pas là plantée comme une asperge, allez surveiller le déballage de ses malles. Je vais prier pour lui. »
La sœur cueille son cadeau, encore sous le charme et l’angoisse de retrouver son frère, dix ans après son départ en Afrique, une jambe en moins. Elle va rejoindre les domestiques.
La mère écoute le silence de la demeure un instant, se saisit de la fiole, la débouche et hausse les sourcils dans une stupéfaction chagrine. Si elle n’est pas certaine d’avoir rien senti d’aussi étrange, elle est bien sûre de ne jamais s’en servir. Un attire-poussière de plus…
La pièce est mansardée, une table-bureau devant la fenêtre ouverte, les volets tirés. Rimbaud allume le bec Auer et retrouve sa chambre, celle où il a composé sa Saison, où il a trouvé refuge après les coups de feu de Bruxelles, dans l’état où il l’avait quittée des années auparavant. Des livres partout, un globe, des cartes jaunies accrochées aux murs, un canapé défoncé, un buffet de chêne et le lit rustique en noyer.
Il repousse la porte. Une étrange sensation, pourtant prévisible, l’envahit. Il prend une grande inspiration et ferme les yeux. L’intensité du passé rejaillit, incontrôlable, et lui donne le vertige. Les meubles semblent s’adresser à lui et lui reprocher son absence. Les formes se mettent à danser dans une valse macabre. Le vieux buffet salue sa présence en ouvrant ses portes noires grinçantes.
C’est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;
Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries […]
Rimbaud, épuisé, s’allonge dans le lit et murmure :
Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis
Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires.
Après une journée harassante, dans le demi-sommeil qui précède la perte de conscience volontaire du corps, l’esprit vaque librement. Celui de Rimbaud ne retient, parmi les ombres du passé, que cette vision du bassin d’argent aperçu au bas des marches et qui le ramène trente ans plus tôt…
*
Le tic-tac sonore de l’horloge emplit le silence de la demeure. Arthur enfant, allongé sur son lit, étudie son gros dictionnaire qui le recouvre presque entièrement.
Frédéric, son frère de deux ans son aîné, arpente le couloir sur la pointe des pieds. Tout à coup il se rue dans la chambre d’Arthur et se jette sur lui. Il lui écrase le livre sur le nez, Arthur se défend, envoie les genoux, les jambes. Frédéric crie : « Aïe ! » Il saigne du nez. L’encyclopédie chute dans un bruit sourd sur le sol.
La mère en prière sous le grand crucifix s’est redressée. Elle scrute l’étage, terrible, et se signe. Elle passe devant les deux jeunes sœurs de Rimbaud occupées à jouer à la poupée et prend l’escalier.
Au rez-de-chaussée, le père pousse du pied la porte de son bureau. La mère le voit et hausse les épaules. À l’étage, les deux frères épient, inquiets, la réaction maternelle.
Frédéric chuchote : « Abruti ! C’est malin. »
Arthur (sur le même ton) : « C’est toi qui l’as cherché. »
La mère pousse la porte de la chambre d’Arthur : « Qu’est-ce que c’est que tout ce raffut ! »
Les enfants essaient de justifier leur maladresse.
« Vous, Frédéric, vous êtes au pain sec. Vous, Arthur, vous me réciterez, avant de dîner, tous vos devoirs. » Elle redescend et frappe à la porte du père. Pas de réponse, elle entre dans le bureau et, tout en faisant mine de ranger : « Mon ami, vous pourriez un peu vous préoccuper de votre progéniture. Arthur et Frédéric n’en font qu’à leur tête. Je vous rappelle que c’est toujours moi qui vaque à l’ordre dans cette maison. Ce sont des garçons, bon sang. Pour un capitaine d’infan¬terie, avouez que vous n’en…
— Je travaille.
— Et moi, je me tourne les pouces ?
— Il ne semble pas que vous étiez si occupée tout à l’heure », réplique le militaire.
Elle arrête subitement son activité et le fixe : « De quoi, grand Dieu, parlez-vous ?
— Grand Dieu justement !
— Pardon ! La raison vous abandonne, mon ami. » Elle le querelle d’un ton menaçant : « Vous n’allez pas me reprocher, tout de même, d’être une bonne chrétienne ! Ah ça ! »
Le père reprend sa lecture : « Loin de moi cette pensée, je disais simplement que, tout à l’heure, pendant que j’écrivais mon traité sur les déplacements de troupes en Algérie… » Il se retourne et, dans un sourire carnassier : « Tu sais que c’est un peu mon métier, que de rédiger des rapports et des plans pour l’armée… Donc pendant que je travaillais et que les enfants chahutaient, toi, tu priais, de toute évidence. Et vu l’état dans lequel tu es rendue, je n’ai pas l’impression que tes vœux aient été exaucés. » Il se repenche sur ses copies et prend son air détaché : « Si vous voulez mon avis, priez moins et occupez-vous plus de votre progéniture. Tout le monde s’en portera mieux. Sur ce, laissez-moi, je vous prie. Et fermez la porte. »
La mère, dont le visage s’est empourpré d’indignation, vocifère : « Monstre, misérable, abominable athée, comment ai-je pu t’épouser ? Mais va, tu ne l’emporteras pas au paradis ! » Elle claque la porte et se précipite vers la cuisine.
Dans sa chambre, Arthur repose son gros livre et se lève de son lit. Il s’accroupit en haut de l’escalier et attend à travers les barreaux la suite des événements.
Le père sort de sa chambre. Il porte une robe de chambre soyeuse, sa haute taille lui donne un air de grand seigneur. Il se saisit du cratère de métal étincelant installé sur le guéridon d’acajou et se place au centre de l’entrée sous le lustre. Là, il laisse tomber la coupe sur le carrelage de grès. Bing wong-wong-wong tac-ga-da-tac-tac-tac…, fait le bassin d’argent qui danse dans un bruit de spirale. Des éclairs de lumières vives flamboient en virevoltant sur les murs.
Arthur, les mains sur les oreilles, sourit, fasciné ; il attendait ce moment. Le père interrompt les circonvolutions du cratère et le dépose sur son socle, avant de retourner, satisfait, dans sa chambre.
La mère sort illico de la cuisine la tête haute et envoie le bassin répéter la même chorégraphie ! Elle repose ensuite la vasque à sa place, sans manquer de l’essuyer de son tablier, pour retourner dans sa cuisine engueuler la bonne.
*
Ce rituel de la discorde amusait beaucoup l’enfant, mais aujourd’hui l’homme blessé, blotti dans la tiédeur de son lit, songe à tout cela avec amertume. Il s’endort enfin.
Un pigiste russe à bicyclette
Sur la place des Abbesses à Paris, par cette chaude ¬journée d’été 1891, Rodolphe Darzens adossé à l’ombre d’un frêne parcourt le journal Le Gaulois à la rubrique des courses. Sa crinière noire laisse dépasser des mèches en bataille sous un feutre mou, gris sale. Un paletot d’un autre temps recouvre sa liquette au col droit et un foulard chamarré dissimule une croix byzantine en sautoir.
Il consulte sa montre sans arrêt et lève la tête dès qu’une demoiselle passe. Enfin, une élégante jeune femme se glisse dans son dos et lui pose ses doigts gantés sur les yeux. Ils s’embrassent et filent. Elle lui reproche sa tenue débraillée, et lui son allure de coquette.
Un peu plus tard, Rodolphe descend à grands pas le boulevard de Clichy. À son bras, sa petite amie trottine sur ses bottines à talons. Elle semble essoufflée, mais il l’entraîne, jovial, en la guidant par le coude.
« Pas si vite, Rodo, je n’en peux plus.
— On est presque arrivés, Sarah, le magasin va fermer. »
Ils débarquent dans une boutique de vente et de réparation de cycles. Rodolphe se présente au comptoir, un grand espoir dans les yeux.
« Oui, monsieur Darzens, elle est arrivée, elle est là, derrière. Bonjour, madame. »
Sarah remarque tout de suite la jolie caissière Angèle.
La boutique-atelier exhale le caoutchouc, le cuir et la graisse cuite. Ancien maréchal-ferrant, Albert, le patron, a senti le vent tourner et s’est mis à la vente de bicyclettes.
Une nausée monte à la gorge de Sarah. Elle se détourne pour crachouiller une toux sèche dans son mouchoir de batiste. Angèle a un sourire discret. Darzens soutient sa petite amie tandis que le patron les accompagne vers l’arrière-boutique.
Là, suspendu à des crochets, parade un magnifique deux-roues : la dernière création des Manufactures Mercier brille de mille feux. Darzens l’inspecte sous toutes ses brasures, admiratif et connaisseur. Albert ne tarit pas d’éloges sur sa conception moderne : le cadre « diamant » en acier galvanisé parfaitement géométrique, la courbe étudiée de la fourche pour plus de sûreté, le cintre rabaissé, aérodynamique. « C’est très ingénieux », précise le patron. Un braquet de neuf mètres ! Le système de freinage, lui aussi révolutionnaire grâce aux nouvelles chambres à air de Michelin, beaucoup plus confortables que les boyaux. Monsieur Albert lui vante pour finir une dernière innovation : un grand pignon pour les côtes et en retournant la roue, hop, un petit pour la course !
Darzens, courbé sur la machine, un large sourire aux lèvres, fait tourner la roue arrière. Sans quitter des yeux la perfection de la superbe bicyclette, il sort une liasse de billets de sa poche et la tend au patron.
Sarah ne peut réprimer une stupéfaction muette devant la somme incroyable que Rodolphe est prêt à dépenser pour une « machine à courir ».
Le couple quitte le magasin de cycles. Darzens, très fier, guide sa nouvelle conquête par la potence et sa petite amie par le bras. Puis soudain, n’y tenant plus, il embrasse Sarah sur la tempe et saute sur sa bécane rutilante avant de dévaler la rue, en zigzag, heureux… « Je te retrouve chez toi demain ! » lance-t-il à Sarah, et il est déjà loin.
Elle fronce les sourcils et lui envoie un : « Tu me le paieras, ça, mon coco ! », en se dirigeant vers un magasin de nouveautés.
Le soir même, dans une ruelle tortueuse du quartier des Halles encombrée de barriques, des becs de gaz éclairent l’enseigne Au Tord-Boyaux. Darzens débarque sur son vélo étincelant. Il l’attache d’une chaîne à la devanture de la salle, salue le portier et lui glisse une pièce pour surveiller sa machine. Il entre dans le caboulot.
Dès qu’on pénètre dans ce cloaque, l’odeur âcre de tabac et de bière vous saute à la gorge. La fumée empêche de voir à plus d’un mètre. Des numéros miteux de music-hall se succèdent sur la scène.
Darzens rejoint au fond du bouge un homme tatoué sur l’avant-bras d’une ancre prise dans une tête de mort. Il le congratule d’une grande bourrade dans le dos pour son tuyau aux courses. Le bookmaker lui en a pris cinquante, mais il a levé un joli magot sur « Rose des Sables » à 7 contre 1. Il en a profité pour se faire plaisir : la bécane dernier cri de chez Mercier qui l’attend dehors.
Le Tatoué, bougon, se moque de Darzens et le traite de « pédale ». Darzens tique à ce genre de sous-entendu et le fait savoir d’un geste vif et suspendu. Néanmoins, il se rapproche du Tatoué et essaie de le convaincre : c’est le nec plus ultra du progrès, l’alliance de la force, de l’élégance et de la technique, la liberté sur le cheval, l’homme-machine, le surhomme ! En plus, fini le crottin, l’avoine, tous les besoins de l’animal, bref, l’avenir !
Ils trinquent aux temps modernes. Le Tatoué lui demande pourquoi il n’invite pas sa régulière. Darzens montre le plafond enfumé, Sarah ne supporterait pas ce genre d’atmo¬sphère. Il en profite pour lui réclamer les cigarettes indiennes qu’il lui a commandées. Le Tatoué lui remet discrètement un paquet.
Sonneries : on installe une tombola géante avec sa roue chiffrée pour le clou du spectacle. Le premier numéro tombe. Un homme en goguette se lève devant Darzens en criant : « J’ai gagné ! » Son portefeuille dépasse de la poche, Rodolphe fait un signe à son comparse. Il bouscule le client tandis que le Tatoué en profite pour le délester. Tous deux sortent en plaisantant pendant que le badaud va chercher son lot. Ils se partagent la monnaie et jettent le larfeuille dans le caniveau avant de se séparer.
En récupérant son vélo, Darzens entend un miaulement famélique. Il se dirige vers une remise sombre encombrée de cageots et de barriques abandonnés. Alors qu’il essaie d’y voir quelque chose, il sent la pression d’un petit chat roux qui se frotte à ses jambes. L’animal se laisse prendre dans les bras du jeune homme qui l’observe. « Tu me sembles affamé, toi. Tu veux bien devenir mon ami ? Je vais t’appeler… Polo. Je te donnerai du lait et un peu de mou de temps en temps. D’ac ? » lui dit-il de sa voix roucoulante de Slave. Il le serre contre sa poitrine, referme son paletot et fait démarrer sa bécane. Polo ronronne d’aise…
Le lendemain, Darzens déboule à vélo dans la « République du Croissant », ce quartier de la rive droite, entre la butte Montmartre et les rues Réaumur et Richelieu, siège des grands titres parisiens. Là se trouvent les locaux du Gaulois.
Le Gaulois a alors la réputation d’un quotidien plutôt républicain, populaire et satirique. Sa ligne éditoriale phare couvre les affaires de cœur des célébrités. Il entretient avec son lectorat une relation particulière faite d’attraction et de répulsion. Un style quelque peu direct, mais toujours avec délicatesse pour ne pas heurter le public féminin.
Depuis dix ans que la liberté d’expression, et de fait celle de la presse, a été votée, la frénésie des chroniqueurs à débusquer les travers de l’élite n’a pas cessé. Le fameux « bon goût à la française » représente la seule censure au Gaulois. Le rédacteur en chef, le grand « Mondanitaire » comme on l’appelle, Arthur Meyer, y veille de près.
Les rubriques les plus appréciées sont assurément La chronique mondaine, L’écho de la vie des salons et Le carnet du jour, avec ses faits divers qui ravissent les curieux.
La vaste salle de la rédaction ressemble à un gymnase, l’effort cérébral remplaçant l’effort physique. Les bureaux des différentes rubriques s’étagent de chaque côté de l’allée centrale traversée par des journalistes et commis affairés. Sur son pupitre, chaque rédacteur a son organisation et ses manies. Certains, prolixes, remplissent des corbeilles de papier froissé et hèlent sans cesse le commis – « Va me chercher un tel », « Trouve-moi des feuillets »… Les uns travaillent sur un coin de table tandis que d’autres, rejetés en arrière sur leur siège, rêvassent de la tournure d’une expression. Ailleurs, des groupes se forment pour discuter avec volubilité un point capital. Une véritable ruche de messieurs en ébullition.
La banque des faits divers, sous le bureau de la direction, tout au fond, se distingue des autres desks. Une succession d’employés à visières de celluloïd, debout sous les becs de gaz, trie les billets bleus, les télégrammes des reporters de terrain, les comptes rendus d’audience, les petites annonces, et tamponne les reçus. Cela donne à l’ensemble l’aspect insolite d’un travail à la chaîne, rythmé par le tambourinement des cachets.
Juxtaposées au hangar de la livraison des journaux, la « presse » et la salle de rédaction du journal sont mitoyennes pour faciliter le circuit de l’information.
Rodolphe Darzens arrive en sifflotant sur sa bécane rutilante au journal. Il fonce sur un groupe de jeunes saute-ruisseau devant les entrepôts. D’un dérapage acrobatique, il les évite.
« Hourra, monsieur Darzens ! » s’exclament-ils en se précipitant. Ils veulent tous faire un tour. Le journaliste a bien du mal à attacher son engin futuriste au bec de gaz. Ils lui crient : « Le manège, monsieur Rodolphe ! »
Darzens, souriant, sélectionne trois jeunes qui n’ont pas encore eu ce plaisir. Il retire son galure, s’accroupit et les enfants se cramponnent aux longues mèches de sa tignasse. Il se relève et se met à pivoter sur lui-même en faisant tournoyer les gamins en l’air dans les éclats de rire. Il faisait ce numéro quand il bossait pour le cirque qui l’avait accueilli et fait sortir de Russie. Les gosses ovationnent une nouvelle fois leur grand frère Rodolphe.
Une casquette à visière bleue émerge de la porte du journal. On l’appelle. Au boulot ! Darzens donne des conseils aux crieurs sur les meilleurs endroits où vendre le papier et rejoint le Gaulois.
Il se met à trier le courrier avec Pierre Lefranc, le chef du service des faits divers. Le Mondanitaire descend de son bureau, Darzens se précipite vers lui et l’aborde de sa voix chaude à l’accent slave : « Monsieur Meyer, écoutez-moi, je sais, je vous en ai déjà parlé, mais je vous promets qu’une rubrique sportive…
— On en a déjà une, mon cher, occupez-vous plutôt de vos traductions, je n’ai pas vu beaucoup de papiers sur mon bureau, ces derniers temps…, réplique le patron, absorbé par son inspection des rédactions.
— Il n’y a pas d’infos intéressantes dans le Journal de Pétersbourg ces jours-ci, alors je donne un coup de main à M. Lefranc au classement des courriers, monsieur Meyer… », se justifie Darzens en le suivant.
Le patron hausse les épaules et continue son tour des services. Accroché aux basques du Mondanitaire, Rodolphe reprend : « Et puis, dans la rubrique sportive du Gaulois, si je peux me permettre, monsieur Meyer, on ne trouve que le turf !… Moi, je vous propose une vraie chronique d’aujourd’hui avec des articles sur les nouveaux sports à la mode : le cyclisme, l’aéronautique, l’automobile… »
Il poursuit son exposé avec exaltation, mais le patron s’en moque. « Ces fichus sports mécaniques finiront par tous nous tuer un de ces jours… » Seules les nouvelles des vedettes de l’art ou de la politique intéressent Meyer, qui laisse Darzens en plan.
Rodolphe s’en retourne, dépité, au bureau des chiens écrasés, ce qui ravit certains journalistes qui n’apprécient pas du tout l’ambitieux jeune journaliste à l’accent russe. Ce dernier reprend son tri sous le regard compatissant de Pierre Lefranc, quand Ferdinand fait une entrée fracassante.
La cinquantaine bedonnante, le célèbre grand reporter des arts harangue les employés de sa voix nasillarde en tendant au-dessus de sa tête Le Petit Parisien : « Un attentat de Juifs russes anarchistes déjoué à Montreuil ! Hourra pour les services du renseignement qui sauvent la République ! » Il se pavane dans l’allée et se lance dans la lecture de l’article comme s’il en était l’auteur. L’ensemble du journal salue le prêche de Ferdinand.
Devant l’attitude indifférente de Darzens, qui continue de tamponner ses billets bleus, le grand reporter le toise : « N’est-ce pas, Darzinnsky ? » lance-t-il perfidement.
Pierre surveille Rodolphe, qui ne bronche pas et se concentre sur son travail. Ferdinand monte dans le bureau de Meyer après avoir jeté un regard méprisant sur le pigiste immigré de Russie.
Le repas de famille
Les calculs de côté, l’inévitable descente du ciel et la visite
des souvenirs et la séance des rythmes occupent la demeure,
la tête et le monde de l’esprit1.
Rimbaud sort de sa chambre à midi. Il a passé la matinée à se reposer et à écrire à ses associés en Abyssinie. Il descend avec appréhension les marches jusqu’au vestibule. Sur son socle, le bassin de métal poli et cabossé le nargue de ses reflets. Il entre dans la salle à manger. La mère et Isabelle patientent chacune derrière leur chaise.
Rimbaud prend sa place en bout de table et déplie sa serviette : « Et Frédéric, toujours pas de nouvelles ? » La mère s’assoit et assène d’un air méprisant : « Il doit cuver son gueuleton avec ses amis de la Compagnie… »
Rimbaud reprend, comme pour l’excuser : « Il a toujours préféré la troupe. »
Un souvenir lui traverse l’esprit pendant que la mère touille la soupe.
*
Il va sur ses seize ans et bouquine comme à son habitude dans le silence de la demeure familiale. Soudain, des bruits suspects venant de la chambre de son frère le surprennent. Il s’y rend sans faire de bruit.
Frédéric est en train d’enjamber sa fenêtre. Arthur se précipite. « Qu’est-ce que tu fabriques ?
— Je me taille, frangin !
— Tu vas où ?
— À la guerre, mon ami, à la guerre, défendre la patrie et toucher la solde ! » Il passe la jambe dans le vide et se retourne vers Arthur, il a l’air plus vieux : « Prends soin de notre famille, Arthur, c’est toi l’aîné maintenant. Souhaite-moi bonne chance.
— Et maman ?
— Ne lui dis rien. J’ai laissé un mot… Tu corrigeras les fautes… »
Il s’accroche à la descente de pluie et saute dans la rue, des recrues le rejoignent ; ils s’enfoncent dans la nuit. »
Extraits
« Rodolphe a une semaine de mise à pied, s’il ne trouve rien d’intéressant avant la fin, il sera viré. Il le rappelle, il lui faut un pseudo: ce sera. Lardenay, et le congédie d’un geste en reprenant ses lectures.
Darzens, satisfait et un peu surpris, reste sur place et lui demande le sujet de l’enquête. Interloqué, le patron répond: «Rimbaud.
— Rambot? répète Rodolphe, dérouté.
— Rimbaud Arthur, le poète! articule Meyer, agacé. Il a eu une liaison avec Paul Verlaine et a disparu depuis vingt ans, déterrez-moi des témoins, des révélations, et où se trouve Rimbaud, c’est clair? Et surtout pas de vagues, c’est compris?» Ses yeux transpercent le journaliste à travers ses binocles.
Darzens acquiesce, comme absent. Il réalise dans quel traquenard il vient de se fourrer. Tout ce qu’il ne supporte pas: les poètes, homosexuels en plus! Disparus depuis vingt ans, tant qu’à faire.
Rodolphe sort du bureau accablé. En passant, il fait signe à son ami Pierre de ne pas s’inquiéter et quitte le journal sous les regards plissés des sympathisants de Ferdinand.
De retour chez lui, dans son petit garni sous les toits, le journaliste tourne en rond avec cette enquête improbable. «Un poète, en plus! Disparu depuis vingt ans! Que personne ne connaît, à part quelques intellectuels ou pseudo-artistes, pour sûr! À mettre tous dans le même panier, comme Moréas! J’aurais été verni que je serais tombé sur un sculpteur, au moins ceux-là ils transpirent. » p. 73
« Darzens, étourdi, a perdu ses repères, il se pose sur le lit pour reprendre sa lecture. Verlaine révèle que, incompris dès sa jeunesse, Rimbaud en vrai maudit a rejeté les valeurs de la société. Il s’est conduit de manière provocante, dangereuse, asociale ou autodestructrice. Le journaliste apprend aussi que la plupart des œuvres du poète n’ont jamais été publiées ou ont disparu.
Une Saison en enfer, parue en 1873, sombra corps et biens dans un oubli monstrueux, l’auteur ne l’ayant pas lancée du tout. Il avait bien autre chose à faire. Il courut tous les Continents, tous les Océans, pauvrement, fièrement.., écrit Verlaine.
Poursuivant le recueil, les louanges dithyrambiques de Verlaine sur son amant n’étonnent plus le journaliste, mais la destinée troublante de ce poète inconnu commence à l’intriguer. » p. 88-89
À propos de l’auteur
 Henri Guyonnet © Photo DR
Henri Guyonnet © Photo DR
Enfant de Marseille, Henri Guyonnet fonde des groupes de rock avant de s’installer à Paris, où il écrit et met en scène pour le théâtre. Brûlez tout! est son premier roman. (Source: Éditions Anne Carrière)
Blog de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte X (ex-Twitter) de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur

Tags
#bruleztout #HenriGuyonnet #editionsannecarriere #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #premierroman #ArthurRimbaud #68premieresfois #RentreeLitteraire23 #rentree2023 #RL2023#lecture2023 #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie








 Emma Tholozan © Photo DR
Emma Tholozan © Photo DR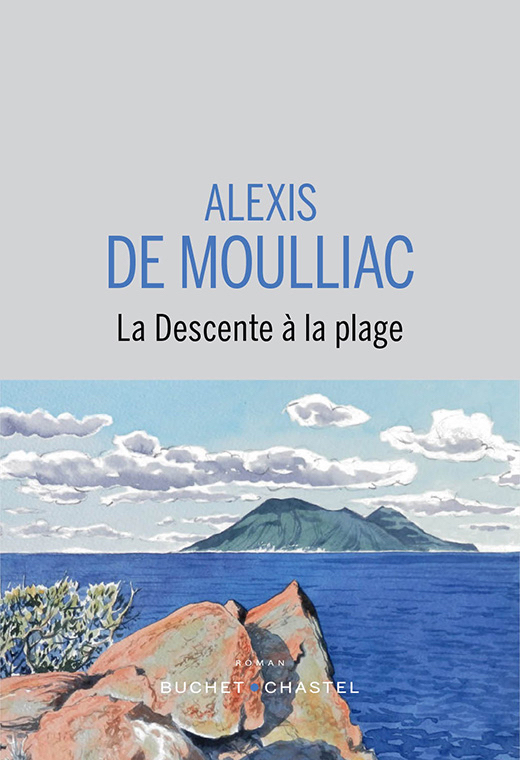


 Alexis de Moulliac © Photo DR
Alexis de Moulliac © Photo DR

 Lydie Salvayre © Photo DR
Lydie Salvayre © Photo DR

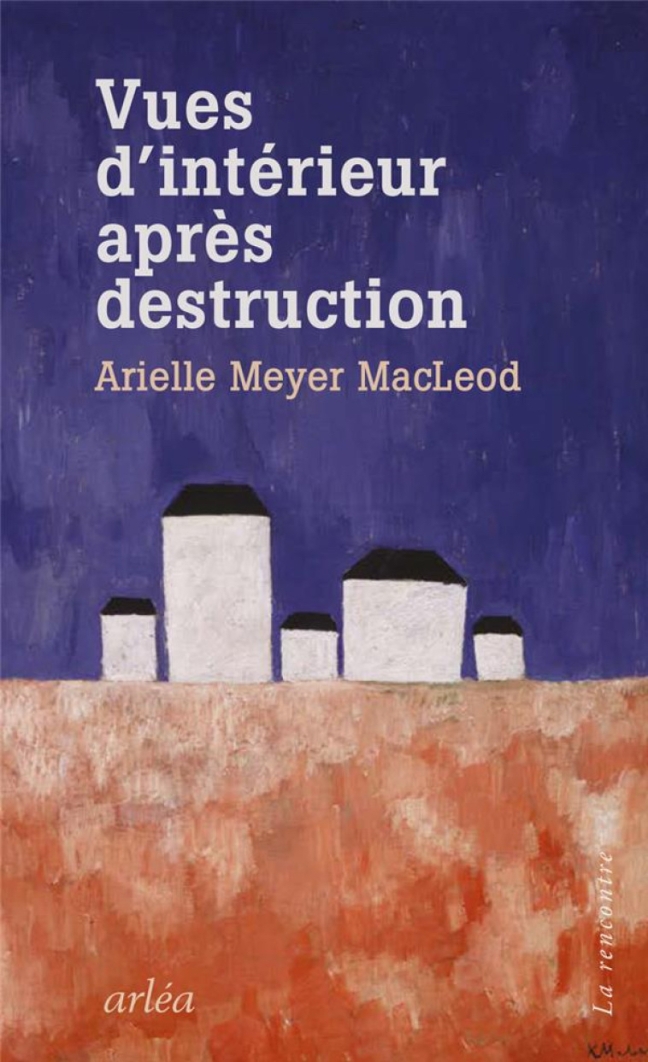

 Arielle Meyer MacLeod © Photo DR
Arielle Meyer MacLeod © Photo DR

 Michaël Sibony © Photo DR
Michaël Sibony © Photo DR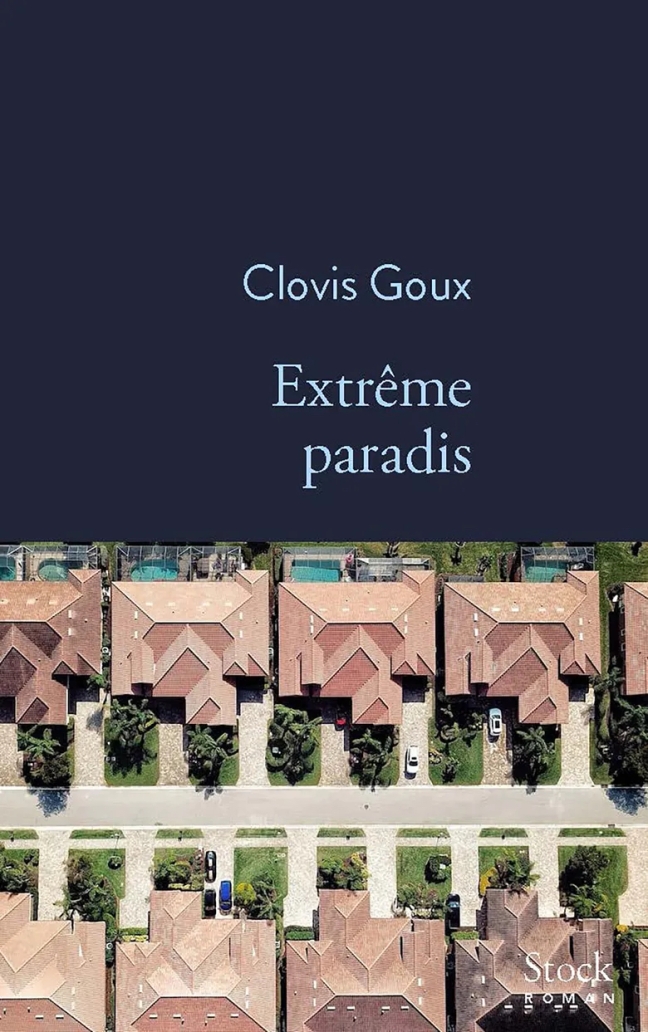
 Clovis Goux © Photo Patrice Normand
Clovis Goux © Photo Patrice Normand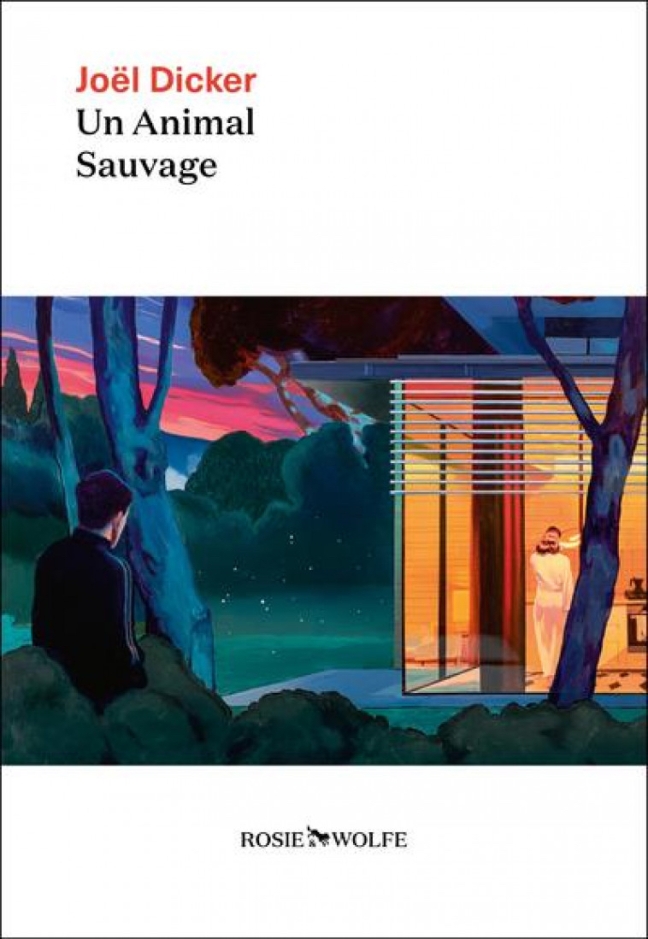

 Joël Dicker © Photo Markus Lamprecht
Joël Dicker © Photo Markus Lamprecht
 Jean-Christophe Rufin © Photo Steeve Juncker Gomez
Jean-Christophe Rufin © Photo Steeve Juncker Gomez